
Le passage du West-Eastern Divan Orchestra est toujours un moment fort pour le public, et d’ailleurs, l’applaudissement long et fourni avec lequel il est accueilli en est un signe tangible. Les dernières positions publiques de Daniel Barenboim sur la question de Gaza et par ailleurs ses opinions bien connues et courageuses font évidemment de ces concerts des moments très sentis.
Comme souvent, je conseille la lecture de Parallèles et paradoxes : explorations musicales et politiques (Le Serpent à plumes), un dialogue de Daniel Barenboim avec Edward Said avec qui il a fondé cet orchestre. C’est une lecture riche et une réponse humaniste à la situation désastreuse qui persiste au Proche Orient.
C’était aussi un concert au programme symbolique, deux créations, celle d’un compositeur israélien, Ayal Adler, et celle d’un compositeur syrien, Kareem Roustom, puis l’acte II de Tristan und Isolde de Richard Wagner, qui, comme chacun le sait, fait problème en Israël où on ne le joue pas.
Les deux créations européennes (elles ont été créées à Buenos Aires au début du mois d’août) sont des petites pièces, l’une d’une dizaine de minutes, l’autre d’une quinzaine de minutes.

Celle de Ayal Adler, Resonating sounds, alterne des moments violents et éruptifs et d’autres, plus retenus et sollicitant l’orchestre de manière assez virtuose. Dédiée au West-Eastern Divan Orchestra et à Daniel Barenboim, elle met effectivement en valeur certains pupitres (percussions, cordes) mais j’ai trouvé les motifs un peu répétitifs, c’est sans doute voulu et la durée (10 min environ) en atténue l’effet.
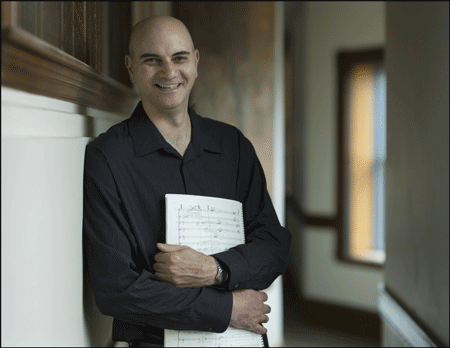
L’œuvre de Kareem Roustom, un compositeur né en Syrie qui travaille essentiellement aux USA, notamment dans le domaine de la musique de films, et très différente. Il a composé de nombreuses musiques et a été nominé aux Emmy Awards. Sa pièce, Ramal, pour orchestre, plus colorée que la précédente, avec d’évidentes influences orientales, semble effectivement proche d’une musique de cinéma, pleine de relief, très agréable à entendre mais aussi un peu superficielle. Mais le contraste entre les deux approches, l’une un peu plus radicale et l’autre plus « ouverte » était intéressant.
On attendait évidemment l’acte II de Tristan. Certains soirs de cette tournée, l’acte II est couplé avec la Liebestod en un seul programme (comme à Salzbourg le 21 Août), sollicitant donc fortement Waltraud Meier.

À Lucerne, la seconde partie du concert est exclusivement l’acte II, entendu dans cette même salle en 2004 (et non en 2003 – écrit par erreur- comme me l’a fait remarquer un lecteur attentif) avec Claudio Abbado (Treleaven, Urmana, Pape, Fujimura), et en 2010 avec Salonen dans le cadre d’un Tristan complet dans la mise en scène de Sellars et Bill Viola (Gary Lehman, Violeta Urmana, Anne Sofie von Otter, Jukka Rasilainen, Matthew Best).

On attendait évidemment l’Isolde de Waltraud Meier, mais c’est d’abord l’orchestre qui a frappé : Barenboim attaque l’introduction avec une énergie folle et une flamme qui ne s’éteindra pas jusqu’à la fin. C’est à ce titre l’un des deuxièmes actes les plus urgents et les plus passionnés jamais entendus. L’orchestre est aussi particulièrement engagé, on sent vraiment que les musiciens sont pris par cette musique qu’ils défendent avec feu, mais aussi avec une précision et une technicité remarquables. Certes, les cors en coulisses qui concluent l’introduction ne sont pas toujours impeccables, mais rien de comparable avec certaines catastrophes entendues ailleurs et par exemple à Bayreuth, avec Daniel Barenboim d’ailleurs.
Le tempo est vif, le son incroyable de relief : voilà ce qui frappe en ce début de deuxième acte.
La première scène met surtout en valeur la voix veloutée, bien projetée, puissante d’Ekaterina Gubanova, dont j’aime la Brangäne. Les aigus sûrs et d’une magnifique rondeur passent l’orchestre très fort, et placé devant les solistes, installés sur une estrade en arrière.
Waltraud Meier en revanche a plus de difficulté. On connaît son Isolde particulièrement subtile, au phrasé sculpté, jamais dans le forte pour le forte, une Isolde pour l’intelligence et non pour les décibels. Mais la voix a des difficultés à passer le flot orchestral, sauf dans les aigus. Les aigus restent clairs, bien contrôlés, puissants, mais les passages apparaissent difficiles. N’importe, la tension est là et l’on rentre dans l’œuvre et dans l’ivresse de cette musique.

Après la fulgurante introduction au duo avec une tension et une pulsion rythmique renversantes d’un Barenboim très engagé, capitaine sûr et enthousiaste d’un navire flottant sur un océan sonore en furie, commence le duo : on comprend vite que le duo ce soir, sera celui de Peter Seiffert, dans une soirée exceptionnelle où il a été stupéfiant. D’abord, la voix a une douceur et une suavité enchanteresse, et puis il lance des aigus triomphants, sûrs, tenus, larges. On sait que Seiffert est quelquefois irrégulier, mais que lorsqu’il est touché par la grâce, il est incomparable. Et ce soir, il est en état de grâce.
Waltraud Meier épouse cette grâce, la voix est moins âpre qu’à la première scène, plus assurée, plus réchauffée aussi, et les moments les plus doux passent avec bonheur, même si certains suraigus sont ratés. Mais lorsque les deux entament « O sink hernieder Nacht der Liebe », ce n’est plus l’enchantement, ce n’est plus l’ivresse, c’est le temps suspendu, c’est l’insurpassable moment de l’extase, c’est le mythe vivant. Le tout est mené par Peter Seiffert, décidément ce soir au seuil de l’incroyable, et Waltraud Meier lui emboîte le pas avec son phrasé, avec sa manière de dire ou de sussurer le texte, avec sa manière aussi de colorer, elle est suivie et soutenue par Daniel Barenboim qui cette fois laisse les voix se développer et s’imposer, et qui veille à mettre en valeur ce qui est dit, ce qui est chanté, car il entend lui-aussi que nous sommes dans un moment rare.
Gubanova lance alors ses Habet Acht, son avertissement mystérieux, du cœur de l’orchestre (elle est habituellement dissimulée en coulisse, Abbado l’avait placée au deuxième balcon), et la magie de cette musique qui vous enlève, qui vous élève, qui vous enivre, est totale. Ekaterina Gubanova a offert ici elle aussi une prestation exceptionnelle. Comme si ces avertissements stimulaient encore plus l’engagement des uns et des autres, le crescendo final du duo est presque insupportable.

Waltraud Meier totalement emportée, engagée, d’une extrême tension, Seiffert au paradis des ténors, et l’orchestre fulgurant, inouï d’engagement et d’allant, mené par un Barenboim survolté tout cela est presque unique : je n’ai pas vécu un tel moment depuis bien bien longtemps.
Pas de Kurwenal pour dire Rette dich Tristan, ce qui est dommage, mais l’orchestre seul, mais en revanche un Seiffert bouleversant pour prononcer Der öde Tag zum letztenmal! de manière résignée et absente, inégalable.
On connaît le König Marke de René Pape, c’est toujours une surprise dans cette salle à la réverbération forte d’entendre sonner ses graves profonds, ses aigus puissants, avec cette voix prodigieuse de couleur. Il avait cloué sur place l’assistance en 2003 avec Abbado, un moment miraculeux accentué par la relative déception procurée par les deux protagonistes, il avait même étonné Claudio Abbado qui m’avait dit son émerveillement. Ce fut en absolu le plus beau monologue de Marke jamais entendu et ça le reste. René Pape il y a onze ans avait cette voix encore jeune, claire et profonde, stupéfiante. Elle garde aujourd’hui cette fascination et cette puissance, cet écho profondément humain qui la caractérise, elle a un peu perdu en couleur, notamment dans la seconde partie du monologue, un tout petit peu plus en retrait, quand la première partie restait suffocante de beauté. Mais n’importe, lui aussi est encore unique et irremplaçable dans ce rôle. Signalons aussi le très bon Melot, très présent, de Stephan Rügamer. Un très bon Melot c’est suffisamment rare pour le noter. Stephan Rügamer fait partie des excellents chanteurs de la troupe de la Staatsoper de Berlin, c’est aussi, rappelons-le, un remarquable Mime .
Vous avez compris qu’on a vécu à Lucerne un moment d’exception, un moment de pure émotion, doublé par la satisfaction visible de ces jeunes musiciens de jouer cette musique, plaisir, ivresse, émotion, engagement, militantisme wagnérien aussi : tout cela était au rendez-vous, mené par un Barenboim des très grands jours, complètement emporté, au geste précis, rendant l’orchestre d’une grande clarté mais aussi cherchant visiblement à en tirer toutes les tripes, et je dirai toute leur force d’amour.
Ce soir, tout le monde faisait de la musique avec son âme.[wpsr_facebook]


































 devenue lieu du couple, puis de la Liebestod, dans un décor très réaliste d’intérieur XIXème, et l’utilisation de cette même table pour en faire une sorte de Tribunal des deux amants. Intérieur impeccable au 1er acte,
devenue lieu du couple, puis de la Liebestod, dans un décor très réaliste d’intérieur XIXème, et l’utilisation de cette même table pour en faire une sorte de Tribunal des deux amants. Intérieur impeccable au 1er acte,  murs décrépis au dernier, où l’on passe tour à tour des des espaces “réels” ou “fantasmés”, l’excellente idée de remimer les soins apportés à Tristan, allongé sur le lit au milieu de bandages sanguinolents, tout cela montre un travail attentif et très rigoureux, non dénué de poésie (acte II) et dont les partis pris radicaux, parce qu’ils sont bien traduits sur scène, ne choquent absolument pas. Il en résulte une fluidité de l’action qui enlève tout statisme à l’ensemble. On voit quelquefois des Tristan statiques, voire ennuyeux: on a ici à la fois une direction musicale très dynamique, incroyablement jeune et vigoureuse, et une traduction scénique là aussi tout en mouvement et prodigieusement stimulante. Tout ennui est banni, et on n’a qu’une envie après cinq heures de spectacle que de recommencer l’expérience a plus vite. Pour Haitink d’abord et avant tout, pour le reste du spectacle ensuite, à ne manquer sous aucun prétexte dès que ce sera repris.
murs décrépis au dernier, où l’on passe tour à tour des des espaces “réels” ou “fantasmés”, l’excellente idée de remimer les soins apportés à Tristan, allongé sur le lit au milieu de bandages sanguinolents, tout cela montre un travail attentif et très rigoureux, non dénué de poésie (acte II) et dont les partis pris radicaux, parce qu’ils sont bien traduits sur scène, ne choquent absolument pas. Il en résulte une fluidité de l’action qui enlève tout statisme à l’ensemble. On voit quelquefois des Tristan statiques, voire ennuyeux: on a ici à la fois une direction musicale très dynamique, incroyablement jeune et vigoureuse, et une traduction scénique là aussi tout en mouvement et prodigieusement stimulante. Tout ennui est banni, et on n’a qu’une envie après cinq heures de spectacle que de recommencer l’expérience a plus vite. Pour Haitink d’abord et avant tout, pour le reste du spectacle ensuite, à ne manquer sous aucun prétexte dès que ce sera repris.