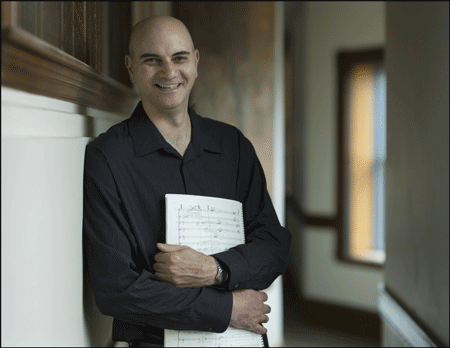Dit la force de l’amour
Il y a une vingtaine d’années, Zemlinsky n’apparaissait pas dans les saisons d’opéra, à de rarissimes exceptions près. La recherche assez récente de titres nouveaux qui puissent élargir le répertoire des maisons d’opéra a changé le paysage, aussi bien la Florentinische Tragödie (par exemple à Amsterdam en novembre dernier) que Der Zwerg (par exemple à Lille également en novembre dernier) sont assez fréquemment donnés, on a vu aussi à l’Opéra des Flandres la saison dernière le très rare König Kandaules.
C’est encore plus rare pour Der Kreidekreis (le Cercle de craie) dont à ma connaissance après la création à Zürich en 1933 et quelques présentations en Europe (De Stettin à Graz) à l’époque de sa création et après-guerre (1955, Dortmund) pas de traces de représentations, à part une reprise à Zürich en 2003 sous la direction d‘Alan Gilbert, dans une mise en scène de David Pountney avec Brigitte Hahn et Francisco Araiza entre autres, si bien que les représentations lyonnaises sont une création en France. Il faut donc une fois de plus saluer la politique de Lyon qui en quelques années a présenté une somme impressionnante d’œuvres rares ou inconnues
.
Une œuvre étrange
Ce Kreidekreis est une œuvre étrange, sur un livret du compositeur appuyé sur la pièce de Alfred Henschke dit Klabund (1925), elle-même inspirée d’une pièce chinoise de Li Qianfu (XIIIe siècle). L’œuvre de Zemlinsky est fortement politique et traite tout à la fois de la misère qui suscite l’oppression et contraint à la prostitution, de la corruption des juges, et d’une justice soumise aux puissants et dure aux petits, de l’appât du gain universel.
Mais elle traite aussi de la force de l’amour maternel, de l’amour en général qui modifie les êtres, et enfin de la grandeur du souverain, qui sait juger, « nous vivons sous un Prince ennemi de la fraude » eut dit Molière (dans Tartuffe) : cette fin heureuse où le Prince Deus ex machina vient résoudre l’intrigue et (en plus) épouser l’héroïne est assez proche du final de Tartuffe, elle consacre un souverain évergète qui sait distribuer le bienfait et surtout démêler le bien du mal et le vrai du faux. Le conte est à la fois moral et politique, et Brecht va s’en saisir (il y a là du millet pour son serin) dans Le cercle de craie caucasien.

Les deux parties sont musicalement différentes, et la musique de Zemlinsky dont on dit souvent qu’elle est quelque part entre Puccini, Strauss, Wagner et Schönberg (une sorte de géographie impossible) prend cette fois des chemins de traverse. Si la deuxième partie fait songer à Chostakovitch, Puccini (Turandot) Strauss, et plus particulièrement le final à Die Frau ohne Schatten , la première partie prend en compte (nous sommes en 1930-31) toute la musique des années vingt, aussi bien du côté d’Hindemith, voire de Schönberg (notamment dans leurs petites formes) que du côté du jazz et surtout de Kurt Weill, notamment dans la première scène (La maison de thé). Deux ambiances, deux univers celui plus symphonique de la deuxième partie et celui presque plus chambriste, fait de miniatures, de la première, comme si la musique de la première partie illustrait la vie fragmentée de la jeune héroïne Haitang (comme dans les vignettes des icônes ou des fresques de vie de saints, voire des miniatures de scènes du XVIIIe à la Pietro Longhi) en quatre moments, Haitang vendue par sa mère à Monsieur Tong, Haitang chez Tong séduit les clients, puis un an après, Haitang chez Monsieur Ma, dont elle est la deuxième épouse et enfin l’empoisonnement de Monsieur Ma au quatrième tableau, tandis que la deuxième partie (troisième acte) est une sorte de variation sur un jugement à rebondissements, une sorte d’anti-jugement dernier où seuls les corrupteurs et les méchants sont vainqueurs avec un juge (Tschou Tschou) sinistre à force d’être désopilant (rôle parlé confié à l’excellent Stefan Kurt)
N’ayant aucune référence sur cette œuvre, il faut faire confiance à notre imaginaire pour nous construire un univers : en tous cas, c’est une œuvre qui excite la curiosité par son développement et son étrangeté : un opéra qui alterne dialogues et chant, avec une fluidité dans les passages de l’un à l’autre qui évidemment nous éloignedes formes de l’opéra-comique par exemple et arrive à la modernité d’un « théâtre musical » avant l’heure.
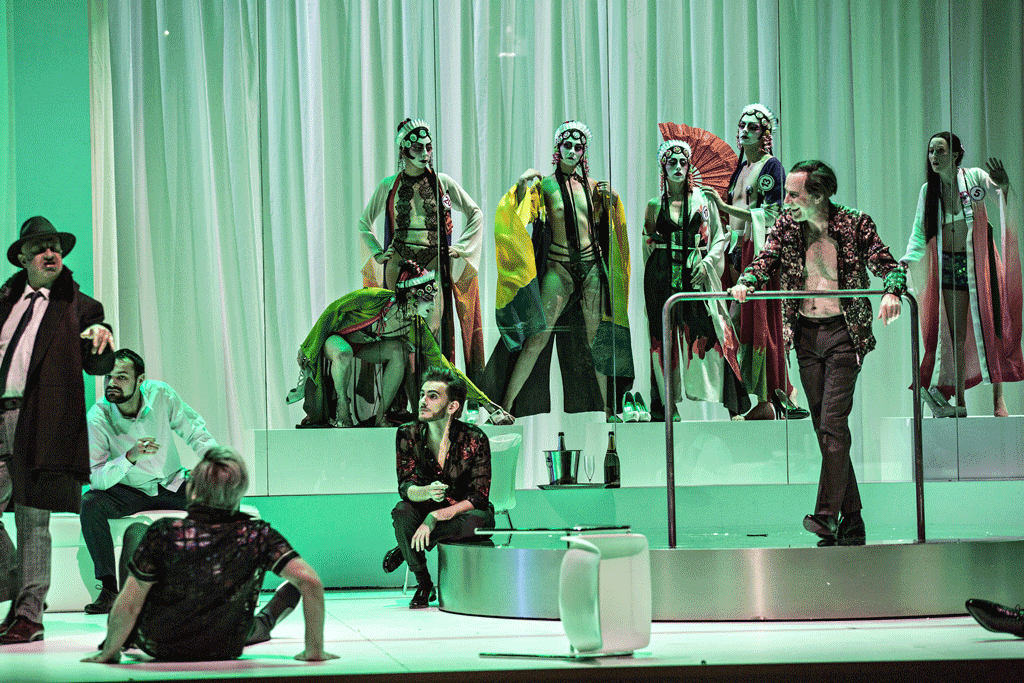
L’histoire met donc au centre l Haitang, vendue par sa mère à Tong propriétaire d’une maison de thé (c’est à dire de tolérance…) parce que son père s’est suicidé, ne pouvant payer l’impôt demandé par le collecteur Monsieur Ma. Cette maison de thé, où les jeunes femmes s’appellent des Blumenmädchen et où le propriétaire Tong, s’est émasculé, rappelle évidemment le monde de Klingsor au deuxième acte de Parsifal: Aussi bien Klabund que Zemlinsky connaissent leur Wagner.
Dans la maison de Tong, la jeune fille excite le désir du jeune Prince Pao, qui en devient amoureux, et celui de Monsieur Ma lui-même, le potentat local : elle est mise aux enchères et c’est Ma qui l’emporte. La voilà donc aux mains de celui qui est cause de sa misère.
Elle finit seconde épouse de Monsieur Ma, qui, au contact de l’amour change totalement à son contact et passe du mal au bien. La jeune femme lui a donné un fils que la première épouse Yu Peï, n’avait pas été à même de lui donner. Cette dernière, écartée et jalouse, a pour amant Tchao, un secrétaire de tribunal fou d’amour et prêt à tout pour sa maîtresse. Sans enfant, Yu Peï sera déshéritée, et Mr Ma veut d’ailleurs la répudier.
Yu Peï va donc empoisonner le mari, en accusant la seconde épouse Haitang, et insinuant l’idée que l’enfant n’est pas d’elle, mais qu’elle-même en est la véritable mère.
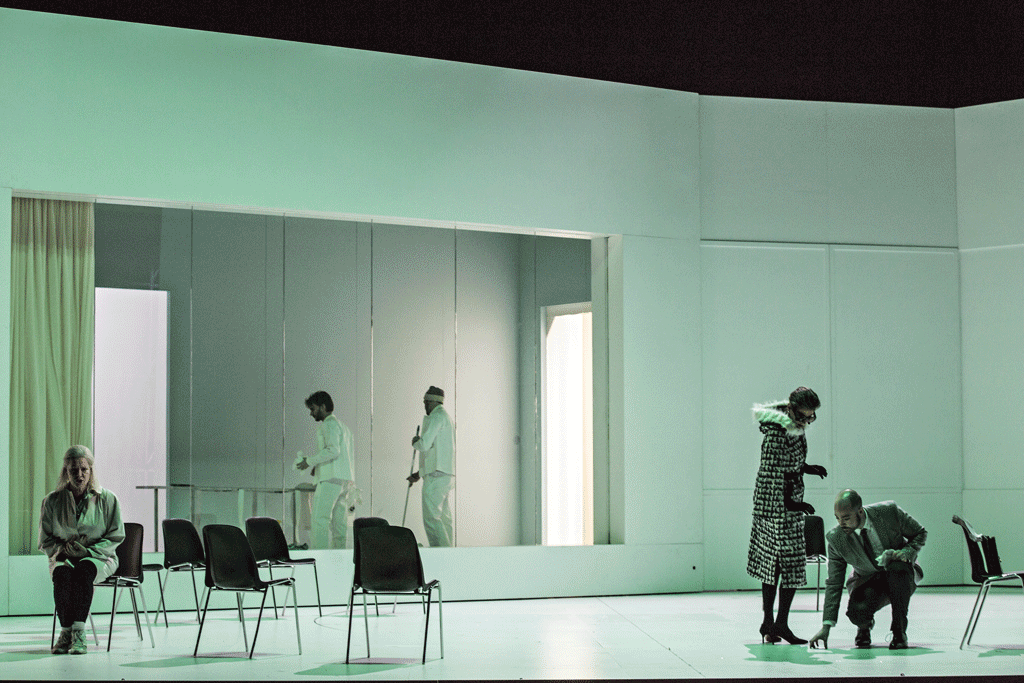
Le piège fonctionne si bien que tout le troisième acte, comme on l’a dit, constitue le procès, avec ses péripéties, ses témoins subornés, sa sage-femme achetée, son juge corrompu et pour finir la condamnation à mort de Haitang.
Au moment où elle va être exécutée (par injection létale), tout s’arrête (écran descendu des cintres montrant une nouvelle d’une chaine d’info: l’Empereur vient de mourir et lui succède le Prince Pao (apparu comme rival de Monsieur Ma au début), qui arrête toutes les condamnations en demandant à juges et condamnés de se présenter à Pékin. Il reconnaît Haitang que, fou d’amour et de désir, il avait aimée (violée?) alors qu’elle dormait en croyant rêver. Il se retrouve donc à arbitrer entre les deux femmes et propose de tracer un cercle avec au centre l’enfant, les deux mères le tireront chacune de son côté et celle qui le portera à l’extérieur du cercle sera la mère. Haitang, ne voulant pas faire souffrir son enfant et lui faire risquer l’écartèlement, renonce pour que l’enfant ne souffre pas.
Le Prince décrète donc que c’est Haitang la mère, parce qu’elle a pris en compte la souffrance de l’enfant. Il se révèle à la jeune femme, propose de l’épouser et de reconnaître l’enfant (qui est peut-être de lui d‘ailleurs, mais l’histoire ne le dit pas, tout en le suggérant). Rideau.
De la fable au regard sans concession sur notre monde
Voilà un vrai conte de fées, une sorte de variation sur Cendrillon avant l’heure, que la production de Richard Brunel évacue au profit d’un récit continu, qui clarifie certes la trame et en fait aussi une sorte de récit plus réaliste que la fable à laquelle on aurait pu s’attendre (option qu’avait au contraire choisie David Pountney à Zurich).
Les avantages de ce choix sont clairs, parce qu’ils rendent fluides une histoire qui ne l’est pas, avec un dispositif scénique à la fois imposant mais aussi paradoxalement léger de Anouk dell’Aiera, privilégiant les voiles (premier acte), les baies vitrées (deuxième et troisième acte), avec un écran vidéo projetant fleurs et pistils (lourdement symbolique …) et les déplacements assez fluides de structures blanches dans les beaux éclairages de Christian Pinaud qui atténuent quand même ce qui serait trop réaliste et déterminent plusieurs espaces qui partagent le plateau, avec des scènes parallèles, des personnages (nombreux) en arrière-plan, un jeu sur les différents plans (par exemple la maison de thé en trois espaces, l’entrée, la salle, et la scène, ou le troisième acte, plus unifié en deux espaces : la chambre d’exécution derrière une baie vitrée et la grande salle qui sert pour ceux qui assistent à l’exécution, puis aussi de tribunal et qui s’efface en espace circulaire pour l’épreuve du cercle de craie. Cet acte s’unifie donc en une sorte d’espace tragique unique dont le cercle lumineux rappelle étrangement l’orchestra des théâtres grecs.

Richard Brunel nous veut de plain-pied avec l’histoire, dont il évacue aussi la Chine, essentiellement présente au premier tableau, par quelques signes, (le maquillage de Tong, le propriétaire de la maison de thé et ses danseuses – des travestis – , ce qui renvoie à la Chine des concessions où la clientèle est occidentale) mais pas vraiment dans les costumes de Benjamin Moreau: il n’y rien de pittoresque qui renverrait à une Chine rêvée ou fantasmée sinon quelques touches : le drame qui se joue semble aller vers l’universalité d’un monde où le pauvre, ce salaud, est systématiquement écrasé par un système où l’argent fait tout.
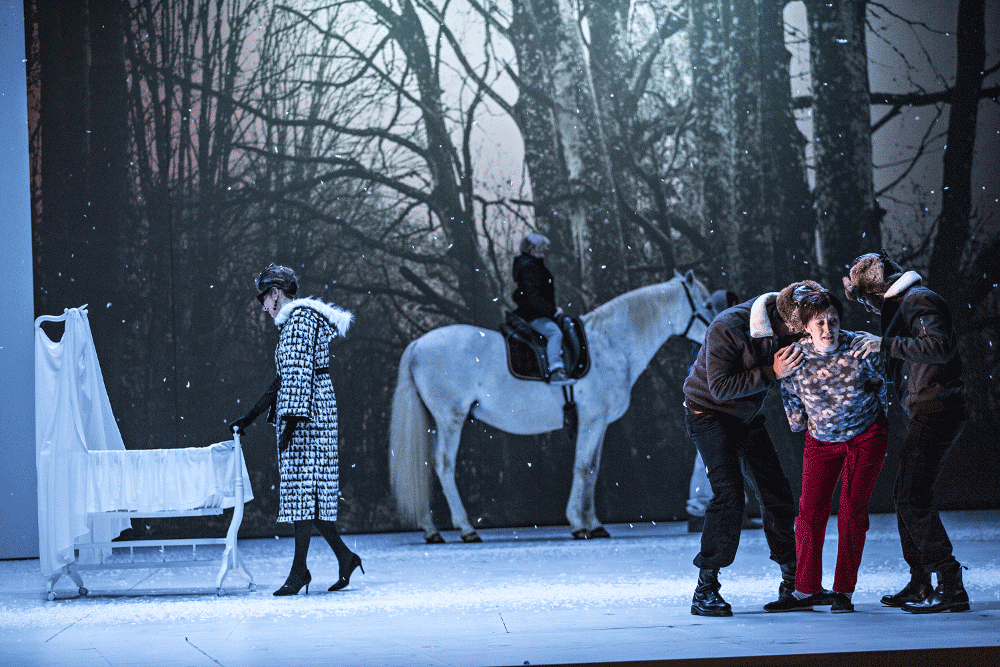
Richard Brunel a soigné la direction d’acteurs, très efficace, mais aussi les mouvements des personnages, les images aussi dont certaines ne sont pas dépourvues de poésie : l’apparition de la neige au troisième acte, du cheval chevauché par l’enfant sur fond de forêt tranche évidemment sur le décor clinique du tribunal-chambre d’exécution. Car le troisième acte a ce caractère terrible de dénonciation d’un système judiciaire qui conduit directement du jugement à l’exécution, – la première image est celle d’une jeune femme condamnée qui se débat, qui finit exécutée : par son aspect démonstratif elle annonce la suite de l’histoire. L’apparition de Pao fait disparaître ce qui glace et transforme l’espace (les cloisons s’effacent)à en espace poétique (forêt lointaine, neige): on quitte le réel, mais la manière dont le décor s’efface en laissant la vitre de la chambre d’exécution au centre, plus longtemps que les autres éléments de décor, éclairée d’un vilain vert, nous avertit en quelque sorte de ne pas croire au rêve.
Adieu à la fable, adieu à la Chine, adieu à Brecht
Car le conte de fées, la fable de l’Empereur qui vient rétablir le bien et le vrai n’est justement qu’une fable, nous dit Richard Brunel, et après le final triomphant qui semble tout droit venu des dernières mesures de Die Frau ohne Schatten il laisse place à une dernière image où le rideau s’ouvre sur la baie vitrée et où le cadavre de Haitang est dévoilé sur la table d’exécution. Tout cela n’était donc qu’un rêve, comme le suggéraient cheval, forêt et neige, en contradiction avec la musique triomphale qui marque ce final et donc ressentie rétrospectivement comme illusoire, voire sarcastique.
L’histoire a sa logique mélodramatique: la jeune femme victime de sa pauvreté est vendue deux fois, trouve un bonheur contrecarré par une première épouse jalouse, est accusée faussement d’assassinat et de vol d’enfant, puis jugée par une justice corrompue et véreuse, elle est condamnée et exécutée. N’en jetez plus ! L’accumulation de malheurs sur cette jeune fille finit par être lui-aussi irréaliste, dans la tradition des mélos du XIXe siècle, ou du néo-réalisme italien, à moins qu’il ne soit démonstratif ou didactique à la manière de Brecht.
Et c’est pourquoi l’option résolument anti-brechtienne de Richard Brunel, très bien rendue, me paraît peut-être discutable : il veut raconter dit-il une histoire d’humanité, de personnes, de situations : l’absence de références à la Chine dès le deuxième tableau conduit à une imagerie proche du téléfilm, esthétiquement et scéniquement et cela dérange, notamment dans les deuxièmes et troisième tableaux.
L’œuvre en revanche a un aspect didactique qui convient évidemment au dramaturge allemand qui en a fait une pièce de théâtre, et Zemlinsky en était proche : sa musique renvoie aussi à Kurt Weill et son histoire raconte l’histoire de la pourriture sociale qui rappelle Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny dont a dirigé d’ailleurs la première berlinoise au Theater am Schiffbauerdamm (l’actuel Berliner Ensemble) en 1931 au moment de la composition du Cercle de craie. C’est donc aussi un univers et une esthétique particuliers à laquelle la pièce renvoie, historiquement brechtiens, sur une thématique commune.
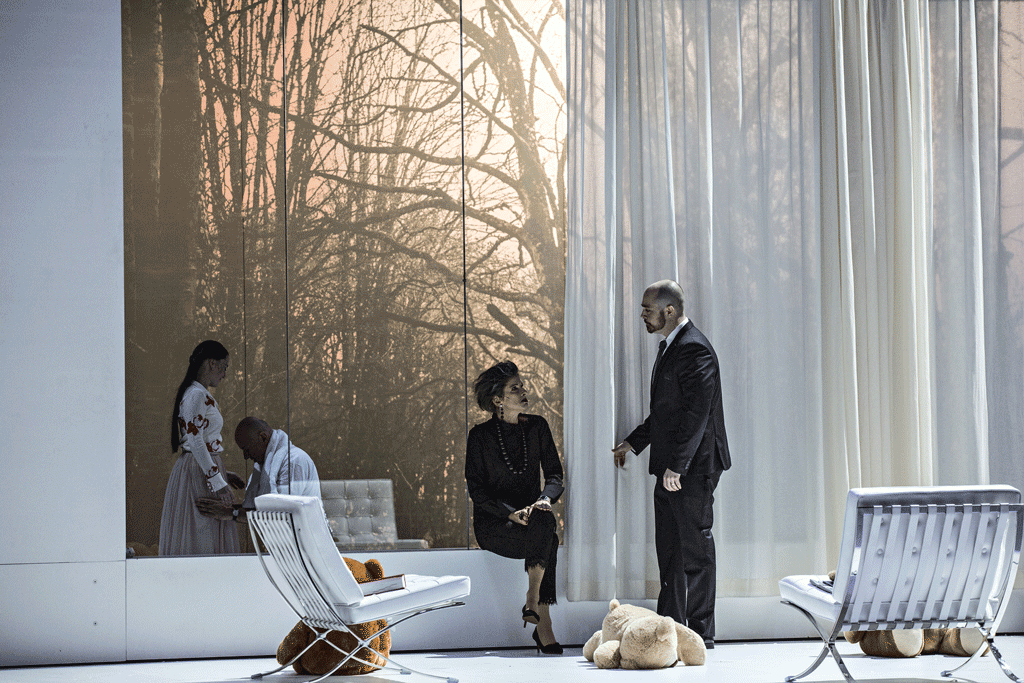
Brunel dit lui-même dans l’interview avoir dé-brechtisé le texte. Je défends suffisamment les metteurs en scène qui travaillent les livrets en soi et en dehors des contextes de création pour ne pas accuser Brunel de trahison, mais je me demande s’il n’a pas par son choix affadi et banalisé le propos qui devient presque un topos télévisuel, avec sa dénonciation de la peine de mort et des exécutions létales à l’américaine et à la chinoise (elles sont fréquemment pratiquées en Chine, y compris dans des camions itinérants spécialement aménagés), de la justice expéditive où le tribunal voisine l’échafaud ou son substitut. J’en prends aussi pour indice l’utilisation du cercle presque anecdotique, qui n’est cité que par le livret auquel il faut de toute manière obéir sans lui donner de vraie fonction sauf au final rêvé. Ce cercle apparaît donc au premier tableau, il est un marqueur pour le frère de Haitang qui inscrit un cercle sur la vitre de la maison de Ma pour signer l’arrêt de mort de Monsieur Ma, comme on marquait les maisons protestantes à la vieille de la Saint Barthélémy, ou comme ces signes de ralliement de sociétés secrètes. Le cercle est donc rappelé à divers moments sans vraiment être le centre du propos, et au troisième acte, le tribunal est un cercle autour duquel tous les protagonistes se retrouvent pour enfin, pendant l’intervention de l’Empereur devenir fonctionnel et devenir espace de jeu et espace de drame ainsi la question du cercle est presque « évacuée » comme signe anecdotique d’une histoire qui est ailleurs, alors qu’il pourrait être l’unique espace scénique.
Si on apprécie l’effort de simplification de la trame et la rigueur du travail de Brunel pour lui donner une linéarité, et pour casser ces vignettes successives qui afficheraient des « scènes de la vie de Haitang », on peut regretter le côté roman noir (ou blanc vu la couleur du décor) à peine compensé par quelques vrais moments de poésie. Et si on avait osé Brecht ?
Une direction très juste et un orchestre remarquable
Mais l’œuvre a aussi une structure et une musique qui ne disent à mon avis pas tout à fait ce que dit Brunel. Il laisse à la musique l’onirisme et se réserve en quelque sorte le réalisme, même avec des « trous » oniriques. La musique de la première partie notamment renvoie aussi bien à la musique de cabaret berlinois qu’à des œuvres plus chambristes. La direction irréprochable de Lothar Koenigs, particulièrement familier de ce type de répertoire, sait valoriser les instruments singuliers, dans une approche d’une grande limpidité et presque légère au premier acte, faisant ressortir de cette musique tout ce qu’elle doit aux inventions des années 20, dont Weill, dont le jazz mais pas seulement : on y trouve la seconde école de Vienne, on y trouve Hindemith, on y trouve tout la foisonnement des inventions sonores de l’époque et les dernières mesures de l’acte II font penser à Mahler. Plus symphonique , et quelquefois un peu plus classique, la deuxième partie renvoie évidemment de manière plus marquée d’autres compositeurs pour un autre univers, on pense à la Turandot de Puccini, on pense aussi de manière fugace à Chostakovitch et à la fin, à Strauss, on l’a dit . Non que cette musique ne soit pas personnelle ou originale, mais elle est si inhabituelle et si peu connue que l’auditeur essaie de composer sa propre géographie musicale. Il reste qu’il y a des moments d’une très grande intensité et d’une grande originalité qui doivent évidemment beaucoup à l’expressionisme aussi. Le chef a su rendre à cette musique sa variété, sa diversité, son étrangeté aussi avec ses sons légèrement orientaux, tout en soulignant sa richesse et son originalité, une musique qui dans l’ensemble diffère de la production connue de Zemlinsky, et Lothar Koenigs a su aussi insuffler à l’orchestre un engagement qu’on identifie très vite, et à valoriser chaque pupitre, en grand coloriste.
Une distribution sans failles
Comme souvent à Lyon, une distribution solide, sans failles, homogène, équilibrée illumine la soirée, à commencer par l’ensemble de femmes sans conteste dominé par Ilse Eerens, qui est à l’image de son personnage d’apparence fragile et incroyablement solide. Un physique tendre, et une voix bien assise, contrôlée, puissante, parfaitement posée, qui remplit la salle, avec une diction impeccable et un vrai sens de la couleur, nécessaire dans un rôle qui traverse des situations si diverses. Elle sait en effet être énergique voire agressive, mais aussi émouvante et tendre . Une voix sans aucun doute à suivre.
Nicola Beller Carbone est d’abord un personnage, on se souvient d’elle en comtesse de la Roche dans Die Soldaten de Zimmermann à Munich, mise en scène d’Andreas Kriegenburg. Elle promène dans Yü Pei sa silhouette filiforme et élancée, qui se déplie quand elle se lève, sur un plateau où elle s’oppose à la figure menue de Haitang. Son chant est tout dans l’expressivité, plus que dans la démonstration, elle est une interprète avant tout et soigne les couleurs et les variations de l’expression, avec de jolis accents. Et quelle démarche en scène ! quelle figure ! Et quelle justesse !
Moins marquante la figure de la gouvernante chantée par Hedwig Fassbender, un peu plus banale et passepartout, même avec de beaux aigus, tandis que la brève apparition de madame Tschang au premier tableau est marquée par la personnalité toujours forte de Doris Lamprecht, son expressivité et sa capacité à transmettre l’émotion et qu’on remarque avec plaisir la jeune Blumenmädchen qui intervient au début (Josefine Göhmann, du Studio de l’Opéra de Lyon).
Du côté des rôles masculins, domine le Monsieur Ma de Martin Winkler, un rôle qui permet de jouer sur les deux tableaux du bien et du mal, avec un souci éminent de la couleur, un véritable sens du texte (et une diction exemplaire, dans une œuvre qui l’exige à cause de l’alternance chant-parole qui doit être fluide et permettre de passer de l’un à l’autre presque insensiblement), et une expressivité si soignée et si évidente que l’humanité du personnage transfiguré par l’amour frappe à la fin du premier acte autant que le cynisme du premier tableau. Une belle performance qui rappelle que Martin Winkler, à la voix forte, au volume marqué, est l’un des grands barytons du moment doué d’un sens inné des rôles qu’il interprète.
L’autre baryton Lauri Vasar, dont la carrière explose, – il fut dans Lear de Reimann à Salzburg un Gloucester très remarqué et bouleversant-, était annoncé souffrant. Il donne de Tschang Ling une humanité déchirée, très juvénile, avec une voix pleine de relief, même si un peu voilée (la maladie ?) qui tranche avec la retenue de Haitang, deux personnages en quête de vérité dans un monde qui la leur refuse.
Troisième baryton, le Tchao de Zachary Altman, l’amoureux fou au timbre chaud, avec la faiblesse inhérente à ce type de personnage prêt à tout pour servir l’être aimé, et aller jusqu’au meurtre pour affirmer le couple qui compose une sorte de Macbeth-Lady Macbeth au petit pied. L’interprète est juste, presque tendre et rend parfaitement la faiblesse qui conduit au meurtre et à l’abdication de toutes les valeurs, alors qu’il a la réputation d ‘incorruptible, avec en complément sa veulerie devant l’Empereur où il enfonce joyeusement sa bien aimée .
Stephan Rügamer est le Prince Pao ; le ténor, en troupe à la Staatsoper de Berlin où il joue souvent et avec grand talent les rôles de caractère, est moins intéressant dans ce rôle que la mise en scène néglige peut-être un peu. Un rôle qui se veut positif, mais même par amour (ou par désir) Pao abuse de Haitang dans son sommeil et participe donc du système en renchérissant sur Ma. C’est d’ailleurs dans cette scène initiale où l’interprétation est la plus intéressante. Il est donc lui aussi dans ces hommes qui font de la femme une marchandise, au départ, mais il est transfiguré quand il revient comme Empereur où il ne peut plus que dire le vrai, le pouvoir peut aussi changer en bien : il dit le vrai sur le jugement du cercle, mais aussi en avouant avoir violé Haitang : en cette fin prévue par Zemlinsky, l’amour fait tout, amour filial mais aussi amour qui transfigure, Ma d’abord, Pao ensuite. La révolution par l’amour en somme. Rügamer arrive difficilement dans la scène finale à afficher la palette de couleurs requise par ce rôle ingrat (on le voit seulement au tout début et à la fin) parce que le flot musical du final ne lui rend pas la partie facile, bien qu’on l’entende bien. Voilà un rôle qui semble fait pour un Klaus Florian Vogt soit dit incidemment…
Dans les rôles secondaires, on remarque le Tong de Paul Kaufmann assez bien caractérisé, avec la diction expressive d’un personnage coloré qui semble sorti tout frais d’un opéra de Brecht/Weill, pas assez caricatural encore peut-être ici, et enfin les deux coolies tout frais et très énergiques des jeunes artistes du studio Luke Sinclair et Alexandre Pradier.
Malgré mes réserves sur le parti-pris de Richard Brunel, il restera le souvenir d’une production solide, bien réalisée, qui éclaire l’œuvre et qui devrait donner des idées à d’autres programmateurs, l’œuvre de Zemlinsky mérite de figurer au programme des grands théâtres. Encore une réussite de l’Opéra de Lyon, qui justifie plus que jamais les prix reçus en 2017.