
« La scène est une chambre de meurtre » .
Cette didascalie de Jean Cocteau pour La voix humaine créée par Berthe Bovy en 1930, Krzysztof Warlikowski l’a fait sienne dans le travail qu’il a effectué sur La voix humaine dans l’opéra de Francis Poulenc en 1959 tiré de la pièce de Cocteau mais aussi sur le Château de Barbe Bleue (livret de Béla Bálasz) de Béla Bartók, qui remonte à 1911, même si la création à l’Opéra de Budapest date de mai 1918. Dans un même espace se succèdent sans entracte les deux œuvres que rien a priori ne rapproche. En effet, l’opéra de Bartók est très influencé par le symbolisme, par le monde de Pelléas et Mélisande créé 9 ans plus tôt (1902) sur le livret de Maurice Maeterlinck, également auteur du livret encore plus proche d’Ariane et Barbe Bleue, de Paul Dukas, créé en 1907. Les œuvres partagent entre elles l’évocation d’un monde mystérieux, quelquefois pesant, et des relations complexes entre les personnages, encore qu’Ariane et Barbe Bleue soit plus linéaire à cause du rôle réduit donné au personnage de Barbe Bleue.
Dans une ambiance voisine, Le Château de Barbe Bleue est un dialogue amoureux entre Judith et Barbe Bleue, qui se termine en échec, avec un jeu subtil qui rend l’ouverture des six premières fameuses portes autant de gages d’amour, et la septième suprême gage et en même temps constat d’échec qui ouvre sur les trois femmes de Barbe Bleue (chacun bien caractérisée par son costume, comme si elles étaient chacune une part de LA femme recherchée et jamais trouvée) enfermées et gardées vivantes auxquelles va s’ajouter la quatrième, cette Judith bien peu biblique qui va passer du statut d’épouse à celui d’ex, et donc de momie: elle troque sa robe de femme vivante contre un costume noir « en représentation », avant d’entrer déjà momifiée dans « la vitrine ».
La Voix humaine est aussi la voix d’une ex, mais l’ambiance n’a rien de l’univers de contes évocatoire de l’œuvre de Bartók, c’est celle d’un théâtre bourgeois plus prosaïque, et aussi beaucoup plus clair et lisible. Quoi de plus banal qu’une rupture ? on a dit que c’était une tragédie, il s’agit plutôt d’un drame bourgeois version années 30.

En liant l’un à l’autre, Warlikowski fait de « Elle », la voix humaine, une cinquième Judith, celle qui aurait tué son amant (d’où le lien avec la didascalie initiale de Cocteau) qui apparaît bientôt en sang, dont l’allure est proche du Barbe Bleue précédent (costume, coiffure, barbe). Comme si le Poulenc était la conclusion logique du Bartók et des fantasmes qui y sont remués : une fois encore Eros et Thanatos. Une fois encore une relation de couple dans sa complexité et ses drames. D’ailleurs, au moment même où Judith pénètre dans la cage de verre rejoindre les trois autres femmes, « Elle » apparaît en fond de scène et va s’approcher lentement du proscenium, comme pour prendre le relais de l’histoire.
On peut discuter le choix initial de Warlikowski, mais sa construction ne manque ni d’arguments ni de cohérence : ces deux œuvres construisent pour lui deux variations autour du thème du fantasme féminin, mais aussi des relations de couple ; le dialogue et l’absence de dialogue. Que ce soit Judith pour Bartók ou Ariane pour Maeterlinck et Dukas, ce sont deux prénoms qui renvoient à des mythes, biblique pour Judith, grec pour Ariane, mythes de femmes qui décident de donner un sens à leur existence dans la relation à l’homme. Tout comme « Elle » dans la vision qu’en a Warlikowski, prise en instantanée juste après un crime passionnel, non plus victime passive, mais active dans la mesure où elle assume son amour jusqu’au bout, en tuant son amant et en se suicidant ensuite, rejoignant ainsi les grands mythes du couple, ou cherchant jusqu’à la fin à « coupler » les deux existences.

Et d’une certaine manière la recherche de Judith, qui cherche à savoir jusqu’au bout ce que cachent les portes et donc ce que cache Barbe Bleue, a quelque chose de tragique et désespéré, quelque chose qui renvoie à l’insistance œdipienne dans le questionnement et qui va chercher la vérité au risque de tout perdre, et de se perdre, comme si cette vérité pouvait être une sauvegarde, mais l’obsession de la clarté (si importante et répétée dans le texte de Béla Bálasz) devient suicidaire et ruine du couple : la lumière et la transparence sont vite un obstacle à l’amour, et le couple transparent n’existe pas. Ce qui frappe dans l’œuvre de Bartók, et dans le travail qu’en tire Warlikowski, c’est que Barbe Bleue, le monstre du conte de Perrault sur qui courent toutes les rumeurs, est là trop humain, à la limite de la faiblesse, et que c’est Judith qui mène la danse, s’appuyant d’ailleurs sur le motif traditionnel de la curiosité féminine et fatale, de la femme fauteuse du trouble : éternel motif d’Eve, derrière la parabole de la curiosité se dessine toujours celle de la Chute..
La mise en scène de Krzysztof Warlikowski envisage tout cela, mais se réfugie dans l’évocatoire, le minimalisme (ou le minimal ?) sans toujours pour mon goût aller plus loin, comme s’il nous livrait une ébauche, l’ébauche d’un Serpent en quelque sorte.
Le Château de Barbe Bleue a une dramaturgie assez simple : 7 portes à ouvrir et un échange entre Judith et Barbe Bleue à chaque porte, qui théoriquement fait entrer de plus en plus de lumière dans l’espace, et fait sans cesse mieux connaître Barbe Bleue, tortures, armes, jardin enchanté ou joyaux, tous lieux marqué par le sang ou les larmes (le lac de larmes). Le sang est un motif permanent, qui peut évoquer la violence et la mort, et se relier à la didascalie initiale signalée plus haut, mais aussi la dégénérescence (souvenons nous du Parsifal de François Girard, ou de celui de Christoph Schlingensief). Le motif répétitif fait de chaque ouverture le seul élément « dramatique » le seul événement de l’œuvre. Warlikowski conserve cette simplicité, grâce au dispositif de sa complice Małgorzata Szczęśniak qui a conçu une boite, avec des cloisons lisses, des meubles « Art déco », un canapé, une commode. Des cloisons émergent les portes qui sont des cages de verre, comme des vitrines de Musée, où l’on conserve des trophées, des objets symboliques, des objets de collection qui s’accumulent comme dans un cabinet de curiosités, qui seraient autant de replis de l’âme mystérieuse de Barbe Bleue.
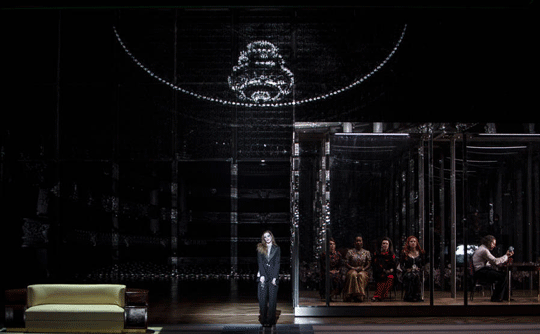
En même temps, Warlikowski comme souvent rappelle sans cesse où nous sommes (on se souvient de l’immense miroir d’Iphigénie en Tauride, dans cette même salle) par ces visions de la salle de Garnier vide où seule Judith est assise, du lustre, qui évidemment implique le spectateur et cherche à faire tomber le quatrième mur (Judith émerge de la salle avant de monter sur scène : elle est nous)
Comme souvent aussi, Warlikowski s’appuie sur le cinéma, comme chambre d’écho, clef de références et outil de vagabondage : il propose comme en un refrain obsessionnel des images La Belle et la Bête de Jean Cocteau, bien sûr parce que Cocteau, mais aussi parce que c’est un autre conte sur la relation de couple, sur l’épreuve, et sur la monstruosité, toujours relative.
Car si c’est Judith qui agit, forçant Barbe Bleue à exhiber ses secrets, c’est bien l’âme de Barbe Bleue qui peu à peu se découvre, un Barbe Bleue qu’on voit à la fois adulte et enfant, sur l’écran, au visage qui perle toujours de sang, et dans la sixième vitrine, où il tient un lapin qu’un Barbe Bleue magicien a exhibé dans le prologue où ce Barbe-Bleue/Mandrake (un personnage créé dans les années 30) fait sortir, tissus pigeons et lapins, comme dans un numéro de magie, comme si allaient surgir de la boite-scène des objets tout aussi hétéroclites, et comme si la relation à Barbe Bleue avait quelque chose de cette magie, et que l’œuvre de Bartók n’était qu’un dévoilement des « tours » successifs du magicien.
Le Château de Barbe Bleue, très bien joué par les deux protagonistes (Ekaterina Gubanova, robe « de scène » verte, John Releya, qui passe de magicien brillant à homme blessé), défile d’une manière claire et linéaire, avec cette esthétique élégante et ces mouvements étudiés typiques de Warlikowski. Pourtant, ce dernier n’arrive pas toujours (à moins que ce ne soit voulu), à sortir du schéma dramaturgique voulu par le livret, et cela devient répétitif, et presque sans surprise, sur un fil ténu qui nous retient à peine de tomber dans l’ennui. Au total, il ne se passe pas grand chose : spectacle de niveau, certes, mais qui ne me fait oublier ni La Fura dels Baus dans le même lieu en 2007, ni même Pina Bausch avec Boulez à Aix en Provence.
Si le lien avec La Voix humaine, sorte de huitième porte « définitive » a été explicité, ni la musique, ni la dramaturgie des deux œuvres ne procèdent du même univers. Warlikowski les a un peu forcées, mais le spectacle a sa cohérence.
Il y a tout de même une vraie différence entre Barbe Bleue et La Voix humaine, c’est que dans le premier, il y a deux personnages, et dans le second il n’y en a qu’un : pour créer l’univers parallèle entre les deux œuvres, va bientôt surgir « Lui », un « Lui » agonisant et ensanglanté, qui éclaire le monologue et le transforme en dialogue. On avait bien compris que quelque chose s’était passé puisque « Elle » entrait en scène en jetant un pistolet, on n’entre pas ainsi sans raison…Par ailleurs, le téléphone bien présent reste totalement muet, trônant orgueilleusement sur la commode: La voix humaine de Warlikowski n’est pas un dialogue avec des blancs (les réponses de l’amant à l’autre bout du fil), mais un monologue ou presque un mélologue où la protagoniste fait à la fois les questions et les réponses. La Judith de la première partie qui a rendu Barbe Bleue muet devient celle qui l’a tué, seule solution pour le garder.
Pour soutenir cette œuvre, il faut évidemment une personnalité hors pair : ce furent récemment Anna Caterina Antonacci, ou il y a plus longtemps au Châtelet Gwyneth Jones (merveilleuse personnalité, mais diction française pâteuse) ; c’est cette fois Barbara Hannigan, et la mise en scène n’est qu’un écrin qui centre tout sur la chanteuse, à qui finalement le metteur en scène lâche la bride puisqu’une longue complicité artistique lie Warlikowski à Hannigan, depuis Lulu et Don Giovanni à Bruxelles. Concerto pour Hannigan et orchestre, une Hannigan d’abord vue de deux points de vue, théâtral et cinématographique avec le jeu initial sur la vidéo : un corps vu de dessus, qui se tort, qui se dresse, qui s’étend, sur un sol géométrique, comme un corps en rupture sur le décor, un corps animal, presque chosifié : on voit ce corps se mouvoir et « Elle » n’est plus « Elle », mais elle est « chose », comme un insecte qui aurait perdu toute identité. On ne jette que quelques regards furtifs sur la chanteuse « en chair et en os » car l’image projetée est tellement forte qu’elle accapare le regard et dissout le théâtre.

Dans la deuxième partie, quand au loin apparaît « Lui » se traînant ensanglanté jusqu’à « Elle », le théâtre reprend ses droits, allant crescendo jusqu’au suicide final, jusqu’aux corps emmêlés et sans vie. Hannigan joue alors une sorte de ballet, et ce ne sont que mouvements et volutes où les corps de l’un et de l’autre s’évitent ou se croisent, « Lui » la regarde et la cherche, mais « Elle » est ailleurs.
Quand on a sous la main un tel monstre sacré, il suffit de la laisser faire, il suffit de la mettre en valeur plus qu’en scène, il suffit de « gérer le reste » que le spectateur ne voit pas tellement il est aspiré par la performance phénoménale de la Hannigan, douée en plus d’une prononciation française impeccable.
Mais dès qu’on a compris le mouvement et ce qui va devenir ligne directrice de l’œuvre (et dès l’entrée en scène on comprend), tout s’enchaine logiquement sans que rien ne soit inattendu, y compris le suicide sur le corps de l’amant emmêlé. Comme si Warlikowski avait laissé l’idée initiale se développer, et qu’il suffisait de laisser aller. Et dans cette histoire de téléphone, on a presque l’impression que Warlikowski est aux abonnés absents, tant c’est Hannigan qui mène la danse. On pourra m’objecter que ce qui apparaît, c’est une sorte de commune création où chacun met du sien, sans doute…il reste que c’est une impression mitigée qui émerge de ce travail : certes, Warlikowski est un grand bonhomme, et les idées qu’il développe dans ce spectacle sont justes et défendables ; il sait créer un univers, rien que par les figures qui traversent muettes toute la production, les trois femmes, l’assistante du magicien et son petit lapin blanc, l’enfant, sont autant de pierres miliaires , de marques de fabrique du metteur en scène polonais : mais la mise en pratique et donc en scène m’a laissé un peu sur ma faim, de cette insatisfaction qui naît de l’attendu voire du trop attendu. Les remarques que j’ai lues sur son « classicisme » supposé ou sur son « minimalisme » semblaient rassurer certains spectateur toujours inquiets des excès possibles (on se souvient de l’accueil absurde à son magnifique Parsifal…), mais laissaient percevoir la convenance d’un spectacle qui pourtant partait de présupposés intéressants : les ressorts psychanalytiques, les montées d’images, tout cela existe mais jamais vraiment exploité, plus laissé en pâture au spectateur que fouillé de manière chirurgicale. Pour moi on est dans du « Warli » (comme l’appellent ses fans) un peu Canada Dry : on ressort du spectacle sans avoir appris beaucoup plus sur les œuvres qu’en y entrant.
Il reste que cette production est soutenue par une approche musicale d’une qualité incontestable.
En appelant Esa-Pekka Salonen absent depuis l’époque Mortier, Stéphane Lissner voulait frapper un grand coup, tant le chef finlandais est populaire auprès du public parisien, et tant l’opéra de Paris depuis cinq ans manquait de grandes figures de la direction d’orchestre. Salonen dirige avec cette incroyable clarté qui répond à la clarté invoquée par les livrets, et qui fait émerger les deux partitions, écrites à un demi-siècle de distance ou peu s’en faut. Cette distance fait de l’une, Bartók, une partition de son temps, ouverte sur l’avenir, une partition contemporaine, et de l’autre, une partition plutôt tournée vers le passé, qui, tout comme le texte de Cocteau d’ailleurs, renvoie à un « avant » ; à vrai dire, le traitement de Salonen fait émerger pour moi le côté « has been » de cette œuvre, sans d’ailleurs la rendre inintéressante, ni moins passionnante mais il en fait un témoignage d’un XXème siècle qui en 1959, cherche dans les replis du passé son identité quand la musique bruisse de nouvelles pistes et de nouveaux sons. Parce que Salonen fait émerger les deux styles différents des deux œuvres, il montre aussi la moindre inventivité de la seconde.
Je me souviens aussi de Bartók plus agressifs, plus acides que cette approche plutôt en légèreté : de manière surprenante, on a un son plutôt grêle, qui laisse les voix s’épanouir sans jamais les couvrir ni faire de l’orchestre le protagoniste. En ce sens, il joue le théâtre, et le théâtre total, en suivant avec une grande tension ce que l’histoire dit et ce que la mise en scène propose. Cette absence de « corps » orchestral n’est pas problématique, parce que l’essentiel n’est pas là, l’essentiel est dans la transparence, dans la clarté qui préside aux différents niveaux de la partition, dans l’excellence des pupitres de l’Orchestre de l’Opéra dans un de ses meilleurs jours, dans « l’accompagnement » du plateau. La pâte orchestrale est fluide, très plastique, toujours présente et jamais envahissante : on est vraiment dans du théâtre musical plus qu’à l’opéra.
La distribution réduite (trois chanteurs) a été plutôt bien choisie. John Releya est Barbe Bleue. Prévu à l’origine, Johannes Martin Kränzle aux prises avec la maladie a dû annuler : on imagine ce que ce chanteur acteur eût pu donner de violence blessée à Barbe Bleue. John Releya a pris le rôle : une voix encore jeune, bien posée, bien projetée, un timbre plutôt velouté qui lui donne une humanité immédiate et efface le monstre pour laisser apparaître plus de subtilité, plus de complexité, plus d’humanité. Un Barbe Bleue sans présence charismatique (on pense à Willard White sur cette même scène), mais qui convient sans doute encore mieux au propos de Warlikowski qui fait de l’homme un comparse de la femme. Bonne interprétation, mais pas vraiment d’incarnation.
Ekaterina Gubanova est Judith, un de ces rôles « border line » entre le mezzo et le soprano, une sorte de Falcon qu’on a vu incarné par des mezzos et des sopranos dramatiques, qui nécessite des graves solides, et surtout une épaisseur vocale marquée, mais aussi un aigu à la cinquième porte que peu de chanteuses assument vraiment. Ici Gubanova fait la note, mais dans une sorte de fragilité vocale intéressante pour la caractérisation du rôle, mais techniquement aux limites.
Gubanova a un très beau registre central et sa personnalité tient le rôle, elle est scéniquement très crédible, et propose un personnage combattif, éminemment vivant, qui ne s’embarrasse pas de détails : elle poursuit son objectif (faire entrer la clarté dans ce château sinistre) ; en ce sens, elle propose (impose ?) une Judith plus directe, moins complexe que le Barbe Bleue de Releya. Très belle figure, décidée, allant droit au but, et la douleur, qui impose une présence sans jamais vraiment imposer son corps, pourtant valorisé par une robe d’un vert agressif et seyant, assez opposée à la figure de Hannigan dans la torture et la douleur, à l’expression corporelle extrême.
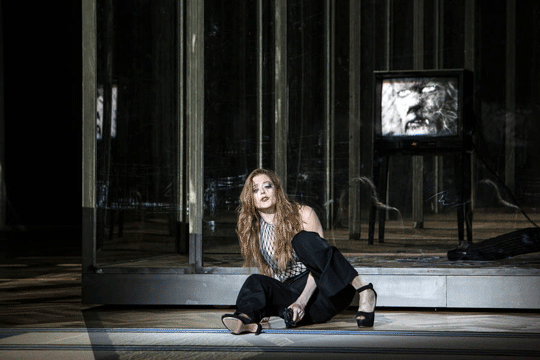
La personnalité hors pair de Barbara Hannigan casse évidemment les schémas préétablis. Bien sûr la voix est sans doute un peu en deçà de ce que le rôle exige, un lirico plutôt spinto. Mais il en va de Hannigan comme de Salonen : qu’est-il il besoin de voix plus grande quand la clarté du texte est telle et la projection telle qu’on entend tout, et surtout les subtilités du ton, la variété des couleurs. La prononciation française impeccable qui fait ressortir toute la théâtralité du texte se fait entendre à un point tel que la nature de la voix plus légère n’a pas d’importance. Comme Salonen avec un son plutôt en deçà de l’attendu fait tout entendre, Hannigan est présente par sa voix sans avoir besoin de la forcer. À quand Salomé ?
Ce qui frappe également, c’est l’adéquation entre ce corps élastique, torturé, polymorphe et cette voix qui en suit les méandres et les moindres sinuosités, on a l’impression que les mouvements même du corps créent le son, créent la projection, créent le ton, créent les accents. Barbara Hannigan a un sens et un souci des accents qui laissent pantois, et qui alimentent le débat fréquent à l’opéra entre belle voix ou voix expressive : Hannigan n’hésite pas à chanter vilain si le personnage doit y gagner en vérité. Elle est une Bête qui est aussi Belle, la Belle et la Bête dans un seul corps. C’est unique aujourd’hui.
Stéphane Lissner voulait marquer ce premier trimestre de trois coups : Castellucci/Warlikowski-Salonen/Hermanis-Kaufmann. Pour son deuxième coup, il a quand même marqué quelques points, mes réserves n’étouffent pas la qualité globale d’un spectacle bien adapté à Garnier qui marquera sans doute plus musicalement que scéniquement, mais qui reste à l’honneur de notre première scène. [wpsr_facebook]




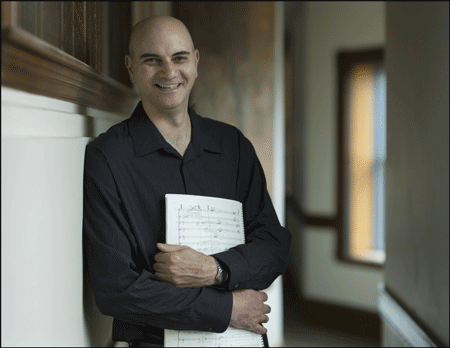

















 Le décor du premier acte, centré autour d’une maison qui semble un peu une cage par son géométrisme , ou qui rappelle une maison à la japonaise, sur laquelle des vidéos (une cheminée par exemple) se projettent ou les personnages évoluent en un jeu d’ombres assez fascinant (différences de tailles, d’éloignement etc…). Le deuxième acte, très essentiel, pour le long récit de Wotan, n’a pas grand intérêt scénique (sinon de beaux et longs échanges de regards jusqu’à l’arrivée des jumeaux), dans un décor de toit de temple (derrière un fronton composé de chevaux enchevêtrés – après tout, la chevauchée des Walkyries n’est-elle pas la référence musicale la plus connue du public, thème repris en vidéo de fond de scène au troisième acte. Le reste se déroule dans une forêt très stylisée, verte d’abord (les amants) grise ensuite (l’annonce de la mort) comme on l’a dit. La mort de Siegmund est comme toujours très soignée scéniquement: c’est Wotan qui pousse Siegmund sur l’épée de Hunding, c’est Sieglinde qui se penche sur lui et le serre avant de fuir avec Brünnhilde.
Le décor du premier acte, centré autour d’une maison qui semble un peu une cage par son géométrisme , ou qui rappelle une maison à la japonaise, sur laquelle des vidéos (une cheminée par exemple) se projettent ou les personnages évoluent en un jeu d’ombres assez fascinant (différences de tailles, d’éloignement etc…). Le deuxième acte, très essentiel, pour le long récit de Wotan, n’a pas grand intérêt scénique (sinon de beaux et longs échanges de regards jusqu’à l’arrivée des jumeaux), dans un décor de toit de temple (derrière un fronton composé de chevaux enchevêtrés – après tout, la chevauchée des Walkyries n’est-elle pas la référence musicale la plus connue du public, thème repris en vidéo de fond de scène au troisième acte. Le reste se déroule dans une forêt très stylisée, verte d’abord (les amants) grise ensuite (l’annonce de la mort) comme on l’a dit. La mort de Siegmund est comme toujours très soignée scéniquement: c’est Wotan qui pousse Siegmund sur l’épée de Hunding, c’est Sieglinde qui se penche sur lui et le serre avant de fuir avec Brünnhilde. C’est d’un certain point de vue le troisième acte le plus “kitsch” , avec ces fils rouges sensés représenter les âmes des héros montant au Walhalla, ces estrades enchevêtrées laissant passer les longues crinolines des Walkyries (même si Brünnhilde est en pantalon…), ce feu réduit autour de Brünnhilde à des lampes rouges régénérantes comme des lampes de couveuses, qui vont couver la femme qui va naître le jour suivant, d’où semblent sortir des gouttes d’eau. le corps de Brünnhilde lui-même, montré sur un podium comme un monument, tout cela est juste un peu exagéré, décalé, créant une distance ironique avec l’histoire.
C’est d’un certain point de vue le troisième acte le plus “kitsch” , avec ces fils rouges sensés représenter les âmes des héros montant au Walhalla, ces estrades enchevêtrées laissant passer les longues crinolines des Walkyries (même si Brünnhilde est en pantalon…), ce feu réduit autour de Brünnhilde à des lampes rouges régénérantes comme des lampes de couveuses, qui vont couver la femme qui va naître le jour suivant, d’où semblent sortir des gouttes d’eau. le corps de Brünnhilde lui-même, montré sur un podium comme un monument, tout cela est juste un peu exagéré, décalé, créant une distance ironique avec l’histoire. Ekaterina Gubanova
Ekaterina Gubanova