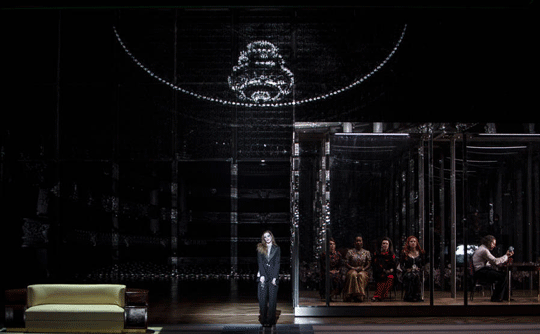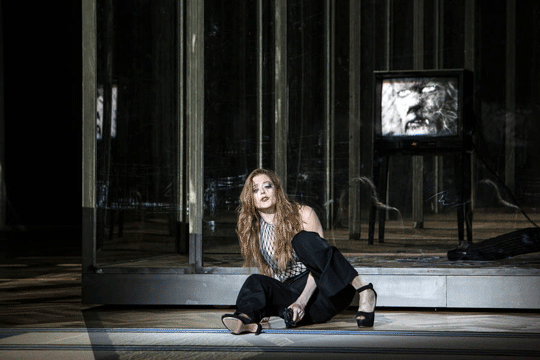La production de Dimitri Tcherniakov de Dialogues des Carmélites de Francis Poulenc sur le texte de Georges Bernanos remonte à 2010, et elle avait alors été dirigée par Kent Nagano et enregistrée en DVD par Bel Air Music. Les « ayant droit » trouvant la fin de ce spectacle contraire au sens qu’en voulaient donner Bernanos et Poulenc ont intenté un procès, perdu en première instance et gagné en appel. Si le spectacle dont ils avaient aussi demandé l’interdiction n’a pas été l’objet d’une sentence, le DVD quant à lui est bel et bien interdit. C’est donc avec une certaine curiosité que j’ai vu à Munich la reprise de ce spectacle, dirigé par Bertrand de Billy, dans une très belle distribution, Laurent Naouri, Stanislas de Barbeyrac, Sylvie Brunet-Grupposo, Christiane Karg, Anne Schwanewilms, Anna Christy, Susan Resmark.
Et si les tribunaux appliquent la loi ou disent le droit, la position des « ayant droit » apparaît difficilement compréhensible à plusieurs niveaux.
D’abord, la mise en scène de Dmitri Tcherniakov n’est en aucun cas choquante. Comme souvent chez Tcherniakov, elle est un bilan de lecture, qui fait de Blanche le personnage clef de l’œuvre, à travers le nom qu’elle s’est choisi, « Sœur Blanche de l’agonie du Christ », un nom qui place la question de la mort au centre de la problématique posée par l’œuvre, comme le montre d’ailleurs la scène de la mort de la première Prieure, Madame de Croissy, qui malgré une vie au carmel, est saisie d’une angoisse existentielle à l’approche du moment fatal. La question du rôle des religieuses est aussi posée par ce nom, qui évoque le Christ qui offre sa vie pour sauver l’homme et qui est de la part de Blanche une affirmation orgueilleuse, héroïque, qui ne correspond pas forcément à la faiblesse intrinsèque de la jeune fille ou même plus généralement à la faiblesse intrinsèque de l’homme.
Dans le livret et la pièce de Bernanos, Blanche, qui a échappé à l’arrestation finit par grimper volontairement à l’échafaud pour accompagner les sœurs et finit par vaincre l’angoisse de la mort pour périr au milieu de ses compagnes, la dernière .
La vision de Tcherniakov est déterminée par le nom que Blanche a choisi, et par la logique qu’il implique : cette dernière, pour honorer ce nom, sauve une à une chacune de ses compagnes, et demeure la seule à aller au sacrifice et au don définitif de soi. Cette démarche est pour Tcherniakov l’aboutissement du chemin que Blanche a pris en choisissant son nom, un chemin qu’il estime conduire logiquement à ce sacrifice-là, un chemin auquel la première prieure a renoncé. Il raconte donc l’histoire d’un basculement d’une Blanche d’abord faible et fragile, qui réussit finalement à agir conformément à son nom.

Tcherniakov a donc conçu son spectacle (3 actes et 12 tableaux), en 12 stations séparées chacune par un noir total et un long silence, comme une fresque iconique en autant d’icônes, d’icônes « vivantes », qui sont le parcours d’une Passion christique.
Pour ce parcours, il garde le plateau systématiquement vide et la première image est celle d’une foule bigarrée qui est une somme d’individus qui se croisent, se saluent, s’embrassent au milieu de laquelle Blanche est perdue, agressée, et se retrouve seule sur cet espace sans limites.
Puis la musique commence, et apparaissent sur ce plateau nu Le Marquis de la Force (Laurent Naouri) et le Chevalier (Stanislas de Barbeyrac, qui fait ses débuts sur la scène munichoise), tout autant que Blanche, petit être emmitouflé, comme des êtres tous perdus dans un univers sans références et erratique chacun dans son ordre.

Après les scènes de prologue, qui aboutissent à la décision de Blanche de partir au Carmel, du fond de scène, émergeant d’une légère brume apparaît une maison de bois, un espace fermé par des cloisons transparentes, aux dimensions assez réduites, voire presque étouffantes, à l’intérieur duquel les sœurs sont réunies autour de la prieure.
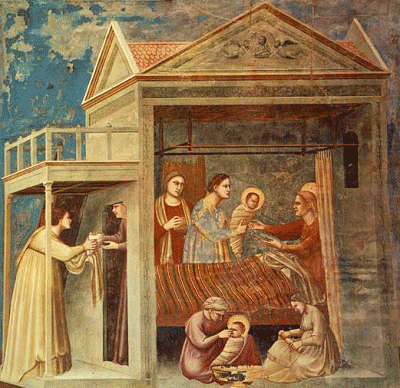 Presque tout l’opéra se déroulera à l’intérieur de cet espace, espace protégé, image de la clôture du Carmel mais aussi de son isolement, et de cette coupure du monde, un monde vide qui répond à un espace trop plein, qui étrangement rappelle la manière dont on représente les espaces intérieurs dans les fresques médiévales ou sur les icônes, où se déroulent des scènes de l’Évangile.
Presque tout l’opéra se déroulera à l’intérieur de cet espace, espace protégé, image de la clôture du Carmel mais aussi de son isolement, et de cette coupure du monde, un monde vide qui répond à un espace trop plein, qui étrangement rappelle la manière dont on représente les espaces intérieurs dans les fresques médiévales ou sur les icônes, où se déroulent des scènes de l’Évangile.
Voilà la ligne directrice de ce travail, finalement assez simple et linéaire, où tout est vu du dedans et au dedans, et où le monde extérieur apparaît très peu, par des bruits, des échos de scènes de foules, et par quelques intrusions des personnages le prêtre d’abord, puis les policiers (le commissaire), mais aussi le Chevalier dans une belle scène qui montre physiquement, par la distance, par l’utilisation de l’espace le fossé qui le sépare désormais de Blanche avec laquelle il entretient une relation si complexe.

Cette dialectique du « trop plein » intérieur : meubles, chaises, personnages envahissent l’espace et l’obstruent et du vide extérieur rend physiquement un aspect rarement souligné, qui est l’impression de sécurité et de chaleur, le côté « cocon », de cet espace intérieur face à un extérieur presque invisible, sombre et brumeux, vide, et angoissant.
Les deux moments où apparaît la foule, l’image initiale et la scène finale, sont deux moments antithétiques : au départ, une foule anonyme où Blanche se perd et qu’elle vit presque comme une agression, et à la fin une foule de badauds réunis pour assister au supplice et que Blanche transcende. D’ailleurs, même si la guillotine n’est pas montrée et pour cause, la maison d’où l’intérieur nous est cette fois masqué est entourée par la police comme une « scène de crime », et l’on pressent que cette « maison » va être brûlée, comme brûlée du feu purificateur. Il est pour moi probable que Tcherniakov ait pensé au sacrifice des vieux croyants dans Khovantchina et qu’il ait rapproché les deux situations, d’autant que la musique de Poulenc puise souvent dans l’univers de Moussorgski.

Si les sœurs ne portent jamais l’habit des Carmélites, leurs costumes indiquent le mépris du monde et des conventions (c’est frappant pour Madame de Croissy et Mère Marie de l’Incarnation) Madame Lidoine, la nouvelle prieure, garde un aspect légèrement plus apprêté et plus « féminin » : elle use de la jupe, au contraire du pantalon porté par les deux autres personnages).
Certains éléments ne sont pas mis en valeur par la mise en scène, comme le vote du martyre, instillé par Mère Marie de l’Incarnation, quand chez Christophe Honoré à Lyon par exemple ce moment était fortement ritualisé, comme si ce qui intéressait Tcherniakov, c’est plutôt l’histoire des destins individuels plus que collectifs.
Il a refusé l’approche historique ou contextuelle, pas de signes ni de vêtements religieux, pas de symboles révolutionnaires non plus, et des costumes pour tous plus ou moins anonymes, c’est frappant dans la simplicité dont Chevalier et marquis de la Force sont vêtus (veste un peu élimée pour l’un imperméable pour l’autre) où les fonctions sociales ou hiérarchiques sont effacées, laissant chaque personnage nu dans sa situation simplement humaine. Cette abstraction fondamentale qui concentre sur « le sens » plus que sur « l’histoire » qu’on raconte ou « l’Histoire » qu’on évoque, me paraît peut-être aussi procéder de la culture orthodoxe de Tcherniakov, où dans certaines représentations (notamment de mosaïques, grecques il est vrai, du Xème siècle) sont effacées toutes références sensibles, absence de sol comme si les personnages flottaient, absence de décor ou décor minimal plus évocatoire d’historié, gestes à peine esquissés.
Comme souvent dans son travail, il essaie non de nous perdre dans des détails d’un univers réaliste, mais de nous proposer des lignes épurées, des signes : on pense à Lulu, avec ses parois translucides d’un labyrinthe de verre où tout se voit, dans un vaste dispositif où l’espace de jeu est réduit en autant de « cages de verre », on pense aussi à Lady Macbeth de Mzensk où derrière un apparent réalisme, l’espace de vie (l’espace intérieur) de Katerina est une niche presque close, un espace de clôture là aussi, ou même la maison dans Macbeth, espace clos et isolant..

Ce qui frappe dans Les Dialogues des Carmélites, c’est que la relation est inversée : là où on lit la clôture qui coupe du monde, c’est le monde qui semble étouffant et l’espace clos qui semble un possible pour la liberté : le vaste plateau nu du Nationaltheater est ici une image étouffante et dangereuse sans direction aucune, quand « la petite maison » reste un espace de sens.
Aussi, et nous y reviendrons, Tcherniakov s’intéresse au mécanisme du don de soi, du don de vie, du don à Dieu, sans rattacher la question à une problématique religieuse voire chrétienne, ou en l’occurrence catholique, ni même historique, mais à la question de l’humanité dans son rapport au mystique, dans son rapport à la transcendance, question fondamentale qu’il semble traiter par antithèse en s’appuyant sur les « pauvres vies » des Carmélites dans une figure oxymorique. Et à ce jeu-là le sacrifice final de Blanche, fidèle au sens de l’agonie du Christ, semble bien proche de ce que les grecs appelaient « ὕϐρις (hybris) », l’orgueil de ceux qui veulent égaler les Dieux : d’où une fin « spectaculaire » là où le spectaculaire a été complètement absent de toute la représentation, avec explosion, flammes et fumées, une fin volontairement « ailleurs » qui effectivement crée un malaise, par rapport à Blanche qui demeure telle qu’elle est rentrée au Carmel, avec sa soif d’héroïsme, et par rapport aux Carmélites, sauvées, mais en contradiction face à leur vœu de Martyre, qui rejoignent Mère Marie de l’Incarnation dans l’anonymat des ordinaires.
A ce travail très tendu, très profond, très juste souvent aussi, mais qui pour moi n’a pas tout à fait la force d’autres spectacles de Tcherniakov, à commencer par cette Lady Macbeth de Mzensk vue à Lyon quelques jours auparavant, correspond une distribution en tous points exemplaire, comme souvent à Munich.

Dans le rôle très réduit du marquis de la Force, Laurent Naouri réussit à donner au personnage à la fois cette relative dureté et cette distance un peu ironique qu’il a souvent, cette distance qui est cause de la fragilité des deux enfants, le Chevalier et Blanche ; diction parfaite, évidemment, et toujours une vraie présence.
Stanislas de Barbeyrac était le Chevalier, et il faisait ses débuts à Munich. Comme toujours, suprême élégance dans la manière de dire le texte, dans le contrôle des notes, dans l’expressivité : il est vraiment émouvant. Est-ce néanmoins un rôle pour lui ? il a eu un peu de mal avec certains aigus et surtout, l’orchestre le couvrait quelque peu et empêchait quelquefois d’entendre sonner le texte. La tessiture est tendue, l’orchestre est important, mais je ne pense pas que le chanteur soit en cause, derrière ce timbre, j’entends décidément toujours un futur Lohengrin (on imagine une future carrière à la Gösta Winbergh), mais la question du volume orchestral s’est posée plusieurs fois.
Christiane Karg était Blanche. J’ai écouté plusieurs fois cette chanteuse, particulièrement valeureuse, sans être toujours convaincu du côté exceptionnel de ses prestations que d’autres amis soulignaient. Ce n’est pas le cas ici : elle est magnifique et totalement convaincante. Elle a la fragilité, elle a le timbre séraphique, et elle a une clarté d’expression (et une diction française !) en tous points exceptionnelle. C’est l’une des plus belles Blanche qui m’ait été donné d’entendre.

Anna Christy était Constance, un peu moins convaincante, bien que très fraîche avec un timbre très clair elle n’a pas l’expressivité de Christiane Karg et n’est pas vraiment émouvante, ou du moins la mise en scène ne lui donne pas l’importance qu’un Christophe Honoré lui donnait à Lyon par exemple. Il reste que leur scène initiale est intéressante dans la manière dont elle est réglée, où Blanche est volontairement méchante (elle lui renverse son seau) , mais sa personnalité scénique n’irradie pas à la manière dont irradiait une Sabine Devieilhe.
Le personnage de Mère Marie de l’Incarnation est campé. On pourrait laisser le mot sans autre qualificatif : campé, solide, et sans doute construit dans ce style pour Susanne Resmark au physique bien planté, qui tranche avec l’idée qu’on se fait de ce personnage. Il en fait un personnage tout d’une pièce, sans grande subtilité, qui évidemment tranche avec sa « rivale » Madame Lidoine, au contraire toute élégance et féminité. Toujours ce souci de tracer des lignes de partage symboliques. La voix est solide, sans vrai caractère, avec quelque problème de projection, mais en tout cas colle parfaitement au personnage.

Sylvie Brunet-Grupposo est comme à Lyon magnifique dans le rôle de Madame de Croissy la première prieure. La table de la « petite maison » devient un lit pour l’occasion, et il n’y a volontairement aucune noblesse dans cette mort, dans ce comportement, dans l’attitude même : c’est très proche de ce que faisait Honoré à Lyon, diamétralement opposé à l’option si théâtrale et si spectaculaire d’Olivier Py au Théâtre des Champs Elysées (avec Rosalind Plowright déchirante et qui savait si bien user d’une voix déchirée). Diction parfaite, violence incroyable, humanité bouleversante, sens du texte et de l’expression, malgré une voix à la projection pourtant limitée. Il est sûr que Sylvie Brunet-Grupposo dont la carrière n’a pas toujours répondu aux espoirs mis en elle a trouvé là son rôle fétiche. Elle remporte d’ailleurs un succès personnel marqué.
J’étais un peu surpris de trouver Anne Schwanewilms dans cette distribution, elle qui est une chanteuse straussienne de très grand niveau.
Dès son monologue conclusif de la première partie, on comprend ce choix. Entre la brutalité de Mère Marie, la déchirure de Madame de Croissy, elle est d’abord d’une humanité et d’une sérénité prodigieuse, qui tranche et qui rassure, elle sait adopter un ton apaisant, mais avec une véritable autorité (notamment avec Mère Marie). Diction impeccable, chant particulièrement intelligent et modulé, suprêmement élégant. Avec cette attitude scénique tellement noble, elle tranche totalement et avec Mère Marie, comme on l’a dit, mais aussi avec Madame de Croissy. La noblesse de naissance de la première ne se sent pas vraiment dans ce travail (au contraire de ce que faisait Py), mais la noblesse d’âme de la seconde, roturière, se lit dans la manière dont elle se meut, dont elle se tient, dont elle domine aussi le groupe des sœurs. Grande interprétation, qu’on voit dans les petits détails et les petits faits vrais que son jeu fait transpirer.
Plus généralement, l’ensemble de la distribution répond aux exigences de l’œuvre de Bernanos et de la musique de Poulenc, notamment en terme de clarté du texte, de diction et d’expression. Heike Grötzinger(Mère Jeanne), Rachael Wilson (Sœur Mathilde) , Alexander Kaimbacher (L’aumônier), Ulrich Reß (1er commissaire), Tim Kuypers (2ème commissaire), Andrea Borghini (le géôlier), Igor Tsarkov (L’Officier) ou Johannes Kammler (Thierry) montrent tous la qualité consommée de la troupe et de l’opéra-studio du Bayerische Staatsoper.
Après Kent Nagano en 2010, c’est à Bertrand de Billy que Klaus Bachler a fait appel. Le chef français, qui fait essentiellement carrière en Allemagne et qu’on voit très rarement (et inexplicablement) en France m’a un peu déçu dans son approche. Je ne suis pas très amoureux de cette musique, mais elle porte en elle une émotion singulière, et des moments de tension spectaculaires et dramatiquement marqués, ce qui explique son succès depuis sa création à la Scala (et en italien) en 1957. Elle porte aussi des souvenirs aussi bien – on l’a déjà souligné- de Moussorgski, très présent, mais aussi de Ravel et d’autres compositeurs notamment du premier XXème siècle. Bertrand de Billy n’a pas réussi – sans doute aussi faute de répétitions (l’opéra de Bavière a mis toute son énergie sur la création de South Pole qui avait lieu le lendemain de la représentation à laquelle j’ai assisté) – à imposer un style et une interprétation marqués, ne donnant aucun relief particulier à une œuvre qui ne manque pas de moments de théâtre forts. L’excellent orchestre est au point (quelques scories aux cuivres), c’est en place, mais ça n’est qu’en place : rien ne se détache, le rendu est assez plat et assez monotone, cette lecture sans particulière clarté ni options ne rend pas justice à la situation et surtout n’est jamais protagoniste, laissant la scène conduire la représentation.
Au terme de ce compte rendu, je tiens à exprimer encore une fois ma très forte surprise devant l’interdiction des DVD de la version Nagano de 2010. Je crois que les « ayant-droit » avaient demandé l’interdiction des représentations et du DVD. Il faut lire à ce propos l’article assez complet de Sophie Bourdais dans Télérama Ils ont obtenu en appel l’interdiction du DVD.
Cette détestable aventure pose une nième fois la question des « ayant droit » qui défendent leur idée de l’œuvre au nom des liens privés qu’ils ont avec les auteurs. Pour ma part, à partir du moment où une œuvre est publiée, elle appartient au public et l’auteur prend la responsabilité de la laisser en pâture au lecteur, au musicien, aux interprètes et bien sûr aux metteurs en scène. L’attitude des « ayant droit » supposerait qu’une œuvre a un sens définitif, marqué dans le marbre, alors que les lois de l’herméneutique contredisent évidemment toute idée de « sens » d’une œuvre. Les exemples ne manquent pas d’œuvres lues d’une certaine manière à leur création et lues au fil des ans d’une manière différente, Molière par exemple mais aussi des romans, ou même la poésie (Baudelaire ou Flaubert, eux aussi objets de procès…). De ce point de vue, il me semble que le droit des héritiers à être dépositaires d’une certaine idée de l’œuvre est abusif. Mais c’est un autre débat.
S’attaquer à une mise en scène dont la fin, selon les « ayant droit », « transformait profondément la fin de l’œuvre et la dénaturait » me paraît erroné, sinon abusif à propos d’un travail qui me semble très respectueux de l’esprit de l’œuvre. C’est pour moi une pièce de plus au débat filandreux sur la mise en scène, et sur le rôle de la mise en scène dans le spectacle d’opéra : c’est là où le débat est le plus crispé, car le public d’opéra reste souvent réfractaire à la mise en scène quand elle va plus loin qu’une illustration et quand elle problématise de manière plus acérée une œuvre, dérangeant les opinions toutes faites et la tranquillité de ceux qui vont à l’opéra « pour la musique » (ceux qui vous disent qu’ils préfèrent une version de concert, allant résolument contre 400 ans d’histoire de la scène, et contre la révolution wagnérienne). Dans cette affaire malheureuse, les « ayant droit » ont ajouté une pièce ridicule et scandaleuse à ce procès-là, mais ils ont surtout mis un peu plus de poussière et de cendres sur leur statut. Honte à eux.[wpsr_facebook]