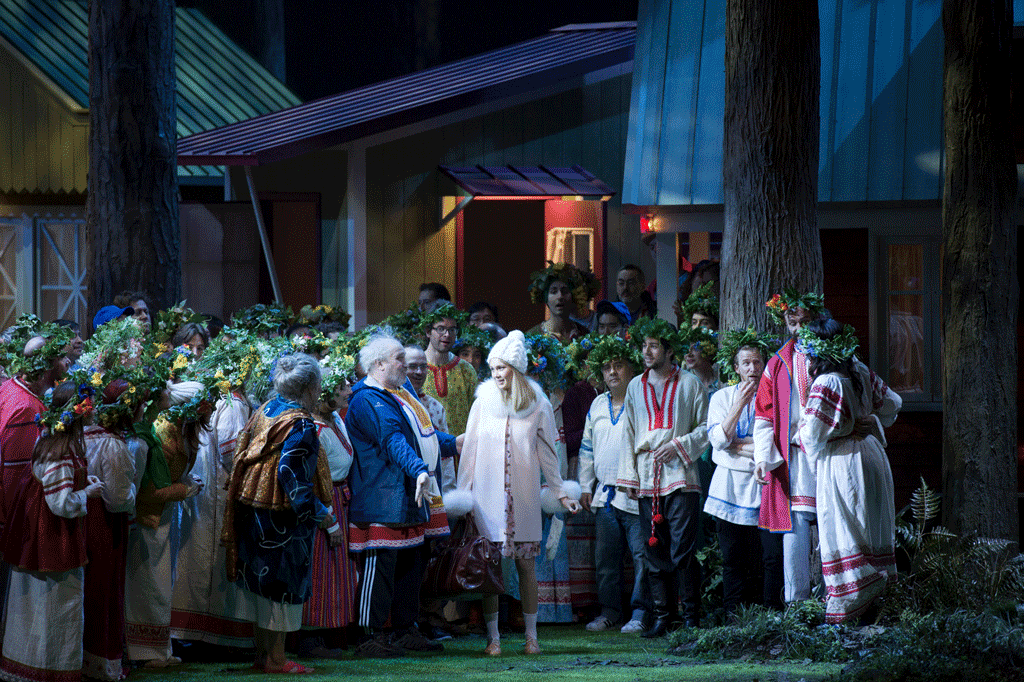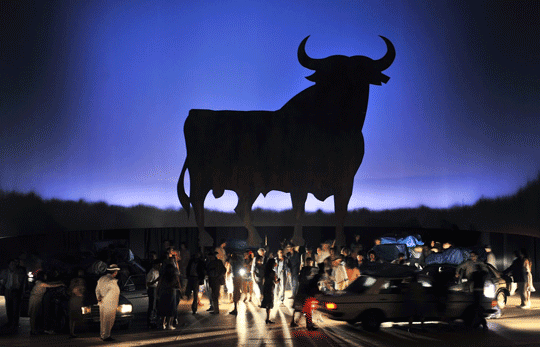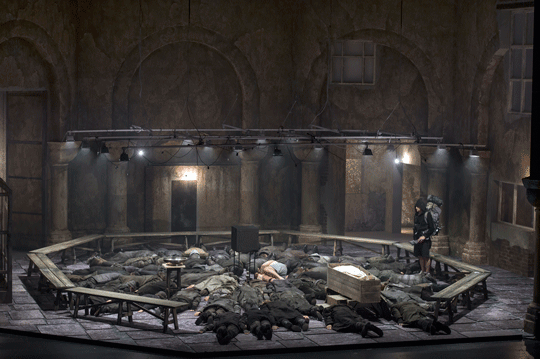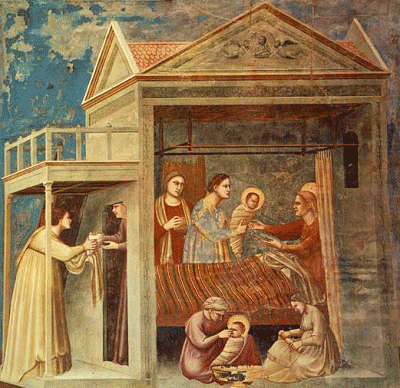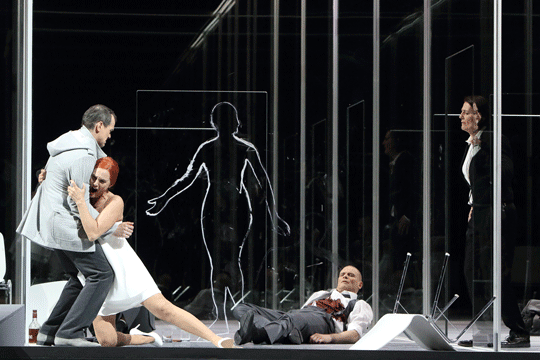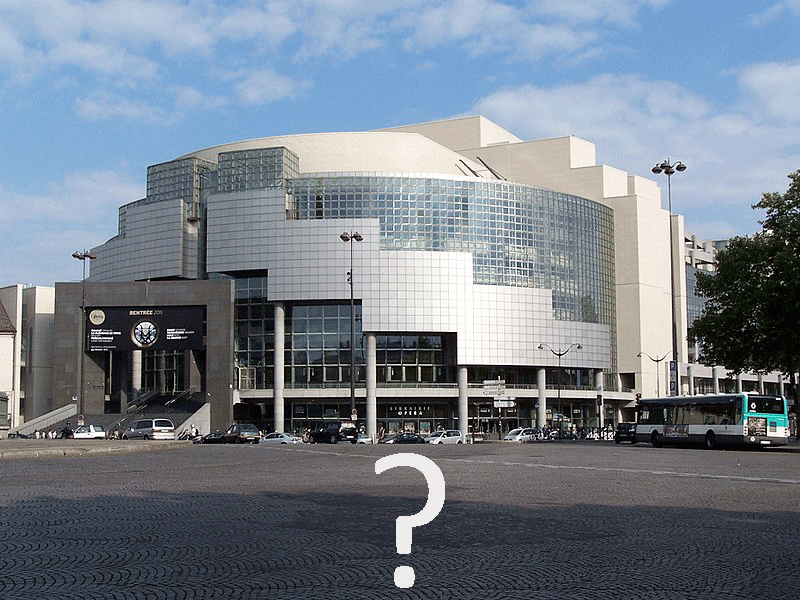 En mai dernier, je publiais une réflexion sur « l’après Stéphane Lissner » à l’Opéra de Paris. Depuis, la situation évolue à peine : les bruits nous ont appris que Stéphane Lissner ne se succèderait pas à lui-même, sans doute à cause d’inimitiés solides en haut lieu. Et, lancés par qui y trouve intérêt, des noms circulent dans la presse de futurs directeurs qui ont à peine pris leurs marques dans leur théâtre actuel, que ce soit Ghristi à Toulouse (depuis 2017), Mantei depuis 2015 à l’Opéra Comique, mais qui a rouvert en 2017 et en est à sa deuxième saison, quant à Sophie de Lint, dont je viens de lire le nom cité, elle ouvre à peine sa première saison à Amsterdam. Leur bilan est pour le moins réduit.
En mai dernier, je publiais une réflexion sur « l’après Stéphane Lissner » à l’Opéra de Paris. Depuis, la situation évolue à peine : les bruits nous ont appris que Stéphane Lissner ne se succèderait pas à lui-même, sans doute à cause d’inimitiés solides en haut lieu. Et, lancés par qui y trouve intérêt, des noms circulent dans la presse de futurs directeurs qui ont à peine pris leurs marques dans leur théâtre actuel, que ce soit Ghristi à Toulouse (depuis 2017), Mantei depuis 2015 à l’Opéra Comique, mais qui a rouvert en 2017 et en est à sa deuxième saison, quant à Sophie de Lint, dont je viens de lire le nom cité, elle ouvre à peine sa première saison à Amsterdam. Leur bilan est pour le moins réduit.
On a dit aussi qu’il fallait des femmes (d’où sans doute Sophie de Lint…) mais ont circulé les noms de Barbara Hannigan pour la direction musicale (on croit rêver), voire de Susanna Mälkki (là c’est quand même plus sérieux). Ce qui transparaît dans la presse, ce ne sont rien d’autre que des noms, mais pas une analyse un peu fine de la situation. L
a réalité, c’est qu’il n’y a pas grand monde dans le monde lyrique aujourd’hui qui puisse sérieusement prétendre à cette maison, l’une des plus grosses, sinon la plus grosse du monde, même si elle n’est pas la plus emblématique.
Les questions posées
La question n’est pas le nom qui va venir, la question n’est même pas non plus la politique artistique.
C’est paradoxal, mais c’est ainsi, une politique artistique est plus essentielle dans un théâtre moins important parce que c’est par elle qu’il va se faire remarquer (on peut citer Bâle, Karlsruhe, l’Opéra-Comique de Berlin, Lyon, Nuremberg ou d’autres) que dans un théâtre de capitale. En effet, Paris, Londres ou New York ont par nécessité des politiques voisines. Seule la Scala qui perd son public à vue d’œil, court après son identité, et sa politique, erratique depuis l’arrivée de Pereira, balançant entre œuvres emblématiques italiennes et grands titres de répertoire étranger vide la salle.
Un grand théâtre-capitale se doit d’être éclectique à tous niveaux :
- Il se doit de servir le grand répertoire international, globalement les grands Mozart, Verdi Puccini, Wagner et Strauss.
- Si possible, il se doit de servir le répertoire maison, pour l’Opéra de Paris, son répertoire historique (ce qui n’est pas encore tout à fait le cas).
- Il doit afficher une troupe de ballet en état de marche (c’est le cas de Londres, de la Scala aussi), mais le ballet de l’Opéra est en crise, de notoriété publique, crise de fonctionnement, de répertoire, de management (depuis le départ de Brigitte Lefèvre).
- Il ne doit pas afficher de ligne artistique trop marquée : il en faut pour tous les goûts entre les mises en scène dites « modernes » et celles qui sont plus « traditionnelles », entre les titres populaires et standards et les titres moins racoleurs, mais il ne peut sans risque faire systématiquement appel à des metteurs en scène décoiffants, ni sans risques non plus proposer des mises en scène vieillies dès leur création (cf bonne part des productions de l’ère Nicolas Joel).
- Enfin le public de fans, qui écume twitter, n’est pas celui qui remplit la salle. C’est attirer régulièrement le public occasionnel et maintenir un public d’abonnés qui est l’enjeu.
À ces considérations générales s’ajoutent des considérations purement parisiennes :
Depuis Rolf Liebermann, c’est à dire depuis que je vais à l’Opéra, j’entends dire que l’Opéra est un gouffre financier : les fautifs, tantôt l’administrateur général (Rolf Liebermann en fut accusé maintes fois par ses adversaires), tantôt les syndicats, dont les exigences sont toujours plus grandes : à lire certains articles, on pourrait penser que travailler à l’Opéra de Paris est une sinécure à nulle autre pareille, le paradis du travailleur, sur le dos des contribuables bien sûr qui paient ces largesses et dont bien peu au total n’accèdent à l’Opéra. En bref, l’Opéra serait la « danseuse » inévitable de l’État, sinon le jardin privé du Prince.
Car l’Opéra de Paris, fondé en 1669 par Louis XIV comme Académie Royale de Musique est depuis sa création liée au Prince : Louis XIV bien sûr, et Napoléon 1er adoraient le genre.
Plus près de nous depuis 1974, de tous les présidents qui se sont succédé, seul Giscard y allait assez régulièrement, hors devoirs de la charge. Mais cela ne veut pas dire que les autres ne s’y soient pas intéressé: Mitterrand qui n’allait pas à l’Opéra a fait construire Bastille, l’un de ses « grands travaux », puis y a placé un proche, Pierre Bergé, qui a vidé Barenboim, et placé René Gonzalès, puis Jean-Marie Blanchard, éphémères administrateurs généraux. Gonzalès, grand homme de théâtre, dont l’Opéra n’était pas la spécialité, a ouvert la maison dans des conditions difficiles, et Blanchard, bref administrateur général, a à son actif quelques productions bien durables (Tosca de Schroeter, Carmen de José Luis Gomez), ou des triomphes mémorables comme Adriana Lecouvreur avec Freni pour sa dernière apparition à Paris ; puis sous Mitterrand et en cohabitation (Balladur aux manettes et Toubon à la Culture) , c’est Hugues Gall, un des deux « enfants » nés de l’ère Liebermann qui a passé dans cette maison une petite dizaine d’années, le temps d’en construire le répertoire, c’est à dire des productions qui puissent faire l’objet de reprises et durer, ce qui n’était pas une mince affaire ni la tradition de la maison. À la fin de l’ère Gall, d’une grande stabilité, la gauche a nommé Gérard Mortier, l’autre « enfant » de Liebermann, mais Mortier homme de gauche a régné sous la droite de Chirac, laquelle a appelé ensuite Nicolas Joel aux manettes, avec le succès (!) que l’on sait, puis arriva Lissner, plutôt opportuniste en politique : il fut l’instrument de la Mairie de Paris (Chirac) quand il était au Châtelet, il revint à Paris nommé par la gauche, en 2012, et aux manettes en 2014 après une dizaine d’années discutées (injustement à mon avis) à la Scala.
De tous ces présidents, aucun n’allait à l’Opéra, mais tous y ont touché de près ou de loin. On ne doit donc pas s’étonner d’entendre dans cette affaire citer l’Élysée, d’autant que le directeur actuel de la communication, Sylvain Fort, est un vrai spécialiste de l’opéra et fondateur du site Forumopéra. Pourquoi se priver de ses compétences?
Mais quand ça bloque, ça bloque: on ne trouve visiblement personne qui ait le profil pour succéder à Lissner, d’où la vanité de cette course à l’échalote et de ces noms (dont certains assez baroques) qui circulent d’autant mieux que la vraie case est vide.
Essayons alors de considérer cette future nomination sous le prisme des enjeux.
Les enjeux
Dans mon précédent article, je pensais possible de renommer Lissner pour un dernier mandat, ou de faire appel à défaut à Dominique Meyer, à cause des immenses avantages de sa candidature (expérience, connaissance de la maison, liens avec le corps de ballet), même si, né en 1955, il ne pourrait tout au plus que faire un mandat. Je maintiens cet avis.
J’ai bien un autre candidat possible en tête, qui a lui aussi les qualités artistiques et la connaissance de la maison voulue…mais je le garde in pectore, car je ne sais même pas s’il serait candidat.
Le nom de toute manière importe peu. Comme disent les italiens Onore/Onere (qui a l’honneur a aussi la charge) et donc au-delà de l’honneur, il faut regarder un peu plus profondément les charges et les tâches prioritaires.
Quitte à surprendre, je ne pense pas qu’à ce niveau l’enjeu soit l’artistique : d’abord parce que l’artistique n’entre que pour 20% des frais de la maison, qui est énorme, sans doute la plus grosse maison du monde et que l’essentiel est ailleurs, vers les frais fixes, qui ne diminueront pas. D’ailleurs, sous le rapport artistique, Lissner a plutôt réussi, en dehors des inévitables échecs ou choix erronés qui ont cristallisé les oppositions.
Sur l’artistique, au moins du point de vue du lyrique, la plupart des candidats savent faire, ils ont l’expérience : c’est une question de dosage et de goût. La question n’est pas la programmation : quel que soit le candidat, il faudra remplir les 2700 places de Bastille et les 2000 places de Garnier, et les recettes de remplissage ne sont pas nombreuses : des titres alléchants qui puissent compenser quelques titres moins populaires obligatoires et les inévitables créations, quelques stars, quelques scandales (toujours utiles pour le buzz), et des chefs corrects à très corrects ainsi qu’un directeur musical respecté. C’est le job de tout directeur d’opéra, à Paris, Rome, Stuttgart ou ailleurs.
Mais Paris a des particularités :
L’enjeu est d’abord de tenir la maison, d’avoir un poids suffisant face aux défis qu’elle pose assez clairs à identifier :
- Sous n’importe quel manager, cette maison coûtera cher, même avec des conventions collectives révisées. L’idée de faire des économies à l’Opéra est un leurre, il faudrait une fois pour toutes arrêter cette polémique idiote. L’antienne du coût exorbitant est l’argument répété de toutes les campagnes contre les managers de l’Opéra de Paris, comme si on pouvait y faire des économies; la répétition de l’argument depuis des dizaines d’années marque sa vanité. La vraie question , c’est que la dépense puisse se justifier aux yeux de la collectivité nationale, c’est à dire qu’elle puisse bénéficier à l’ensemble des contribuables en termes d’accessibilité, de diffusion, d’éducation. Quand l’Opéra était le jardin du Prince, il bénéficiait tout au plus à sa cour et à ceux qui détenaient le pouvoir économique, d’où d’ailleurs les formes alternatives qu’on a inventé pour le public plus populaire comme la foire ou l’Opéra-Comique. L’Opéra est aujourd’hui un jardin national, à défaut d’être un jardin ouvrier…
Mais l’opéra est aussi un art complexe, qui nécessite une foule de métiers, et donc cher. Il faut peut-être contenir les dépenses, mais cela ne suffit pas, et augmenter les sources de recette ne suffit pas, même en les diversifiant entre billetterie, sponsors, produits dérivés ainsi que produits TV et cinéma en streaming encore timides à Paris, alors que les maisons européennes rivalisent en retransmissions en streaming – voir Munich et Berlin-, directs radio ou TV…. - Il reste aussi à avoir une politique tarifaire lisible, ce qui n’est plus le cas depuis des années, qui puisse diversifier l’accessibilité. Du côté de la billetterie, l’augmentation des prix, en une période ou la question du pouvoir d’achat est si sensible a fait long feu et aussi bien Paris que d’autres théâtres (la Scala notamment) en font les frais. Je pense qu’il faut revoir profondément le système de billetterie.
- En plus de ces questions de gestion, il semble aussi qu’il faille donner au manager de cette maison géante aux personnels très qualifiés et très spécialisés, un regard plus sensible à la question des ressources humaines qui ne semble pas être très centrale, du moins à ce qui peut en filtrer. Car les personnels eux-mêmes, à l’ « esprit maison » très développé, restent discrets à ce propos.
- Il faut revoir la question de « l’Académie », dont le concept qui a si bien réussi à Aix n’a pas eu les résultats escomptés à Paris, alors que le « Studio » avait précédemment assez bien marché…et du même coup aussi poser la question d’une troupe éventuelle, pas seulement d’ailleurs composée de jeunes..
- Enfin il faut régler la question du ballet, une institution de très haut niveau et de tradition séculaire qui semble artistiquement piétiner, très (trop) endogène et très marquée par les hiérarchies très enracinées du corps du ballet. Millepied s’y est heurté et a été vaincu : pourtant l’appeler n’était pas une mauvaise idée. Aurélie Dupont ne semble pas vraiment y réussir pour d’autres raisons, et la question du répertoire et surtout de la défense du répertoire classique se pose dans une maison dont il est l’armature sur laquelle s’est construite sa réputation et sa maîtrise technique: combien de grands ballets classiques dans la programmation actuelle ? trois ? quatre ? Même pas: le seul Lac des Cygnes marque le répertoire de grande tradition cette saison C’est à pleurer…
Les origines du projet Bastille
Pour comprendre les questions qui se posent, il faudrait revenir sur l’excellent rapport Gall de 1994, qui pose les défis au plan technique et au plan du nombre de représentations (plus de 550 entre Garnier et Bastille) et il faut aussi revenir aux origines du projet : un théâtre « populaire » pour l’Opéra-Bastille, fondé sur le répertoire.C’est Michael Dittmann, venu du système allemand, collaborateur de Rolf Liebermann à Paris et attaché ensuite à la mission de préfiguration de Bastille (direction Jean-Pierre Angrémy) qui a pensé le système par référence au système de répertoire à l’allemande fondé sur l’existence d’une troupe de base avec quelques artistes invités. Toute l’architecture technique du théâtre est fondée sur la nécessité d’une alternance serrée. C’est pour le système de répertoire que l’Opéra-Bastille a été construit, et pas pour le système stagione: il y a deux scènes prévues à l’origine à Bastille (grande salle et salle modulable) et une scène de répétitions avec fosse d’orchestre (côté jardin de la scène de Bastille) jamais utilisée je crois. Il faut donc utiliser à fond l’outil de production.
Avec une école de chant française assez fournie et de qualité aujourd’hui, il ne serait pas absurde d’y penser une troupe : certains jeunes chanteurs français pour se faire les dents ont été (Julie Fuchs à Zurich) ou sont en troupe (Elsa Benoit à Munich), alors pourquoi pas à Paris ?
Garnier dévolu au ballet était l’idée d’origine, et Garnier est aussi devenu par sa moindre capacité (2000 places quand même, soit la Scala, Covent Garden, la Deutsche Oper de Berlin, Vienne, ou Munich), le théâtre lyrique pour les œuvres baroques ou de plus petit format à cause de l’absence de la « salle modulable » qui était a priori dédiée à ce répertoire et au contemporain, espace laissé en friche à l’intérieur de Bastille dont Lissner a annoncé la reprise des travaux pour une ouverture au début des années 2020).
En fait Garnier (c’est déjà le cas d’ailleurs) pourrait être dédié à la danse et à ces opéras peu ou moins représentés ne nécessitant pas de reprises fréquentes : un système stagione « spécial Garnier » en quelque sorte. Il serait d’ailleurs stupide de fermer Garnier au lyrique pour toutes sortes de raisons, historiques, artistiques, touristiques…
En l’occurrence, et on s’en rend bien compte, l’Opéra de Paris est un outil monstrueux: à l’horizon 2022, trois scènes à entretenir, trois salles, 2700 (Bastille), 2000 (Garnier) et 1000 (Salle modulable, si elle est vraiment construite), cela veut dire à mon avis la nécessité d’une troupe pour Bastille, la nécessité d’un ballet à la programmation séduisante et diversifiée, distribuée sur Bastille pour les « grands standards », et sur Garnier pour le reste, et la salle modulable pour les formes plus petites et l’expérimental, le théâtre musical etc…Mais avec deux conditions sine qua non : que le public vienne, à des prix raisonnables et que se mette en place une recherche fine de diversification des publics.
Le succès de la Philharmonie en est la preuve : le public vient si une politique tarifaire intelligente est appliquée et si la programmation montre son ouverture la plus large.
Les candidats à notre première scène nationale auront sans doute à cœur de résoudre tous ces problèmes, qui ne manqueront pas de provoquer négociations et discussions ponctuées des inévitables grèves.
Enfin, last but not least, la question du directeur musical.
Philippe Jordan a été la très bonne idée de Nicolas Joel : il a choisi un chef qui est arrivé avec un nom déjà internationalement connu avec un profil de répertoire allemand, devenu un chef très aimé à Paris au répertoire suffisamment large pour devenir maintenant le directeur musical de Vienne à partir de 2020. Y-a-t-il aujourd’hui un chef de ce type, quadra si possible, pour lui succéder ? Ou bien faut-il un nom encore plus assis, comme par exemple Antonio Pappano, même si l’on vient d’apprendre qu’il est prolongé jusqu’en 2023 à Londres. (Il pourrait enchaîner avec Paris ensuite car on sait qu’il cherchait à partir du ROH) , lui dont le répertoire est très large, pour frapper encore un plus grand coup ? Ou bien faut-il vraiment un directeur musical ? Autant de questions qui n’ont cessé de se poser depuis des dizaines d’années, sans jamais de réponse définitive et qui dépendent des réseaux du directeur général choisi..
Une politique artistique plus cohérente
Même si face aux défis d’organisation que pose le futur, la politique artistique est moins prioritaire dans une maison qui a dans son répertoire un grand nombre d’œuvres depuis son ouverture en 1990 et qui peut vivre sur son acquis, en limitant les nouvelles productions au strict nécessaire, il reste naturel de l’évoquer.
Lissner a laissé Jordan en place, car en intuitif qu’il est, il a compris qu’il n’aurait pas mieux que ce « right man on the right place ». Il a ramené des stars sur la scène parisienne, et c’est évidemment nécessaire, il a aussi proposé des productions toujours alléchantes sur le papier, pas toujours cependant au vu du résultat, enfin poussé par la tendance du jour, il a continué d’opérer le retour d’un répertoire maison initié par son prédécesseur, voire par Mortier (Werther, Louise) mais de ces titres revenus (de Mireille au Roi Arthus, de Faust aux Huguenots, des Troyens à Benvenuto Cellini) combien de productions convaincantes, et surtout combien de reprises?
Il y a eu aussi de mauvaises idées : une Bohème par Claus Guth qui , indépendamment de la qualité intrinsèque de la production, n’est pas tenable pour un tel standard dont la plupart des productions durent au bas mot une vingtaine d’années, un Don Carlos scéniquement problématique, des Huguenots fades, mais moins ratés que Don Carlos, une Damnation de Faust justement damnée et d’autres.
Et malgré tout, il continue cependant de manquer à cette maison des pans notables de répertoire : le répertoire français maison (les autres Meyerbeer, d’autres Gounod, d’autres Massenet par exemple qui seraient idéaux à Garnier), le répertoire vériste, très grand absent, le grand répertoire romantique (bel canto), peu de Bellini, peu de Donizetti, et peu de Rossini (non seulement les opéras écrits pour Paris, mais aussi les « opéras serias »), sans parler de grands classiques du XXème comme Die Soldaten, voire des Zemlinsky (seul Der Zwerg est au répertoire) ou des Schreker. Rendons grâce à Nicolas Joel d’avoir proposé Die tote Stadt de Korngold et Mathis der Maler de Hindemith et à Mortier d’avoir monté son Cardillac. Mais combien de reprises depuis ? Et que dire de Dialogues des Carmélites, ou Saint François d’Assise, absents de la scène de l’Opéra depuis 2004… ?
Pris entre le système stagione (répétitions et séries de représentations longues) et le système de répertoire (répétitions brèves limitées à une mise en place) et sans troupe, l’Opéra ne peut afficher certains titres pour trois représentations, comme le fait Munich, s’assurant ainsi d’un remplissage satisfaisant. Et donc il s’abstient de reprendre des titres dont il connaît à l’avance le taux de remplissage critique sur six ou sept représentations.
Il y a là toute une ligne de programmation à revoir, car en l’état, il y a de quoi proposer de nombreux titres, mais repenser les nouvelles productions non en fonction des envies ou du buzz, mais en fonction du sens. Prenons l’exemple des Troyens : certes c’est excitant de proposer Tcherniakov comme metteur en scène, et ça fera parler, mais une reprise des Troyens de Wernicke (en 2006, sous l’ère Mortier, reprise de Salzbourg) qui sans être une production définitive, avait une vraie légitimité, pouvait être envisagée. Et on pouvait par ailleurs appeler Tcherniakov pour Die Gezeichneten par exemple, qui attendent une création parisienne…
Mais la question du répertoire n’a de sens que si les productions sont reprises: la garantie de leur reprise, je le répète, consiste, pour Bastille au moins, en un système de troupe. L’art de Liebermann, à l’intérieur d’un système stagione d’ailleurs, consistait en des reprises régulières des productions avec des distributions renouvelées, alléchantes, quelquefois supérieures à la Première. Bastille qui a un fond de productions infiniment supérieur ne s’y essaie pas vraiment.
Je soutiens donc que dans la situation actuelle, qui n’est quand même pas si tragique (même si les questions du ballet et de RH se posent sérieusement), il vaudrait mieux quelqu’un qui n’ait plus rien à perdre à la tête de cette maison, pour travailler sur ce qui fait un peu mal et ne se voit pas, quitte à laisser un peu de côté ce qui se voit, tout en garantissant une production artistique de bon niveau, ce qui n’est pas si difficile au vu des productions existantes de la maison et du marché du chant lyrique actuel.
La tendance d’aujourd’hui est de penser que le présent est éternel, et que le buzz d’une production remplace une politique: on évite de penser long terme, on évite de penser traces. Or la direction d’un opéra consiste à la fois à créer à l’intérieur de la maison un « esprit » derrière une programmation (voir Kosky à la Komische Oper de Berlin), à mettre en place des organisations satisfaisantes pour tous, mais aussi à considérer la maison dans sa perspective historique, dans son patrimoine matériel et immatériel.
Qu’importe le nom du futur directeur général : il suffit qu’il ait la mémoire longue et sache valoriser tous les patrimoines de cette maison, y compris le patrimoine immense et la mémoire que constituent tous ses personnels, une richesse qui compense très largement les coûts supposés de leur travail . Jamais on ne pensera juste en pensant « économie » à l’opéra (les deux termes sont antagonistes), à condition néanmoins que la dépense conduise quelquefois au sublime.