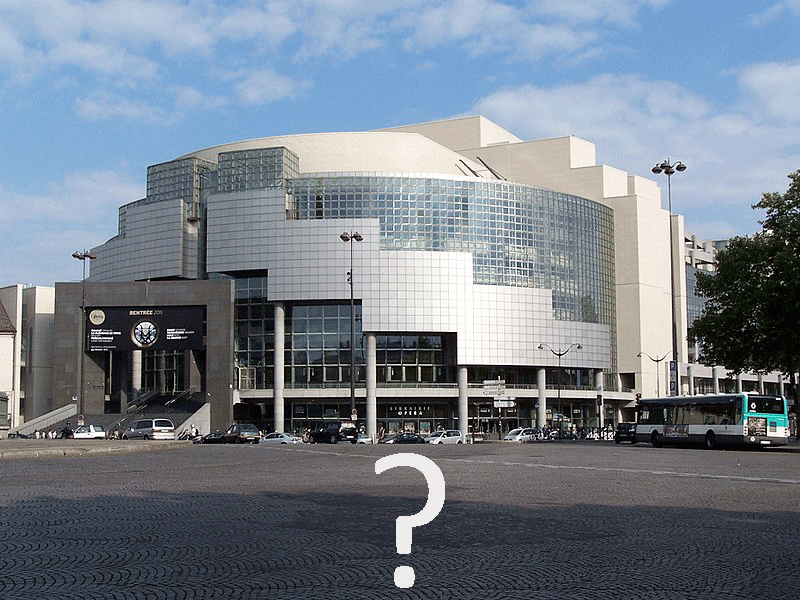L’opéra et nous, nous et l’opéra
Le problème de l’Opéra semble être un peu cryptique pour les auteurs du rapport. Dur à admettre, mais c’est un art exclusivement européen, qui s’est développé en Europe puis étendu au nouveau monde, devenu même un art porte-drapeau d’une « identité nationale » naissante à partir du milieu du XIXe en Hongrie, en Russie, en Bohème et en Moravie, et c’est sans doute le seul art qui soit spécifiquement occidental. Ce n’est pas le cas du théâtre, ni de la danse, ni du cirque ni de la peinture, sculpture, cinéma etc… .
Sans doute faudrait-il d’ailleurs s’interroger sur la symbolique de la construction d’opéras-monuments en Asie et surtout en Chine aujourd’hui, voire au Moyen Orient (et pas seulement au Caire en 1871…). C’est sans doute un acte plus symbolique que culturel (qu’est-ce que le « genre opéra » a à y voir spécifiquement puisqu’on sait qu’il existe en Chine des spectacles musicaux que nous appelons par commodité « opéra » ?). Ce sont des gestes architecturaux toujours spectaculaires d’affirmation du pouvoir souverain plus que du genre artistique en lui-même.
Le genre-opéra véhicule l’histoire, la culture, la littérature, la musique qui constituent le fonds originel de notre culture européenne et sa rapide exportation aux États-Unis et en Amérique du Sud pointe l’Opéra un marqueur de la culture occidentale. Est-ce en soi un crime, une marque au fer rouge ?
Que peu à peu l’opéra se soit ouvert aux artistes non blancs, c’est absolument légitime dans la mesure où tout artiste selon ses capacités peut prétendre à chanter l’opéra s’il en a envie. Sait-on qu’une chanteuse noire a failli chanter à Bayreuth une des Walkyries dès la fin du XIXe (elle y fut empêchée par un problème de santé mais elle était reçue à Wahnfried) ?
Il est vrai que cet art typiquement européen fait par des européens pour des européens, a eu du mal à s’ouvrir à des non-européens (encore que) avant la seconde guerre mondiale, mais tout comme à l’inverse le jazz a été tardivement « investi » par des musiciens blancs. En allant encore plus loin on peut aussi se demander s’il existe aujourd’hui des acteurs non asiatiques dans le Kabuki ou le Nô japonais ?
La question se pose comme si seuls les européens étaient comptables de leur culture et de leur histoire.
Les processus de transformation des rituels et des habitudes sont lents, et cela n’a pas toujours à voir avec le refus de l’Autre mais avec la moisissure de l’habitude qu’on prend pour règle intangible : quand on pense que la « libération » de la femme explose dans les années 1970, mais qu’on en est encore 50 ans après en France à réclamer l’égalité hommes-femmes, notamment dans les salaires, on peut aisément constater que les habitudes culturelles suivent un cheminement tout aussi long. C’est regrettable, mais on sait bien que les processus sociaux et les mentalités sont les freins les plus puissants. N’est-ce pas plutôt le culte de l’instant et du présent qui prétendrait d’un coup de baguette magique effacer le réel, histoire comprise.
Ensuite, que les leçons et les diktats (comment appeler autrement les injonctions sur les traductions d’Amanda Gorman par exemple ?) viennent de l’influence américaine est enfin assez singulier, et que nous nous y soumettions comme à une parole venue d’En-Haut par crainte d’on ne sait quelles conséquences est encore plus désolant. Car les leçons d’humanisme à l’américaine ont fait long feu…
L’opéra est, dit le rapport « un genre en partie lié à la production de savoirs et de croyances sur les mondes extra-européens, en lien étroit avec leur colonisation ». Certes, notre sensibilité à la question de la diversité est aussi l’effet boomerang de la colonisation française en Afrique, en Asie, aux Antilles. Mais les solutions préconisées sont en trompe l’œil.
La prospective lyrique : l’opéra « ouvert » de demain
Pour répondre à ces considérations « identitaires » sur l’Opéra trop blanc, le rapport se lance ensuite dans la prospective lyrique, enfonçant des portes ouvertes que tous les observateurs du monde de l’opéra connaissent depuis longtemps, en proposant des pistes étonnantes.
Les auteurs proposent notamment, pour compléter le répertoire traditionnel et discriminant, de s’ouvrir à la création… « Aida ou Otello mis en regard de nouveaux opéras pour que vive le patrimoine, et qu’il soit rendu par cette attention à la diversité du monde accessible au plus grand nombre ».
Passons sur le fait qu’Aida est l’opéra le plus populaire présenté dans les salles les plus grandes et dans les stades et qui attire le plus de foules dans le monde entier, cela fait sourire… Les auteurs poursuivent en rêvant l’opéra du futur, « favorisant, à moyen terme, les commandes et invitations aux artistes internationaux pour diversifier les plateaux, mais aussi pour que les thèmes abordés par les œuvres reflètent les préoccupations de la société » …
Si je suis convaincu qu’il faille faire appel à tous les talents, en dehors de toute considération pigmentaire, je ne suis pas sûr que les œuvres les plus populaires soient celles qui reflètent les préoccupations du jour.
On ne va pas forcément au théâtre pour voir sa vie au quotidien, et la fortune du répertoire et des Bayadère diverses montre que le spectacle est aussi sinon plus la recherche d’un ailleurs.
Dans un autre ordre d’idées, mon expérience d’enseignant (vers 1980), m’avait fait constater que les livres de Français destinés aux élèves sections technologiques privilégiaient les ouvrages sur la condition des travailleurs et des ouvriers (comme Elise ou la vraie vie de Claire Etcherelli), au détriment de la qualité et de la variété, au contraire des manuels pour les sections « générales » à l’ouverture littéraire bien plus grande. Est-ce cela dont on rêve pour l’opéra ?
« L’opéra a tout à gagner à se nourrir du monde et à s’ouvrir à des cultures non occidentales, métissées » prophétise encore Clément Cogitore.
Les sujets à choisir doivent être d’abord bien ficelés dramaturgiquement, ce qui manque cruellement aujourd’hui : il y a peu de bons livrets. Mais il faut aussi trouver des compositeurs qui créent des opéras, et ce n’est pas gagné, comme on sait ; à ce titre ce qui s’est passé avec le Musical et la comédie musicale dont les auteurs ne disent pas un mot pourrait être une piste intéressante.
Si le genre offrait régulièrement des créations qui soient des succès, allant, comme la comédie musicale, chercher des sujets dans toute la société on n’aurait aucun problème pour trouver les créateurs.
La preuve ? La danse contemporaine a depuis longtemps fait sauter les verrous de la diversité avec des chorégraphes et artistes de toutes origines. Et l’opéra qui lui en revanche a fait sauter depuis longtemps celui de la couleur de peau des chanteurs.
Le rapport reconnaît que les grands chanteurs non-blancs sont depuis longtemps invités à chanter sur la scène de l’opéra, mais déplore en incise que la jeune Marie-Laure Garnier, originaire de Guyane, récente révélation des Victoires de la musique, n’y ait pas encore été invitée. Encore un exemple de méconnaissance.
Marie-Laure Garnier a une voix magnifique et un grand talent, elle chantera à Paris, n’en doutons pas, mais elle est à l’orée de sa carrière, et dans le cursus honorum du chanteur quel qu’il soit, les débutants font leurs classes dans des théâtres moins importants, dans des salles plus petites où ils se rôdent. Ce serait une erreur de les projeter à l’Opéra National de Paris au risque de les brûler, et de les faire passer alors pour l’artiste de la diversité de service. Ce n’est pas un service à leur rendre en général, et la jeune Marie-Laure Garnier n’est pas invitée à l’opéra parce qu’elle est une chanteuse de couleur ou issue d’une colonie, mais parce qu’elle débute. Il y a une quarantaine d’année, Christiane Eda-Pierre, elle aussi issue des colonies a chanté Antonia, Eurydice, La Comtesse, Konstanze tout simplement parce que c’était une grande. De l’art de voir un caillou dans la chaussure là où il n’y en a pas.
La salle modulable
La deuxième proposition du rapport dénote « Achever la salle modulable de l’Opéra pour permettre des représentations contemporaines plus audacieuses, que ce soit des œuvres nouvelles pour la production desquelles un circuit mécénat ad-hoc devrait être monté ou pour faire revivre des figures oubliées dans le répertoire. A défaut, monter des partenariats avec d’autres scènes pour permettre la représentation d‘œuvres opératiques dans des salles plus petites ».
Placer cette demande en deuxième position de la liste proposée en fin de rapport, c’est lui donner une importance justifiée pour attirer un public plus restreint pour des propositions moins « grand public ». Mais dans un rapport sur la diversité à l’Opéra National de Paris, que vient faire la salle modulable, serpent de mer depuis 30 ans qui semblait s’être débloqué avec la promesse de l’achever dans les années qui viennent ?
Cela pourrait laisser entendre, que les auteurs du rapport croient à moitié à la puissance d’attraction du nouveau répertoire qu’ils appellent de leurs vœux et pensent simplement à une salle plus petite, « d’art et d’essai », pendant qu’à côté, on continuerait de jouer Aida ou Otello.
Diversité ou pas, créateurs métissés ou extra-européens ou non, les managers d’opéra ont depuis longtemps voulu des salles plus petites pour répondre aux exigences des cahiers des charges sans perdre de l’argent dans la grande salle. La Scala faisait souvent ses créations contemporaines au Teatro Lirico voisin… L’opéra d’Amsterdam au « Carré » voisin. L’opéra de Lyon au Théâtre de la Croix Rousse.
On sent bien là un nœud : les œuvres expérimentales ou moins connues à la salle modulable, et les œuvres qui rapportent (et donc, du grand répertoire) dans la grande salle, et ainsi les apparences seront sauves, les cahiers des charges respectés et le système opéra continuera de tourner comme avant.
Cela montre une confiance limitée dans les perspectives que les auteurs du rapport énoncent eux-mêmes, et « surtout si ces œuvres qui demandent aux artistes un investissement important ne sont pas ensuite reprises dans d’autres scènes dans le monde ». Voilà une gestation riche d’avenir… Si on veut imposer le renouvellement du genre, autant assumer le risque de la grande salle.
Alors demander la construction de la salle modulable pour afficher des œuvres proposées par des artistes issus « de la diversité », c’est évidemment afficher une autre discrimination, artistique, qui ne dit pas son nom pour des motifs bêtement économiques. C’est se tirer une balle dans le pied.
Il est à mon avis bien plus intéressant d’attirer quelquefois le public inhabituel par une offre différente, pour qu’il prenne possession des lieux, car la question est plus le lieu « Opéra » que l’art « opéra ». Je me rappelle Paris Quartier d’Eté, offrant en 1992 ou 1993 une soirée de musique kabyle avec la chanteuse Cherifa au Palais Garnier, envahi par un public qui découvrait le lieu, pour une musique qui provoqua un délire dans la salle. Garnier alors appartenait à tous et c’était un vrai bonheur de constater la joie des spectateurs. Il faudrait peut-être commencer par montrer que ces lieux sont ouverts à tous les publics par des manifestations ciblées, marquant peut-être un pas de côté, avec la certitude d’attirer un autre public et de faire évoluer le public traditionnel.
On touche ici à la complexité du problème, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir, notamment si le carburant financier ou créatif manque, mais aussi quand les politiques menées n’ont pas assez pris en considération l’éducation et la diversification du public, gage de curiosités nouvelles… .
La question des publics
La question essentielle n’est pas tant celle de « la diversité » mais celle de la diversité des publics. Le public qui accède à l’opéra pour du ballet ou pour du lyrique doit refléter l’ensemble de la société. Ce qui n’est pas le cas. Et c’est pourtant la condition « pour que les thèmes abordés par les œuvres reflètent les préoccupations de la société ».
La diversité sociale est loin d’être représentée dans la salle, et c’est l’un des éléments que certains pointent pour condamner a priori l’opéra à mort : ses crimes ? coûter très cher et être réservé à une élite sociale qui se retrouve « entre soi ». Autrement dit, l’ensemble de la collectivité qui paie n’en profite pas.
La encore, la question est un serpent de mer, auquel on a cherché à répondre depuis l’élaboration du projet « Opéra-Bastille » conçu d’abord comme Opéra National Populaire. Notre post « La valse des Branquignols » en a longuement parlé et l’on connaît quel destin a eu le concept initial.
La question de l’accessibilité est essentielle si on veut que des « rôles modèles » issus de la diversité puissent irriguer les populations concernées, sinon les « rôles modèles » continueront de chanter pour les « mâles blancs ».
Là encore, la question touche divers niveaux de réflexion, de nombreux pays et pas seulement la France . Je me rappelle de K.Warlikowski découvrant Covent Garden et son public « sélect », qui lui donna en réaction[1] envie de mettre sur scène des artistes de Breakdance des quartiers populaires londoniens.
La plus évidente des réponses, celle qu’on brandit, c’est la politique tarifaire. À l’Opéra de Paris, les tarifs pratiqués empêchent effectivement la diversification sociale du public, et ce public nouveau n’est pas le public de fans qui se contentaient de places debout à bas prix qui n’existent plus. Le public nouveau a droit à une place assise « normale » mais à un prix « politique ».
Pour qu’on puisse pratiquer des prix politiques, c’est vers l’État qu’on doit se tourner pour compenser, mais comme la dite puissance publique a réduit les subventions à l’Opéra au point qu’elle n’atteignent que 40% du budget, ce sont les sponsors privés et la billetterie qui doivent compenser. Sont favorisés alors les billets « hautes contributions » et les sponsors qui ainsi offrent des places à leurs employés ou leurs obligés, tout en bénéficiant de prix politiques au regard du coût rélel du billet. Autrement dit, la politique de l’État, tout en préchant pour la diversité et l’élargissement du public, au nom du fait qu’un art réservé « aux riches » n’a pas à s’engraisser sur la peau du contribuable, induit une poltique aux effets pervers. Politique à courte vue et anticulturelle du serpent qui se mord la queue.
D’un autre côté, si les subventions augmentaient, même fléchées sur des publics nouveaux et divers, les oppositions politiques (qui quand elles étaient au pouvoir, ne faisaient pas mieux) ne manqueraient pas de dénoncer le gouffre financier représenté par l’Opéra, face à d’autres pans de la culture plus nécessiteux (cf. l’analyse édifiante de l’adjointe à la culture de Lyon, voir notre article à ce sujet).
Donc rien à espérer de ce côté.
Cependant la politique tarifaire n’est pas seule en cause : il est loin d’être évident qu’une politique tarifaire ciblée ferait aller à l’opéra un public qui n’y est pas habitué. L’ignorance du genre, les représentations qu’on en a sont autant de freins que des prix politiques ne compenseraient pas. On sait bien qu’il y a toujours un public prêt à dépenser des centaines d’euros dans un match de foot ou concert de rock dont les tarifs n’ont rien à envier à ceux de l’opéra bien au contraire.
Il est évident que des publics dont l’opéra ne fait pas partie de la culture ne s’y intéressent pas. C’est tout le problème de la musique classique en général, qui coûte bien moins que l’opéra.
Il ne sert de rien de se désoler du manque de diversité à l’orchestre, au ballet ou dans le chœur si la politique culturelle de l’État n’a pas depuis des dizaines d’années (depuis le plan Landowski à la fin des années 1960), fait un réel effort envers la musique classique, par manque de conviction ou d’ambition, et surtout par manque de constance dans la durée même si paraît-il les conservatoires sont pleins…
Les constats faits par Bourdieu sur la distinction d’une part et la reproduction sociale d‘autre part n’ont bien évidemment rien perdu de leur actualité.
De son côté, l’Education Nationale de Jean-Michel Blanquer affiche à nouveau et pour la nième fois une volonté de développer les arts et la culture, mais du côté de la musique classique, les initiatives restent sporadiques, laissées à l’initiative locale, quelquefois magnifiques, comme le travail du quatuor Béla dans les collèges, mais cela reste assez rare. La musique classique et encore plus l’opéra sont totalement mis sous cloche, tout autant que la danse académique et le ballet classique à l’école, d’une manière souvent revendiquée par les enseignants eux-mêmes (Ghetto… C’est du passé… C’est trop complexe… Ils n’iront jamais… Toutes remarques entendues sur le terrain).
DEMOS et le Sistema vénézuélien
Enfin le rapport parle de DEMOS, une initiative de la Phiharmonie de Paris fondée sur le modèle du Sistema vénézuélien, qui a fait rêver à un avenir radieux pour la musique classique bien des pays ou régions européennes, bien des institutions et bien des mélomanes.
Le Sistema vénézuélien a été mis en place pour porter la musique dans les classes les plus défavorisées, dans les bidonvilles, en rayonnant dans tout le pays pour lutter contre les fléaux des quartiers pauvres, drogue et délinquance essentiellement. Le tout avec une logistique efficace de mise à disposition d’instruments que les familles ne pouvaient payer (avec un engagement fort de la puissance publique, et avant Chavez, il faut le souligner), grâce à une pédagogie active de type « apprendre dans l’orchestre », d’origine nord-américaine assez élaborée et très séduisante – loin des pédagogies en cours dans nos conservatoires (qui portent bien leur nom), ainsi qu’une distribution territoriale de centaines d’orchestres décentralisés de jeunes ou d’enfants avec un effet sensible assez rapide sur la délinquance des jeunes, ainsi que sur l’estime de soi des familles qui est tout aussi essentielle.
Le système (qui a transcendé les aléas politiques du pays) arrivait par capillarité dans les territoires reculés, mais a mis en place une structure pyramidale d’orchestres qui était couronnée d’orchestres nationaux d’une telle qualité que bien des musiciens venus du Venezuela irriguent aujourd’hui les formations du monde entier, sans parler des chefs, dont le plus connu, Gustavo Dudamel, m’avait raconté que ce qui l’avait frappé au début de sa carrière, c’était l’âge du public en Europe ou aux USA, alors que les jeunes venaient par cars entiers assister aux concerts des grands orchestres vénézuéliens.
Alors soyons clairs : DEMOS ? Combien de divisions ? 6400 enfants bénéficiaires en dix ans en France. Les tentatives similaires ailleurs et notamment en Europe n’ont pas encore vraiment réussi à l’échelle vénézuélienne. Cela s’explique aisément parce qu’elles peuvent concurrencer des organisations déjà installées (conservatoires ou écoles de musique etc…) qui labourent leur clientèle habituelle sans trop aller au-delà et qui craignent d’être détrônées : les conservatoires et écoles de musique répondent à leur public traditionnel. Ce qui a marché au Vénézuela, c’est que tout était à inventer et que ce Sistema ne heurtait pas des institutions établies.
Si la Philharmonie prétend piloter toutes les initiatives, avant d’arriver à un maillage territorial total, le pont Mirabeau aura vu couler bien de l’eau de la Seine… Et que faire des conservatoires et écoles de musique ? Comment combiner les systèmes, comment même considérer les deux publics d’élèves? Autant de questions qui sont autant d’obstacles.
Faisons un rapide calcul. Il y a 25 millions de vénézuéliens et le Sistema au plus fort atteignait environ 500000 jeunes (en 2017, 2 millions d’enfants bénéficiaient d’une éducation musicale gratuite) engagés dans des orchestres. A l’échelle française, 65 millions d’habitants, cela ferait près de deux millions de jeunes engagés dans un orchestre. Avec 6400 jeunes engagés en France… on rêve !
Il y a donc hélas loin de la coupe aux lèvres et la logistique du projet engloutirait des sommes folles pour dynamiser le système. DEMOS est un excellent projet qui fait plus parler qu’il n’irrigue. A ce niveau, c’est évidemment à la fois de décisions politiques, d’une déconcentration du système et d’engagements locaux pour financer les instruments, les enseignants, les lieux de pratique des orchestres que dépend tout le système.
Cela suppose une décision politique au plus haut niveau ou un sponsoring énorme et idéaliste (ce qui est plutôt un oxymore); cela suppose un plan réel et collectif de promotion de la musique classique pour en faire un élément partagé et non confisqué, au-delà de toute considération de diversité, parce que la question n’est pas seulement d’attirer à l’opéra ou au concert les jeunes « issus de la diversité », mais tous les jeunes « éloignés » quels qu’ils soient.
Comme les politiques ont privilégié clairement en France non la musique ou la culture, mais le sport qui rapporte plus en termes économiques (mais pas forcément en termes de valeurs morales) et qu’il a fallu 40 ans de palabres avant de décider de construire à Paris un auditorium digne de ce nom alors qu’en 40 ans la carte des stades et équipements sportifs s’est nettement étoffée, il est inutile de gloser. Un DRAC particulièrement engagé dans les politiques d’irrigation culturelle, Jean-François Marguerin, disait naguère à qui voulait l’entendre. « On construit des piscines, on construit des stades, on équipe les collèges ou les lycées de gymnases, mais où sont les salles, les gymnases, les piscines de l’éducation culturelle et artistique ? »
La musique classique, dont l’accessibilité suppose des déplacements dans les capitales régionales, et une logistique souvent coûteuse et mobilisatrice d’énergie, parce que les ensembles musicaux n’irriguent pas souvent les territoires plus éloignés sauf rares initiatives associatives locales, est évidemment victime d’une situation qui fait qu’elle est réservée de fait aux villes-centre. Souvenons nous au moment de la construction de la Philharmonie de Paris de ceux qui défendaient la salle Pleyel et prédisaient qu’aux confins de Pantin terra incognita, la Philharmonie était d’avance condamnée. Le résultat ? La Philharmonie par sa politique de prix, par la diversité de son offre, est non seulement une réussite, mais elle a prouvé qu’elle répondait à un vrai besoin. Cependant, elle ne peut porter seule une politique nationale. N’est pas Zorro qui veut.
Il ne suffit pas d’incantations pour attirer un public divers au concert ou en l’occurrence à l’opéra, bien que ce public soit particulièrement disponible, et, lorsqu’il est confronté à l’art lyrique, souvent séduit et surpris de l’être. Par ailleurs les établissements scolaires ne manquent pas de jeunes qui jouent de la musique, qui sont dans des groupes, mais mobilise-t-on ces compétences souvent souterraines pour amener simplement à goûter un jour, pour voir, de la musique classique ?
La question de la diversité du public de l’opéra ne dépend donc pas de l’Opéra lui même qui seul, ne peut rien faire sinon à un niveau très atomisé. Combien d’enfants d’écoles ou de collèges vise une opération, non seulement excellente, mais historique (depuis 1991) comme « Dix mois d’école et d’opéra » que Roselyne Bachelot vantait sur Twitter récemment ?
Une vraie politique vers ces publics éloignés socialement et aussi souvent géographiquement implique une logistique coûteuse en animateurs, en personnel, en communication (ciblée) et ce que je disais plus haut, des prix « politiques » dans la salle ou un accès systématique aux générales, mais surtout une stratégie à long terme et approfondie qui ne soit ni une politique de vitrine (ou une vitrine de politiques…), ni les incantations ressassées d’un rapport.
Ce qu’on disait du public de l’opéra il y a cinquante ans, on continue à le dire : cela suffit pour montrer les effets des politiques vers les publics éloignés. D’ailleurs , vu le résultat, poser la question, c’est y répondre.
Ainsi la question de la diversité chez les artistes de l’opéra, mais aussi dans son public est moins liée à l’Opéra de Paris en tant que tel qu’aux politiques menées, aux financeurs publics ou privés, mais aussi aux traditions culturelles, aux représentations qu’on a de certains arts. C’est dire là aussi une complexité que les auteurs du rapport n’effleurent même pas.
Conclusions
Au terme de ce très long parcours à travers le rapport sur la diversité à l’Opéra de Paris, il apparaît que les auteurs ont fait leur miel de tendances d’aujourd’hui à fractionner la société en autant d’individus dont il faudrait respecter « l’identité ». Même si personne ne nie les exactions, massacres, destructions, persécutions dont certaines minorités (ou majorités dans le cas du colonialisme) ont été l’objet, on procède à une victimisation systématique, y compris là où elle n’a pas lieu d’être et notamment en instituant un rapport à l’histoire dévié, des dispositions quelquefois absurdes qu’on croit susceptibles d’effacer les taches originelles.
La question est aussi dépendante des modes du jour où l’on braille la notion d’identité à tout va alors que personne, notamment dans le personnel politique et les faux intellectuels qui la portent en drapeau, n’est capable de définir ce qui la constitue, ni même d’ailleurs sa propre identité.
La meilleure preuve est que paraissent depuis Braudel (qui n’a d’ailleurs pas terminé son livre) régulièrement des ouvrages sur « l’identité française », qui ne donnent ni les uns ni les autres de réponse définitive puisqu’on se sent le devoir d’en réécrire. C’est surtout aussi une niche de marché exploitable et exploitée par les margoulins de la pensée assez nombreux en ce moment…
Comme dit Elisabeth Roudinesco, « je suis je » et je m’arrête là. Clairement, je n’en ai rien à faire de l’identité de qui que ce soit, à commencer par la mienne.
Affirmer ou revendiquer son identité, j’ai bien peur que ce ne soit qu’une manière déviée de la définir par ses différences avec autrui, qui commence dès son palier. Si le monde n’est fait que de ces Autres différents, c’est bien vite la guerre ou le massacre. On a connu ça de manière industrielle et systématique il y a moins d’un siècle, merci. C’est largement suffisant pour mépriser les thuriféraires de l’identité et craindre leur folie.
Les comportements d’étiquetage ont abouti par le passé à nier l’humanité à des esclaves, à des juifs, à des tziganes, à des peuples colonisés (comme par hasard souvent les victimes des camps nazis…) : il n’est peut-être pas très judicieux de retourner à ce monde-là.
Jean-Claude Carrière mort très récemment, avait écrit un livre qu’on a beaucoup lu – heureusement- dans les écoles « La controverse de Valladolid » qui traitait de la question fondamentale de savoir si les peuples conquis en Amérique du Sud avaient une âme : selon la réponse, c’est toute une construction (géo)politique qu’il fallait revoir. Et curieusement, dans le concert de louanges post-mortem, ce livre n’a pas été beaucoup cité…
Ainsi ce rapport à divers points de vue s’avère superficiel et plus proche du vœu pieux, voire de la conversation de salon bien-pensante (avec un zeste de perversion) que de propositions vraiment constructives. Il se serait strictement limité à des réponses précises et pragmatiques sur les recrutements et sur le fonctionnement de l’Opéra, il eût sans doute gagné en crédibilité.
Il serait resté un outil de pilotage interne pour le Directeur Général, sans diffusion large parce qu’il ne fait pas le poids ; c’est d’ailleurs étonnant s’agissant d’auteurs de ce niveau. Il sert mal les causes qu’il prétend défendre parce qu’une fois qu’on aura réglé son compte à Aida, Butterfly, La Bayadère, Turandot, Otello, Petrouchka, Raimonda, le ballet blanc, le problème restera entier, pour ce qui est des discriminations dans le monde d’aujourd’hui, de la tentation communautariste de style anglo-saxon dans la société, de l’accessibilité du public le plus large à l’opéra, de l’éducation culturelle des jeunes, et notamment des moins favorisés.
Que l’on nous invite plutôt à respirer, à accueillir, ouvrir, et pas à nous étouffer un peu plus dans le carcan des idées reçues, du conformisme et de la peur de l’Autre. Ce rapport emprunte un mauvais chemin tout simplement parce qu’il propose des solutions peut-être possibles aux questions posées par les danseurs de l’opéra dans leur manifeste, mais à l’ombre d’analyses médiocres qui consistent à suggérer sans dire et à citer sans penser ni vérifier.
Il faut combattre sans hésiter l’opéra comme vecteur de la distinction mais s’en prendre pour ce faire au genre artistique, c’est une idiotie sauf à vouloir lui régler son compte au nom de la fameuse cancel-culture, pur exemple de la bêtise humaine.
Lire le rapport:
Rapport_sur_la_diversité_à_l_Opéra_de_Paris
[1] NdR pour De la Maison des morts