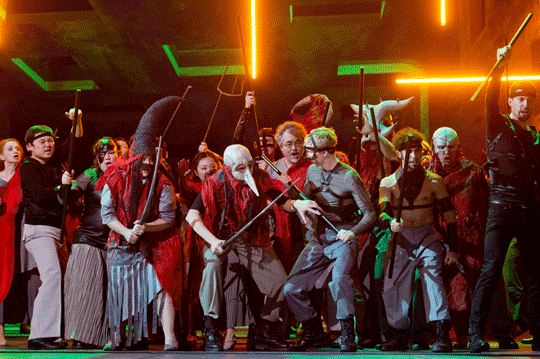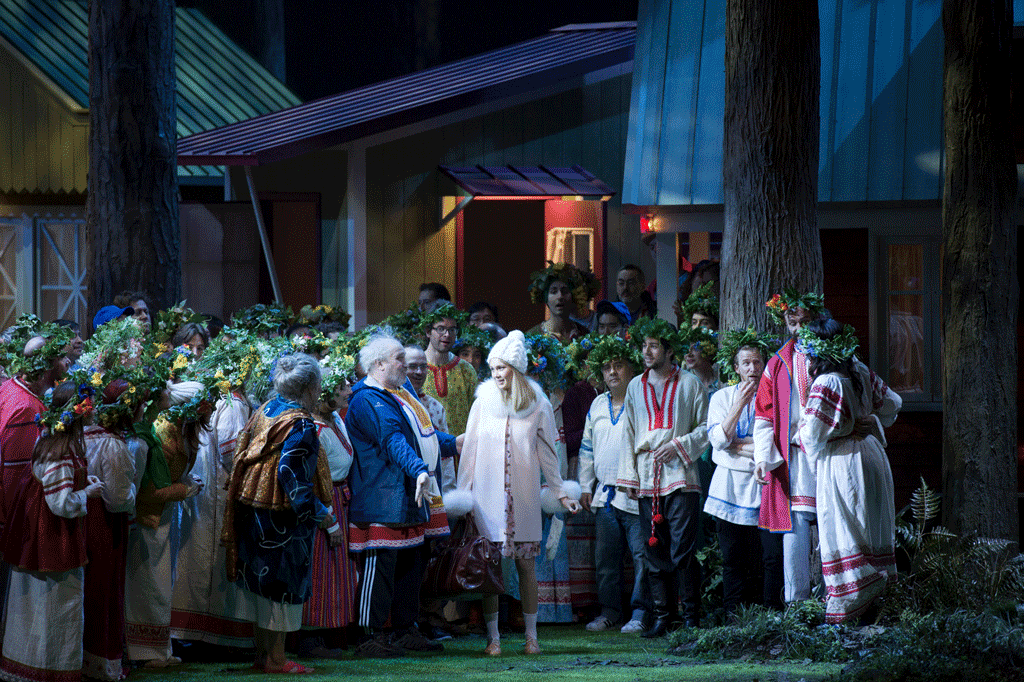
Dans la vaste programmation parisienne, qui n’arrive pas toujours à me passionner, j’avais repéré cette production de La Fille de Neige, un opéra que je n’avais jamais vu sur scène, comme beaucoup, et qui m’a aussi attiré à cause d’une distribution de très haut niveau, et de la mise en scène de Dimitri Tcherniakov : bien m’en a pris.
Le conte de fées amer qu’est la Fille de neige, d’après Ostrowski, est l’histoire d’une jeune fille née des amours de Dame Printemps et du Père Gel, et qui doit être protégée du soleil qui veut sa perte (ou sa fonte). Le Père Gel quand il doit se retirer à la fin de l’hiver, vient rencontrer la mère, Dame Printemps, pour envisager comment protéger leur fille. Celle-ci est attirée par la communauté des Berendeis, où elle est séduite par le chant d’un berger, Lel, qu’elle veut connaître. Mais vivre chez les hommes, même dans une communauté dont le but est le bonheur humain, n’est pas si facile.
L’histoire est celle d’une initiation à l’univers humain, et au sentiment amoureux, qui va finir tragiquement. Arrivée dans ce monde, la fille de neige (Fleur de neige, dans la traduction d’André Markowicz), par sa stupéfiante beauté, va créer le désordre.
La jeune fille dont les garçons tombent tour à tour amoureux, ne sait répondre à cet amour auquel elle est étrangère : fille de neige, elle est froide et c’est bien ce que lui reproche Lel, le berger à la voix d’or (c’est un contreténor). Protégée par ses parents adoptifs qui la recueillent, elle va se trouver confrontée à un autre couple, celui de la jeune Koupava et son fiancé Mizguir, qui va tomber immédiatement fou d’amour pour Fleur de neige et renoncer illico à Koupava. Voilà toute les données de l’intrigue.
La pièce d’Ostrowski -et le livret qu’en a tiré Rimski Korsakov- est une histoire païenne, de forces de la nature qui s’opposent, et d’une communauté humaine isolée d’un village, une sorte de communauté idéale et simple, sans conflits ni histoires sinon celles du cycle humain, avec ses amours, ses mariages, et son quotidien.
Cette histoire d’hiver et de Printemps, mais aussi de soleil, c’est évidemment une histoire (originale) qui renvoie au cycle de la nature et aux saisons, très sensibles dans la tradition russe (on songe au Sacre du printemps), mais aussi dans toutes les traditions païennes depuis l’antiquité, profondément animistes.
Le conte amer n’est en fait qu’une traduction des bouleversements subis par la nature dans toutes ses transformations. L’inéluctabilité de ces bouleversements emporte évidemment Fleur de neige, piégée par le réchauffement climatique, parce que fille du gel et du dégel (Dame Printemps), elle a une nature intermédiaire qui ne répond pas aux cycles tels qu’ils sont définis. Elle est autre et elle le paiera.
Cette idée de cycle naturel traverse l’œuvre et implique le moment final. Fleur de neige est forcément isolée et singulière, dans un monde printanier et donc en bouleversement. Belle et froide, Fleur de neige doit le rester, mais au contact des hommes, elle finit par en épouser les passions.
Ainsi le conte d’Ostrowski est-il à la croisée de deux chemins : un chemin mythologique, animiste, cyclique, dont Fleur de neige est le produit intermédiaire et donc forcément en danger, et un chemin humain, qui se traduit par le désir et la passion qui expose la jeune héroïne également. Tant qu’elle ne réussit pas à en épouser les brûlants sentiments, Fleur de neige est protégée, mais dès qu’elle y touche, elle s’y brûle et meurt. Vivre sans passion, ou mourir d’amour, voilà le choix implicite auquel la jeune fille se confronte, et elle choisit la mort, et donc d’une certaine façon, la vie.
Pour traduire cette alternative, Dmitri Tcherniakov propose un travail d’une très grande intelligence, une lecture a plusieurs niveaux, aidé par de magnifiques décors qu’il signe, et les costumes faussement traditionnels d’Elena Zaytseva, mais surtout les merveilleuses lumières diaprées, brumeuses, ombreuses, de Gleb Filshtinski.
D’abord, il situe cette communauté des Berendeis de nos jours, une sorte de communauté sectaire isolée et nomade, nostalgique d’un âge d’or de la tradition, réfugiée au fond des bois (le rideau est ouvert pendant que les spectateurs s’installent : sur scène, c’est nous, hic et nunc).

Le rideau se ferme pour que la musique commence, et la première scène se situe dans une école de danse, dont Dame Printemps est la directrice, qui prépare les oiseaux à envahir l’espace. L’invitation au Printemps, vue sous le rapport de la danse, c’est évidemment pour Tcherniakov une manière implicite d’évoquer la traduction dansée de l’irruption du Printemps, à savoir Le Sacre du Printemps de Stravinski, qui est un des prolongements de cette tradition paysanne de l’arrivée du Printemps vue comme explosion de la nature et des sèves diverses qui la traversent. C’est évidemment l’apothéose de Dionysos. Cet espace clos intemporel où se préparent les diverses explosions de la nature accueille aussi le père Gel, personnage très aimé de la tradition russe (une sorte de Père Noël), vu ici comme une sorte de fonctionnaire un peu triste et gris, qui amène Fleur de neige à sa mère, pour décider simplement de l’avenir de la jeune fille, qui se dissimule derrière une porte, comme pour signifier qu’elle n’a plus sa place auprès de ses parents.
Le stupéfiant décor de forêt où sont installés dans un village éphémère les Berendeis est aussi vu avec une grande intelligence : la forêt, c’est un lieu protégé du soleil, un lieu d’ombre et de lumière diffuses, où la jeune fille est en sécurité. C’est ce lieu qui a toujours été depuis l’antiquité un lieu transitionnel (la forêt druidique des gaulois), entre les hommes et les dieux, lieu de séjour des divinités sylvestres : l’arbre par son élévation monte au ciel, mais aussi plonge ses racines dans les entrailles de la terre, il symbolise ce lien entre les forces invisibles et visibles. Ce lieu est donc lui aussi un lieu de ce dialogue entre esprits et humains, un lieu inquiétant tant exploité par les contes de fées.
Dans ce lieu inquiétant, Tcherniakov place les Berendeis, une communauté rassurante, où l’on trouve des êtres placides, souriants, habillés de manière traditionnelle, mais aussi en costumes contemporains, un faux décor d’opérette, comme fait pour le spectateur traditionaliste qui voit enfin la Russie de ses rêves, mais traversé aussi par les passions et les désirs : très subtilement, Tcherniakov par les costumes identifie les rôles : Lel, le berger, c’est le barde, mais il est aussi comme berger le représentant de l’Arcadie qui est le paradis des anciens, qui s’exerce à la musique, qui comme l’on sait est l’art du paradis. Koupava, c’est avec son costume traditionnel la représentante d’un monde d’une réalité un peu rêvée, mais terrien, c’est la riche paysanne d’opérette qui va entrer en tragédie. Quant à Mizguir, par son costume gris sombre, sans couleur, il se définit comme autre, comme citadin, déjà ailleurs et séparé de la communauté.
Intéressante aussi la manière dont le Tsar Berendeis est proposé : rien d’un tsar, mais plutôt un vieux sage qui regarde la vie paisible du groupe et s’en abstrait, il peint (un portrait de Dame Printemps) et toutes ces affaires de cœur l’ennuient un peu. Mais il sait que les Berendeis sont poursuivis de l’hostilité du Soleil (Iarilo), et cherche à l’apaiser en cherchant la résolution collective (et politique) des problèmes. La présence de Fleur de neige en est la raison inconnue, elle est l’intruse qui provoque le désordre des hommes et la colère des dieux. Le monde ordonné n’aime pas les êtres non définis, intermédiaires, dont la seule présence est facteur de trouble.
Fleur de neige est facteur de trouble parce qu’elle ignore la chaleur du désir, les brûlures de l’amour, et les échauffements du cœur. Elle aimerait les connaître, mais son monde est ailleurs. Lel la délaisse et Mizguir qui en est tombé fou amoureux, a rejeté Koupava, mais n’est pas aimé de retour, il devient l’essence même du Mal aimé.
C’est à cause de l’hostilité du soleil que Berendei le Tsar va marier les couples amoureux, mais Lel va choisir Koupava abandonnée de Mizguir, tandis que Fleur de neige se refuse à Mizguir.
Une situation que Fleur de neige peut de moins en moins supporter au point qu’elle retourne à sa mère Dame Printemps au moment où cette dernière doit fuir l’arrivée de Iarilo le soleil d’été. Elle demande à sa mère de lui procurer le don d’amour.

Dans une scène magnifique où elle court dans la forêt déserte aux arbres qui dansent une sorte de valse désespérée, Fleur de neige va rencontrer Mizguir et lui donner son amour : tout devrait donc finir avec bonheur, mais Fleur de neige offerte à la brûlure de l’amour se met à fondre et meurt en déclarant son amour à Lel : Mizguir part se tuer. Tcherniakov fait alors de la jeune fille une sorte de martyre tant la position de son corps ressemble à une statue baroque de Sainte Cécile (patronne des musiciens…).
Ainsi donc Tcherniakov d’une manière très délicate, propose une sorte de polyptique où se mêlent à la fois les racines paysannes et mythologiques, les passions toutes humaines, mais aussi et très nettement les dérives d’une sorte de vie sectaire, la vision finale du soleil figurée par une roue qui brûle en est l’image évidente, une vie sectaire où la mort de Fleur de neige n’a pas d’importance, au contraire accueillie par une fête et un soulagement. L’élément perturbateur du groupe, celle qui n’est pas comme les autres et son pendant masculin(Mizguir) disparaissent et le monde redevient « comme avant ». Car c’est bien le sens de l’histoire racontée par Tcherniakov : les deux personnages qui cherchaient à se racheter une normalité et un anonymat (Fleur de neige et Mizguir) sont morts, et c’est le prix à payer pour que tout continue pour les autres.
C’est sans contexte un grand spectacle, une des mises en scènes les plus fines de Dmitri Tcherniakov, qui regarde le monde russe qui veut retourner à la tradition ancestrale non sans ironie, parce le prix à payer est l’uniformisation souriante (et terrible), et qui regarde en même temps l’état de nature avec la même crainte : la nature est toute aussi hostile que les hommes à ce qui n’est pas dans l’ordre, comme cet être hybride fait de gel et de printemps. Seule la norme compte, pour que l’ordre naturel, politique et culturel, règne : effrayant.
Musicalement, c’est un enchantement.
D’abord la musique de Rimski-Korsakov, une musique aux couleurs variées, profondément impressionniste, descriptive, très diverse, jamais tonitruante, où l’orchestre de l’Opéra de Paris fait vraiment merveille, dirigé par Mikhail Tatarnikov, évidemment dans son répertoire idiomatique. Cependant sa direction très au point et qui mérite d’être saluée, aurait mérité d’être plus lumineuse, avec un rendu orchestral plus limpide, pour encore mieux apprécier la délicatesse de l’orchestration. Cela reste un peu « conforme », et aurait peut-être gagné à une vision plus audacieuse, à l’image de la mise en scène.
Du côté de la distribution, essentiellement russo-germanique, bien peu de remarques, et aucune vraiment désobligeante. Malgré les changements de dernière minute (notamment Ramon Vargas qui a renoncé, remplacé par un Maxim Paster aux aigus un peu problématiques et à la ligne de chant instable, même si le personnage est très bien campé), le spectacle est l’un des plus homogènes vus ces derniers mois.
Thomas Johannes Mayer est Mizguir, certes il n’est pas slave, mais la diction ne m’est pas apparue si étrangère à la langue russe. Dans la mesure où il incarne un personnage à part, autre, langue russe dans bouche allemande peut se justifier. En tous cas, comme souvent, il a l’intensité, il a l’engagement, il a les accents, et aussi la ligne de chant, et les aigus. Son timbre légèrement opaque fait aussi merveille pour caractériser ce personnage déchiré. J’aime ce chanteur et il ne m’a pas déçu.
Franz Hawlata est Bermiata, le conseiller du Tsar. Particulièrement à l’aise en scène, c’est un straussien exceptionnel (son Sir Morosus !) mais à la voix ternie ces dernières années. C’est un acteur hors pair, d’une grande intelligence mais il est moins à l’aise dans ce rôle, dans les accents et dans la manière d’avoir le texte en bouche avec des aigus problématiques et sans la fluidité à laquelle il nous a accoutumés. Prestation moyenne dirons-nous.
En revanche, magnifiques les deux parents adoptifs de Fleur de neige, le bonhomme Bakoula (Vasily Gorschkov) et la bonne femme (Carole Wilson), particulièrement bien dessinés par la mise en scène, avec de l’humour, de la présence, et de la voix, vraiment intéressants.
Vasily Efymov, l’Esprit des bois, à la voix sonore et à la belle présence, est aussi un élément emblématique de l’excellence du plateau dans les rôles secondaires.
Martina Serafin est Koupava, un rôle inhabituel pour ce soprano plus habitué aux rôles de lirico spinto du répertoire. Elle a l’autorité, elle a la voix au volume qui remplit facilement le vaisseau Bastille, elle a aussi la présence scénique, où Tcherniakov lui donne un rôle duplice par rapport au berger Lel, choisi pour se venger de Mizguir.
Lel, c’est Yurij Minenko, contreténor qui partage avec l’héroïne le plus gros succès de la soirée, qui s’est substitué à Rupert Enticknap initialement annoncé.
La voix est claire, forte, bien projetée, et le chant très bien contrôlé. Une vraie performance, d’autant que le personnage, léger, négligeant, insouciant est parfaitement campé avec son look vaguement hippie chaloupé. Une trouvaille !
Elena Manistina est une Dame Printemps au beau mezzo grave, peut-être un peu tendu dans les aigus, notamment au dernier acte, et marqué par un vibrato un peu excessif mais la personnalité scénique, les attitudes, les accents atténuent ces problèmes, tandis que Vladimir Ognovenko est toujours la basse solide qu’on connaît et sur lequel l’outrage du temps n’a pas d’effet, le court rôle du Père Gel est parfaitement tenu, avec une belle palette de couleurs.
Aida Garifullina, enfin, qui donne un incroyable relief au rôle de Fleur de neige. Elle en a le physique grêle et fragile, elle a la présence, la timidité, la sensibilité, et surtout une incroyable voix, puissante, magnifiquement contrôlée, avec un chant coloré, une interprétation si exceptionnelle qu’on se demande désormais qui d’autre pourrait s’emparer du rôle aujourd’hui. Etonnante et bouleversante, elle remporte un immense succès. Signalons enfin la performance du choeur de l’Opéra dirigé par José Luis Basso, vraiment somptueux ainsi que celle des enfants du choeur d’enfants de l’Opéra et de la Maîtrise des Hauts de Seine.
Une magnifique soirée, qui prouve qu’une œuvre rare, quand elle est défendue de cette manière et avec une mise en scène d’une telle profondeur, remporte le succès qu’elle mérite. À quand à Paris les autres chefs d’œuvres de Rimski-Korsakov, qu’on commence à voir sur les scènes européennes ici et là. [wpsr_facebook]