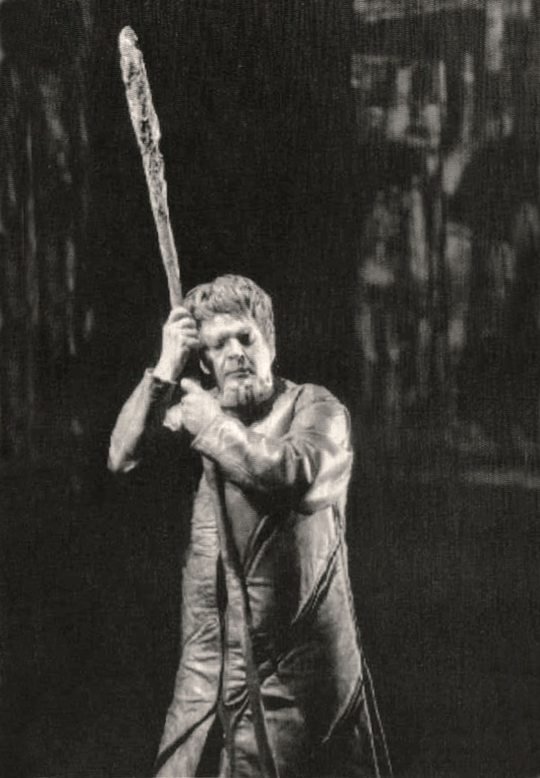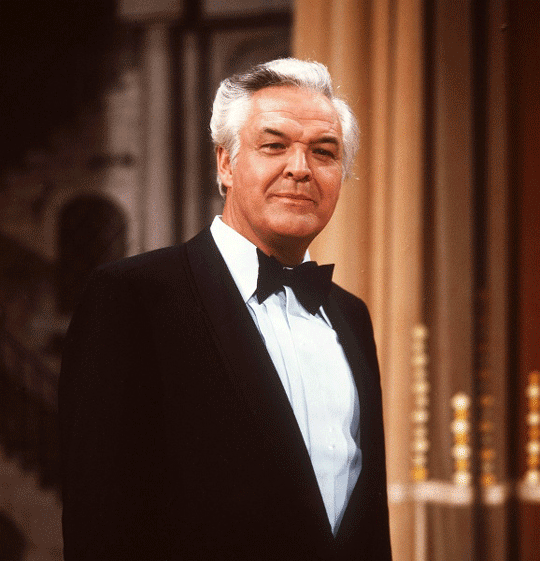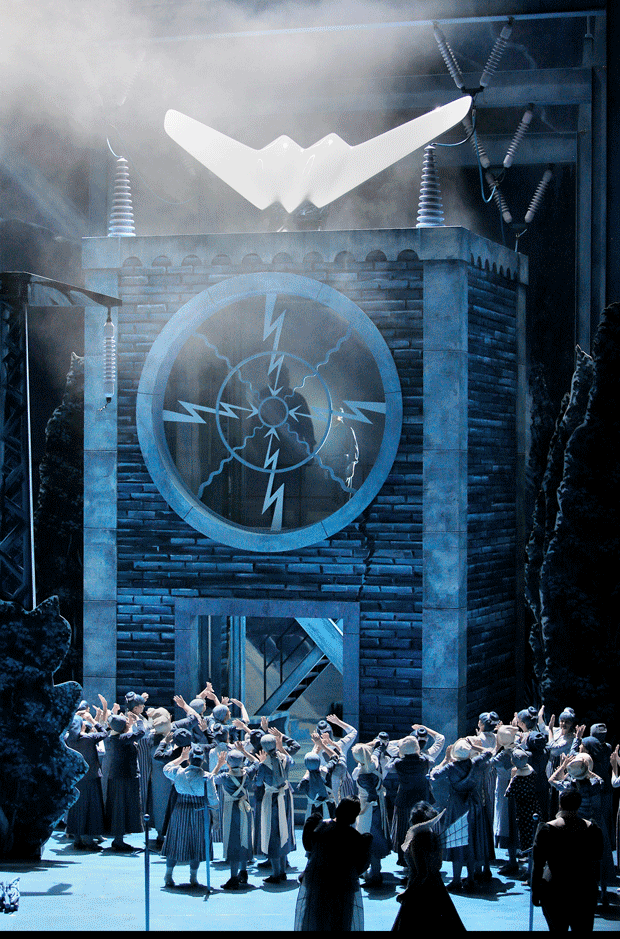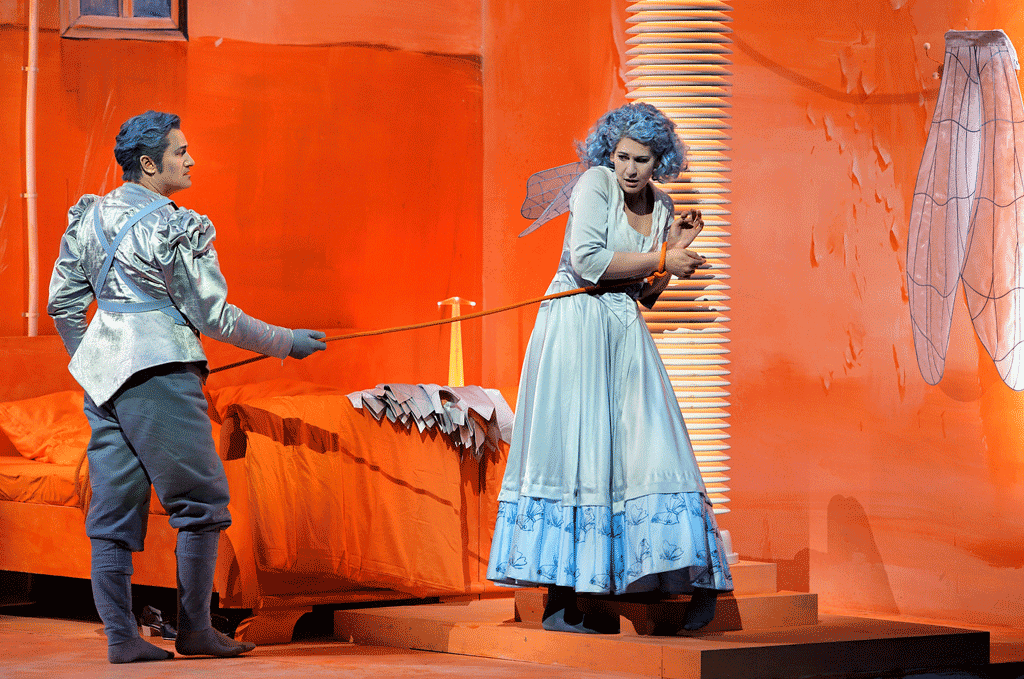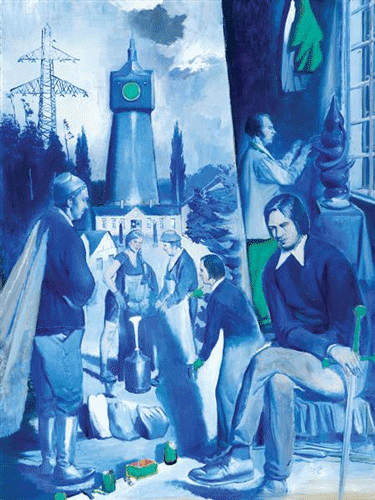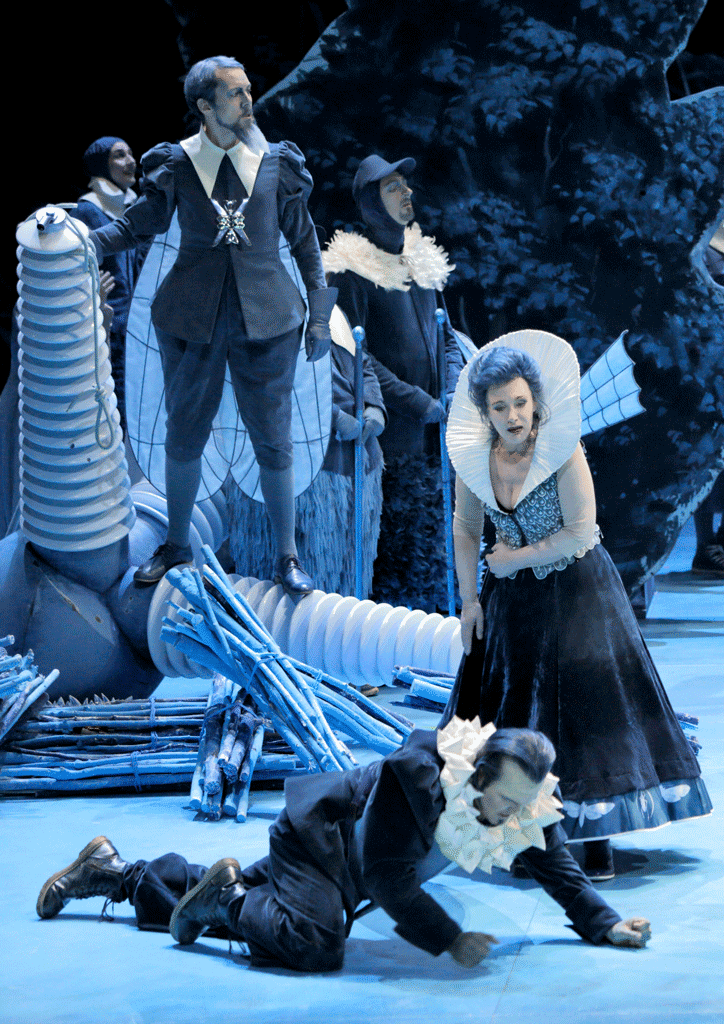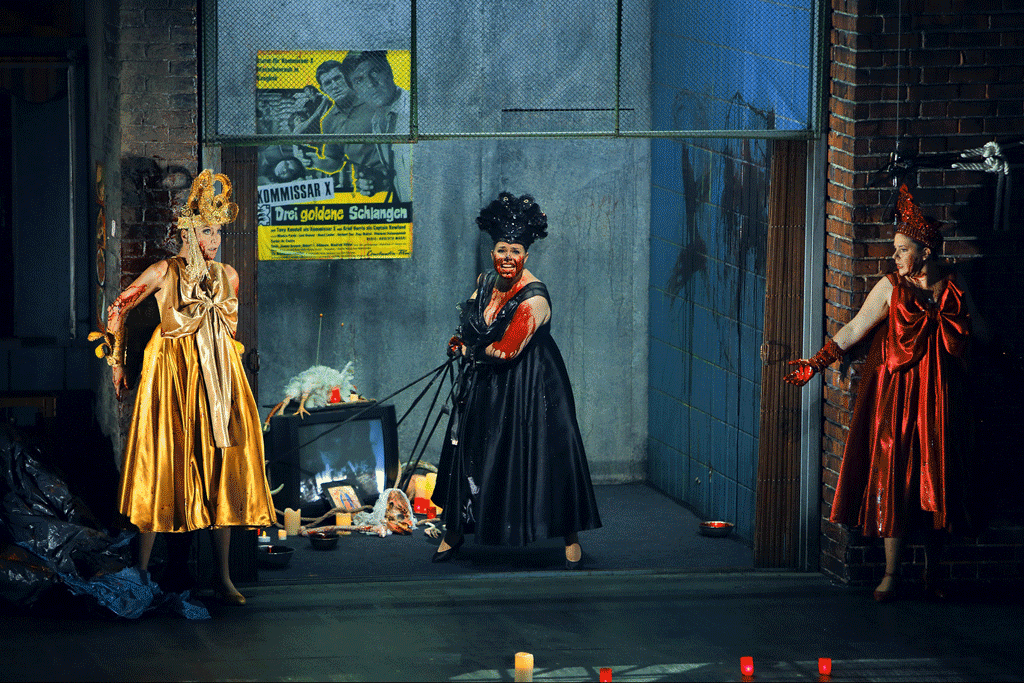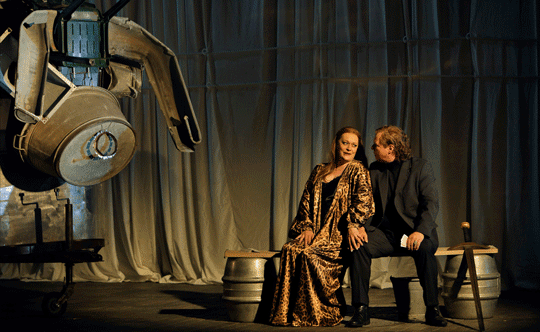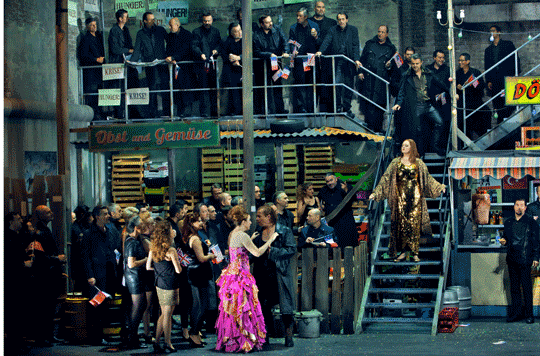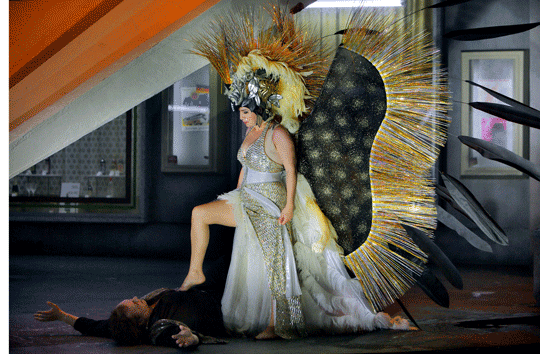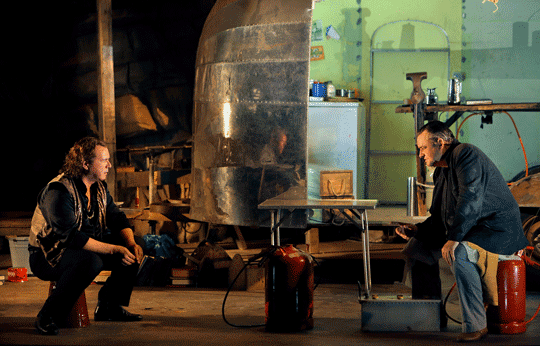L’été d’un nouveau Ring est toujours un moment où le Landerneau des wagnériens s’agite un peu autour de son Festival chéri, et les crises et les déclarations tonitruantes sinon définitives sur la chute du niveau de Bayreuth ne sont pas nouvelles : dès la fin du XIXe, on note une dangereuse baisse du niveau du Festival. De baisse en baisse, je n’ose m’interroger sur le niveau actuel, de peur de la crise cardiaque.
Observateur de la vie et de la production du Festival depuis plusieurs décennies, je voudrais revenir un peu sur les bruits qui courent, sur les vraies difficultés et les rumeurs, en commençant par l’étrange déclaration de Madame Claudia Roth, ministre de la Culture de la République Fédérale allemande.
Au vu de l’argent accumulé que j’ai laissé dans les caisses du Festival depuis 1977 et dans celle de la Société des amis de Bayreuth, il me semble que j’ai le droit de m’interroger sur la pertinence de cette déclaration.
Angela Merkel elle-même, qui fréquente le Festival très régulièrement et depuis longtemps, avait émis des remarques sur son manque d’ouverture vers l’extérieur et sur une billetterie qui privilégiait les associations Wagner et la Société des amis de Bayreuth plutôt que le grand public. Elle avait donc demandé à faire revoir les quotas pour ouvrir le Festival à un public plus large, ce qui avait été fait il y a une dizaine d’années. Elle n’avait pas tout à fait tort, du reste. Pendant longtemps, le système de traitement de la billetterie était suffisamment brumeux pour s’interroger sur ces queues supposées : après la première demande de billet, il fallait paraît-il attendre 7, 8, 9, 10 ans avant qu’une réponse positive n’arrive…
Celui qui écrit a eu une chance incroyable : première demande 1976, premiers billets 1977, peut-être grâce à la fuite des « cerveaux » consécutive au Ring de Chéreau, plus sûrement parce que Dieu-Richard savait reconnaître les siens.
Mais tout cela est un mauvais souvenir, puisqu’internet a permis de résoudre à peu près la question des billets, non sans humour d’ailleurs : le logiciel de vente illustre le temps d’attente par une queue virtuelle qui vous conduit jusqu’au palais des festivals, Graal mystérieux où le quidam découvre les places encore disponibles ; toute virtuelle qu’elle soit, la queue n’en dure pas moins plusieurs heures… Et les oiseaux de mauvais augure, qui ne sont jamais contents, observent désormais qu’il reste des places, avec la même inquiétude qu’ils observaient jadis le pont-levis de la forteresse désespérément levé.
Ceux qui ont fréquenté le Festival 2022, le premier d’après Covid, ont pu remarquer que la délicieuse chaleur des corps serrés les uns aux autres dans le Festspielhaus était revenue… avec bien peu de trous.
Avant d’émettre une série d’observations sur le Festival aujourd’hui, considérons d’abord la déclaration de Madame Roth en rappelant avant tout que le Festival est essentiellement co-financé par l’État Fédéral, l’État Libre de Bavière, la ville de Bayreuth et la Société des Amis de Bayreuth depuis la réforme de ses statuts au début des années 1970. Jusqu’alors, Bayreuth était une entreprise privée familiale. Il devenait clair que ce fonctionnement ne correspondait plus ni à l’époque, ni aux moyens de la famille.
Le nouveau statut qui fait du Festival de Bayreuth un établissement public précise grosso modo que la direction de celui-ci sera assurée par un membre de la famille Wagner aussi longtemps qu’il y en aura un capable de l’assumer. Tant que Wolfgang Wagner a été aux commandes, le silence a prévalu dans les rangs : le prestige de l’homme, son histoire, son parcours interdisaient évidemment toute remarque ou protestation. Par ailleurs, Wolfgang Wagner qui a introduit à Bayreuth Patrice Chéreau, Harry Kupfer, Heiner Müller, Christoph Schlingensief, Christoph Marthaler, Stefan Herheim, Claus Guth, avec des réactions quelquefois violentes, a su aussi équilibrer ses choix par d’autres personnalités, gages de tradition, lui y compris, telles que Jean-Pierre Ponnelle, Peter Hall, Werner Herzog, August Everding, Alfred Kirchner, Deborah Warner et d’autres…
Sous sa direction, on a pu entendre notamment dans la fosse de Bayreuth Pierre Boulez, Sir Georg Solti, Daniel Barenboim, James Levine, Christian Thielemann, Giuseppe Sinopoli, Daniele Gatti.
Il y a eu des remplacements, des accidents (mort de Sinopoli), des choix quelquefois erronés, mais dans l’ensemble, le bilan de Wolfgang Wagner est plutôt flatteur.
Sa succession en revanche a été chaotique : le conseil de surveillance du Festival avait désigné sa fille aînée Eva Wagner-Pasquier comme directrice au début des années 2000, tandis que Wolfgang Wagner désirait y voir son autre fille Katharina, bien plus jeune, qui lui servait alors de conseillère. En tant que « Directeur à vie », il a bloqué le processus, restant en place jusqu’à ce qu’une solution qui lui convienne soit trouvée.
La solution justement, on le sait, a été un Festival à deux têtes : les deux demi-sœurs, Eva et Katharina, ont pris le Festival en main après le dernier été (2008) de Wolfgang Wagner, en se répartissant grosso modo les tâches, Eva sur la musique et Katharina sur les aspects scéniques jusqu’en 2015. Le symbole de cette double direction a été le Ring 2013, où Kirill Petrenko procédait du choix de Eva Wagner-Pasquier, et Frank Castorf de Katharina Wagner.
Depuis le départ d’Eva Wagner-Pasquier en 2015, Katharina Wagner est désormais seule à la barre.
Nous n’avons pas à entrer dans les considérations qui ont présidé au départ d’Eva Wagner-Pasquier, car bien des bruits ont circulé et il est inutile d’y revenir.
Il est clair cependant que Katharina Wagner a dû se faire épauler par des conseillers musicaux et vocaux, ne pouvant assumer seule l’ensemble des tâches et c’est entre autres le sens de la présence à ses côtés comme « directeur musical » de Christian Thielemann, une charge dont il a été relevé discrètement au moment de la période Covid.
Or, Katharina Wagner cristallise des oppositions, pas toutes désintéressées, à la faveur du renouvellement (ou non) de son contrat en 2025 : des voix s’élèvent pour dire qu’il est désormais temps de confier les rênes du Festival à un non-Wagner. Une série de personnages sont sur les starting-blocks qui sont persuadés évidemment qu’ils feraient mieux. Être premier directeur/trice non-Wagner du Festival de Bayreuth devrait être sans doute un titre de gloire à accrocher sur une carrière.
Par ailleurs, Katharina Wagner n’a jamais eu une relation apaisée avec la puissante Société des amis de Bayreuth, notamment depuis que, dès son arrivée à la direction, elle a laissé naître (ou suscité ?) une société concurrente, la TAFF (Team Aktiver Festspielörderer).
Et puis il y a aussi ceux qui sont exaspérés de la politique artistique menée par Katharina Wagner notamment en matière de mise en scène. Comme je l’ai entendu par un éminent confrère cet été : « quand verra-t-on à Bayreuth une vraie mise en scène ? ».
Qu’est-ce qu’une vraie mise en scène ? Mystère, mais on subodore qu’il s’agit d’une mise en scène plus classique, plus plan-plan que ce à quoi Bayreuth nous a habitués ces dernières années, pour pouvoir « écouter la musique » tranquillement et n’être pas obligé comme ces américains ridicules au moment de Castorf de poser sur leurs yeux un pudique masque de sommeil pour ne pas voir et ne faire qu’écouter… Que ce soit au mépris de tout ce que Wagner a déclaré, et au mépris même du sens de la salle de Bayreuth, importe peu… On n’en est pas à une contradiction près.
J’avoue être las de ces cris d’orfraie sur les mises en scène, et de ces combats ridicules contre les « mises-en-scène-modernes-qui-cultivent-la-laideur »… Mais qu’est-ce que la beauté ? Qu’est-ce que la laideur ? on sait depuis longtemps que ce sont des notions, au théâtre surtout, qui n’ont strictement aucun sens et qui sont relatives. Combattre le laid pour imposer le beau c’est grand, c’est noble, c’est surtout désespérément simpliste.
Évidemment les attaques se sont réveillées en ce Festival 2022 qui présentait un nouveau Ring, pas vraiment bien accueilli.
Enfin, d’autres ennemis doivent aussi en vouloir à Katharina Wagner d’avoir écarté de Bayreuth Christian Thielemann. Mais il n’est pas illégitime de relativiser le départ de ce dernier, après une vingtaine d’années de présence régulière à Bayreuth, comme ce fut le cas en son temps de Daniel Barenboim (à peu près vingt ans de présence régulière pour lui aussi).
La politique artistique de Katharina Wagner est claire, dans la droite ligne du concept de Werkstatt Bayreuth, ce laboratoire cher à son père : il s’agit d’explorer tous les possibles de mise en scène aujourd’hui dans différentes directions et sans exclusive. On parle pour le prochain Parsifal d’effets tridimensionnels par exemple, mais c’est encore un objet de conflits puisque le Président de la Société des amis de Bayreuth refuse le financement des lunettes 3D nécessaires au dispositif.
Dans tous ces débats, évidemment pilotés et visant à déstabiliser la direction actuelle, personne n’a évoqué l’éclatante réussite des opéras pour enfants, qui depuis une dizaine d’années propose l’ensemble des opéras de Wagner (ceux présentés au Festival) en version réécrite et adaptée pour les plus jeunes, une entreprise où Katharina Wagner s’est fortement engagée avec des moyens qui ne sont pas indifférents (véritables équipes de mise en scène, orchestre d’une trentaine de musiciens, chanteurs engagés au festival). Comme c’est une réussite, on n’en parle évidemment pas…
A tout cela, il faut ajouter que Katharina Wagner a été assez gravement malade pendant la période Covid, ce qui a évidemment relancé les plans sur la comète et remis en selle les espoirs et les paris sur un départ anticipé.
Tout cela est simplement délétère.
Là-dessus, en dépit d’un Festival qui a renoué avec des conditions normales et a affiché exceptionnellement huit productions, avec un Tristan conçu comme « secours » en cas de défections en masse dues au Covid – ce qui n’était pas si absurde quand on considère les problèmes de remplacement qu’ont eus certains théâtres européens –, la ministre allemande de la Culture Claudia Roth, intervient dans le marigot, appelant à un nécessaire redressement du Festival. Que le Ring ait fait discuter, rien d’étonnant : les hyènes font toujours comme si c’était la première fois. Une nouvelle production est toujours un risque. Moi qui pourtant n’ai pas aimé ce Ring, je ne réclame aucune tête…
Que la ministre qui finance (partiellement) le Festival fasse part de ces remarques, c’est légitime. Qu’elle le fasse brutalement en couronnant les polémiques qui ont couvé tout l’été, c’est déjà moins sympathique. Et qu’elle se propose d’intervenir dans la ligne artistique, c’est franchement insupportable.
J’espère seulement que les Verts allemands (le parti de Madame Roth) ont une vision culturelle moins désolante ou inexistante que leurs cousins français.
Que dit Madame Roth ?
Comme représentante de l’État fédéral, l’un des financeurs du Festival de Bayreuth, la ministre est évidemment légitime pour demander que soit revue l’organisation du Festival. Elle affirme en effet qu’il y a une nécessité de beaucoup réformer le Festival de Bayreuth (« Es gibt auf dem Grünen Hügel wirklich sehr viel Reformbedarf ») .
Elle a ensuite affirmé que le public du Festival ne reflète pas notre société « diverse et colorée » et qu’il faut donc attirer un public plus jeune et plus large.
Enfin, tout en déclarant que confier la direction à un Wagner n’était pas une « obligation rituelle », elle a demandé de faire en sorte que « l’excellence artistique soit atteinte », ce qui à la fin d’une saison où le Ring a été fortement critiqué ne manque pas d’interpeller.
La question de l’excellence artistique ne devrait pas se poser pour un festival aussi fameux que le Festival de Bayreuth et le rappeler a quelque chose d’un peu insultant.
Par ailleurs, l’élargissement du public, tout le monde le sait, ne se commande pas et les vœux d’un public plus diversifié, plus coloré et plus jeune ressemble à de la pure démagogie, de celle qui inonde la société d’aujourd’hui. En ce qui concerne le public jeune, nous avons rappelé les efforts du Festival pour le jeune public qui, une fois de plus, ne semblent pas pris en compte.
Enfin au-delà des goûts du public pour l’opéra en général et pour Wagner en particulier, ouvrir le Festival « aux jeunes » suppose aussi des investissements que l’État et les autres associés sont, en cette période faste pour les budgets, sans nul doute prêts à consentir…
Il faut tout de même rappeler que le Festival de Bayreuth a longtemps été l’un des moins chers des Festivals internationaux et que la révision de la politique tarifaire est intervenue à la fin des années Wolfgang Wagner, puisque dès l’arrivée des sœurs Wagner aux commandes, un mouvement des personnels du Festival a exigé une révision des politiques salariales. Visiblement, c’était le cadeau de début de mandat.
Par ailleurs, les prix des billets ont subi une forte augmentation, de l’ordre de 30% a minima, avec une différentiation entre les Premières, les nouvelles productions et les reprises. Il n’en demeure pas moins que les finances du Festival restent assez justes, même si l’on considère que Bayreuth paie moins bien ses forces artistiques que d’autres institutions, avec des exigences néanmoins en terme d’exclusivité et de présence, qui se sont cependant beaucoup assouplies ces dernières années. Les très grands noms passés par Bayreuth le font pour le CV, mais n’y restent pas, et ceux ou celles qui ont été lancés par le Festival restent quelques années et puis succombent à d’autres sirènes plus rémunératrices.
Cette ouverture à d’autres publics, qui signifie pour le Festival d’autres investissements dans un contexte économique mondial peu favorable, plaide donc aussi pour un financement consolidé de la part des associés… On voit bien que les demandes de Madame Roth, pieuses et généreuses, sont lancées comme un pavé dans la mare, pour éclabousser plus que pour construire.
Car enfin, faisons un rapide bilan artistique des années 2009-2022.
Il y a d’abord de très grandes réussites, musicales et scéniques :
- Le Ring de Frank Castorf et Kirill Petrenko (n’en déplaise aux traditionalistes) sans oublier les deux années Marek Janowski, qui n’ont pas été musicalement médiocres – même si sa direction ne m’a pas personnellement enthousiasmé ;
- Le Tannhäuser de Tobias Kratzer, éclatante réussite scénique et vocale, stabilisé dans la fosse par Axel Kober après le passage très discuté de Valery Gergiev ;
- Le triomphe répété des Meistersinger von Nürnberg, signée Barrie Kosky et Philippe Jordan ;
- Der fliegende Holländer, dans la production 2021 de Dmitry Tcherniakov avec Oksana Lyniv, première femme dans la fosse de Bayreuth, qui a été ces deux dernières années un très gros succès ;
- Lohengrin dans la mise en scène de Hans Neuenfels et direction musicale de Andris Nelsons, connu comme le « Lohengrin des rats », qui a finalement laissé un bon souvenir, tout simplement parce que la mise en scène de Neuenfels était l’une des plus intelligentes de l’œuvre de Wagner et que musicalement et vocalement il tenait largement la route (y compris lorsqu’il a été dirigé par Alain Altinoglu).
Il y a bien entendu des demi-succès ou demi-échecs (selon l’adage du verre à moitié vide ou à moitié plein) :
- Der fliegende Holländer, dans la production de Jan Philipp Gloger, qui sans être une production médiocre, reste discutable et vocalement de facture moyenne, mais musicalement brillante (Thielemann) ;
- Le Tristan und Isolde de Katharina Wagner qui n’a pas réussi à convaincre à la hauteur de ses Meistersinger, sa production précédente à Bayreuth, mais qui n’était pas une production médiocre non plus, aux distributions irrégulières mais à la direction musicale incontestable de Christian Thielemann ;
- Parsifal, mise en scène discutable de Uwe Eric Laufenberg, musicalement solide que ce soit avec Hartmut Haenchen ou Semyon Bychkov et vocalement incontestable. Il faut se souvenir que la mise en scène avait été confiée initialement au plasticien Jonathan Meese et que le projet avait été abandonné pour des raisons financières (ou peut-être idéologiques). A cela s’ajoute le départ du chef Andris Nelsons à la suite d’un conflit avec Christian Thielemann. Malgré tous ces avatars, la production a quand même tenu ;
- Lohengrin dans la production de Yuval Sharon et les décors du célèbre plasticien Neo Rauch, n’a pas convaincu totalement du point de vue scénique, ni du point de vue vocal la première année mais a toujours été un fantastique succès de Christian Thielemann en fosse.
Reste un échec cuisant : le Tannhäuser de Sebastian Baumgarten, avec une distribution très discutable, une valse des chefs selon les années. Un des pires souvenirs de Bayreuth : l’enfer pavé de bonnes intentions.
Enfin, en 2022, la production du Tristan « de secours », signé Andreas Schwab et dont nous avons parlé, n’a pas soulevé l’enthousiasme mais laissé le public indifférent. Une production passable et très digne en fosse (Markus Poschner, arrivé au dernier moment).
Quant au nouveau Ring, signé Valentin Schwarz, particulièrement problématique au niveau scénique, il mérite sans nul doute d’être revu dans le cadre du Werkstatt Bayreuth, mais reste très défendable vocalement, avec un résultat contrasté en fosse. Le chef Cornelius Meister, arrivé deux semaines avant la première (à cause du Covid qui a frappé le chef Pietari Inkinen), n’ayant pas réussi à homogénéiser l’ensemble. Mais l’an prochain, Pietari Inkinen reprendra la direction et donc avis suspendu.
Au total, le bilan n’est pas si noir que les hyènes ne le prétendent. Certes Katharina Wagner au niveau des productions a eu à cœur d’appeler des metteurs en scène très célèbres en Allemagne, qui n’y avait jamais travaillé (Castorf ; Neuenfels) et s’est ouverte à la génération des metteurs en scène les plus en vue dans l’aire germanophone aujourd’hui.
Il y a eu aussi des accidents et des remplacements de dernière minute qui ne sont pas toujours de son fait, mais dans l’ensemble, en ce qui concerne les choix scéniques et musicaux, le bilan 2009-2022 n’est ni moins ni plus honorable que certains festivals comme Salzbourg ou Aix-en-Provence. On tire à vue sur les choix scéniques de Katharina Wagner, plus au nom de l’idéologie que des véritables résultats artistiques. La liste que nous avons rappelée nous montre qu’à part un seul véritable échec, il n’y a aucun scandale.
Est-ce à dire que tout soit parfait dans le meilleur des mondes wagnériens possibles ? Évidemment pas.
On a notamment remarqué des évolutions dans les organisations qui ne sont pas toutes des réussites.
D’abord le public du Festival a pu constater qu’en une dizaine d’années, une séparation plus nette s’est faite entre les espaces publics et les espaces professionnels : c’est peut-être un détail aux yeux de certains, mais dans l’histoire de ce lieu il a son importance. On pouvait faire le tour du théâtre, traverser le passage de l’arrière scène vers les dépôts de décors, jeter un œil par ci par là. Ce n’est plus possible, de hideuses cloisons provisoires bloquent tous les accès arrière. Cette fermeture a sans doute été décidée pour des raisons de sécurité et pour que les professionnels puissent travailler sans que le public ne gêne. Quand on pense que jusqu’au seuil des années 1970 la cantine était commune au public et aux artistes, on ne peut que constater que le sens de l’histoire va vers la clôture.
Précisons également que si les espaces professionnels ont été protégés, le public ne l’est toujours pas les jours de pluie, qui peuvent être fréquents à Bayreuth. C’est un problème lancinant depuis qu’ont été supprimés les galeries couvertes qui protégeaient l’arrivée des spectateurs.
Si l’on n’a pas veillé à la pluie, on a en revanche veillé à la nourriture… Toute la politique de catering, importante à Bayreuth dans la mesure où les spectacles durent jusqu’à six heures avec des entractes d’une heure, a été réorganisée. Jusqu’au seuil des années 2020, il y avait essentiellement un self, le fameux stand des saucisses, un bar-self et un restaurant un peu plus chic : le public pouvait circuler dans les différents espaces. Aujourd’hui, les comptoirs qui vendent glaces, bières, eaux minérales et autres délices se sont multipliés tout autour du théâtre, ridiculement baptisé « Walk of fame » et prenant la forme de « barnums » (ceux-là même qui auraient pu être utilisés il y a encore peu de temps pour tester le Covid renforçant le côté un peu piteux de la chose). D’autres accès se sont fermés, comme le bâtiment du restaurant, réservé aux VIP et autres privilégiés. La salle du self a été réaménagée dans le genre faux chic, les prix également. Et les espaces publics (rappelons qu’à Bayreuth il n’y a pas de foyer) se sont remplis de kiosques à catering (appelés « Wahnfood ») qui ont troqué la simplicité d’antan contre un style chic et choc plus douteux. A l’évidence, le Festival en tire aussi quelques rentrées, mais Bayreuth a perdu en naturel et en simplicité ce qu’il n’a pas gagné en efficacité : la queue est toujours aussi longue devant le kiosque à saucisses !
Par delà l’anecdote, rappelons qu’un festival, c’est un caractère, une ambiance, des rituels et de ce point de vue les évolutions ne vont pas forcément dans une direction sympathique.
Les autres changements ont affecté les agendas. Et l’organisation des représentations, essentiellement pour des questions dues au Covid. L’ajout de la production de Tristan a contraint à trouver des espaces pour les répétitions et laissé le théâtre fermé une semaine après l’ouverture officielle du 25 juillet. Deuxième conséquence : la concentration des représentations (normalement, le Ring est étalé sur six jours avec deux journées de repos, mais cette année les journées de repos étaient occupées par d’autres représentations singulières). La communication du Festival n’a pas été claire à ce propos, mais dès 2023, les choses reviendront à la norme.
En revanche, la communication sur les prochaines productions, les chefs invités et le calendrier du Festival 2023 est très claire, ce qui n’a pas toujours été le cas sur la colline verte.
Autre évolution, la diffusion TV des productions est devenue plus ouverte. On a pu voir dès cette année le Götterdämmerung du nouveau Ring par exemple. Il y a encore quelques années, seuls les spectacles éprouvés étaient enregistrés pour la télévision ou la production de DVD.
Du point de vue des distributions, il est clair que tout mélomane est un membre actif du café du commerce. Chaque période a eu ses habitués, ses fidèles, chaque période a également eu ses conflits et ses exclusions. Vogt, Zeppenfeld sont des habitués de Bayreuth. Groissböck l’était mais ne l’est plus. Lise Davidsen quitte le Festival l’an prochain, mais Catherine Foster y revient et si certains choix peuvent étonner, Bayreuth nous a toujours habitués à des surprises ou à des choix bizarres. Disons que globalement, les distributions de Bayreuth ne sont jamais scandaleuses. Du point de vue des chefs, à côté de noms bien connus et expérimentés, la politique semble être d’inviter également ceux ou celles de la génération montante, charge à ces derniers ou dernières de conquérir leur place. Katharina Wagner désormais veille à équilibrer les invitations entre chefs et cheffes. Mais l’histoire nous montre qu’il y a eu des chefs régulièrement attachés à Bayreuth et d’autres – et pas des moindres – qui n’y ont jamais dirigé, pas forcément parce qu’ils n’étaient pas invités d’ailleurs. Les choix de chefs actuels, entre jeune génération et chefs d’expérience, sont globalement équilibrés.
Alors quelles réformes ?
Il y a d’abord ceux qui déclarent que la famille Wagner ça suffit ou encore que « Richard Wagner exclusif à Bayreuth, ça suffit ».
Avec le festival baroque de fin d’été de Max Emanuel Cencic, la ville de Bayreuth s’enrichit pourtant d’un autre horizon dans l’autre théâtre exceptionnel de la ville, l’Opéra des Margraves.
Ensuite j’ai toujours soutenu et continue de soutenir que le Festival de Bayreuth doit rester exclusivement consacré à l’œuvre de Wagner. Il existe un festival éclectique pluridisciplinaire de grand niveau en Europe et c’est Salzbourg. Il n’y a aucun intérêt à faire de Bayreuth un second Salzbourg. Personne n’en comprendrait la raison.
Bayreuth est un théâtre qui a été construit par Wagner pour représenter les œuvres de Wagner et il doit le rester.
Toutefois, si le Festival d’été doit rester avec les œuvres « canoniques » et reconnues, rien n’empêcherait de créer un festival à Pentecôte ou à Pâques, peut-être plus « ouvert » où seraient représentées les autres œuvres de Wagner, jusqu’à Rienzi. En 2013, elles ont été représentées à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Wagner, en amont du Festival et dans un lieu impossible (une grande salle de sport) dans des conditions indignes. Le théâtre n’était pas disponible, du fait des répétitions du Ring de Castorf. Sans doute également n’a-t-on pas osé utiliser le Festspielhaus pour des œuvres que Wagner n’y voulait pas voir. Ce fut un échec cuisant.
Je pensais à l’époque et je continue de penser qu’un festival plus concentré, placé à une autre époque de l’année pour attirer du public avec les autres œuvres de Wagner pourrait fonctionner. Pentecôte et Pâques fonctionnent à Salzbourg, Pâques et novembre fonctionnent à Lucerne. Cela vaudrait le coup de tenter. Il est regrettable que Rienzi, ou Das Liebesverbot, qui ne sont pas des œuvres médiocres, aient si peu d’espace dans les théâtres.
Et pour s’ouvrir aux jeunes, des solutions peu onéreuses expérimentées ailleurs comme les pré générales ou générales ouvertes pourraient fonctionner même si la tradition actuelle du Festival est à la fermeture pendant les répétitions.
En somme, il y a un espace pour du neuf à Bayreuth mais il faudrait surtout penser à faire fonctionner un peu plus la salle, qui est LE monument que les touristes et les visiteurs veulent voir, même si les coûts d’une ouverture (personnel de salle, contrôles, techniciens, etc.) sont importants.
Alors rêvons un peu et supposons que tous les problèmes soient aplanis.
Ne pourrait-on pas par exemple impliquer, pour quelques concerts Wagner par an (ou des représentations en version concertante), les Bamberger Symphoniker, qui sont à 65km, en les faisant jouer dans la fosse avec les chanteurs sur la scène, à des tarifs plus bas, pour permettre à un autre public de pouvoir apprécier cette acoustique exceptionnelle ? Il y a là des pistes sans doute à explorer, mais cela suppose des financements supplémentaires que Madame Roth est sûrement prête à assurer.