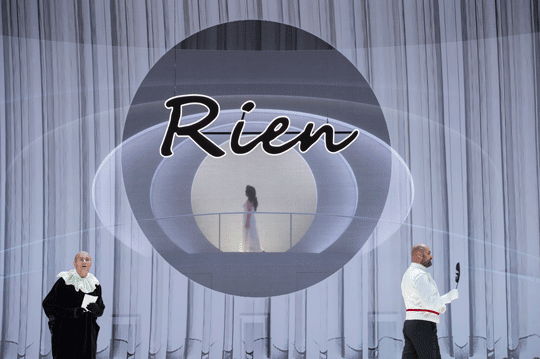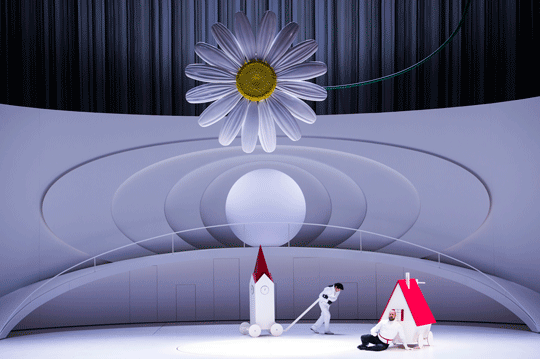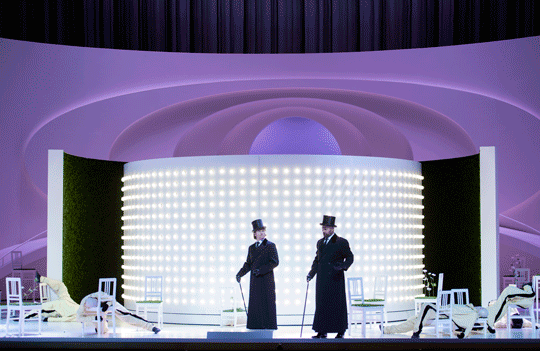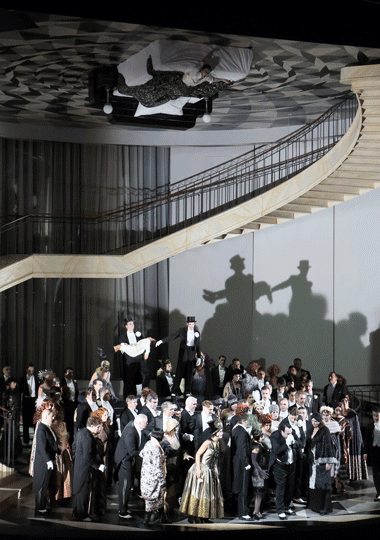L’Électricien devra repasser
Ma cinquième production
Depuis 1977, ma première année à Bayreuth, quatre productions de Lohengrin se sont succédé : celle de Götz Friedrich en 1979 (jusqu’à 1982), dirigée par Edo de Waart puis Woldemar Nelsson, avec le Lohengrin de Peter Hoffmann alternant avec Siegfried Jerusalem, celle de Werner Herzog, de 1987 à 1993 – avec un trou en 1992- dirigée par Peter Schneider avec Paul Frey en Lohengrin, celle de Keith Warner dirigée par Antonio Pappano puis Sir Andrew Davis qui courut de 1999 à 2005 (avec trou en 2004) avec plusieurs Lohengrin dont on retiendra Peter Seiffert et Robert Dean Smith, celle de Hans Neuenfels (les rats..) dirigée par Andris Nelsons (de 2010 à 2014) puis Alain Altinoglu (en 2015) avec Jonas Kaufmann puis Klaus Florian Vogt en Lohengrin. Chacune a laissé des traces, la plus complète (musique et mise en scène) étant sans doute celle de Hans Neuenfels, qui fut toujours bien dirigée et chantée.
La production présente est donc la cinquième, et a connu quelques aventures de distribution et de mise en scène – c’est désormais l’usage –. Ce devait être Alvis Hermanis, mais suite à des déclarations politiquement peu correctes, il fut écarté et on appela l’américain Yuval Sharon (Die Walküre à Karlsruhe), dont la mission fut de reprendre la production là où elle était, avec ses décors déjà tout prêts. La tentation était trop grande pour un jeune metteur en scène comme Sharon ; il a donc accepté de travailler dans des conditions assez étonnantes, devant s’adapter à une esthétique plutôt (décors et costumes de Neo Rauch et de Rosa Loy, des plasticiens importants en Allemagne, chefs de file de la “Nouvelle école de Leipzig”).
Il est à espérer qu’il pourra retravailler sa mise en scène dans le cadre du Werkstatt Bayreuth, parce qu’il est difficile de voir dans cette production un travail achevé.
À cela s’ajoute que le Lohengrin prévu de longue date était Roberto Alagna, qui a abandonné en juin s’apercevant un peu tard qu’il ne savait pas son texte – eh oui, Bayreuth se prépare…- et que Piotr Beczala, annoncé en 2019, a accepté de reprendre au pied levé le rôle – tandis qu’Anna Netrebko, prévue elle aussi en 2018, a préféré attendre 2019 (le temps de répétitions est moindre, elle n’en a évidemment aucun besoin) pour venir assurer la bagatelle de deux représentations…Elle a été remplacée cependant par une autre star, Anja Harteros, qui a déjà souvent chanté Elsa à Milan, Munich et Berlin et qui faisait ses débuts à Bayreuth.
Des errances de management aux caprices de divi et dive, il faudra revenir sans doute sur la situation actuelle du Festival qui semble hésiter entre un marketing artistique un peu putassier (Domingo, Netrebko), des exigences de présence des chanteurs qui aujourd’hui semblent hélas ne plus convenir au marché lyrique réel, et surtout aux stars du jour qui sont des oiseaux de passage, Netrebko qui Netrebko la, et des choix de mise en scène soit radicaux, soit erratiques. Netrebko est-elle bien utile dans ces conditions ? Sa présence donnera-t-elle du lustre au festival de Bayreuth 2019? Je crains que ce ne soit pas le cas, sauf dans les magazines glamour.
On a de toute manière peine à suivre…
Tout cela annonçait néanmoins un bon cru, agrémenté de la dernière Ortrud du dernier vrai mythe de l’époque, Waltraud Meier, qui faisait cette année ses adieux à un rôle qu’elle a marqué à jamais, revenant sur la colline après une vingtaine d’années : elle avait rompu avec Wolfgang Wagner en 2001 pour une affaire d’agenda, car à Bayreuth (en théorie) on reste sur place pendant le temps des répétitions et le temps des représentations, soit deux mois au bas mot sans avoir la licence d’aller chanter ailleurs. Cette licence, elle fut accordée à certains chanteurs à commencer par Gwyneth Jones qui alternait des Brünnhilde à Bayreuth et pendant les journées de repos, des Maréchales munichoises (sous la direction de Kleiber). L’histoire ne dit pas pourquoi elle fut refusée à Waltraud Meier.
Il reste que sur le papier, Thielemann, Harteros, Meier, Beczala, Zeppenfeld , Koniezcny, c’était un ensemble digne d’attirer public avide et presse curieuse.
Mais le résultat est un peu plus contrasté qu’attendu .
Un propos scénique pas toujours « éclairant »
Yuval Sharon est un metteur en scène très sympathique, très ouvert, à qui l’on doit une Walküre respectable, mais pas très novatrice dans la Tétralogie tétrarégie de Karlsruhe (quatre metteurs en scène différents pour un Ring). Il fait partie des metteurs en scène dont on parle aujourd’hui, post-Regietheater, qui reviennent à une lecture moins idéologique des œuvres. Du moins a priori parce que le récit de ce Lohengrin reste tout de même dépendant d’une lecture du monde loin d’être neutre.
Il est d’abord tributaire d’un décor qui impose une vision singulière de l’œuvre et particulièrement fort, voire envahissant. Lohengrin prend sa source légendaire dans les romans arthuriens et sa source historique dans les efforts de l’Empereur Henri 1er (L’Oiseleur) pour réorganiser les états liés au monde germanique autour de la couronne impériale vers le Xe siècle et qui se trouve au bord de l’Escaut par la nécessité de lever des troupes.
Historiquement le duché de Brabant est plus tardif : il embrasse la région nord de la Lotharingie (nous sommes au bord de l’Escaut, peut-être aux alentours d’Anvers et le Brabant s’étend au bas mot de Bruxelles au sud à la Meuse au Nord).

Les plasticiens Neo Rauch et Rosa Loy ont travaillé sur les sources picturales hollandaises (Franz Hals, Rembrandt, Van Dyck), en y insérant en même temps une tour de guet aux deuxième et troisième actes qui ressemble assez à certaines tours franconiennes, avec un paratonnerre cependant.
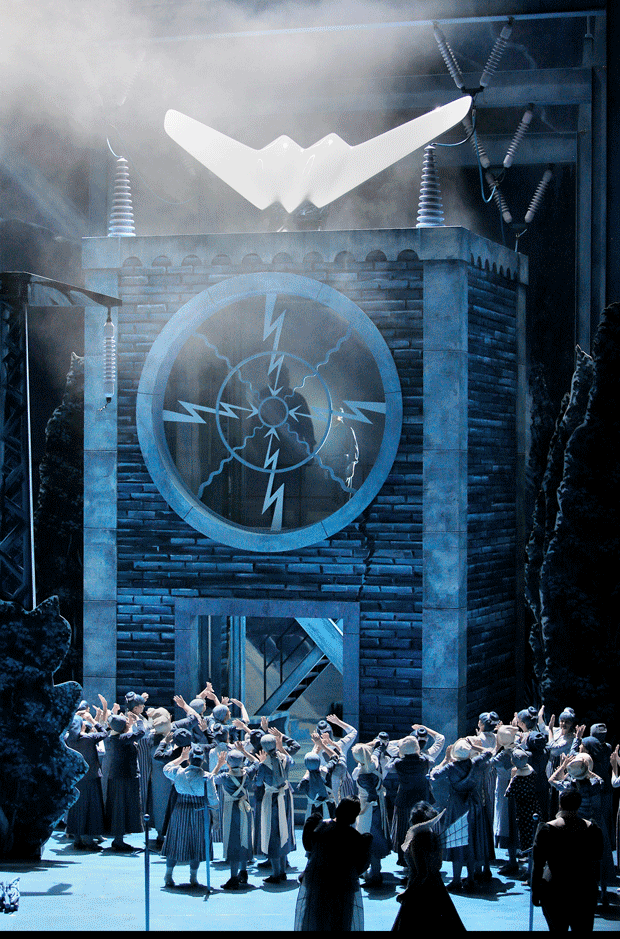
En effet mis à part le cadre « flamingant » plus que brabançon, l’autre donnée est la présence monumentale de l’énergie électrique dans cette production. L’analyse du livret est claire : Lohengrin arrive dans ce Brabant un peu perturbé en sauveur tombé du ciel sur un cygne qui ressemble à un véhicule interstellaire ou à un jouet pour enfants. On a déjà souvent glosé sur les aspects politiques de ce récit, comme Neuenfels dans sa production, mais aussi jadis Götz Friedrich : comment un peuple se donne-t-il à un homme providentiel ? C’est l’une des problématiques toujours actuelles de Lohengrin.
Mais l’idée va ici encore plus loin : si l’arrivée de Lohengrin répond à un besoin, il vient aussi pour satisfaire le sien.
Éclairer par l’électricité

Dans un monde d’aujourd’hui en recherche d’énergies nouvelles, le Brabant est en panne d’énergie et d’électricité. Un peuple en panne en quelque sorte. D’où un décor de lande, au ciel tourmenté, tout en variations bleutées de type bleu de Delft, traversé de lignes à haute tension dont les isolateurs sont tombés, avec au centre un transformateur électrique ouvert sur un escalier qui barre la perspective et difficile à pénétrer (les secrets de l’énergie – des hommes aussi- sont complexes). D’où aussi un peuple aux mouvements divers cherchant désespérément la lumière (au propre et au figuré), comme ces insectes qui tournent autour des lampes.
L’autre couleur qu’on va découvrir bientôt est l’orange, symbole d’amour et d’énergie affective, qui est aussi l’autre couleur de la région (la couleur de la famille d’Orange-Nassau qu’on voit tant lors des fêtes royales aux Pays-Bas), ce n’est évidemment pas un hasard: la couleur du pouvoir en quelque sorte, peut-être plus que celle de l’amour.
Le cadre est donc bien inscrit dans une géographie historique, dans les couleurs symboles , et enfin dans les préoccupations du monde contemporain.
Le chœur est divisé en aristocrates vêtus à la manière des maîtres hollandais, comme évoqué plus haut, avec leurs collerettes quelquefois un peu fantaisistes, et en paysans qui eux rappellent un peu Breughel. Dans ce Brabant scénique, les aristocrates de haut rang sont affublés d’élytres. Serait-on passé des rats de Neuenfels aux insectes (?) de Sharon?Ces élytres ont une fonction symbolique haute : les perdre, c’est tomber en déchéance, c’est ne plus pouvoir voler pour chercher la lumière. C’est ce qui arrivera à Telramund dans son combat avec Lohengrin : il en perdra une et en perdre une, c’est perdre tout…Quant aux deux femmes, elles ont de petites ailes de papillon pour la gentille Elsa, petites, mais acérées pour la méchante Ortrud…
Much ado about nothing
Dans ce cadre dont on verra plus loin les variations, le premier acte se déroule néanmoins d’une manière singulièrement traditionnelle, sans travail particulier sur la direction d’acteurs, sans mouvements bien réglés du chœur, dans une disposition qu’on pourrait voir dans n’importe quel Lohengrin classique, sans autre regard novateur que le regard du décorateur. La pauvre Elsa – coiffure aux reflets bleutés- est attachée à un isolateur et on prépare son bûcher (évidemment, plus de courant : on est bien obligé de recourir aux vieilles méthodes !). Le couple Telramund-Ortrud est au contraire en noir et blanc, et Telramund est coiffé à la Frankenstein. On voit bien où sont les méchants…Et le roi et le héraut sont au milieu, dans une sorte de neutralité désappointée.
Tant de signes, dans une vision plus ou moins élégante, ou esthétisante, en tout cas indiscutablement forte, voire dérangeante, renvoient à un univers proche des contes, ou des albums pour enfants. Le combat Telramund/Lohengrin se déroule d’ailleurs dans les airs (il faut bien utiliser les ailes d’insecte…), comme un quelconque Peter Pan.
Ainsi est souligné ce qui dans cette histoire peut être légendaire, voire mythologique : Lohengrin arrive en portant non une épée, mais la foudre avec laquelle il combat, comme Jupiter ou Zeus des anciens temps…On ne compte plus les statues de Zeus lançant la foudre.
Face à cette forêt de symboles, très (trop ?) syncrétique, et assez (trop) chargé, il ne se passe pas grand-chose de nouveau sur scène ni, il faut bien le dire, de très électrisant.
Un deuxième acte entre mystère et ironie
Le deuxième acte commence cependant dans une atmosphère plus mystérieuse, mieux venue, un jeu d’ombres et de pâle lumière où Telramund et Ortrud jouent un étrange jeu de cache-cache derrière un bosquet, et où apparaît Elsa, en haut d’une tour dans l’embrasure d’une petite fenêtre qui fait cadre, comme un portrait lointain. C’est un moment de grande poésie, d’une intensité qui rachète bien des moments plus banals de cette production, sans doute le plus réussi de la soirée, suivi bientôt par l’un des plus ironiques (du moins on l’espère), l’entrée du cortège nuptial dans la cathédrale, précédé de jeunes filles jetant des pétales de roses qui peu à peu recouvrent la scène, en un rite répétitif, emprunté à tant d’images de cortèges d’opéra et à tant de mises en scène gnan-gnan. Il fallait cette ironie pour distancier la scène, parce que Yuval Sharon place l’histoire d’amour d’Elsa et Lohengrin dans l’espace infini du doute.

Un Lohengrin aux valeurs renversées
C’est la seconde idée de la mise en scène, qui en soi n’est ni ridicule ni incongrue, abondamment explicitée dans le programme de salle.
Elsa influencée par Ortrud, refuse le deal de Lohengrin («aime-moi, épouse-moi et tais-toi !») qui suppose l’adhésion a priori et la soumission de la femme aux exigences de l’homme, fût-il le sauveur. Ainsi la situation traditionnelle est-elle retournée : Elsa en refusant le silence conquiert sa liberté de dire non.
Et d’ailleurs le troisième acte encore plus tendu que de coutume, est consacré à cette situation nouvelle.
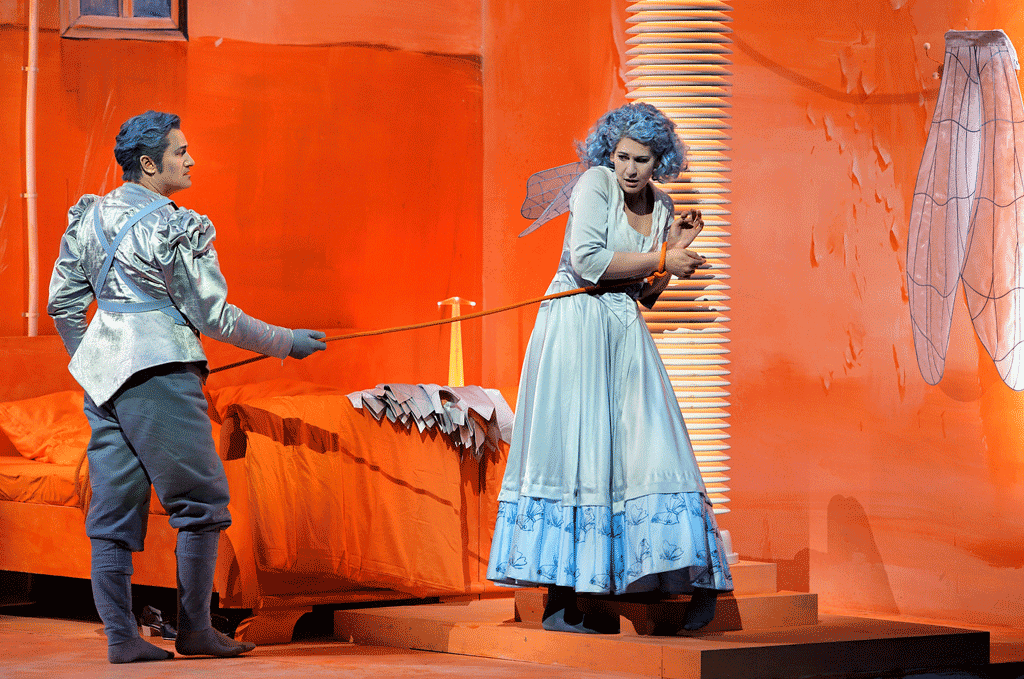
Le couple est isolé dans une chambre nuptiale orange, éclairée, Lohengrin qui a gagné ses ailes au combat (!) les a accrochées au porte manteau, le tout sans problème d’énergie sauf quand Elsa commence à s’exprimer (noir absolu, problèmes d’intensité électrique…) : l’arrivée d’énergie est alors l’indice de l’amour naissant ou disparaissant ou de l’obéissance due à Lohengrin…
Lohengrin n’est donc pas le beau chevalier blanc (ici bleu) qui sauve et conquiert les cœurs, il est celui qui sauve certes, mais au prix de la contrainte et de la soumission : do ut des. D’une part il n’y a pas de sauveur « gratuit », d’autre part Elsa est conquête au sens guerrier, prix du combat initial contre Telramund. Aucun signe d’adhésion ne lui est demandé, puisque l’acquiescement est automatique, comme femme par définition obéissante et soumise, et comme objet-récompense. Dans la situation d’Elsa au premier acte, elle n’a aucun moyen d’exercer un quelconque libre arbitre et on le lui refuse ensuite.
Ortrud au contraire est une femme païenne, héritière d’un monde où souvent les déesses sont déterminantes et exercent leur pouvoir (voir Fricka sur Wotan), le paganisme n’est pas toujours un patriarcat où le mâle triomphe. Entre le monde du Graal monolithique, exclusivement masculin d’où vient Lohengrin et celui d’Ortrud, beaucoup plus riche et touffus, monde de la nature animiste, monde d’un savoir mystérieux (alors qu’on demande à Elsa l’ignorance) il y a une béance.
Ortrud elle-même est le cygne noir face au cygne blanc qu’est Lohengrin[1]. Et c’est Ortrud qu’Elsa a écouté. Lohengrin s’est dévoilé cruellement dès les signes évidents de résistance d’Elsa, en l’attachant à un isolateur, comme elle l’avait été au premier acte par les autres, les méchants, les accusateurs, comme si elle était destinée à être dominée et prisonnière.
Ortrud attachait Telramund, Lohengrin attache Elsa. On voit bien où sont les supposés forts et les supposés faibles.
La liberté de la femme
 On parlera donc de conquête de la liberté des femmes, de victoire des femmes dans un genre, l’opéra, que Catherine Clément dans un livre resté célèbre associe à la défaite des femmes[2]. En réalité, le livret lui-même permet ce retournement, qui veut qu’à la fin Lohengrin soit le perdant car c’est celui qui part et qui parle au conditionnel-irréel du passé.
On parlera donc de conquête de la liberté des femmes, de victoire des femmes dans un genre, l’opéra, que Catherine Clément dans un livre resté célèbre associe à la défaite des femmes[2]. En réalité, le livret lui-même permet ce retournement, qui veut qu’à la fin Lohengrin soit le perdant car c’est celui qui part et qui parle au conditionnel-irréel du passé.
Ach, diese letzte, traur’ge Fahrt,
wie gern hätt’ ich sie dir erspart!
In einem Jahr, wenn deine Zeit
im Dienst zu Ende sollte gehn, –
dann durch des Grales Macht befreit,
wollt ich dich anders wiedersehn! [3]
Alors qu’Ortrud parle au présent et reste en scène, Lohengrin
doit quitter la scène. Telramund le faible est mort, restent donc les deux femmes.
Ainsi la lecture de l’histoire prend-elle un autre point de vue, qui est loin d’être sot ou inintéressant.
La vision traditionnelle de l’œuvre de Wagner a toujours été « je viens, je (te) sauve, et tu me suis sans poser de question ». Lohengrin est le chevalier des contes de fées, un prince charmant auquel on ne résiste pas. On ne se pose d’ailleurs pas la question,bien heureusement .
Mais Elsa se pose en revanche la question et la pose : dans la vision traditionnelle de l’œuvre, c’est évidemment encore une fois par la femme que vient le problème et la ruine c’est l’éternel élément perturbateur : Elsa n’est guère qu’une des descendantes d’Eve, celle par qui la chute arrive, parce qu’elle veut connaître. Cette vision judéo-chrétienne qui fait de la femme la cause de la chute s’est installée depuis longtemps dans les habitudes et le final devient alors encore plus chrétien : devant le mal représenté par Ortrud (la femme qui sait, donc dangereuse…), Lohengrin rétablit le statu quo ante et pardonne.

Elsa, munie désormais de tous les outils permettant de maintenir le courant (dans un panier d’osier qu’elle porte au dos) vivra dans la repentance et le remords d’avoir gâché sa vie qu’on supposait radieuse auprès de Lohengrin même si dans la famille et dans l’entourage de Parsifal son papa, le destin des femmes n’est pas vraiment enviable, il vaut peut-être mieux qu’elle ne l’aie point connu.
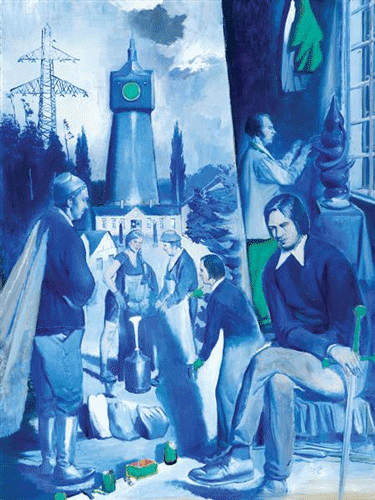
Enfin, le Duc de Brabant qui avait disparu réapparaît sous la forme d’un petit homme vert (le futur écologique de la planète?), réplique exacte du petit bonhomme vert aux feux rouges berlinois, comme le précise un lecteur, une vision un peu cryptique qui a laissé la salle perplexe, feu vert pour le Brabant avec l’électricité du panier d’Elsa?…Encore un signe sans doute à affiner, même si l’on remarque que le vert est une couleur forte et fréquente dans les tableaux de Neo Rauch, qui fait le même contraste avec le bleu dans son tableau Der Former
Vu et lu de cette manière le livret dit des choses effectivement nouvelles. La question de l’électricité devient alors anecdotique et décorative ou métaphorique : l’arrivée de la lumière qui éclaire le monde et les âmes. Seulement elle pèse lourd visuellement, elle s’impose au spectateur comme si c’était la question cruciale : elle renvoie à une sorte de relation maître-esclave élargie au peuple et à son sauveur.
La question de la relation de Lohengrin à la femme et de l’attitude d’Elsa est aussi une relation maître-esclave, ce qu’Ortrud a priori refuse, et c’est là pour moi le centre de gravité de la soirée : comment la femme fragile et sans défenses conquiert-elle son autonomie et sa liberté, en disant non au souverain et au “sauveur” ?
C’est effectivement une vraie lecture dramaturgique du récit.
Une dramaturgie intelligente que la mise en scène souligne mal
Malheureusement, si l’analyse dramaturgique se défend, la mise en scène la défend moins et ne reflète qu’occasionnellement ces intentions, notamment au niveau de la conduite d’acteurs, pratiquement inexistante, laissée à l’appréciation des individus sur scène, sans idées, avec des mouvements souvent conventionnels et bien peu de gestion générale du plateau, notamment en ce qui concerne le chœur, peu mobile, souvent divisé en deux latéralement, avec les conséquences possibles sur la conduite des ensembles. Et de fait, on a rarement entendu autant de décalages notamment dans le choeur clé du début du troisième acte, l’un des musts musicaux de l’opéra. Ce qui lui a valu quelques huées (les abrutis sont en service permanent), ce que je n’ai jamais entendu auparavant, en 41 ans de présence fidèle sur la colline.
De cette mise en scène, Il résulte (je crois injustement) l’impression de pauvreté de manque d’idées, de platitude sinon de ridicule. Il s’agit en effet d’une mise en scène pavée sans doute d’intentions (bonnes), qui ne sont pas rendues évidentes sur le plateau.
Des personnages peu traités individuellement
Un des problèmes de ce travail est la caractérisation des personnages.
Le traitement scénique d’Elsa par exemple est indigent, ne permettant qu’au troisième acte à l’intensité dramatique de s’installer. Attachée à un isolateur au premier acte, lointaine et apparaissant dans une lucarne au deuxième, Elsa n’a guère d’occasions d’affirmer sa personnalité. C’est peut-être voulu, parce qu’il s’agit de faire du troisième acte celui de l’affirmation de soi, celui de l’existence en quelque sorte, mais scéniquement, cela reste singulièrement paresseux.
Dans l’ensemble les personnages bougent peu et sont distribués sur le plateau comme des pions d’un quelconque jeu, les confinant dans des gestes éculés : Piotr Beczala n’a jamais été un acteur engagé sur scène, et il ne lui est pas demandé grand-chose sinon d’être-là. Il est vrai qu’une entrée en scène avec une foudre à la main n’aide pas vraiment, et donne l’impression d’être chez Offenbach.
Seule dans ce monde un peu plâtré, Waltraud Meier remplit la scène par sa présence. Elle est Ortrud dès qu’elle apparaît. C’est le privilège des grands de remplir la scène par leur seule présence et par la puissance d’un seul regard. Et le premier acte qui ne donne à Ortrud qu’une présence vocale infime lui laisse toute latitude au contraire pour répondre au personnage, pour s’y installer, par la démarche, par le moindre mouvement, par les attitudes. C’est elle qu’on suit, par une puissance magnétique, presque magique qui correspond si bien à Ortrud. Elle est théâtre à elle seule. Au milieu d’un monde de statues de sel, elle est la chatte sur un toit brûlant. Fabuleux.
Cette présence est ce qui a toujours caractérisé Waltraud Meier, qui, au moment où nous écrivons ces lignes, vient de renoncer à jamais à ce rôle et à Wagner et a fait un adieu à Bayreuth en gloire. Même le soir où nous l’avons entendue, où la voix n’était pas toujours au rendez-vous, elle fut une reine parce que Waltraud Meier a toujours chanté avec la tête, toujours été en scène à l’écoute des autres, à l’affût des autres, toujours dans son rôle et n’attendant jamais passivement son tour. Au premier acte elle est à la fois muette et envahissante. Muette, mais magnétique. Muette, mais impériale. Et dans les autres actes, supérieure parce qu’elle est la seule à donner l’impression de savoir ce qu’elle chante, de connaître le poids des mots qu’elle cisèle. Elle est d’autant plus juste d’ailleurs dans une mise en scène qui consacre en quelque sorte le triomphe de son personnage.
Un plateau de qualité, mais qui peine à convaincre totalement
Face à un tel monstre sacré, le plateau réuni, l’un des plus enviables qu’on puisse trouver sur le marché, s’en trouve singulièrement pâli, et de fait il est apparu partiellement décevant, pour des raisons complexes qui imposent une analyse plutôt que des déclarations à l’emporte-pièce et des oukases.
Egils Silins
Le héraut d’Egils Silins (qui est pourtant un Wotan qu’on rencontre souvent sur scène) apparaît un peu empâté. La voix qu’il faudrait aiguisée et bien projetée (le métier du Héraut, c’est le gueuloir), garde un timbre opaque et un peu vieilli. Rien n’est scandaleux, mais rien n’est convaincant, c’est passable.

Tomasz Koniezcny
Le public a été en revanche très injuste avec Tomasz Koniezcny qui a été hué. On lui a reproché simplement de ne pas savoir chanter, ce qui est totalement faux. Koniezcny, qui est lui aussi quelquefois un Wotan, sait parfaitement chanter, moduler, exprimer. Son chant est particulièrement expressif en effet, pour un rôle qui, il faut bien le reconnaître, n’est pas aisé. N’importe quel baryton ne peut le chanter, il faut savoir colorer les paroles, montrer à la fois le côté noir et le côté obtus, mais aussi la noblesse parce qu’elle existe.
Telramund veut entrer dans ce qu’il croit être son droit, et il se soumet au jugement de Dieu. Il perd , ne l’accepte pas et va tomber dans le complot, qu’il va perdre. Telramund est un looser (y compris face à sa femme, voir comment elle le ligote au deuxième acte), mais un looser têtu…perseverare diabolicum…La mise en scène lui donne des faux airs de Frankenstein, identifie en lui le méchant, comme chez Guignol. Rendre tous ces aspects n’est pas si simple. Et Koniezcny a exactement la voix et le timbre qu’il faut pour le rôle. Il a une manière de projeter les sons qui rappelle un autre Telramund, de Bayreuth et d’ailleurs, oublié aujourd’hui, Siegmund Niemsgern : exactement le même timbre désagréable notamment dans les graves, exactement la même projection qui fait qu’on a l’impression qu’il chante et qu’il gueule– qu’on me pardonne- en même temps. Mais le texte est dit, bien clairement, et les couleurs sont là : il fait le méchant et chante comme tel. Il a la voix pour ce rôle-là. Koniezcny, – mais je peux me tromper- ne sera jamais Wolfram ni Amfortas – pas plus que Gerhaher ne sera un jour Telramund.
Georg Zeppenfeld
Un des grands triomphateurs de la soirée est Georg Zeppenfeld, qui chante König Heinrich, comme en 2010 et 2011 dans la production Neuenfels où il fut inoubliable, par le chant, et surtout par l’incarnation. Sur un plateau que la mise en scène veut passif au dernier degré, il n’a rien à faire, il est comme tous les autres, il attend, il regarde, mais il n’a plus rien de ce souverain halluciné à la Ionesco avec sa p’tite couronne, dont on se souvient si vivement dans la production Neuenfels. Lui aussi il se contente d’être là.
Mais il chante.
Et là une fois de plus il nous frappe par sa science du phrasé, par la ligne de chant d’une rare homogénéité, par la couleur vocale, par l’intelligence du propos. Il incarne par la voix, mais sans la présence qu’on sait forte quand on lui donne quelque chose à faire sur scène.
On peut admettre qu’une mise en scène veuille montrer la passivité ou l’impuissance des personnages, mais pour cela, il faut trouver des gestes qui la traduisent, et ne pas les laisser sur scène les bras ballants, comme c’est le cas ici Voilà qui pèse lourdement sur l’ambiance générale du plateau, voire sur la lecture scénique.
Piotr Beczala

Piotr Beczala est Lohengrin. Il l’a été une fois à Dresde avec Anna Netrebko sous la direction de Christian Thielemann. Ce fut une représentation annoncée par les trompettes de la renommée. Elle fut honorable, mais pour le mythe, il faudra attendre le prochain cygne…
Beczala est un chanteur éminemment sérieux, qui se prépare, qui maîtrise parfaitement le texte, qui sait magnifiquement chanter. J’ai souri cependant en lisant çà et là qu’il avait un style italien : vu le succès très moyen remporté à la Scala dans Alfredo (huées comprises), on doit supposer que le public de la Scala, ne sait ce qu’est le style italien.
On s’est bien gardé de souligner que là où il possède incontestablement du style, c’est dans le répertoire français. Beczala est une voix, qui affronte la plupart du temps certains opéras italiens et qui devrait se mettre très sérieusement à chanter beaucoup plus en français.
Cependant cette voix parfaitement éduquée et maîtrisée techniquement a le défaut de produire sauf exception un chant uniforme, peu expressif, peu coloré, sans véritable engagement et sans accents : dans le répertoire italien, qu’il chante Alfredo, le Duc de Mantoue ou Riccardo, c’est toujours un peu pareil, dans une perfection formelle qui peine à émouvoir.
Il en va de même pour Lohengrin, qu’il affronte en maîtrisant parfaitement l’ensemble du rôle, à peu près impeccable techniquement, malgré quelques problèmes dans les passages, et un défaut d’appui sur certains aigus, notamment dans « In fernem Land ». Mais plus que les menus problèmes techniques qu’on peut comprendre et sur lesquels on peut aisément passer, il ne dit rien, il ne transmet rien, sauf à de rares moments où la plainte élégiaque semble prendre le dessus (notamment à son arrivée): c’est sans doute dans cette direction qu’il devra approfondir le personnage car il y a là une véritable émotion. C’est sinon un chant d’une perfection assez incolore. Ce chanteur sérieux, qui sait travailler, ira sûrement plus loin dans la caractérisation du rôle, mais pour l’instant, ce n’est pas encore ça. Il n’a pas la manière éthérée de chanter d’un Vogt, il n’a pas les modulations et l’expressivité poétique d’un Kaufmann, ni le charisme d’un Domingo: il a pour l’instant un beau timbre clair, une technique notable, un registre central enviable et stable, mais pas trop d’expressivité. Attendons.
Anja Harteros
Anja Harteros faisait ses débuts à Bayreuth, dans un rôle qu’elle a chanté souvent et dans lequel elle a souvent triomphé. Le soir où je l’ai entendue (le 29 juillet), ce fut une déception. Il semble que les dernières représentations aient été plus convaincantes. Il est vrai que la température avoisinait les 38°/40° et que les efforts physiques consentis par les artistes dans ces conditions peuvent expliquer certains problèmes.
La prestation est allée en s’améliorant après un premier acte non pas hésitant, mais en sous-régime, la voix n’était pas toujours bien projetée, avec des acidités qu’on ne lui connaissait pas. Le deuxième acte, grâce la stimulation du duo avec Waltraud Meier, a été bien mieux dominé. Mais on lui demande dans les deux premiers actes une telle passivité qu’elle peine à rentrer dans ce moule-là. Harteros a besoin de la scène, pour s’exprimer : or aussi bien au premier qu’au deuxième acte, elle reste fixe et au deuxième acte, pendant une partie du temps, on ne voit d’elle que le visage et encore, dans le lointain: il est difficile d’exprimer dans ce contexte.
C’est sans conteste au troisième acte qu’on retrouve la tragédienne qui s’engage, et qui s’affirme : son troisième acte fut saisissant, exceptionnel, la voix n’avait plus ni hésitations ni acidité, elle s’imposait avec une volonté farouche, avec des variations tellement justes dans l’expression, avec un phrasé modèle et de tels accents que ça lui a valu un très grand triomphe aux saluts. Quoiqu’on en glose et on sait ce que vaut quelquefois la glose, Anja Harteros est encore une très grande Elsa : un chanteur peut avoir une fatigue passagère, qui provoque des problèmes dans la manière de travailler le son, mais l’intelligence et la technique restent. Reconnaissons cependant que cette soirée ne fut pas l’une de ses meilleures.
Waltraud Meier
Waltraud Meier disait adieu à Wagner et à Ortrud dans cette série de représentations. On peut dire sans hésiter qu’elle pouvait encore attendre un peu.
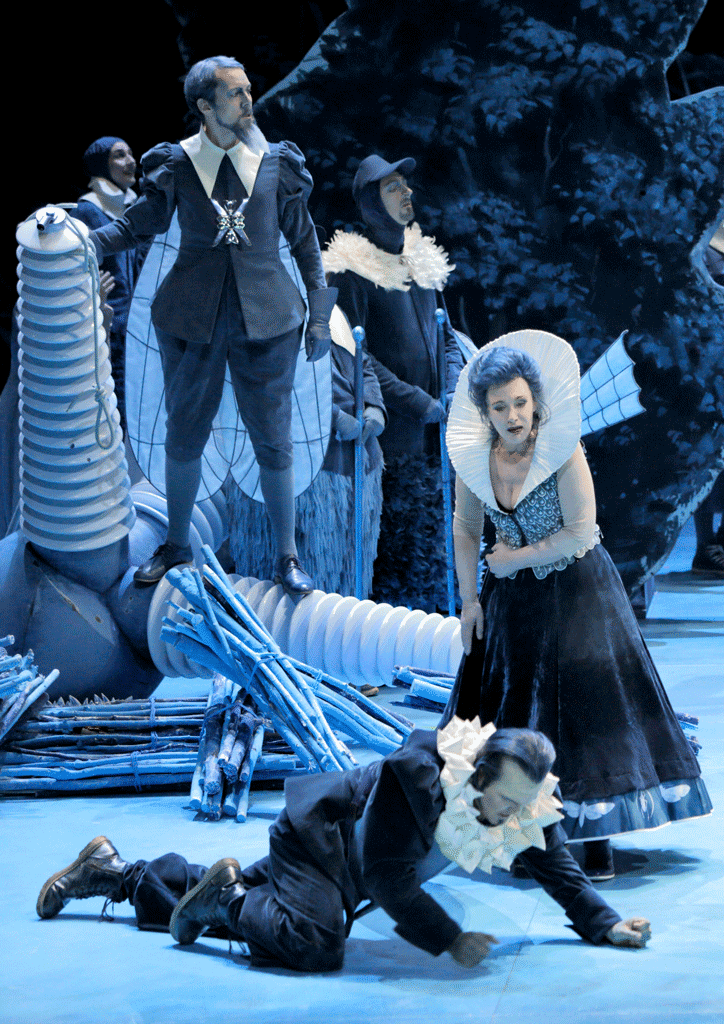
Certes, et ce soir-là en particulier, la voix n’était pas dans sa meilleure forme, ni les imprécations du deuxième acte (Entweihte Götter! Helft jetzt meiner Rache!), ni en particulier celles du troisième (Fahr Heim !), où les aigus étaient particulièrement courts . La voix n’était pas toujours stable et ce ne furent pas les moments impériaux qu’on pouvait attendre. La comparaison avec l’enregistrement de la Première montre qu’il y avait ce soir de la fatigue, que la chaleur épouvantable peut là aussi contribuer à expliquer. Pour les aigus, ce n’était pas son jour et la voix se dérobait.
Mais il y a le reste, qui rend cette Ortrud plus passionnante que toutes les Ortrud « à voix » du marché: nous avons évoqué plus haut l’incroyable composition du premier acte, du grand art, où Ortrud ne chante pratiquement pas, et en tous cas pas en soliste, mais le second acte est stupéfiant d’intelligence du mot, du phrasé, d’expressivité. Aussi bien avec Telramund qu’ensuite avec Elsa, Waltraud Meier trouve immédiatement la juste couleur, ici persiflante et méprisante, là insinuante et douce, pesant chaque mot, infléchissant chaque syllabe, donnant à faire ressentir tout un univers.
On ne peut qu’admirer cet art du dire et cet art du chant, un art du chant qui transcende la musique car – on le voit au premier acte- elle arrive à avoir une présence scénique même sans chanter, comme si elle faisait percevoir au public une voix intérieure. Alors, elle peut avoir raté quelques aigus, d’autres artistes auront sans doute les décibels, mais sans le phrasé, sans le dire, sans cette intelligence ni cette sensibilité… Je doute qu’on trouve à court terme une artiste qui maîtrise à ce point le texte, son sens et surtout qui sache à ce point transmettre. Waltraud Meier, c’est d’abord une tête et c’est ensuite une voix : c’est à cette seule condition qu’on devient mythe.
Un Christian Thielemann des grands soirs
Cette production était confiée à Christian Thielemann, qui cette année aura dirigé à Bayreuth tous les titres disponibles[4] sur ses dix-huit ans de présence. Même si on sait qu’il ne fait pas forcément partie de mon Panthéon des chefs, j’ai toujours plus apprécié son approche des opéras romantiques de Wagner. À Bayreuth, il m’a époustouflé dans Tannhäuser (2004) et dans Der Fliegende Holländer (2013). Et ce Lohengrin est dans la même veine. Le seul point dolent de cette performance exceptionnelle, c’est le suivi du chœur qui ne semble pas avoir été aussi attentif. Comme on l’a vu plus haut, il y a eu des moments très sérieusement erratiques qu’on n’avait jamais vécus ici notamment dans le chœur initial de l’acte III, si attendu.
Par ailleurs, force est de reconnaître un prélude en tous points exemplaire, exceptionnel de retenue, de clarté, de subtilité. Un des moments de grâce de la soirée. D’autres moments furent aussi marquants, comme le final du premier acte, ou l’arrivée du peuple dans le troisième, avec des cuivres dans le lointain d’une netteté et d’une justesse très rares, et un sens du crescendo ahurissant. Il a su doser les volumes avec une grande maîtrise (il connaît la fosse et ses possibilités comme peu de chefs aujourd’hui), sans jamais sur-jouer, sans jamais être « violent » mais gardant toujours une réserve. Ce sens des équilibres, cette manière de faire entendre les choses les plus subtiles, et de garder à l’œuvre son relief sans tomber dans la complaisance (en particulier à l’acte II) ni dans le beau son cultivé pour lui-même ont caractérisé son approche, d’une très grande fluidité et d’une incroyable maîtrise, laissant l’orchestre donner son meilleur.
Au terme de cette longue promenade dans une production dont certains diront qu’elle ne méritait pas tant, deux observations :
- Au sortir de la représentation, j’étais beaucoup plus sévère sur la mise en scène. Le décor impose fortement une vision qui écrase un peu le reste. Même si l’idée dramaturgique est intéressante, la mise en scène et surtout le travail sur les personnages méritent des approfondissements. C’est au Werkstatt Bayreuth de prendre le relais, en profitant de nouveaux protagonistes pour revoir ce qui fait problème (le premier acte par exemple).
- Les aspects musicaux, malgré telle ou telle déception ou fatigue passagère, restent de très haut niveau, à commencer par une direction musicale qui cette fois arrive à convaincre. Il reste au protagoniste de rentrer dans le personnage et d’imposer un style qu’il n’a pas encore trouvé. Laissons du temps au temps.
C’est donc une production en suspens, qui n’est pas si insipide qu’on a bien voulu le dire, mais pour laquelle un travail supplémentaire s’impose. L’électricien devra repasser.
_________________________________________
[1] Chez Neuenfels, si le cygne noir était aussi Ortrud, mais le cygne blanc – la mariée- est Elsa, et non Lohengrin
[2] Catherine Clément, L’Opéra ou la défaite des femmes, Grasset, Paris, 1979
[3] Ah ! ce dernier, ce triste voyage
Comme j’aurais voulu te l’épargner !
Dans un an, quand ton temps
De service se serait achevé,
Libéré grâce au pouvoir du Graal
C’est autrement que je t’aurais revu !
[4] Pour information, Daniel Barenboim, l’autre recordman de présences sur la colline après-guerre, n’a dirigé ni Lohengrin, ni Der Fliegende Holländer.