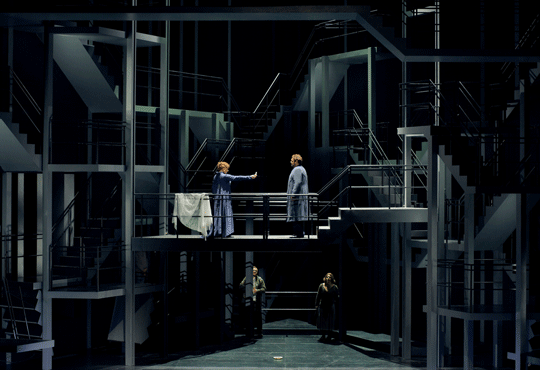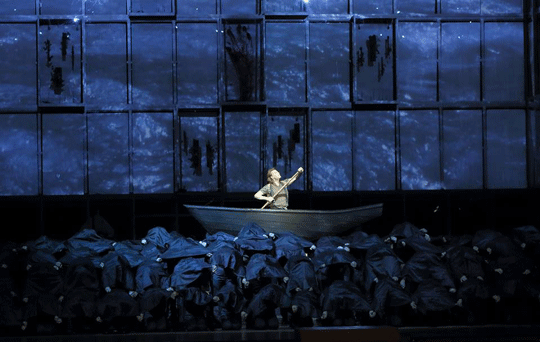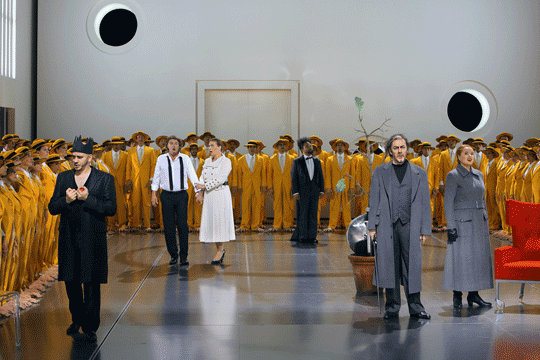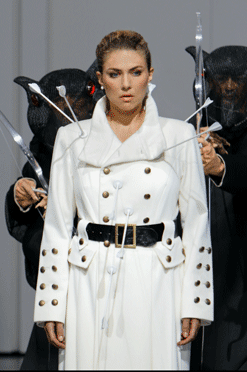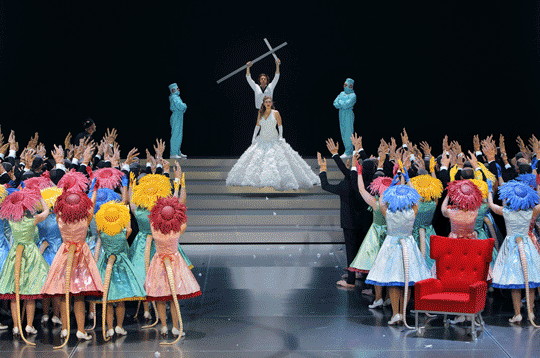Une vision générale
La production de Tristan und Isolde avait un peu déçu à la création en 2015, et cette année encore à la première, Katharina Wagner a reçu des huées, un spectateur s’est même distingué en poussant un buh ! aussi sonore que scandaleux pendant la Liebestod.
A voir et à revoir cette production, elle ne manque ni d’intelligence, ni d’une volonté ferme d’aller jusqu’au bout d’un concept qui a sa cohérence même s’il banalise l’histoire. Au lieu de consacrer le mythe des amants, Katharina Wagner propose de partir des données initiales, à savoir l’amour préexistant de Tristan et d’Isolde, impossible à réprimer, de faire de ces deux êtres des victimes d’un mariage politique. Il n’y a pas de contradiction avec le mythe. Le voyage de Tristan et Isolde est douloureux pour les deux au premier acte puisque leur amour est obéré d’une part par la situation, d’autre part par le sens de l’honneur de Tristan dans le monde chevaleresque médiéval.
Ce qui fait la différence ici ce sont deux éléments :
– d’une part la volonté des amants de vivre au grand jour cet amour (pourtant nocturne)
– d’autre part l’attitude de Marke, qui refuse la situation pour sauvegarder les apparences.
Il y a donc deux mondes, un monde du calcul politique pour qui tout doit aller selon les formes, indépendamment de la substance, et un monde personnel et intime des émotions et des moi qui veulent vivre leur passion, pour qui tout est substance et rien n’est forme.
Toute l’histoire réside dans la totale incompatibilité des deux univers, que Katharina Wagner concentre dans sa manière de traiter le personnage de Marke, loin du vieillard accablé dans sa chair, mais plutôt le roi qui doit gérer une sale histoire politique qui gêne ses objectifs.
Katharina Wagner refuse de laisser aller le spectateur à une sorte d’ivresse musicale alimentée par la musique de son aïeul. Elle revient à une analyse froide et distanciée d’une situation et d’un contexte, avec le bistouri caractéristique du Regietheater, qui refuse les moments attendus : pas de navire au premier acte, mais un enchevêtrement d’escaliers à la Escher, qui se meuvent sans cesse, qui sans cesse aboutissent au vide en une sorte de labyrinthe amoureux impossible. Le philtre n’est pas bu (inutile dans ce cas) et la fiole est vidée ensemble.
Après qu’Isolde et Brangäne eurent été jetées dans une cour sombre, bientôt rejointes par Tristan et Kurwenal, le duo d’amour du 2ème acte est cassé pour l’essentiel par l’apparat du décor et des accessoires, hauts murs d’une prison, projecteurs violents qui éclairent les amants et surveillance permanente de Marke et ses sbires en hauteur. Au fond de la cour, il se passe beaucoup de choses aussi, dissimulation sous un grand drap brun éclairé par des petits étoiles, grilles multiples qui semblent être des parkings à vélo dont on voit le modèle dans Bayreuth, qui deviennent instruments de torture, volonté de mourir en s’ouvrant les veines etc.…Un lieu dont on n’échappe pas, et peut-être fait pour mourir…
Si au deuxième acte les amants essaient d’abord de se dissimuler, l’exaltation fait qu’ils s’exposent à la lumière des projecteurs, jusqu’à vouloir mourir ensemble, mais cette mort leur est empêchée par Marke arrivant avec Melot, qui ne veut surtout pas d’une mort à deux. Ainsi donc Marke ne surprend pas les amants mais intervient pour empêcher le pire, non dans leur intérêt mais dans le sien propre. Il hésite d’ailleurs à sacrifier Tristan, arrache Isolde et l’emmène, pendant qu’il laisse Melot faire le sale boulot. Un Melot qui aussitôt après semble pris de trouble, de remords devant un Tristan qui semble déjà passé à meilleure vie. C’est sur ce trouble que tombe le rideau
Le troisième acte est au départ plus conforme : une autre ambiance dans les éclairages brumeux sublimes de Bayreuth. La mise en scène du troisième acte, avec le très long monologue de Tristan est toujours un peu une gageure : Katharina Wagner entre dans l’univers visionnaire et délirant de Tristan, et en suivant le texte, fait apparaître dans des bateaux stylisés dans lesquelles des fantômes/fantasmes d’Isolde apparaissent, qui échappent à Tristan sans cesse dans une sorte de quête désespérée.
La fin est plus radicale.
L’arrivée tardive d’Isolde n’ayant pas empêché la mort de Tristan, conformément au livret, elle prépare avec Kurwenal le cadavre, mais l’arrivée de Marke (brutale), interrompt l’action, la scène s’éclaire comme si dans l’ombre tous étaient déjà là depuis longtemps. Marke, Melot, Brangäne sont entourés de soldats, avec un catafalque, et les soldats portent une écharpe de deuil. Funérailles que Marke veut officielles, politiques sans aucune autre forme de procès : on dresse donc le catafalque et le cadavre de Tristan. Mais Kurwenal ne l’entend pas ainsi et c’est un massacre mutuel : les cadavres gisent en tas, et sur scène restent seuls Marke, Brangäne, Isolde.
Isolde chante donc sa Liebestod dans un beau mouvement où elle dresse le corps de Tristan à ses côtés, comme s’il était vivant, dans une dernière étreinte. Mais visiblement Marke estime qu’on a trop perdu de temps et arrache Isolde à son Tristan, et l’emporte, dans le même mouvement qu’il l’emportait au 2ème acte, pour laisser sur scène le cadavre de Tristan abandonné sur le catafalque, et Brangäne, seule et désemparée.

Les personnages
Plusieurs observations sur une mise en scène qui déstabilise le public et n’a pas enthousiasmé la critique :
Les personnage de Tristan et Isolde sont traités dans la vérité d’un amour et d’un besoin absolu l’un de l’autre, sans rémission, sans aucune considération sur leurs destins individuels ou sur le regard d’autrui : ils existent, l’un pour l’autre, à l’exclusion de tout le reste. Ils s’excluent de toute société, et ainsi, acceptent les destins quels qu’ils soient, ils portent les mêmes couleurs, un bleu soutenu, une sorte de bleu céleste et profond qui tranche sur les couleurs des autres personnages. C’est en fait les deux personnages les plus conformes à l’histoire et à la tradition.
Brangäne et Kurwenal sont tous deux à la fois dépendants des deux premiers, et essaient sans cesse de les faire revenir à la réalité du quotidien, qui est compromis, voire compromission. Ils sont leur seul lien vers les autres, des représentants d’une raison sociale qu’ils ne peuvent que mal défendre, ils sont le relatif qui se bat contre l’absolu, mais en même temps leur destin est étroitement scellé aux amants : ils sont là, toujours là, cherchant à empêcher le pire, au premier acte où ils font tout pour bloquer issues et coursives, et empêcher une rencontre, mais aussi pendant le duo du deuxième acte où ils essaient, prisonniers eux aussi des haut murs qui barrent tout horizon et tout futur, d’en sortir sans succès.
À la fin du III, Kurwenal est mort et Brangäne laissée seule avec le cadavre de Tristan, sans fonction, sans futur non plus.
Kurwenal à l’instar de Brangäne est un combattant de l’inutile, ce sont tous deux des personnages trop terriens, trop prosaïques, pour lutter à armes égales, ils portent les mêmes couleurs et des costumes voisins, leur statut est semblable, celui des confidents désespérés.
Marke et ses sbires, mais aussi Melot sont en jaune-moutarde, une couleur désagréable et vive : le jaune n’est-il pas selon certains la couleur des cocus, des traitres et des jaloux ? Cette identification qui tranche avec les autres costumes est violence en soi, tant elle est désagréable au regard, renforcée par le chapeau et la fourrure de Marke : le chapeau qui dissimule le visage et la fourrure qui donne le statut et le pouvoir. Marke est celui qui surveille, qui veille à ce que les formes soient respectées, et qui doit se débarrasser d’un gêneur. Tristan n’est pas seulement le rival en amour mais sans doute aussi le rival en politique : un bras armé de la monarchie trop noble, trop puissant et donc trop dangereux. Rival en amour, il pourrait aussi tramer avec Isolde quelque méfait : Sieglinde et Siegmund contre Hunding chez Wagner, mais tant de couples chez Shakespeare ou Marlowe qui se débarrassent du roi gêneur. Rien de tel n’est écrit bien sûr, rien de tel n’est dit, d’autant que le discours de Marke dans le livret peut se prêter à toute autre interprétation. Mais si on le lit avec une clef exclusivement politique, c’est un discours qui condamne le traître, dans une sorte de tribunal où le traitre ne répond pas
« O König, das
kann ich dir nicht sagen;
und was du frägst,
das kannst du nie erfahren.»
Georg Zeppenfeld, les deux années précédentes, allait jusqu’au bout de la figure voulue par la mise en scène et se comportait en salaud patenté. C’était même la marque de fabrique de ce Marke et de cette mise en scène, que de transformer le roi en monstre glacial et calculateur.
Ce que change l’arrivée de René Pape
 Le changement de distribution, où René Pape (après deux décennies d’absence de Bayreuth) chante Marke, a demandé une réadaptation de la mise en scène au chant et à l’expression de René Pape – encore un exemple du Werkstatt Bayreuth.
Le changement de distribution, où René Pape (après deux décennies d’absence de Bayreuth) chante Marke, a demandé une réadaptation de la mise en scène au chant et à l’expression de René Pape – encore un exemple du Werkstatt Bayreuth.
Zeppenfeld était un Marke jeune, un roi qui avait à asseoir son pouvoir et à se débarrasser des dangers potentiels.
René Pape introduit par son interprétation même un espace humain plus large, plus complexe que le méchant absolu de Zeppenfeld, et donne du même coup à la mise en scène « du mou », un espace où les hésitations des hommes et où les sentiments, avec leur fragilité et leur relativité, peuvent s’épanouir, un espace pour le doute. Car René Pape est plus âgé que Zeppenfeld, avec une voix plus profonde, à peine vieillie (il fut avec Abbado en 2004 à Lucerne dans l’acte II de Tristan, le plus grand des Marke, un monument insurpassable et insurpassé) et il ne peut faire le même personnage. Il chante donc avec une autre expressivité, d’une manière plus bouleversée, plus personnellement atteinte, plus intérieure aussi, comme s’il se chantait à lui-même : c’est un homme blessé presque contraint, presque poussé par un Melot (Raimund Nolte, remarquable, l’un des meilleurs Melot qui soit donné d’entendre, alors que souvent c’est un rôle sacrifié) plus âme damnée que chevalier. Marke est venu pour sauver Isolde de la mort qu’elle veut se donner, et Marke laisse le poignard à Melot non parce qu’il laisse aux médiocres les basses œuvres et qu’il ne veut pas se salir (ça c’était Zeppenfeld), mais parce qu’il en est simplement incapable et qu’il ne veut pas voir ça. Et s’il emmène Isolde avec lui, c’est tout autant pour la soustraire à Tristan que la soustraire au spectacle de la mort du héros. Ainsi le sens de la scène en est changé, et du même coup le sens de la Liebestod.
Au dernier acte en effet : Marke vient pour des funérailles officielles (il a donc vu et su la mort de Tristan, il continuait donc d’être dans l’ombre…) qui peut-être sont alors sincères, et pour chercher Isolde, pour en finir sans doute avec cette histoire et quelque part pour la sauver, comme au deuxième acte, de la mort, même si c’est une Liebestod. Marke, c’est d’une certaine manière la volonté de vivre.

Un parti pris radical
Il y a donc dans ce travail de Katharina Wagner certes un parti pris de lutter contre le mythe, ou plutôt lutter contre les effets de catharsis chez le spectateur, une volonté de distancier, très brechtienne, assez idéologique, et d’expliquer par des raisons humaines (qui peuvent être politiques ou cyniques) les comportements et les réseaux de causalités. Elle ouvre ainsi – peut-être pas toujours avec doigté (mais c’est voulu) – d’autres espaces à cette histoire où toutes les mises en scène, Chéreau dont ce n’est pas le meilleur travail compris, restent dans le mythe, et dans la musique enivrante de Wagner qui nous atteint physiquement. Katharina Wagner connaît trop bien un phénomène dans lequel elle a vécu toute sa jeunesse et elle cherche donc autre chose, qui puisse aussi éclairer l’histoire, la faire descendre du piédestal et montrer de cette œuvre d’autres horizons. On peut ne pas partager cette vision, on ne peut nier sa logique : on comprend alors mieux la sécheresse des décors de Frank Philipp Schlößmann et Matthias Lippert, leur aspect géométrique, acéré et coupant, la volonté de noirceur, de froideur qui domine toute la soirée, et surtout le refus d’un esthétisme (on se rappelle Ponnelle sur cette même scène, mais aussi Heiner Müller) qui ramènerait le spectateur à la chatoyance de la musique et lui ferait abolir une fois de plus la distance que Katharina Wagner désire installer.
La splendide exécution musicale
La distribution
Ce qui caractérise aussi la soirée c’est une exécution musicale supérieurement réussie à tous niveaux. On a évoqué le cas de René Pape, impérial d’intériorité et de présence, à la voix profonde et sonore, incroyable d’humanité. On évoquera évidemment Stephen Gould, le Tristan du moment, en pleine forme en pleine voix, au timbre clair, à la diction impeccable, à l’émission complètement maîtrisée et contrôlée, simplement prodigieux.
Iain Paterson en Kurwenal a à la fois l’élégance, et l’expressivité, il a la retenue et en même temps la tension, son texte est dit de manière impeccable et il est doué d’une vraie présence dans ce rôle qui lui convient mieux que Wotan : il est vrai aussi que la direction d’acteurs de Katharina Wagner est moins millimétrée que celle de Castorf.
Les seconds rôles sont tous très bien interprétés : aussi bien, on l’a dit, le Melot de Raimund Nolte, vraiment excellent, que Tansel Akzeybek, à la voix de ténor toujours claire, acérée, très bien projetée dans le double rôle du berger et du jeune marin, ainsi que Kay Stiefelmann (ein Steurmann), qui intervient très peu, mais donc on reconnaît immédiatement le beau baryton qu’il sera sous peu.
D’une rare intensité, puissante, présente, la Brangäne de Christa Mayer, qui a sans doute le plus gros succès auprès du public avec Stephen Gould : c’est aujourd’hui l’une des meilleures Brangäne qui soient, expressive, au chant nuancé, coloré, à l’engagement vocal sans failles, vraiment extraordinaire.
Quant à l’Isolde de Petra Lang, voilà une voix clivante qu’on aime ou qu’on déteste. On ne peut nier un véritable engagement, une volonté d’interpréter le rôle, une voix au volume important, des aigus triomphants, une Liebestod très contrôlée, que le tempo large de Christian Thielemann accompagne et fait respirer. On ne peut nier non plus des moments où la voix s’échappe, mal contrôlée, pas toujours juste, avec des sons moins agréables. Ce n’est pas l’Isolde de mes rêves mais soyons justes, elle a eu naguère des moments plus difficiles et on est loin d’une prestation médiocre. C’est une Isolde digne, sans être celle du moment.
Une direction musicale fascinante
Enfin, Christian Thielemann, moins complaisant dans la recherche du son que les années précédentes, fait entendre un orchestre totalement bluffant. D’abord ce qui frappe, c’est l’absolue maîtrise des volumes et du son, c’est l’absolue maîtrise de la fosse, c’est un son orchestral d’une incroyable pureté, complètement dominé, massif et fascinant, qui vous saisit dès le prologue, c’est aussi une démonstration impressionnante de science des équilibres et des couleurs, dont toute la palette est utilisée, c’est enfin une énergie et une tension qu’on n’avait pas les autres années et qui cette année frappe. Ce n’est pas toujours émouvant – mais cette mise en scène n’appelle pas l’émotion- c’est plutôt fascinant à chaque instant dans le rendu. Seules les dernières notes excessivement tenues, me paraissent un peu exagérées et complaisantes. L’orchestre conduit par Thielemann n’a pas toujours la clarté ou les qualités cristallines de certains, mais il produit un son quasiment unique dans ce théâtre, un son qui vous rend ivre, presque hypnotisé.
Impeccable et discutable en même temps, ce Tristan ne mérite pas la violence de certaines réactions, mais il appelle sans conteste d’âpres discussions : c’est justement pour ça qu’on vient aussi à Bayreuth.[wpsr_facebook]

________________________________________________
| Musikalische Leitung | Christian Thielemann | |
| Regie | Katharina Wagner | |
| Bühne | Frank Philipp Schlößmann Matthias Lippert |
|
| Kostüm | Thomas Kaiser | |
| Dramaturgie | Daniel Weber | |
| Licht | Reinhard Traub | |
| Chorleitung | Eberhard Friedrich | |
| Tristan | Stephen Gould | |
| Marke | René Pape | |
| Isolde | Petra Lang | |
| Kurwenal | Iain Paterson | |
| Melot | Raimund Nolte | |
| Brangäne | Christa Mayer | |
| Ein Hirt | Tansel Akzeybek | |
| Ein Steuermann | Kay Stiefermann | |
| Junger Seemann | Tansel Akzeybek | |