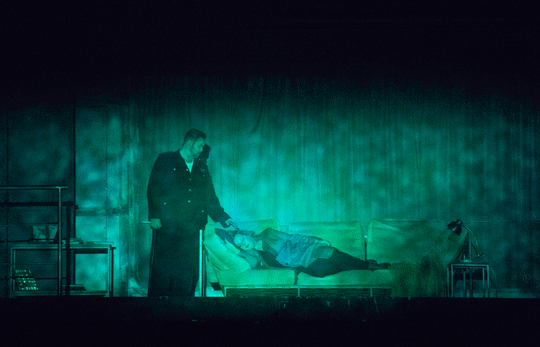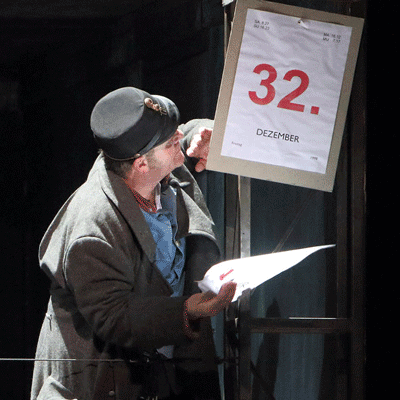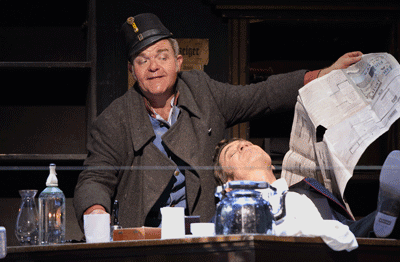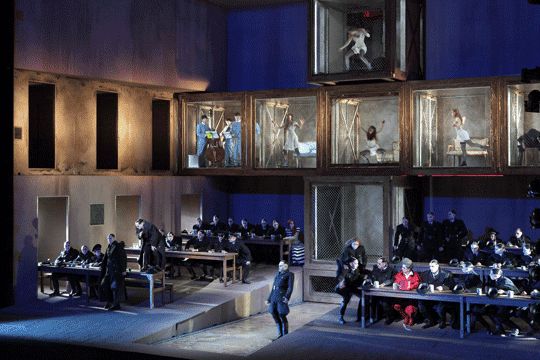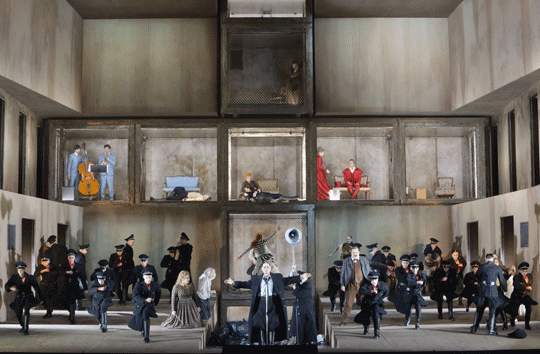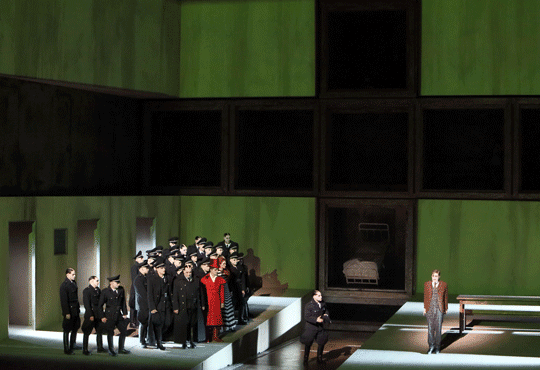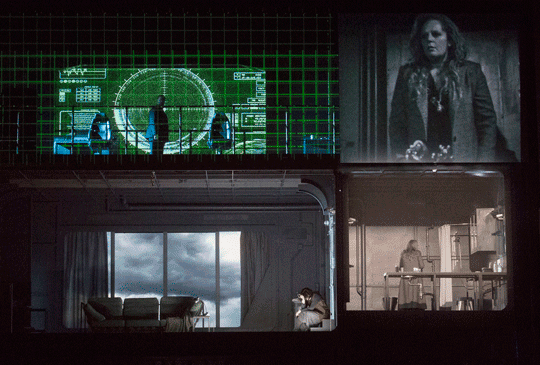
Il y a une histoire de la relation de Tristan und Isolde aux Berliner Philharmoniker depuis la deuxième guerre mondiale et notamment depuis Karajan. Karajan à l’aube des années 70, Abbado au crépuscule du siècle (1998 et 1999) et maintenant Rattle au début du XXIème siècle vont alimenter l’histoire de la lecture de l’œuvre par les berlinois : chacun a apporté un vrai point de vue, et à chaque fois l’orchestre de Berlin a stratifié ces lectures par des traces sonores qu’on a encore très vivantes et fortes. L’enregistrement Karajan a marqué, parce qu’il a toujours fait discuter. Il existe des traces radio du Tristan berlinois d’Abbado qui n’en doutons pas vont un jour ressortir des archives (tout comme son Parsifal) et qui, par son acte II notamment et par les harpes finales de l’acte III, remet quelques pendules à l’heure. Ce qui ressort de Rattle, c’est d’abord la mise en valeur de l’orchestre, à vrai dire époustouflant. On a rarement atteint tant de clarté, tant de chair, tant de transparence aussi. Karajan se (et nous) noyait dans une ivresse sonore jamais reproduite depuis, Rattle ne nous noie pas, mais nous fait flotter sur un océan harmonique, fait de détails si pointus qu’ils étonnent, comme émergés d’une partition qu’on croyait connaître et qui révèle encore des constructions multiples et foisonnantes, abyssales mêmes. L’auditeur en reste stupéfié et frappé.
Le chef britannique s’intéresse aux détails les plus minimes, met au point d’une manière maniaque une mise en ondes sonores qui laisse rêveur, et donc la somptuosité de l’orchestre secoue. Et ainsi son Tristan est présent, puissant, charnu, rutilant même quelquefois (un peu trop ?), en une interprétation soucieuse de mise en relief de la partition, avec ses modulations, ses contrastes de volume, sa présence, grâce à un orchestre au sommet dont les bois notamment sont à dire vrai inhumains dans leur perfection, sans parler des cordes et notamment des violoncelles et contrebasses.
Oui, ce Tristan commence par l’orchestre, inouï, stupéfiant, historique. Par l’orchestre que le chef ne cesse de mettre en valeur, mais qui et c’est presque paradoxal, ne propose pas cependant de lecture neuve de cette partition si fréquentée par les théâtres et par les grands chefs. L’interprétation reste académique, au bon sens du terme, classique, au bon sens du terme : rien de neuf, mais une perfection formelle telle qu’elle devient presque un modèle pour les classes, un modèle pour les académies, une interprétation statufiée telle qu’en elle-même l’éternité pourrait la changer. On n’est ni dans une danse de la mort comme chez Abbado, ni dans la lente et fascinante progression bernsteinienne, ni dans la profusion sonore kleibérienne ou l’énergie d’un désespoir à la Barenboïm (j’en reste aux Dieux de mon Panthéon personnel). Rattle ne s’attarde pas sur le son, à la manière d’un Thielemann, mais ouvre une boite de Pandore infinie avec une sorte de modestie personnelle qui le dissimule derrière les splendeurs de l’orchestre.
Car la question du beau est bien centrale dans l’analyse de ce Tristan. De la part des Berliner Philharmoniker et à ce niveau d’exécution, le beau est le « nécessaire basique», mais une exécution de ce niveau réclame peut-être autre chose : le beau est l’attendu, mais à part cette foule de détails révélés qui ajoutent à notre connaissance de l’œuvre et à la stupéfaction permanente dont elle est l’objet à chaque exécution, il n’y a pas de « propos ».

En terme d’interprétation, de regard sur l’œuvre, de point de vue, d’originalité, il reste donc un peu de frustration car on ne trouve pas dans cette exécution, si « belle » soit-elle, de quoi nous ouvrir vers d’autres possibles musicaux. L’exécution correspond à l’attendu dans sa perfection formelle, mais peut-être pas à l’espéré dans ses possibles interprétatifs.
Je sens le lecteur agacé par mon analyse d’enfant trop gâté, mais à quoi servirait ce blog s’il se contentait de servir la soupe ? J’ai toujours considéré Sir Simon Rattle comme un très grand chef, voire un inventeur dans certains répertoires, dans le répertoire français par exemple, ou britannique et américain dans lequel il n’est pas égalable aujourd’hui, mais pas dans Wagner, ni dans le grand répertoire germanique romantique et post romantique.
Dans ce Tristan, il valorise une lecture plutôt pathétique de l’œuvre (il est en accord avec la mise en scène qui refuse à l’histoire de Tristan une valeur de tragédie), marquant avec insistance les moments les plus urgents, qui sont même souvent abordés avec un volume un peu excessif : on n’est pas dans une lecture philosophique, ni dans une lecture abstraite, ni dans une métaphysique de l’œuvre mais dans une lecture plus psychologique qui laisse la place aux déchirures individuelles, aux drames intimes des personnages. Tristan vu comme drame romantique, presque comme mélodrame, et non comme tragédie universelle.
Et notre oreille complaisante d’éternelle midinette accueillera sans doute le pathos avec une certaine satisfaction. Mais le pathos, c’est ce qu’on ne garde jamais dans les souvenirs.
Dans cette optique, le chant peut se déployer avec des couleurs variées. Le britannique Sir Simon Rattle a choisi une distribution de protagonistes essentiellement non germaniques: Sarah Connolly, Stephen Milling, Stuart Skelton, Eva-Maria Westbroek et c’était pour beaucoup des prises de rôle : une distribution neuve pour un festival est toujours un élément excitant, et une prise de risque intéressante, de cela on doit vivement remercier. Quel intérêt d’aller dans un festival pour retrouver les mêmes que sur les scènes en vue : pour cela il suffira d’aller au MET l’an prochain où nous attendront René Pape, Nina Stemme et Ekaterina Gubanova dans la même mise en scène et avec Sir Simon Rattle dans la fosse.
Choisir le risque, c’est aussi assumer les erreurs de casting ou les décalages : Sarah Connolly est une non-Brangäne valeureuse, douée d’une diction impeccable, qui aborde le rôle en musicienne, mais en projection et en style, nous n’y sommes pas, il manque une véritable couleur dramatique, comme dans les « Einsam wachend in der Nacht…habet Acht » et le second « Habet Acht » du deuxième acte, où la voix manque de corps et ne réussit pas à s’imposer, cette présence vocale forte, en dépit de notables qualités d’une artiste bien connue et appréciée, manque une peu dans l’ensemble de l’oeuvre. Sarah Connolly, une des artistes les plus prisées dans le répertoire baroque, abordait là un tout autre univers, elle n’est pas encore bien installée dans Brangäne, et pour l’instant le rôle n’apporte rien de plus à sa (flatteuse) réputation.
Michael Nagy était Kurwenal. Une prise en rôle pour un chanteur bien familier du grand répertoire, c’est un notable Heerufer de Lohengrin, un Wolfram éminent. Il a été un magnifique Stolzius dans Die Soldaten à Munich. Bref, un chanteur aux qualités multiples (il est aussi un bon chanteur d’oratorio) et toujours intéressant. Dans Kurwenal, il semble avoir quelque difficulté à projeter au premier acte, où la brutalité du rôle ne lui convient pas et où la voix est quelquefois un peu couverte. Au troisième acte au contraire, il est dans son élément, plus poétique, plus intérieur : la palette des couleurs peut s’ouvrir avec une émission et une diction qui font de ses premières répliques quelque chose qui rappelle l’univers du Lied. Nagy est décidément un chanteur intelligent et raffiné, il pourrait être un Beckmesser de choix. Une belle prestation qui ne déçoit pas dans l’ensemble, même si ses qualités seraient sans doute plus mises en valeur dans l’autres rôles.
Stephen Milling est Marke, tout en blanc comme le Pinkerton des familles dans cet univers de marins un peu américanisés qu’installe le metteur en scène Mariusz Trelinski (en préparation de la présentation au MET ?). Ce chanteur valeureux, mais à la personnalité pas toujours marquée, se montre ici un Marke remarquable. Sans être une basse profonde, il montre un chant incarné, bien projeté, puissant, à la diction parfaite, et avec une jolie palette de couleurs, très expressif. On connaît bien ce chanteur, souvent sans reproche au niveau musical – il a chanté Marke sur toutes les scènes- mais quelquefois un peu en retrait du point de vue scénique, il est ici pleinement dans le rôle, dans une sorte de simplicité naturelle, sans jamais forcer et la prestation est remarquable.
`Les rôles moins importants sont bien tenus, notamment Thomas Ebenstein, le « Hirt » (berger) au début du troisième acte, à la voix bien marquée, très claire, bien projetée et énergique, plus affirmée que dans le Junger Seeman au premier acte. Quant à Melot, il est bien défendu par Roman Sadnik. C’est un rôle ingrat, peu mis en valeur (et pour cause, c’est le traître) et il est souvent distribué de manière moyenne. Ce n’est pas le cas ici, la voix est claire, et se note.
`

Stuart Skelton est Tristan, une prise de rôle qui attisait la curiosité. Disons-le tout de suite, ce n’est pas un Tristan à la voix qui telle l’ouragan écarte tout sur son passage. Et c’est ce qui justement en fait le prix : Skelton est un Tristan lyrique plus que dramatique, émission soignée, diction impeccable, clarté de la voix exemplaire : on comprend tout, on entend tout pas tant à cause du volume mais plutôt du style et de la technique. Il y a beaucoup de poésie dans cette manière de chanter. Et donc, on peut dire que c’est une jolie surprise, et qu’il assume le rôle. Certes, la voix n’a pas toujours la puissance dramatique habituelle et elle fatigue, notamment dans les tensions du troisième acte. Dans une salle aussi favorable pour les voix que Bayreuth, il serait sans doute plus à l’aise que dans l’immense vaisseau de Baden-Baden. Il reste que même là, il réussit à émouvoir et à proposer un Tristan inhabituel, au chant quelquefois proche de la cantilène et vraiment attachant. D’autant qu’il n’y pas un seul Tristan aujourd’hui qui soit un véritable Heldentenor, même pas Stephen Gould qui est la référence aujourd’hui.
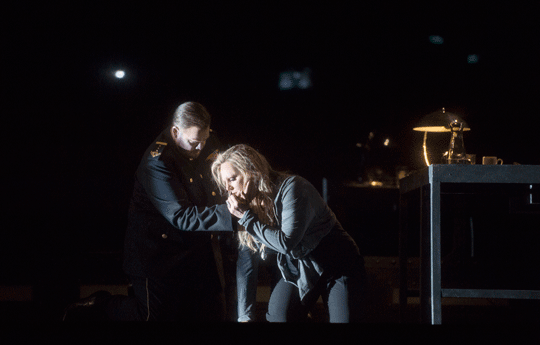
Enfin Eva-Maria Westbroek, qui devait chanter Isolde à Bayreuth puis qui a renoncé chante le rôle de mieux en mieux à mesure qu’avance la représentation. Elle aussi est une voix plus lyrique (spinto bien sûr) que dramatique pour mon goût. C’est une belle Sieglinde, une magnifique Cassandre. Est-ce une Isolde ? Elle arrive au bout du rôle, avec des aigus et suraigus difficiles et métalliques à la limite de la justesse au premier acte et des graves détimbrés. C’était même un peu inquiétant car seul un registre central riche et charnu la rendait convaincante. Le début du deuxième acte n’est pas arrivé à convaincre non plus ; mais le duo d’amour avec un Skelton élégiaque a fonctionné, et par rapport à la voix du ténor avec une fusion assez magique, et aussi en soi, avec un lyrisme, un allant, un engagement qui n’appellent que des éloges. Même conviction au troisième acte, peut-être encore plus dans sa première intervention Ha! Ich bin’s, ich bin’s, süssester Freund! Où elle montre un engagement peut-être plus tendu et émouvant que dans le Mild und leise proprement dit. Dans sa première intervention, elle arrive à donner des couleurs très variées, avec une urgence éperdue. Et toutes les notes passent. Ce qui donne à son « Mild und leise » une humanité extraordinaire et presque une authentique émotion, au-delà de certains éléments techniques, et même si la note finale « Lust» est tenue en filé, et très légèrement savonnée. Elle est aidée par un orchestre formidable qui la soutient, mais qui ne donne pas aux dernières mesures la suspension que donnait un Abbado par exemple (pour parler du même orchestre). D’autres Isolde sont plus convaincantes, mais sans être l’Isolde du moment ni je pense du futur, elle est une Isolde présente. Je pense que dans la salle de Bayreuth elle-aussi eût été plus à l’aide avec une voix qui serait mieux passée. Il est dommage qu’on ne l’y voie pas. Plus généralement je crains un peu qu’elle se perde dans la fréquentation de répertoires divers : Isolde, Sieglinde, Santuzza, Manon Lescaut, Minnie, Desdemona, Wally, Jenufa, Katia Kabanova, Maddalena di Coigny sont des rôles très différents et pas forcément adaptés à sa voix actuelle, ce qui peut être dangereux. À ce jeu, une Cheryl Studer y a laissé une voix qu’elle avait splendide.
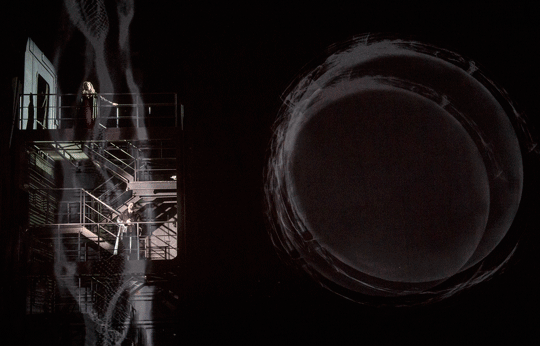
Scéniquement, le travail de Mariusz Trelinski me laisse perplexe. Je suis sorti agacé de la représentation, parce que j’y ai vu une production faussement moderniste, un habillage, pour des options finalement assez banales, ou empruntées : les vidéos (signées Bartek Macias) , dans leur rapport à la scène (bateau dans la tempête, mer houleuse ou démontée, mouettes, soleil noir de la mélancolie – selon les dramaturges du spectacle) font penser (ou référence ?) au travail de Sellars et Viola, le lit d’hôpital au 3ème acte, ressemble beaucoup à celui de Marthaler. Ce sont deux productions très axées sur le monde mental des individus, sur leur affectivité, sur les déchirures, mais très hiératiques. Certes, les besoins des coproductions imposent de travailler en direction de publics très divers. Le public américain n’a pas la même relation à la scène que le public européen par exemple, et la scène polonaise théâtrale est bien plus avancée que d’autres scènes européennes. L’impression prévaut d’options finalement peu dérangeantes, destinées à plaire à tous. Non que je désire par force être dérangé ou bousculé, mais on connaît mon goût pour les mises en scènes qui posent clairement une problématique et qui proposent des axes de lecture. Tout me semble dispersé ou anecdotique : fallait-il qu’Isolde ait la cigarette au bec ? fallait-il qu’à la fin elle s’ouvre les veines pour justifier faire de la Liebestod un « banal » suicide, dans une sorte de réalisme bien discutable. À ce jeu, l’Isolde aux stigmates de Chéreau était autrement plus forte.
Mon premier problème avec cette production, c’est le décor, assez chargé, multiple, notamment au premier acte. Salon, bureau, coursives, pont supérieur, passerelle, où on monte et on descend et où les personnages sont dispersés. Un décor qui devient presque trop anecdotique lui aussi. Qui surcharge sans nous apprendre plus de l’histoire. Fallait-il aussi trois décors pour trois scènes à l’acte II, une sorte de tour de contrôle mirador, la même retournée, et un salon obscur ?
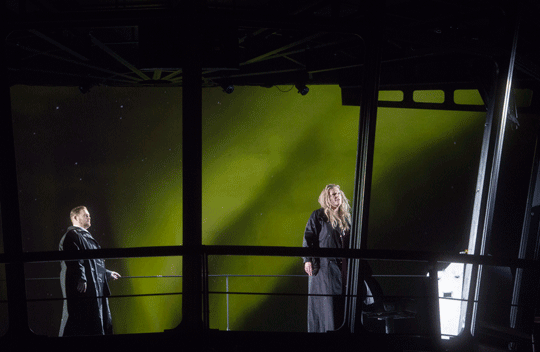
Le troisième acte reste plus concentré sur un seul espace, parce que l’espace en l’occurrence, c’est d’abord l’espace intérieur de Tristan, et c’est un peu plus clair.
Mariusz Trelinski et son décorateur Boris Kudlička veulent évidemment un espace sans chaleur, métallique, vaguement inquiétant parce que guerrier. Ce n’est pas d’ailleurs le fait qu’on ait un navire de guerre au premier acte qui soit dérangeant : c’est cohérent avec l’histoire, c’est surtout cette déperdition inutile dans le détail, les écrans radars verts, projetés dès le prélude, et à chaque acte, la passerelle de commandement ultra moderne et sa version terrestre à l’acte II, le divan sur lequel dort Isolde (on lui donne un salon parce qu’il n’y sûrement pas de cabine), comme une invitée de dernière minute à qui l’on n’a pas trouvé de couche, ou le revolver Tristan et Isolde s’échangent. Il y a quelque chose de cinématographique dans ce réalisme agressif, alors qu’il n’y pas moins cinématographique, ni plus théâtral que Tristan, dans sa concentration et son essentialité.

Le seul élément cohérent et juste, c’est la présence permanente de la nuit, thème central du duo du 2ème acte, une nuit oppressante, avec ses lueurs et ses phares : des projecteurs qui aveuglent et qui cachent plutôt qu’éclairer : un jeu d’ombres qui devient menaçant notamment au 2ème acte. Les lumières (de Marc Heinz) dans cette ambiance uniformément nocturne, ont donc une particulière importance, notamment le vert un peu glauque qui est celui des radars, mais aussi des éclairages nocturnes extérieurs, un vert qui ne cesse de rappeler un monde de nuit et de brouillard. Il n’y a pas de lumière apaisante mais sans cesse des lumières glaciales, violentes ou rasantes, diffuses ou coupantes, qui ne laissent jamais indifférent voire qui dérangent.

Voilà pour l’ambiance, volontairement concrète et menaçante, une ambiance qu’on aimerait fuir.
Fuir, c’est bien ce qui occupe l’âme de Tristan, prisonnier de codes qui l’enserrent, code de l’honneur, code de l’obéissance, code militaire : Trelinski insiste sur le monde militaire et ses contraintes, nous sommes au milieu d’officiers en uniforme (au deuxième acte leurs visages sont dissimulés par des masques argentés, presque comme des restes d’armures), qui ont un rapport agressif et violent à Tristan, frappé, mis à terre, puis dégradé, mais aussi à Isolde, qu’on fait sortir de la salle et qui regarde la scène derrière une vitre. Cela aussi m’a gêné : faut-il tant d’action ? Une fois de plus, l’univers cinématographique s’impose dans cette vision, comme s’il fallait à toute force faire ou montrer quelque chose, alors que par ailleurs le metteur en scène ne fait rien de Marke, qui dans d’autres mises en scène à tort ou à raison est un pivot : chez Chéreau c’était un être profondément humain qui adressait son monologue non à Tristan mais à Melot, ce qui prenait un sens face aux lois de l’amitié et de la fidélité, chez Sellars, il se déclarait à Tristan en amant trahi, chez Katharina Wagner, c’était l’insupportable méchant, voyeur, vengeur, chez Marthaler, il apparaissait dans le pardessus gris d’un dignitaire du Parti local. Ici…rien, il dit son monologue, va de droite à gauche, s’asseoit, se lève, mais rien n’est dit sur lui et sur son être profond. C’est bien l’une des faiblesses de ce travail ne pas vraiment travailler sur les ressorts psychologiques des autres personnages : Kurwenal est dans l’ombre et la mise en scène laisse le chanteur gérer, Brangäne est juste une gouvernante sans même comme chez Marthaler, être une sorte de double réaliste d’une Isolde déjà ailleurs. Comme si la mise en scène ne voulait se concentrer que sur le couple Tristan-Isolde, dans son mystère et ses replis intérieurs, avec des ingrédients extérieurs un peu insistants, comme les costumes (de Marek Adamski) : Isolde en pantalon au premier acte, puis en robe rouge au deuxième et au troisième, rouge passion qui tranche avec le noir ambiant : on a vu la même chose dans La Juive de Py une semaine avant, pour dire l’originalité du choix. Tristan engoncé dans son uniforme (Robert Dean Smith aussi chez Marthaler, mais c’était un uniforme moins rigide), avec ses nombreuses décorations, marin à l’américaine, puis dégradé par ses pairs, Kurwenal en treillis, visiblement très loin et bien plus bas dans l’échelle sociale, Marke tout blanc, comme Brogni dans La Juive. On utilise des codes de couleur où s’identifient l’amour, le pouvoir, la soldatesque, et là aussi, on se demande ..et après ? Tout se passe comme si la représentation était sa propre exégèse, mais qu’au-delà du littéral, rien ne nous était dit.

Au troisième acte, Trelinski insiste sur l’impossibilité de démêler le vrai du fantasmé : Tristan rêve à Isolde (vidéos), et à la fin, les autres personnages apparaissent à peine, comme des ombres, laissant le couple seul : bataille, intervention de Marke, tout cela semble ouaté, en arrière scène, embrumé et donc il est impossible de déméler jusqu’à la fin la nature même de ce que l’on voit ou que l’on ne voit pas, et quelquefois en contradiction avec la tradition : Isolde arrive quand Tristan est encore vivant, il la voit, lui parle et meurt dans ses bras (à cet égard, la fin la plus terrible était celle de Ponnelle à Bayreuth, qui en faisait vraiment un rêve de Tristan agonisant), là aussi, une sorte de scène de cinéma destinée à mettre en valeur du pathétique.

Quand Tristan s’écroule, Isolde s’ouvre les veines. Dit ainsi, on dirait du Giordano ou du Leoncavallo, voire une mort sanguinolente d’héroïne de bel canto, Maria di Rudenz ou autre. Alors bien sûr, la dernière image qui montre Tristan et Isolde assis côte à côte au proscenium, comme image éternelle du couple, alimente l’image mythique. Mais il reste que les choix de mise en scène pour mon goût diminuent l’aspect mythique, voire philosophique de l’œuvre.
En ce sens aussi, la direction très expressive et très appuyée de Sir Simon Rattle correspond bien cette mise en scène anecdotique : même les plus beaux moments (le début où Tristan vient contempler Isolde dormant) deviennent des éléments d’une histoire d’amour qui n’est qu’histoire d’amour. Trelinski a voulu rendre concrets des sentiments, des souffrances, des relations humaines et sociales, quoi de plus évident que ce bateau dans la tempête qui lutte contre les éléments en furie ? quoi de plus évident que ces mouettes qui volent en escadrille dès que le couple chante l’amour ? Le spectateur n’est jamais sollicité sinon pour regarder, jamais pour penser. J’ai souvent cité Brecht en travaillant sur le Regietheater, comme un stimulant pour l’esprit. Ici nous sommes vraiment à l’opposé, dans le cathartique, et même dans l’hypercathartique, et dans une optique de drame, presque de drame bourgeois, à l’opposé d’un théâtre qui chercherait par son abstraction à impliquer l’intellect du spectateur. Sans le vouloir signifier directement, on cherche la tripe, le partage des émotions, et que des émotions, presque – je suis méchant et sans doute excessif – comme dans les mauvais films.
Cette mise en scène a été pensée en fonction d’un public plutôt américain, sensible à une esthétique et à des références que nous n’avons pas dans le théâtre européen. Pourquoi pas ? On a tellement trituré l’œuvre dans tous les sens que cette option est aussi possible. Seulement, elle ne me parle pas. Elle exige aussi une option musicale, où le sublime laisse la place au pathétique. Impossible de faire coller une mise en scène crépusculaire et déchirante à la Grüber (avec Abbado) avec cette option musicale-là. En revanche, il y a une vraie cohérence entre Rattle et Trelinski, et il y a une logique à ce que Rattle dirige au MET la production : on peut ne pas partager l’option, mais saluer un travail cohérent, où ce qu’on voit trouve écho dans ce qu’on entend. Ce n’est pas un « mauvais » travail, loin de là, c’est un travail auquel je n’adhère pas, et qui pour moi est inutile parce qu’il ne contribue pas à mieux répondre aux questions posées par l’œuvre. Tout cela serait à discuter des nuits durant autour d’une Guiness ou d’un Irish coffee, pour rester en Irlande…
Mais quand même…quel orchestre fabuleux ! [wpsr_facebook]