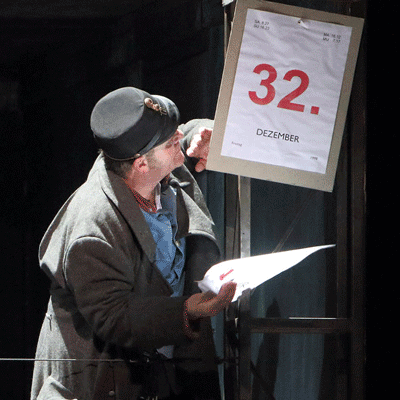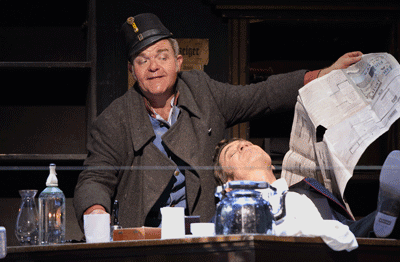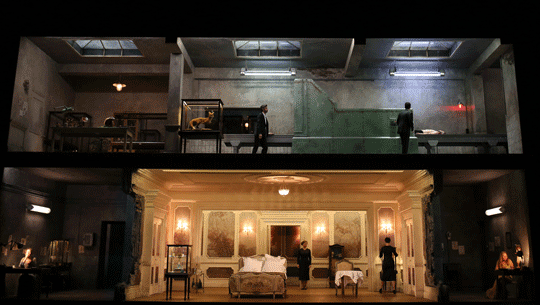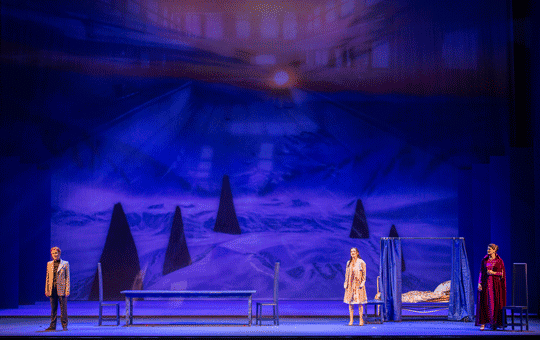Je rappelle souvent quand j’écris sur une oeuvre baroque ma relation à l’Incoronazione di Poppea. J’en ai vu de nombreuses productions respectueuses, reconstitutions modernes des codes baroques. Elles ne m’ont pas marqué plus que ça; même merveilleusement chantées, mises en scène et dirigées, elles sont presque oubliées. J’ai vu l’Incoronazione di Poppea (impossible aujourd’hui) de l’Opéra de Paris en 1978 (Gwyneth Jones, Jon Vickers, Nicolaï Ghiaurov, Christa Ludwig) dans l’antique version Leppard. Et c’est cette production pour moi qui demeure à tout jamais inoubliable.
Je sais parfaitement que je suis à rebours. Mais je soutiens que toute oeuvre d’opéra s’apprécie par l’effet produit sur le spectateur, au-delà des codes et de ce qu’il faut ou qu’on doit faire ou ne pas faire. Je plaide pour cette disponibilité-là, je plaide pour l’absence de doxa, partout, toujours, dans un sens comme dans l’autre: la doxa, c’est le début de la bêtise. Il y a bien des idéologues du baroque en France, certains respectables, que j’ai lus avec attention (le regretté Philippe Beaussant par exemple) même si je ne partageais pas toujours leur avis. Je comprends la volonté de retour aux sources, mais pourquoi alors ne pas s’y mettre aussi au théâtre, et montrer Racine comme au XVIIème et surtout le dire comme au XVIIème?
Les conditions de la représentation d’opéra au XVIIIème n’avaient rien à voir avec celles d’aujourd’hui, et aujourd’hui, on impose un style musical reproduit du XVIIIème siècle ou prétendu tel, avec des codes de représentation et un espace théâtral qui n’a plus rien à voir avec les contextes pour lesquels ces œuvres ont été conçues. Je ne prétends pas que l’on rentre à cheval au :milieu de l’orchestre, ni qu’on déguste des plats raffinés dans sa loge, mais la question de la fidélité à une tradition ou une histoire continue de me poser problème quand elle s’oppose à des habitudes bien ancrées de la représentations aujourd’hui. Faire de la reconstitution musicale à notre sauce d’hommes et de spectateurs du XXIème siècle en pensant respecter une vérité historique qui n’est évidemment pas celle qu’on pense sera pour moi longtemps encore un sujet de méditation et de discussion. Les temps avancent, les regards se transforment, de plus en plus vite et les formes théâtrales s’adaptent au public, aux modes, aux sociétés et à leurs évolutions. c’est la loi de l’herméneutique. Les regards d’aujourd’hui doivent accueillir des spectacles d’aujourd’hui.
C’est ainsi que j’ai été un peu étonné de constater les réactions très contrastées à la production des Indes Galantes du Festival de Munich signée Sidi Larbi Cherkaoui, qui a reçu un accueil exceptionnel du public local, et pour laquelle j’ai lu émanant de spectateurs français des réactions d’une très grande violence sur les réseaux sociaux, criant pour faire bref à la trahison.
Ma première constatation, c’est au-delà des débats sur le style, que le public s’est précipité pour voir Rameau, qui entrait au répertoire de la Bayerische Staatsoper de Munich. Cela veut dire qu’à travers cette production, et quelles qu’en soient ses qualités ou ses défauts, Rameau a parlé au public. C’est déjà un point formidable. Tout comme l’Orfeo de Monteverdi magnifique de David Bösch en 2014 et 2015 avec Christian Gerhaher, dans ce lieu magique qu’est le Prinzregententheater, idéal pour ce type de représentations, petit Bayreuth pour petites formes (même si on y a représenté jadis Die Meistersinger von Nürnberg) . Mon seul regret est que le théâtre ne serve pas pendant la saison, ne serait-ce que quelques soirées.
L’entrée au répertoire des Indes Galantes, et je crois même, celle de Jean-Philippe Rameau au Bayerische Staatsoper ne pouvait se faire sous le signe de la tradition : en confiant la mise en scène à Sidi Larbi Cherkaoui, en résidence au Toneelhuis d’Anvers, c’est la tradition flamande de danse (héritée d’Alain Platel et d’Anna Teresa de Keersmaker) et de mise en scène (Au Toneelhuis d’Anvers, règne Guy Cassiers avec lequel Sidi Larbi Cherkaoui a collaboré pour Rheingold à la Scala et à la Staatsoper de Berlin) qui débarque dans l’univers baroque.
Rappelons pour l’histoire que Les Indes Galantes fut la production phare de l’Opéra de Paris dès qu’elle fut créée en 1952: ce fut même un objet de curiosité du public, tant le spectacle était fastueux et même parfumé ! Une vitrine pour une maison à l’époque assez traditionnelle. La production était signée Maurice Lehmann, alors administrateur de l’Opéra, mais qui fut aussi longtemps directeur du Châtelet, et où il signa des productions qui firent époque (L’Aiglon en 1945 sans cesse repris, L’Auberge du Cheval Blanc en 1960) et qui furent parmi les premiers spectacles de théâtre que je vis tout enfant. Ce maître du grand spectacle fit de ces Indes Galantes un triomphe (283 représentations à l’opéra jusqu’à 1970) . C’est que Les Indes Galantes est un opéra fantasmagorique, au livret lâche, hétérogène, divisé en quatre entrées qui sont en fait quatre histoires différentes et quatre ambiances différentes, toutes exotiques, (Turquie, Pérou, Perse, Amérique du Nord) permettant à Rameau une fantaisie immense dans la composition et des moments virtuoses. De fait, il y a dans Les Indes galantes des morceaux de bravoure que beaucoup connaissent sans même savoir d’où c’est extrait.
C’est la question de l’exotisme qui est ici centrale, la représentation de l’autre dans un XVIIIème où se consolident dans les grandes puissances d’alors les possessions coloniales et où on découvre des mondes divers et leurs produits.
Sidi Larbi Cherkaoui a parfaitement saisi la problématique de l’oeuvre, si l’on peut parler de problématique qui est une vision généreuse d’un monde pacifié par l’Europe. Ce belge d’origine marocaine représente par ses origines et sa formation ce melting pot, cette diversité que les Indes Galantes fantasmaient. C’est bien de l’idée de diversité qu’il est parti, mais de la diversité du monde d’aujourd’hui: que reste-t-il de la diversité du XVIIIème dans celle du XXIème. Il répond: l’école, les musées, les réfugiés et toujours la religion.
Sidi Larbi Cherkaoui ne « modernise » pas le propos, il l’actualise en posant la question: que nous montreraient aujourd’hui du monde Les Indes Galantes ? Que sont nos Indes? Où vont-elles se nicher? Quels horizons le monde nous propose-t-il aujourd’hui?
Le colonialisme, ses souvenirs, ses restes, ses conséquences y compris sur les enfants, les réfugiés, la questions de l’ailleurs à nos portes: voilà les thèmes que Sidi Larbi Cherkaoui a choisi de traiter. Très intelligemment il décale ironiquement la vision un peu condescendante de l’occident du XVIIIème sur ces mondes inconnus qu’il découvrait et qu’il a colonisés, exploités puis quelquefois abandonnés. Au milieu des préoccupations fortes de l’Europe d’aujourd’hui, dans le maelström des causes et des effets de sa propre politique, y compris dans ses relations aux USA, à la paix à la guerre, Sidi Larbi Cherkaoui, non sans ironie assez souriante nous présente les Indes Galantes du jour.
Des Indes Galantes devenues Indes Galeuses en quelque sorte.

La démarche d’actualisation peut évidemment être discutée et questionnée, mais elle n’est pas la première sur cette oeuvre (Laura Scozzi à Toulouse, Bordeaux, Nuremberg) et ainsi Sidi Larbi Cherkaoui pose lui aussi la question du regard occidental sur l’autre.
Les Indes Galantes, avec son livret complètement a-dramaturgique, et sa nature de divertissement est ici une oeuvre mise sur sur le grill de l’analyse: quel sens aurait aujourd’hui par exemple la mise en scène mythique de Maurice Lehmann, pur divertissement superficiel qui d’une certaine manière nie la valeur éventuellement didactique de l’oeuvre.
Cherkaoui pose la question de notre propre regard sur ce regard un peu condescendant des contemporains de Rameau: en posant la question de l’exotisme du jour. L’exotisme vaut quand on va au devant des pays ou populations concernées, par le tourisme par exemple; il vaut moins lorsque l’exotisme vient à nous: et comment vient-il à nous?
En faisant appel au chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui, Nicolaus Bachler tient à respecter la nature de l’oeuvre, un « opéra-ballet » et en même temps il lui confie non un ballet, mais une mise en scène d’opéra, ce qui détermine des prises de position nettes, puisque Sidi Larbi Cherkaoui par sa culture très ouverte, par ses origines, par ses fonctions dans le Toneelhuis d’Anvers, est parfaitement adapté à diriger une oeuvre par nature hybride, et dont le livret propose une dramaturgie finalement tout aussi ouverte. Monter au XXIème siècle Les Indes Galantes peut parfaitement emprunter le chemin proposé par Munich.
Il n’y a pas de règle écrites ou non écrites qui déterminent un style d’approche pour des oeuvres qui elles-mêmes ne sont pas catégorisées, et offrir un Rameau aussi stimulant, c’est évidemment le servir auprès d’un public qui n’a aucune idée préconçue sur la manière de le représenter: il n’y pas de doxa sur Rameau en Allemagne, bien heureusement.
Quelle histoire nous raconte donc Cherkaoui?
Si l’on se fonde sur le prologue, le sujet du librettiste Louis Fuzelier en est la querelle entre Hébé (la jeunesse) Cupidon (l’amour) et Bellone (la guerre).
L’espace de jeu (décor d’Anna Viebrock, la décoratrice de Christoph Marthaler) est neutre et s’adapte à toutes les situations, sur la scène assez vaste du Prionzregententheater (où l’on jouait le répertoire d’opéra quand le Nationaltheater était fermé ou en reconstruction). Ce plateau est délimité par des cloisons plutôt neutres (encore que les hauts murs fassent voir des fils barbelés, comme si l’on était à l’intérieur d’un camp) dominées par une hélice d’hélicoptère (et non un ventilateur comme j’ai lu) signe que la guerre menace toujours (rappelons que les hélicoptères signaient la fameuse attaque d’Apocalypse now) …mais tour à tour ce plateau, avec quelques objets rapidement mis en place sera salle de classe, musée, église, camp de réfugiés, les changements se faisant aussi en chorégraphie. Car il n’y a pas de frontière entre danse et jeu et danse et chant, d’où l’avantage d’avoir dans la troupe une Lisette Oropesa américaine qui a touché à tous les arts de la scène dans sa formation, qui peut chanter en dansant dans le prologue où à la fin par exemple.

Cette circulation des genres est parallèle à la circulation des lieux et des idées. Commençons donc, une fois n’est pas coutume, par le programme de salle qui évoque de manière très précise les cahiers d’écolier et le matériel pédagogique d’antan, y compris du XVIIIème, interrogeant la représentation du savoir et son évolution, montrant une salle de Museum, avec ses squelettes sous vitrine, mais aussi des écoles en Palestine (Bethleem) ou au Mexique. La question que pose le programme de salle, et bien évidemment le spectacle, c’est « qu’est devenu l’exotisme ? » et, mieux encore, que sont devenus ces pays idéaux des Indes Galantes. Le XVIIIème, c’est la cité idéale (Turin par exemple) héritée de la renaissance, c’est le bon sauvage, c’est l’état de nature rousseauiste, c’est le monde comme représentation (il n’est que rappeler ces « sauvages » qu’on ramenait de ces contrées exotiques pour les présenter dans les salons, et qui le plus souvent mouraient de maladies inconnues chez eux.La démarche de Sidi Larbi Cherkaoui au contraire de ce qu’on écrit des spectateurs qui ont crié à la trahison, est pour moi, particulièrement proche de ce XVIIIème siècle des Encyclopédistes, avec leur volonté d’apprendre le monde et de l’expliciter : il utilise dans son décor et ses accessoires

des planches qui remontent à cette époque, et l’idée même de Musée, est en même temps idée de capture d’un état du monde. S’il a pensé à Diderot, Rousseau, D’Alembert et même Voltaire, dans leur regard et sur la scène du théâtre et sur la scène du monde, Sidi Larbi Cherkaoui me paraît aussi bien proche dans sa démarche d’un Montesquieu, très contemporain de Rameau (son aîné de 6 ans, et qui mourra, en 1764, 9 ans après Montesquieu), avec son regard sur l’exotisme, y compris les ambiguïtés sur l’esclavage, mais aussi et surtout ses considérations sur la relation des peuples au climat. Comme on le voit, Sidi larbi Cherkaoui et ses dramaturges sont loin du n’importe quoi dont certains les ont accusés.
Ainsi de l’école, premier tableau, prologue, qui est en même temps un enjeu essentiel de toute civilisation. Et la discussion entre Hébé (Lisette Oropesa en souriante institutrice) et Bellone (une matrone en costume militaire américain) pose la question d‘une manière brutale qui est celle de la formation ou de la formatation des esprits.
L’idée du livret de Fuzelier est que sous tous les climats c’est l’amour qui doit vaincre. C’est une idée éminemment pacifiste et typiquement illuministe : la croyance en la paix éternelle ou à l’apaisement des oppositions par le savoir et la raison est un élément central de la pensée de l’époque (voire d’aujourd’hui chez ceux qui croient encore aux Lumières). En la rendant visiblement idéologique, Sidi Larbi Cherkaoui en donne les clefs d’aujourd’hui, soulignant que les débats sont toujours ouverts. En transférant cette idée toute simple dans le monde d’aujourd’hui, il place évidemment l’ensemble au bord de la falaise, au bord du gouffre, car les événements du jour vont tous, sous tous les horizons, à rebours de cette généreuse proposition. Non, ni les Indes, ni l’Europe hélas ne sont Galantes, pour reprendre le titre d’un ouvrage de Campra (1697) que Rameau évidemment connaissait. Pour rendre cette fragilité, il place les chanteurs et le chœur (magnifique Balthazar Neumann Chor) toujours sur le fil du rasoir qui sépare la danse du chant et du jeu. Les chanteurs chantent, mais dansent aussi, de manière quelquefois hésitante et fragile, mais ils jouent le jeu : en refusant la séparation des genres et des fonctions, et de manière prodigieusement intelligente parce que presque métaphorique, Sidi Larbi Cherkaoui dit l’impossibilité des œillères, d’un seul style, de la séparation des genres : très moderniste pour cela il joue l’opéra-ballet ou le ballet-chanté où tout le monde fait tout, même avec la maladresse sympathique qui en ressort. Comme entre les Indes et nous en cette époque globale, entre les genres il n’y a plus les frontières, fussent-elles celles du rêve, il y a devant tous la réalité de l’effort que chacun doit fournir : effort des artistes jouant aux funambules entre les genres, effort des élèves dans cette classe initiale du prologue, effort du spectateur pour comprendre que nous ne sommes plus dans le monde des Indes Galantes, et qu’aujourd’hui les Indes se présentent à nous dans une réalité plus crue.
Ainsi aux frontières de l’humain les cartes sont brouillées : maître et esclave, femmes et hommes, dieux et hommes:

Amour devient aussi une sorte de dame-pipi qui garde des toilettes qui sont aussi une cabine d’essayage mais même dans les mariages (la célébration des mariages est une scène désopilante de la deuxième entrée (le Pérou) avec des couples qui se présentent devant le prêtre, où il refuse de regarder les couples homosexuels : dans un monde où les frontières se fissurent à tous les niveaux, nos Indes à nous sont à la fois fragiles et tellement plus élargies. Sans parler du rôle du Musée, où les couples mythiques sont muséifiés à l’intérieur de vitrines et où les danseurs miment des scènes mythologiques. Ce spectacle est une ode à la respiration, à l’humanisme et à l’humanité. Toutes les valeurs d’un monde « idéal » du jour y sont exaltées, au cœur d’une Allemagne qui vit cette question qu’une brûlante actualité a ramené sous les feux de la rampe et que la Chancelière affronte avec honneur. La première partie est donc ce mélange viebrockien entre salle de classe et salle de Musée d’histoire naturelle, celle qui nous apprend qu’un squelette en vaut en autre, comme prison pour couples sous vitrines…

La première entrée le turc généreux semble être une des racines du Singspiel de Gottlieb Stéphanie le jeune Die Entführung aus dem Serail, c’est la même histoire. La scène péruvienne où la religion est représentée par Huascar le prêtre est ici représentée par un prêtre catholique devant un autel baroque construit de corps entremêlés, devant qui on va procéder à des mariages (y compris, – horreur- gays, comme je l’ai plus haut évoqué) allusion double aux méfaits des religions et à l’art baroque d’Amérique du Sud, signant le triomphe de la vraie religion sur les “superstitions” locales :

et toute la trame prend une étrange actualité. D’autant que la jeune Phani, objet du désir du prêtre, est amoureuse d’un étranger (dans l’histoire un espagnol) : toutes les ambiguïtés de la religion d’aujourd’hui sont évoquées, avec un vrai sourire. Ainsi donc toute la deuxième partie pose la question de « l’exotisme chez nous », non pas l’exotisme souriant d’un zoo humain qu’on regarde avec condescendance séparé par des grilles qui sont des océans ou des montagnes ou ces frontières qu’on veut fermer (les imbéciles !!) poreuses depuis l’éternité et pour l’éternité, mais l’exotisme brutal qui a débarqué « chez nous » conséquence des folies de ce Bellone du début qui veut apprendre aux enfants les armes (planches newlook) au lieu des papillons.

Nous sommes tous égaux devant l’amour, car l’amour veut dire égalité. Et Cherkaoui nous impose ce regard sur l’autre à aimer. Ces réfugiés avec leur tente en plastique et leurs habits de fortune sont au pied de la porte blindée de l’Europe, qui en laisse généreusement passer quelques-uns. La dernière image revient à un réalisme plus cru mais en même temps très poétique : on revient dans la salle de classe du début (l’institutrice qui était Hébé et qui est Zima): car ce voyage en exotisme moderne était en fait une leçon de choses, une leçon de morale, une leçon dirait notre Education Nationale, d’Education civique et morale. Les enfants sont là, brandissant les couleurs de l’Europe, la maîtresse est là, l’amour est là et tout le monde participe au nettoyage…sur fond de soldats sur des Segways qui sécurisent le terrain. L’Utopie a des limites, mais c’est quand même la paix des hommes dans sa désormais terrible fragilité. Le spectacle qui ne sépare ni chorégraphie, ni mise en scène, les frontières sont abolies entre les genres, met sans doute les uns et les autres un peu en danger, la compagnie Eastman d’Anvers (les danseurs) qui est celle de Cherkaoui, sans doute plus coutumière du mélange des genres que le merveilleux Balthasar Neumann-Chor (dirigé par Detlef Bratschke) appelé comme spécialiste de la période, et contraint à bouger, à danser, à chanter dans ce magnifique creuset lyrique et théâtral, les solistes, dont certain dansent franchement, d’autres moins, mais tous très engagés dans la mise en scène, avec une distribution que j’ai trouvée très engagée, très vivante, malgré les difficultés évidentes pour certains de la mise en scène.

On note l’excellent Goran Juric, de la troupe du Bayerische Staatsoper, Bellone sonore et personnage remarquable, Hébé (et Zima, qui ferme par la dernière entrée l’opéra) est Lisette Oropesa, qu’on a vue dans Konstanze au Nationaltheater, et dans Sophie (de Werther) au MET, et dans Nanetta de Falstaff à Amsterdam. Comme d’habitude, elle est très attentive à la diction, au contrôle de la voix, à la fluidité, et en plus elle chante quelquefois en dansant. Encore une chanteuse qui montre la formation accomplie de l’école anglo-saxonne, ainsi qu’un engagement scénique notable qui se traduit par un plaisir visible à être sur scène, même si l’engagement scénique nuit quelquefois à la fluidité de la langue, pourtant si travaillée. Moins efficace sur la diction, mais remarquable de musicalité et de contrôle, Anna Prohaska (Phani/Fatime) est une Phani très lyrique et très émouvante (« Viens hymen, viens m’unir au vainqueur que j’adore ! ») Et tout aussi prenante dans Fatime (notamment dans l’air « Papillon inconstant vole dans ce bocage » ), c’est dans ce répertoire que je la trouve la plus convaincante.
Le jeu des doubles rôles ne permet pas seulement de resserrer la distribution, mais permet surtout au metteur en scène de raconter son histoire avec des personnages qui sont quelquefois des doubles (Hébé/Zima en est un exemple), Tareq Nazmi est aussi un Ali très convaincant. François Lis est vraiment très convaincant en Huascar, le prêtre amoureux d’un Pérou très proche de nous, j’ai beaucoup apprécié et sa diction et une voix bien posée, et des graves sonores. J’ai aussi particulièrement apprécié le ténor Cyril Auvity, en Valère et Tacmas, avec sa très belle ligne et sa très belle diction et surtout sa suprême élégance , qualités partagées par Mathias Vidal en Carlos, qui réussit à imposer un vrai personnage. Dans l’ensemble, les français engagés en nombre sur cette production ont bien défendu un chant français qui dans ce répertoire a peu de rivaux et l’ensemble du plateau (y compris l’Adrario élégant de John Moore) se sort avec beaucoup de style de l’aventure assez neuve dans laquelle les a entraînés Sid Larbi Cherkaoui.
J’ai souligné combien ie Balthasar Neumann-Chor de Fribourg familier d’un chef aussi sensible que Thomas Hengelbrock avait su s’intégrer dans la production, y compris parmi les danseurs, sans perdre grand chose de ses qualités, notamment sa diction et son sens des rythmes et sa musicalité.
Le britannique Ivo Bolton, désormais directeur musical du Teatro Real de Madrid, où on l’a entendu excellemment diriger Das Liebesverbot de Wagner, est à Munich l’unique référence en matière d’opéra baroque: c’est lui qui dirige toutes les productions. On lui doit aussi l’Orfeo de Monteverdi l’an dernier; Il est souvent critiqué par les français, d’autres disent en revanche qu’il n’est correct que dans le répertoire baroque. Bien sûr on peut regretter que s’ouvrant à ce répertoire la Bayerische Staatsoper ne fasse pas aussi appel à d’autres chefs. En tous cas, il s’en sort dans Rameau avec tous les honneurs: as de lourdeur, pas de tempos trop rapides, mais une vraie élégance, une vraie souplesse de l’orchestre avec de très beaux moments et une dynamique affirmée dans certains morceaux (à la fin notamment). Rassemblé autour de lui un orchestre spécialement réuni, avec des solistes venus d’autres orchestres baroques, qui sonne sans aucune scorie, avec force, avec style, parfaitement en place. Une direction qui accompagne avec sureté, mais aussi quelquefois une certaine ironie les folies du plateau.
Il faut reconnaître l’investissement notable de la Bayerische Staatsoper dans l’opération: un choeur extérieur, un orchestre composé ad-hoc, ce sont des coûts notables pour seulement quelques représentations; On comprend pour quelles raisons la production n’est pas reprise au répertoire dans l’année mais on peut le regretter: le succès extraordinaire du spectacle, longuement applaudi à la première, et l’affluence de public ensuite pour un répertoire inhabituel, sont des indices que peut-être il faudrait songer à reprendre ces productions qui l’an dernier et en 2014 (David Bösch pour l’Orfeo) et cette année, ont fait le plein et on donné envie de les revoir. Il faut noter aussi que la production des Indes Galantes de Laura Scozzi, vue à Bordeaux cette année et à Nuremberg, a marqué aussi par son approche (un peu similaire) les publics. Le baroque ferait-il son chemin dans ce temple de l’opéra du XIXème qu’est la Bayerische Staatsoper? [wpsr_facebook]