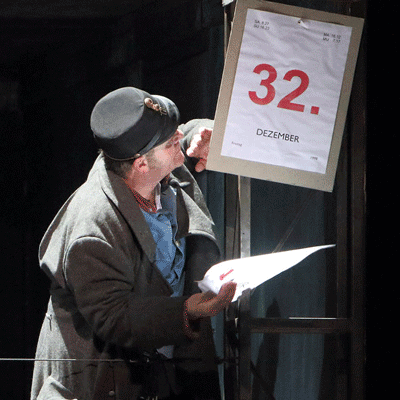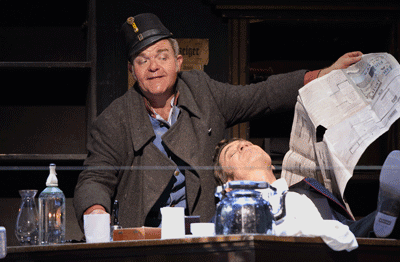Voir deux fois La Juive en une saison est assez exceptionnel pour qu’on s’y arrête. Contrairement à ce que certains affirment, l’opéra de Halévy le vaut bien, et vaut bien des œuvres de la même période qu’on représente plus fréquemment ; évidemment la nature même de l’histoire de cette jeune sacrifiée sur l’autel des croyances, des luttes religieuses et au final de l’obscurantisme sonne aujourd’hui à nos oreilles de manière plus aiguë qu’il y a seulement une décennie.
Le travail de Calixto Bieito choisit la voie hiératique : décor unique, un mur qui rappelle celui qui sépare Israël des territoires palestiniens, béton gris, qui va servir de fond, de séparateur et comme les lattes de bois dans Lear ( qui est aussi de Rebecca Ringst ) des pièces de béton vont s’abaisser pour créer un espace nouveau, permettant un jeu haut/bas et rappelant par son esthétique étouffante certaines perspectives du Musée juif de Berlin. Tout va se jouer autour de cet espace essentiel, installé sur une tournette, avec l’autre face du mur désespérément identique. On n’échappe pas aux murs, dans ce monde qui continue d’en construire.
A l’occasion des représentations lyonnaises j’ai pu rappeler quelques points de l’histoire de cette œuvre très populaire au XIXème dans le monde entier, disparue des scènes après 1934 et réapparue à Vienne en 1999, puis à Paris en 2007 avec le grand Neil Shicoff, encore inégalé parmi les interprètes modernes du juif Éléazar.
Il n’est pas fortuit que réapparaisse l’œuvre qui montre les fanatismes dans leurs œuvres jusqu’au sacrifice consenti d’une jeune fille que ni son père adoptif ni son vrai père ne peuvent ou ne veulent sauver, à cause du jusqu’au-boutisme des postures dans un monde ou la simple humanité n’a plus sa place.
Au XIXème le genre “Grand Opéra” par son côté pittoresque, ses décors monumentaux et ses costumes chamarrés étouffait un peu la portée intellectuelle et humaine du message. C’était d’abord du grand spectacle, dont le rôle était un peu celui du « musical » aujourd’hui. Sans aucun mépris pour le genre, puisque certains « musicals » historiques ont une portée humaine et morale immense, comme West Side Story. Bieito, et le chef Bertrand de Billy ont décidé d’éliminer tout pittoresque et toute “distraction” de la représentation. Se concentrant sur l’essentiel, Bieito en fait une vraie tragédie, dans la lignée de son récent Lear, et sacrifiant volontairement la dramaturgie de la première partie qui pose les éléments du drame d’une manière peut-être plus “romantique” et touffue. Sans éliminer le personnage de Léopold, il le rend pratiquement invisible et inexistant et du même coup même le public munichois, qui ne connaît pas l’œuvre lui fait un accueil passable aux saluts, comme si c’était un personnage secondaire. Rien dans la dramaturgie ne le met en valeur : le monde est universellement gris et noir, et seule la robe verte de Rachel l’isole et l’identifie, mais pour le reste des personnages, il est difficile, notamment au début, d’identifier qui est où, qui fait quoi et qui est qui.
C’est bien ce qui frappe dans ces premières scènes dont l’ouverture a été ôtée pour revenir à la représentation de la première, pour s’ouvrir sur le Te Deum initial violemment sonorisé qui fête la victoire de Léopold sur les hussites, et prendre un tour immédiatement dramatique puisque le chœur a les yeux bandés et force des enfants de manière assez violente à être baptisés. Têtes plongées dans l’eau, enfants en sous-vêtements et mouvements suffisamment brusques pour avoir choqué certains spectateurs.

Immédiatement Bieito expose la situation par l’image : une population aveugle, des conversions forcées, une violence immédiate alors que c’est la fête : on fête la victoire mais c’est aussi bientôt Pâques, que ce soit Pessa’h ou les Pâques chrétiennes, et l’espérance devrait être portée par ces rameaux verts que la foule agite (et dont elle fouette aussi Rachel) et par la couleur de la robe de Rachel : le vert, couleur symbole dans les trois religions révélées et marquant l’espérance, mais aussi la Passion, est porté dans ses deux signification par Rachel, seule tache verte dans un univers gris ou noir. Une violence immédiate, disais-je, qui s’abat sur Eléazar et Rachel, alors qu’ils sont « comme les autres » : c’est, exposé de manière crue, le refus initial et définitif de la différence qui est non dans les faits mais dans les têtes.

En même temps, il me semble difficile pour un public qui ne connaît pas l’œuvre de déterminer clairement par la dramaturgie ce qui se passe, car même Brogni est fondu dans la foule, et donc l’uniformisation des foules correspond à une universalité de la barbarie. Certes, la volonté de Bieito est de montrer à la fois la banalité (Eléazar et sa fille) du non conforme (et son absence de justification) et l’universalité conformiste du refus. La manière dont il présente le couple Rachel/Samuel-Léopold est aussi singulière, puisque de ce groupe uniforme émerge Leopold pendu à des échelons de fer fichés dans le béton (une position difficile pour chanter un rôle particulièrement périlleux en soi) et Rachel en équilibre instable sur une marche, comme si leur relation ne pouvait se définir que dans l’acrobatie, au sens propre.

Le mur est uniforme, semblable des deux côtés comme s’il n’y avait aucune issue possible, il arrête l’horizon, mais il sépare aussi les êtres dont il empêche les rencontres : les duos se passent souvent d’un côté ou de l’autre, comme à l’aveugle.
Dans cette vision si épurée, si hiératique, le genre Grand Opéra est oublié : le style en est volontairement à l’opposé : les espaces sont tous similaires, aucun pittoresque, aucun « grandiose », et l’aire de jeu est un pur espace tragique. Rien de romantique ni d’échevelé, mais une concentration sur l’action dramatique et la progression vers la chute. Pendant toute la première partie, le plateau ne change pas, et seul le mur dressé fait décor. Il faut attendre la seconde partie, la chute proprement dite, pour que le plateau se transforme, pour que les personnages taraudés par le drame soient moins distanciés : le mur se disloque, les morceaux de béton s’abaissent pour devenir comme ces masses bétonnées qui empêchent le passage sur certaines routes de Palestine occupée, murs horizontaux plutôt que verticaux. Car Bieito de manière sarcastique renvoie dos à dos les juifs et les autres, tant ce béton rappelle le sort qu’Israel réserve aux territoires palestiniens et ainsi nous rappelle que le pourchassé devient à son tour celui qui frappe, qui sépare ou qui pourchasse.
Alors qu’Olivier Py faisait de Brogni tout de blanc vêtu un substitue pontifical et une sorte de médiateur politique chargé de réconcilier les hommes et d’installer une paix sociale, Bieito affiche immédiatement son impossible office: habillé comme les autres, il est comme les autres et impuissant. Malgré sa bonne volonté, il ne peut agir contre l’aveuglement collectif, et doit s’y soumettre.
Bieito prend appui sur le livret et sur ses ambiguïtés, notamment le fait que Scribe ne prend pas partie, Eléazar et Brogni étant tous deux responsables du sacrifice de Rachel, et qu’il n’y a pas de bons ou de méchants : Léopold est en proie à ses désirs et ses passions et finalement « récupéré par le système » comme on dirait aujourd’hui : son histoire individuelle est dérisoire, voire minable il laisse Rachel s’accuser et préserve sa vie. Il disparaît très vite de l’intrigue, en ayant pourtant un rôle parmi les plus difficiles au niveau musical. Mais c’est justement l’anecdote qui fait la première partie de l’œuvre, c’est le pittoresque. Le Grand Opéra, c’est la première partie.
La seconde partie est concentrée sur Rachel, qui va cristalliser sur sa personne, et à son corps défendant, les nœuds et les haines. D’abord par Eudoxie, qui vient lui dire en somme « puisque tu vas mourir de toute manière, sauve au moins Léopold ». Puis par Brogni, dont elle est la fille qu’il croit morte, et dont elle sent intuitivement que quelque chose la lie à lui (et vice versa), et enfin par Eléazar, qui l’utilise pour aller jusqu’au bout de sa vengeance après avoir hésité. Rachel est un personnage biface, elle est chrétienne, mais aussi juive par éducation et meurt en juive. On est donc ce qu’on devient par imprégnation et culture familiale, on ne naît pas ce qu’on est. On n’est pas juif ou chrétien par nature, mais on l’est par culture. Belle leçon sur l’éducation et la culture qui n’est pas encore bien comprise aujourd’hui.

Alors, la deuxième partie du travail de Bieito est plus humaine, assurément : les individus se révèlent, Eudoxie, déchirante et suppliante aux pieds de Rachel, Brogni, suppliant envers Eléazar dont il lave les pieds, symbole fort et chrétien. Les symboles, les allusions s’accumulent, jusqu’au moment où Rachel va être sacrifiée, où sur la vidéo (utilisée comme dans Lear) on voit un agneau qu’on sacrifie, établissant ainsi un parallèle entre le sacrifice d’Abraham et celui de Rachel, Eléazar devenant alors une sorte de substitut prophétique d’Abraham. Et Rachel gagnant du même coup son statut de « vraie juive ».
Ainsi la scène finale atroce prend son sens. Enfermée dans une cage de fer comme ces suppliciés du Moyen Orient abandonnés à Daesh, elle va être brûlée vive – la scène est d’un saisissant, voir insupportable réalisme, elle devient victime des hommes après avoir gagné le statut de martyr. Bieito dans cette deuxième partie mêle approche psychologique et contextes religieux, montrant – c’est une évidence encore plus lumineuse aujourd’hui – que le fanatisme religieux est destructeur et le message religieux, même lorsqu’il prêche humanité et tolérance, n’y peut rien (Brogni). Tuer au nom de(s) Dieu(x) est une constante barbare de la vie des sociétés et de l’Histoire, depuis le sacrifice d’Abraham ou d’Iphigénie.
À cette approche très dénudée et débarrassée de toute fioriture, correspond une approche musicale délicate, approfondie et particulièrement raffinée. Il ne nous appartient pas de juger de la qualité de la musique de Halévy. D’autres l’ont fait (Wagner ou Berlioz) qui sont plus avisés. Cette musique ne me paraît pas moins intéressante que certaines œuvres du temps et d’une certaine manière plus proche d’une musique « de l’avenir », dans certains moments ont inspiré Wagner et même ses successeurs. Daniele Rustioni à Lyon avait opté pour une approche dynamique et énergique, tout en produisant un son d’une lisibilité cristalline. Même lisibilité chez De Billy, mais sa lecture soigne moins la dynamique que la couleur, ralentissant le tempo, en faisant de l’œuvre une sorte de cérémonie quelquefois plus intimiste et quelquefois funèbre. Cette « Juive » est sombre avant que d’être dramatique. Celle de Rustioni avait une sorte de jeunesse désespérée qui n’était pas sans séduction.
Ainsi, De Billy fait le choix de supprimer l’ouverture qui n’existait pas à la création pour la remplacer par le Te Deum initial, avec orgue et chœur sonorisés et écrasants : ce Te Deum sonne prophétique, il sonne « Dieu », avec toute la construction antinomique initiale où le Te Deum, action de grâce, sert en même temps de prétexte à forcer au baptême des enfants avec une violence concentrée assez insupportable, un Te Deum qui d’ailleurs rend grâce de la victoire sur les Hussites, autre révolte à connotation religieuse. Nous sommes donc bien dans un monde traversé par les luttes religieuses et les fanatismes des uns et des autres. L’Orchestre est à la fois très détaillé, fortement marqué par les drames intérieurs, marquant une certaine réserve dans le rendu qui marque, comme chez Bieito, l’abandon d’un son « multicolore » qui rappellerait trop le Grand Opéra. Dans la deuxième partie, plus tendue, l’orchestre de De Billy est plus volumineux, plus contrasté, avec un Bayerisches Staatsorchester des grands jours. Enfin, De Billy, toujours très soucieux des chanteurs, les accompagne avec constance et attention, les laissant respirer, d’autant que des remplacements ont émaillé la préparation du spectacle.

On sait qu’il est particulièrement difficile de distribuer le Grand Opéra, La Juive n’y échappe pas, avec dans les principaux rôles deux ténors et deux sopranos chacun aux antipodes du spectre, une basse profonde et quelques barytons. À Lyon, on avait privilégié une distribution plutôt jeune, pour une salle aux dimensions moyennes. Pour une salle comme Munich, faite pour le grand spectacle et les voix larges, il est clair qu’on avait privilégié de « grandes voix » comme celle de Kristine Opolais dans Rachel. Cette dernière ayant déclaré forfait, c’est Aleksandra Kurzak plus habituée à des rôles au volume moins exposé et qui était distribuée initialement dans Eudoxie, qui a repris la partie.
On pouvait nourrir des doutes, parce que la soprano polonaise est plutôt spécialisée dans des rôles d’agilité plus légers, et pourtant ceux-ci se sont effacés tant l’engagement de l’artiste, sa présence, le volume vocal et le sens dramatique dont elle a fait preuve ont fait merveille. Certes, au début, on a nourri quelques craintes car la voix semblait ne pas sortir et manquer de projection, mais peu à peu, à mesure que le drame se nouait, Kurzak a su prendre le virage dramatique du rôle et a montré quelles réserves sa voix avait. Un seul problème, la diction : elle était, de tout le plateau, celle dont le français était le moins clair ; c’est gênant pour un spectateur français ou dans un contexte français, moins pour un public bavarois. Il reste que pour Rachel on pense traditionnellement à des « grands lyriques » ce que Kurzak n’est pas. Elle s’en sort néanmoins avec tous les honneurs et même plus.

Du même coup, Eudoxie a dû être confiée à une autre chanteuse que Kurzak, et c’est une jeune soprano allemande, Vera-Lotte Böcker, en troupe à Mannheim et qui a chanté le rôle cette saison à Mannheim qui a été appelée. Outre que la diction est très honorable, elle a fait preuve d’un sens dramatique affirmé, elle est même bouleversante dans la scène II de l’acte III avec Rachel. Du point de vue du chant, elle n’a peut-être pas la précision de certains sopranos comme Annick Massis, qui reste pour moi l’Eudoxie modèle, entendue à Paris en 2007. Ce n’est pas toujours un son bien dessiné, mais les aigus sont dominés, et la voix très bien projetée. Nul doute qu’il sera intéressant de suivre cette artiste très engagée.
Ain Anger prête sa voix profonde, très sonore, à Brogni. Sa diction du français est claire, et son personnage difficile est bien incarné. Ce Brogni est volontairement anonyme, au sens où sa présence en scène n’est pas vraiment clarifiée par la mise en scène au moins au départ, tout comme celle de Léopold, on le verra. C’est dans la deuxième partie que les protagonistes se mettent en place pour dénouer les nœuds de l’action, et notamment pour Brogni au quatrième et cinquième acte. Son beau timbre, sa présence, la profondeur de l’expression en font un Brogni de très bonne facture. Il manque cependant un peu de personnalité (Scandiuzzi à Lyon, même avec une voix fatiguée, avait un tout autre charisme). Mais Bieito n’a visiblement pas voulu « imposer » des « personnages » ou des « rôles », et le Brogni qu’il veut est un personnage intérieur, renfermé voire méditatif qui frappé par le même drame qu’Eléazar : il a voulu en tirer d’autres conséquences. D’une certaine manière il a épousé la tolérance et l’humanité en entrant en religion, tandis qu’Eléazar a nourri son désir de vengeance que les circonstances lui offrent d’assouvir. D’où la scène du lavement de pieds qu’on a déjà évoquée face à Éléazar, qui fait partie de la symbolique traditionnelle chrétienne, et qui marque son humilité et son désir de contrition face à Éléazar. Évidemment, la question de la tolérance est ambiguë dans le livret de Scribe, au sens où l’opéra est censé se positionner contre l’antisémitisme alors le personnage le plus humain est Brogni le chrétien, et le plus rigide Eléazar le juif.
Ainsi donc le Brogni de Ain Anger n’a pas la « surface » de ces grandes basses définitives comme un Grand Inquisiteur, par exemple, mais c’est plus une volonté de mise en scène qu’une question d’individualité de l’interprète.
Même problématique pour Léopold. Olivier Py marquait particulièrement sa distance par rapport au personnage, en faisant un « léger », tributaire de ses désirs et finalement revenant au bercail eudoxien après avoir été un peu inquiété pour son imprudence.

Ici, le personnage est assez neutre, lui aussi anonyme au départ, qui émerge de la foule pour former couple avec Rachel. Le Léopold de Bieito, comme tous les autres est un parmi d’autres semblables, en noir, n’émergeant pas de la foule, sauf lorsqu’il va entamer son air adressé à Rachel, perché et appuyé sur un échelon métallique fiché dans le béton, dans une position éminemment fragilisée et acrobatique, qui correspond symboliquement à sa situation, mais aussi qui correspond à la nature de l’air, puisque Léopold a dans cet opéra les airs les plus virtuoses et peut-être aussi les plus superficiels, par la forme, et par le fond. Rachel émerge aussi de la foule et le couple se retrouve en position d’équilibre instable à chanter un amour à la fois interdit et menacé et donc comme leur position, instable. Il est à noter que les deux personnages qui chantent les airs les plus ornementés sont Eudoxie et Léopold, c’est à dire, la cour, l’apparence, les faux semblants, mais que, des deux, Eudoxie est la plus vraie. Bieito d’une certaine manière règle son compte au ténor. Certes, John Osborn, une fois encore, montre la qualité d’un chant ornementé, aux aigus ravageurs, avec une diction française proche de la perfection, une sûreté dans les attaques, une qualité dans l’émission inégalables. En même temps,Bieito fait tout dans la mise en scène pour ne pas mettre en valeur le personnage, noyé dans les autres, dans tous les autres, et comme tous les autres. D’où une virtuosité qui tombe à plat et qui ne fait plus spectacle : là-aussi le Grand Opéra cède le pas car est effacé le côté démonstratif et spectaculaire, au point qu’aux applaudissements, Léopold ne recueille pas l’ovation habituelle. Le public, ignorant du déroulement de La Juive, n’a pas noté l’extrême difficulté de ce chant, non valorisé et volontairement noyé dans la masse ; c’est évidemment dommage pour l’artiste, mais c’est aussi intéressant sur le fonctionnement dramatique que Bieito a voulu installer.

Le traitement « fâcheux » des ténors n’est d’ailleurs pas limité à Léopold. Dans cette œuvre, deux ténors s’opposent comme deux sopranos, de tessitures sensiblement différentes. Le ténor « léger » c’est Léopold, léger par le caractère et léger par la voix. Mais n’est pas si léger qu’on le pense, tirant vers le lyrique, avec des agilités redoutables et des suraigus, comme nombre de ténors du Grand Opéra (Raoul des Huguenots par exemple). L’autre ténor est un ténor lyrique, dont la voix est plus large, moins « acrobatique » peut-être, mais exigeant des graves notables, des aigus eux aussi redoutables, et une négociation des intervalles pour le moins délicate, notamment dans les trente dernières minutes. Mais c’est aussi une voix paradoxale. On confie le rôle en général à des voix plus mûres, à des artistes dans la seconde moitié de leur carrière. Neil Shicoff a abordé Éléazar dans les dix dernières années de la sienne. Le personnage est plus mûr, c’est une figure paternelle, tout cela a sa logique. Toutefois, si l’air « Rachel quand du Seigneur » est un must de tout ténor (et tous le chantent dans des compilations pour ténor), ce n’est pas le cas de la cabalette qui le suit, indispensable pour comprendre le déroulement dramatique puisque c’est le moment où Éléazar choisit de ne pas sauver sa fille et de lui faire vivre le martyr, il la sacrifie comme Abraham est décidé au nom de Dieu à sacrifier son fils (d’où la vidéo très claire du sacrifice de l’agneau qui est projetée). Cette cabalette est redoutable par les intervalles ravageurs, avec des notes aiguës et suraiguës plus habituelles aux ténors plus « jeunes ». De fait, elle est souvent coupée. Un rôle difficile, qui demande beaucoup d’intériorité, mais aussi de la vaillance, et une tension de tous les instants.
Roberto Alagna abordait ce rôle que tout ténor lyrique français de référence rêve d’ajouter à son répertoire. Des grands ténors des trente dernières années, seuls Neil Shicoff et Chris Merritt l’ont affronté. Même Domingo n’a fait que chanter isolément « Rachel quand du Seigneur ». Il est vrai aussi que La Juive avait disparu des scènes pendant les années les plus importantes de sa carrière. Alagna affronte donc ce rôle, avec ses éminentes qualités.
Alagna est l’un des « ténors » de notre temps. C’est l’un des très grand du chant italien, et l’un des immenses du chant français : il le montre dans toute la première partie. Phrasé inégalable, diction de rêve, timbre solaire, d’une clarté incroyable, un chant d’une précision et d’une justesse miraculeuses. La scène de Pessa’h (acte II) est à ce titre une scène de référence. Pendant les deux premiers actes, Alagna est au sommet, comme on l’a entendu dans d’autres rôles français comme Le Cid.
Dans la deuxième partie et les trois derniers actes, là où il doit être le plus tendu et le plus virtuose, les choses ne vont malheureusement pas aussi bien, pour des raisons subjectives et objectives. Les raisons objectives sont d’abord que ce rôle long et tendu exige une endurance qui semble manquer à Alagna, la voix fatigue, et l’effort pour la conduire fait que l’interprétation s’en ressent. De même les exigences techniques du rôle ont semblé ce soir-là dépasser les possibilités actuelles du grand ténor. Dans « Rachel quand du Seigneur » on reconnaît le phrasé miraculeux, la pureté du timbre, mais il manque une tension, il manque une couleur hallucinée que Shicoff avait et qu’Alagna n’a pas encore : il faudra voir à ce titre les représentations de la saison prochaine au moment où le rôle aura été plus mûri. Mais pour la cabalette, les choses sont plus difficiles encore : aigus mal négociés, manque de rythme, intervalles difficiles, notes peu précises : l’héroïsme demandé n’est pas vraiment là et on entend la difficulté et les limites de la voix. D’ailleurs, elle a été coupée dans les représentations suivantes, mais on doit apprécier en ce soir de Première le cran de l’artiste qui l’a affrontée, tout en étant conscient de ses difficultés. Cela s’appelle de la générosité.
Mais, au-delà des capacités strictement techniques, (et pour de tels artistes, c’est même secondaire) il y a à mon avis des raisons subjectives qui tiennent au rôle et qui font qu’Alagna n’a pas forcément la voix qu’il faut pour Éléazar. Alagna n’est jamais si convaincant que dans les rôles solaires, auxquels son timbre s’adapte idéalement. Éléazar est tout sauf solaire : et Bieito l’a bien compris dans sa mise en scène noire, funèbre du début à la fin. Éléazar est un rôle tendu, sombre, halluciné, un rôle qui exige une expression de l’intériorité, qui exige de rentrer en soi, qui exige aussi une sorte d’aveuglement, de possession même au sens fort du terme, en bref, Éléazar est un ravagé, un lacéré. Qu’on le veuille ou non, le timbre d’Alagna n’a aucun de ces caractères, il évoque un tout autre univers que celui d’Éléazar. Alagna est un solaire, un diurne : il ouvre la bouche et « apriti Cielo !» (ouvre-toi Ciel !). Éléazar est un lunatique, un lunaire, un nocturne, un rongé de l’intérieur et le chant d’Alagna, qui a toujours une couleur de santé, voire de sérénité ne me paraît pas correspondre à ce rôle. Pour moi donc la raisons subjective, c’est que ce rôle ne lui correspond pas, et qu’il ne le fait pas (encore) sien.
À cela aussi correspond le traitement du personnage par Bieito. Là où un Py ou même un Audi l’identifiaient clairement, Bieito « l’anonymise » en lui faisant revêtir le costume le plus neutre possible, un costume-cravate gris, des cheveux gris, des lunettes et une serviette de rond-de-cuir, un look de petit fonctionnaire rabougri, qui ne fait plus « signe », il suit Rachel, qui elle est la seule « identifiable » avec sa robe verte, comme une ombre, avec les caractères d’une ombre. Bieito, comme pour Léopold, défait le rôle de son aura, de l’aura du ténor, de l’aura de la star qu’on attend, comme si la danseuse-étoile était noyée dans le corps de ballet. Ainsi défait des attributs opératiques habituels, presque « désalagnisé », Alagna ne semble pas vraiment à l’aise dans les atours, même si les qualités de l’artiste sont là et qu’il relève bravement le défi.
Comme souvent à Munich, les autres rôles le plus souvent au premier acte, sont très bien tenus et contribuent à la réussite d’ensemble. On notera d’abord le Ruggiero de Johannes Kammler, sonore et juvénile, l’Albert très bien dessiné de Tareq Nazmi, pilier de la troupe de Munich, et toujours à l’aise dans les rôles où il est distribué, et Christian Rieger en officier de l’Empereur, autre membre bien connu de la troupe.
Au total, nous nous trouvons face à une entreprise où la couleur de la mise en scène emporte tout : les costumes noirs ou gris de Ingo Krügler, les lumières, rasantes, contrastées, violentes de Michael Bauer contribuent également à une ambiance dérangeante, tendue, qui va à l’opposé du grand spectacle ou de la distraction. Si le Grand Opéra comme on l’a dit correspond à ce que serait le Musical aujourd’hui, on est aux antipodes, plutôt vers la cérémonie funèbre, vers une sorte de Requiem pour un martyr.
On est aussi aux antipodes de certaines productions de Bieito, échevelées, colorées (je pense à ce Mahagonny d’Anvers vu deux jours auparavant), qui offrent une profusion spectaculaire. Peut-être d’ailleurs assiste-t-on à une nouvelle phase du travail du metteur en scène espagnol, dans la veine du récent Lear parisien, plus marquée que Lear, plus terrible aussi, voire impitoyable, mais austère, mais réduite à l’essence des choses.
Et musicalement, la voie où s’engage Bertrand de Billy, entouré d’un orchestre des grands soirs et d’un chœur magnifiquement préparé par Sören Eckhoff est bien la même, où tout spectaculaire et tout pittoresque est effacé, et où la profondeur, l’intériorité et le raffinement sont privilégiés. Une direction très élégante, analytique, qui révèle plus qu’elle ne montre. Une révélation plutôt qu’une démonstration, voilà ce qu’est l’ambiance musicale, qui sacrifie un peu dynamisme et pulsion au profit d’un chemin plus difficile, peu complaisant, qui rend tout autant justice à une partition dont la richesse est grande. En trois mois deux visions contrastés d’une des œuvres phares du répertoire, avec ses qualités, et ses ambiguïtés. Le répertoire et les saisons, les mises en scènes s’inscrivent dans les tensions du moment. Gageons qu’une nouvelle carrière est lancée pour La Juive. [wpsr_facebook]