
Ma dernière recension de 2015, sur Il Viaggio a Reims se terminait ainsi: “c’était le dernier rendez-vous (un peu gris) de 2015, le premier de 2016 sera une fête, c’est promis, et c’est prévu”.
Est ce fut.
Quand j’ai vu sur l’avant-programme de Munich que La Chauve-Souris (Die Fledermaus) serait dirigée par Kirill Petrenko, mon sang n’a fait qu’un tour. L’opérette de Johann Strauss, comme toutes les grandes opérettes classiques, ne supporte pas la médiocrité et a besoin d’un grand chef pour l’exalter. Ma dernière Fledermaus, ce fut Carlos Kleiber en mars 1984 (Lucia Popp, Brigitte Fassbaender, Janet Perry). Depuis, je n’avais pas osé retourner en revoir une, préférant garder intact son souvenir. Il en va de Fledermaus comme de Viaggio a Reims, on pense que ce à quoi on a assisté est définitif et qu’il n’y aura pas mieux.
S’il y a une culture de l’opérette classique en pays germanique, elle n’existe pas (ou plus) en France, à quelques exceptions près, comme Lyon qui a depuis longtemps une « politique » Offenbach; l’Opéra de Paris n’aborde qu’avec parcimonie ce répertoire, même si Die Fledermaus avait bénéficié d’Armin Jordan en 2000 et du pape de l’opérette viennoise Rudolf Bibl en 2003.
Ainsi, le public était essentiellement germanique ce lundi, avec bien moins d’étrangers que lors de Götterdämmerung deux semaines auparavant, comme si on ne se déplaçait pas pour Fledermaus.
La production a 18 ans d’âge et elle a succédé à celle, mythique, d’Otto Schenk qu’on peut voir encore en vidéo (dirigée par Kleiber), c’est une production de Leander Haußmann et Helmut Lehberger, et elle a été pour l’occasion rafraîchie par Andreas Weirich: elle n’a jamais été une référence et reste médiocre, les décors de Bernhard Kleber sont peu imaginatifs, celui du second acte est plutôt sinistre dans le genre évocatoire. Parce que la chorégraphie imaginée exige un espace vide central, des toiles peintes (ou des projections) sur les côtés en constituent le cadre, alors que les 1er et 3ème actes sont plutôt réalistes (le 3ème est un hommage direct à la production d’Otto Schenk et aux décors de Günther Schneider-Siemssen). Je me demande toujours si l’on n’a pas intérêt à conserver ces productions mythiques jusqu’à ce qu’elles n’en puissent mais, comme on le fait pour La Bohème de Zeffirelli à la Scala et de ne tenter la nouvelle production que si l’on est sûr de son coup. C’est l’art du manager de savoir choisir et Sir Peter Jonas à l’époque s’était trompé.
Ce type de spectacle est en effet assez périlleux: il exige une mécanique parfaite (un peu comme les pièces de Feydeau), et un rythme concerté entre fosse et scène pour pouvoir fonctionner à plein ; si les choses ne sont pas a tempo, ça coince.
Enfin, le spectateur doit rire, toujours, et souvent même bêtement, de ce rire mécanique qui vous prend aux jeux de mots les plus pitoyables ou aux gestes et mouvements divers, y compris les plus lourds ; mais, et là est le secret, même la lourdeur doit être légère…
N’oublions pas que Die Fledermaus est écrite à partir d’une pièce de Meilhac et Halévy «Le Réveillon», et que les deux compères étaient les librettistes habituels d’Offenbach. Et c’est bien là le secret de ce type de spectacle, une légèreté pétillante, y compris quand dans un autre contexte on trouverait cela un peu lourd.
Ainsi, les parties parlées doivent être très soignées, dans le jeu, dans l’expression et aussi dans les accents divers, russe, allemand, français, viennois, et dans le ton et les attitudes (Adele !). Tout le dernier acte tourne autour du personnage de Frosch, un rôle parlé de geôlier ivrogne à l’impayable accent viennois qui tient la scène la moitié de l’acte. Un Frosch médiocre et tout le troisième acte qui n’est qu’un dénouement rapide plutôt maigre musicalement, s’écroule.
Ainsi Die Fledermaus n’est pas une entreprise facile, et Klaus Bachler a préféré éviter la nouvelle production. La Bayerische Staatsoper est plongée dans la préparation de South Pole, la création qui aura lieu le 31 janvier et ce n’était pas opportun de faire une nouvelle production qui aurait forcément été très attendue et aurait éclipsé le reste, vu le côté emblématique de l’œuvre, notamment dans un théâtre où Kleiber a tant marqué. Bachler a créé l’événement par la seule présence au pupitre de Kirill Petrenko et par le retour un 31 décembre de Fledermaus, qui avait disparu depuis quelque temps ; ce retour à la tradition a payé, puisque toutes les représentations étaient complètes. Mais le spectacle actuel nous fait dire qu’il faut sans tarder penser à une nouvelle production.
De la représentation, il n’y a pas grand chose à relater, quelques répliques marquantes (dues au livret), quelques scènes désopilantes au premier acte portées par Alfred le chanteur (Edgaras Montvidas) et Adele la bonne (Anna Prohaska) dans une sorte d’acte boulevardier, proche du vaudeville très XIXème siècle, mais aussi quelques pas de danse réglés à l’américaine (cannes et chapeau claque) et d’autres mouvements, pas vraiment légers, notamment quand Falke et Eisenstein dansent sur Komm mit mir zum Souper ensemble et finissent l’un sur l’autre en position un peu (!) équivoque. Voilà qui déroge au goût et à l’équilibre nécessaires à ce genre de spectacle, à moins qu’on ne choisisse une lecture à la Neuenfels, ravageuse, idéologique, faite expressément pour violenter un public hyperconformiste, qui avait indigné Salzbourg en 2001 pour des adieux en pied de nez de Gérard Mortier.
L’Acte II qui contient les ensembles les plus fameux, les airs que tous connaissent et la Polka finale étourdissante (la fameuse polka « Dans le tonnerre et les éclairs ») n’est pas très imaginatif et vraiment décevant. Nous avons évoqué le décor à la fois évanescent, peu suggestif, fait de projections sur des toiles latérales (et en fond de scène), pour laisser l’espace central vide et permettre une chorégraphie autour de l’immense table qui sert de podium et qui tourne sur elle-même, on y boit, on y marche, on y danse, on y pose…et on s’y ennuie un peu.
C’est assez mal réglé dans l’ensemble. Une fois de plus, la chorégraphie veut rappeler les grands ensembles des comédies musicales américaines des années 40, Fred Astaire et Ginger Rogers pourraient surgir dans cette fête où traditionnellement le 31 décembre surgissent des vedettes inattendues : ce fut Thomas Hampson au 31 décembre dernier qui chanta “Komm, Zigan, spiel mir was vor” de “Gräfin Mariza” mais pas le 4 janvier. Une fête au rythme peu rigoureux, avec quelques décalages avec la fosse, avec des mouvements peu clairs et désordonnés, et un Orlofsky (Michaela Selinger) au look tiraillé entre personnage de la famille Addams et Michael Jackson, intéressant en scène mais doté d’une voix pas vraiment passionnante en revanche, qui ne réussit pas vraiment à s’imposer. Au contraire, Anna Prohaska tire vraiment son épingle du jeu en Adele fraîche et délurée.
Ce deuxième acte qui devrait voir champagne et fête couler à flots, ne réussit pas à prendre le spectateur, parce que au lieu d’une comédie en musique, on a une succession de numéros sans vraie fluidité, ni fil rouge dramaturgique. Ainsi du Docteur Falke, le très bon Michael Nagy, voix chaude, claire, et surtout un vrai naturel en scène, jamais exagéré, avec toujours une touche d’élégance : c’est lui l’artisan de la farce, et c’est lui la Chauve Souris qui se venge. On le voit déguisé en Chauve Souris pousser le décor du 1er acte pour faire apparaître le second. C’est certes une transition logique puisqu’il est l’artisan de la farce, mais on n’en fait rien de plus et on peut même dire qu’il est complètement effacé par la mise en scène de l’acte II, peu explosive et mal organisée, prise au piège d’une direction musicale époustouflante et éperdue de dynamisme alors que le rythme sur scène ne lui correspond pas tout à fait .
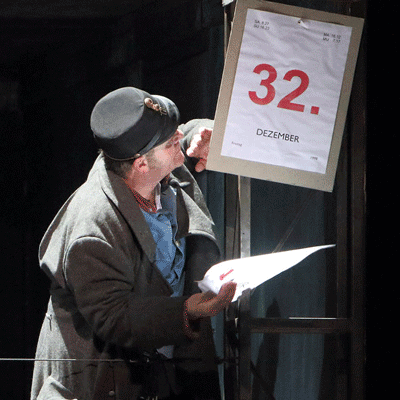
Le troisième acte est assez bref, essentiellement théâtral, dont la moitié repose sur la créativité de Frosch, toujours confié à un acteur en général connu (Franz Muxeneder avec Kleiber), qui est ici l’acteur viennois Cornelius Obonya, authentique star du théâtre qui interprète à Salzbourg actuellement le Jedermann de Hoffmannsthal. À lui seul évidemment il remplit l’espace pourtant chargé (à la différence de l’acte II où l’espace est vide). Accent viennois à couper au couteau, suite de ratiocinations d’ivrogne sur l’actualité, complètement en roue libre, on passe de la privatisation des prisons (prévue en Hesse) à Monsanto, la Fifa, jusqu’à des allusions aux 70 vierges de Mahomet: c’est presque un One man show où il pousse même la chansonnette en chantant Wien, Wien, nur du allein accompagné par l’orchestre en faisant grassement remarquer que pour une fois sur cette scène un acteur chante accompagné par le GMD en personne !!
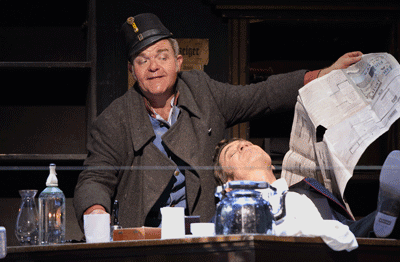
Quand un tel Frosch occupe la scène, même quasiment sans musique, le temps passe très vite et l’arrivée successive de tous les personnages se retrouvant dans la prison va précipiter le dénouement, où tous les quiproquos s’expliquent, où Alfred le chanteur (qui était en prison pour sauver l’honneur de Rosalinde) est libéré, où le directeur de la prison (« chevalier Chagrin ») retrouve son vrai prisonnier Eisenstein dans le « Marquis renard » avec qui il avait noué amitié durant la fête. Tout finit finalement assez vite par un ensemble festif.
Ce troisième acte est un peu mieux réglé, grâce à un décor à deux niveaux qui permet de distribuer les personnages et disposer le chœur, sans l’impression de fouillis donnée par l’acte II, décidément le moins réussi.
Par bonheur, la distribution est faite de chanteurs qui ont une vraie agilité en scène et un vrai jeu, à commencer par le couple vu sur cette même scène il y a quelques mois dans Lulu, Marlis Petersen et Bo Skhovus et qu’on retrouve dans un tout autre contexte avec autant d’aisance et autant de joie de vivre qu’ils étaient mortifères dans Lulu. Marlis Petersen (qui avait chanté Adele à Paris en 2000) très engagée et très joyeuse sait très bien dominer le personnage de Rosalinde, mais elle ne semble pas vraiment à l’aise vocalement: sa Czárdás (Klänge der Heimat), morceau de bravoure que tous attendent, est bien exécutée, sans être le feu d’artifice qu’on attend, les aigus, suraigus, jeux sur les trilles et acrobaties, sont un peu sotto tono, et la voix est peut-être un peu petite et trop « droite » pour le rôle, qui exige une assise forte dans le registre central et aussi des graves en bref une voix charnue qui n’a pas ici la ductilité ni la puissance qu’on attend et le dernier aigu est crié… Le succès est là, mais pas le triomphe. Elle avait les aigus dans Lulu, et certes, elle a ceux de Rosalinde mais plutôt tendus dans le genre toccata e fuga sans toujours les mettre en valeur, les tenir, les exposer, les livrer au délire du public. Il faut dire à sa décharge que l’espace vaste et non réverbérant du décor ne l’aide pas vraiment et contribue à noyer la voix.
Bo Skhovus qui est baryton, chante Eisenstein. Eisenstein est confié tantôt à un baryton (comme Hermann Prey, ou Eberhard Wächter) tantôt à un ténor (Nicolaï Gedda, Werner Hollweg), Bo Skhovus a une voix claire, assez ténorisante ici, et Eisenstein ne chante que dans les ensembles (duos ou trios) sans avoir d’air à proprement parler. Mais il doit être un personnage : il est donc un vrai personnage à la Feydeau, en faisant même quelquefois un peu trop, même si son aisance et sa manière de se mouvoir épatent à certains moments. Il est amusant, très leste, mais au total il n’a pas toujours ce naturel fluide qu’on attendrait d’un chanteur qui a pourtant toujours été un grand acteur. Là où Nagy est parfaitement équilibré, élégant et plutôt discret, il compose un personnage un peu, voire un peu trop, exubérant.

J’ai dit souvent tout le bien que je pense de Michael Nagy, un chanteur intelligent, à la voix chaude, toujours très en place, un merveilleux Wolfram, un hérault de Lohengrin notable, un magnifique Stolzius dans Die Soldaten sur cette même scène. Dans le rôle de Falke qui est dans l’intrigue celui qui combine toute l’affaire, il a une sorte de discrétion non démonstrative, mais très efficace : il doit être toujours là pour veiller au bon déroulement de la farce et n’intervient pas beaucoup sinon dans les ensembles ou dans le duo avec Eisenstein Komm mit mir zum Souper au premier acte, un des moments où le chant demande raffinement au départ et progressivement allant et dynamisme, vu la manière dont le duo se conclut, mais la mise en scène ne convient pas vraiment et effleure la vulgarité. Compagnon de beuverie d’Eisenstein, il est ici un peu son opposé, là où Skhovus en fait beaucoup, il reste presque en retrait, mais ce rôle est ici voulu par une pièce où le couple central est Eisenstein et Rosalinde, et où les autres sont épisodiques (sauf Adele qui est un vrai rôle, un personnage réellement incarné).

Justement, depuis qu’Abbado voulait en faire sa Lulu qu’il n’a pas faite hélas, Anna Prohaska ne m’a jamais vraiment convaincu, encore dernièrement dans l’Alcina d’Aix (Morgane) et le Rosenkavalier de Baden-Baden où elle était une Sophie sans relief vocal aux côtés d’Harteros.
La voix ici convient en revanche parfaitement, le personnage est juste, très bien joué, avec l’exagération voulue, les mignardises exigées, la touche de vulgarité, aussi quelquefois l’élégance; c’est surtout vocalement impeccable (son air d’entrée) . C’est elle qui est la plus convaincante et qui remplit la scène d’une manière remarquable.

Michaela Selinger est un vrai personnage sur scène, j’ai écrit plus haut qu’elle était à mi chemin entre Michael Jackson et la famille Addams, avec cette ambiguïté sur le travestissement qui nous emmène loin de Fassbaender ou de Resnik, mais qui pose un Orlofsky particulier et finalement intéressant. Mais vocalement elle ne réussit pas à s’imposer, la voix reste petite, et n’a pas la profondeur voulue ni la largeur, c’était évident pour moi dans Im Feuerstrom der Reben où la voix n’a pas l’épaisseur suffisante pour porter l’ensemble. Il faudrait aujourd’hui une Elisabeth Kulman, ou une Sophie Koch, ou peut-être explorer un contre ténor (Jochen Kowalski l’a fait).
Edgaras Montvidas, est un ténor que j’ai apprécié aussi bien dans Lenski (à Lyon et Munich) que dans Le Rossignol de Stravinski (Lyon), ténor élégant, avec une belle projection et une voix claire, il est à sa place dans ce rôle de ténor ténorisant, aussi bien dans le vaudeville du premier acte (où il ouvre l’opérette) qu’au troisième où il est en prison par galanterie; pour passer le temps et tromper l’ennui il esquisse quelques airs du répertoire dont un nessun dorma qui fait beaucoup rire. Il remporte un bon succès, dans ce rôle de complément indispensable à l’action, mais musicalement plus modeste.

Michael Laurenz, ex-trompettiste du Gustav Mahler Jugendorchester, est passé de la trompette au chant, comme Klaus Florian Vogt et il est ici l’avocat Blind, très « caractériste » qui a quelque chose du Basilio de Nozze di Figaro, plus marquant ici pour le personnage qu’il incarne sur scène que pour la voix (il est vrai qu’on ne l’entend guère que dans les ensembles), tandis que Christian Rieger, qui appartient à la troupe de Munich est vraiment excellent en Frank, directeur de la prison, aussi bien scéniquement que vocalement.
J’ai dit mes doutes sur la chorégraphie de Alan Brooks qui ne me semble pas vraiment adaptée, mais pas le chœur rompu à cette œuvre dirigé par Sören Eckhoff, vraiment magnifique, aussi bien dans les ensembles puissants de l’acte II que dans les parties plus lyriques ou plus retenues, voire poétiques.
L’orchestre est lui aussi rompu à cette œuvre traditionnelle du répertoire germanique, et il a sonné d’une manière exemplaire, dans aucune scorie, avec un raffinement dans les parties plus solistes qui faisaient entendre une partition qu’on nous invitait à redécouvrir. Aussi bien dans les parties les plus rapides, et le train était d’enfer que les plus lyriques, il sonnait merveilleusement dans la salle du Nationaltheater.
Mais bien sûr, last but not least, le motif du voyage était pour moi Kirill Petrenko, dans une œuvre où sa présence en tant que GMD est nécessaire et traditionnelle, mais où on ne l’attend pas forcément, vu le répertoire jusque là embrassé à Munich. D’ailleurs, comme je l’ai dit, on hésite à faire le voyage pour une Fledermaus. Mais les absents ont eu tort, grand tort.
Ce fut une direction musicale inoubliable, un moment de grâce; ce fut incroyable, oui incroyable de rythme, de dynamisme; il y avait dans ce travail du feu, il y avait du lyrisme et il y avait surtout une joie phénoménale. À l’évoquer, l’émotion m’étreint comme elle m’a étreint lors de l’exécution de l’ouverture, qui m’a arraché un cri d’enthousiasme : elle explose d’abord avec une force incroyable, puis immédiatement le raffinement et la légèreté, et même quelques surprises (un hautbois au son un peu rugueux, comme émergé d’un quelconque sabbat) et tout le temps, une clarté, une fluidité, une finesse inouïes : comment expliquer que je n’avais jamais perçu cette œuvre avec cette profondeur, jusqu’à des phrases de contrebasses jamais entendues, jusqu’aux percussions qui vivent, qui dansent et qui ne « frappent » pas. Petrenko nous montre une construction, une composition, une œuvre enfin, qui ne laisse pas de nous étonner. Oui, cette ouverture est phénoménale, il n’y pas d’autre mot…tout comme tout le final du second acte, et notamment la polka, emmenée à un rythme infernal, oui infernal, étourdissant comme jamais, une incroyable fête musicale qui donne le tournis et qui laisse cloué sur place.
Mais ce ne sont pas seulement ces moments attendus qui ravissent: il y a la délicatesse inouïe de l’accompagnement, le lyrisme de certains ensembles, le rendu cristallin de certains passages plus retenus, plus poétiques, et aussi l’évocation d’autres moments très donizettiens (eh oui), ou certains lointains souvenirs de Rossini (encore et toujours lui). La manière dont Petrenko dirige cela fait émerger toute une tradition et toute une culture musicales, certes viennoises, mais qui transcende les identités traditionnelles (Rossini était fort populaire à Vienne dans les années 1850), toute une épaisseur sensible à laquelle cette musique universellement connue ne nous avait pas habitués, ou que nous n’étions pas habitués à entendre ; les ensembles, scandés comme dans l’opéra italien (il m’a rappelé la manière enivrante dont il a emporté l’ensemble final du premier acte de Lucia di Lammermoor), le dynamisme explosif, et communicatif ont montré avec quelle virtuosité il a réussi à tout faire tenir ensemble, avec quel fabuleux entrain il a emporté l’orchestre, et surtout quelle joie très détendue il affichait au pupitre. Je vais peut-être un peu étonner mais jamais comme ce soir l’évidence d’entendre un des plus grands chefs du jour ne m’avait à ce point ébloui, aveuglé, assailli, et les conversations à l’entracte confirmaient la stupéfaction de tous : on s’attendait bien sûr à une magnifique performance, mais on a eu plus : le ciel s’est ouvert.
Comment s’étonner alors que toute la presse a évoqué Carlos Kleiber dans la manière dont il a entraîné l’orchestre et dont il a rendu à cette œuvre profondeur musicale et authentique noblesse, en en gardant toute la saveur, toute la gaieté, toute l’émotion aussi, et surtout tout le naturel!
Alors, c’est vrai, la production est bancale. Il est vrai aussi que la distribution, de bon niveau, n’était peut-être pas celle qu’une telle direction musicale exigeait . Ce soir le Verbe était dans la fosse, la verve était dans la fosse, la magie était dans la fosse, la folie était dans la fosse, et nous, nous étions collés au fauteuil, bouleversés par ce moment aux intenses vibrations, et tourneboulés par ce qu’on entendait, que dis-je entendait, découvrait. [wpsr_facebook]












