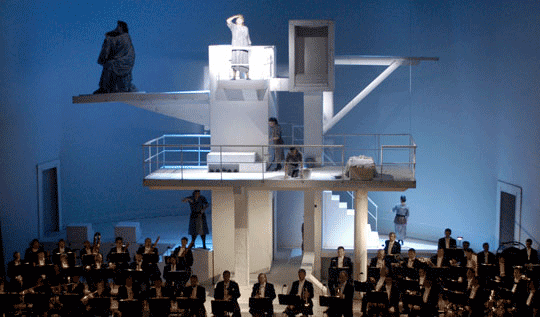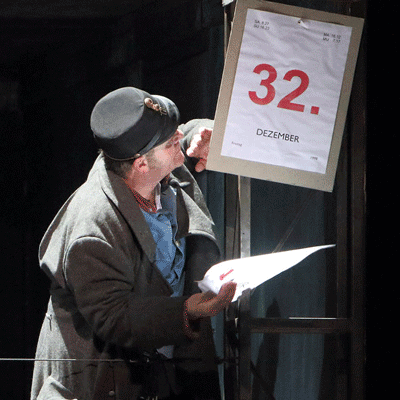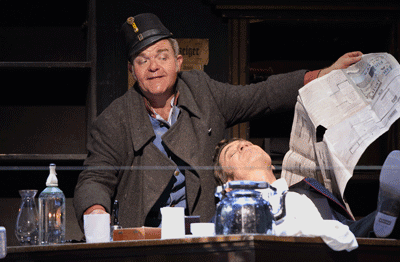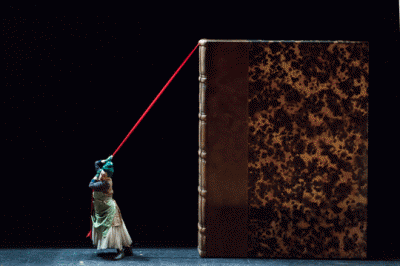Il y a quelque chose de familial dans cette production du Barbe Bleue de Jacques Offenbach présentée à Lyon depuis le 14 juin dernier. Familial parce que si un théâtre a rendu hommage à Offenbach, c’est bien l’Opéra de Lyon depuis plus de deux décennies, et avant même l’arrivée de Serge Dorny. Il est donc naturel qu’en 2019, deux centième anniversaire de sa naissance, Lyon affiche cette nouvelle production (en fait création à Lyon) de Barbe Bleue, mais aussi qu’à la fin de l’année l’opéra affiche une reprise de la production de Pelly du Roi Carotte, dont la révélation avait beaucoup marqué il y a quatre ans.
Familial aussi par la fidélité marquée envers Laurent Pelly, qui a lié son nom à toutes les productions lyonnaises d’Offenbach. Serge Dorny a compris, en continuant de lui confier les Offenbach ce que cette fidélité signifiait pour la maison, pour la couleur et la cohérence de l’approche mais aussi pour les habitudes de travail avec une équipe qu’on connaît et qu’on aime. D’où cette impression d’aisance et de fluidité qu’on voit notamment dans la manière dont le chœur (emmené cette fois par l’excellente Karine Locatelli, responsable de la maîtrise de l’Opéra de Lyon) joue, chante et danse avec une joie visible et une liberté régénératrice. Serge Dorny aime inscrire sa programmation dans des fidélités, très diverses, qui créent des habitudes chez le public mais aussi dans le personnel de la maison. C’est ce que j’appelle « quelque chose de familial » : le retour de Pelly, c’est le retour du cousin rigolo qui va mettre une ambiance joyeuse dans le travail.
Ce travail est d’abord marqué par la mécanique de précision nécessaire à toute œuvre d’Offenbach, comme à toute opérette d’ailleurs. Il en va de l’opérette ou de l’opéra-bouffe comme des pièces de Feydeau : sans le rythme, sans le tempo soutenu, sans l’impeccable travail millimétré, tous les effets tombent à plat.
On chante et on danse au rythme de la musique avec des mouvements calculés, des gestes bien réglés dans une chorégraphie impeccable, le tout avec une fluidité scénique qui est la caractéristique du travail de Laurent Pelly.

L’approche n’a rien de commun avec la mise en scène de la Komische Oper de Berlin (Stefan Herheim); elle est plutôt réaliste, notamment le décor initial de ferme, qui aurait pu être idéalisé et pastoral, mais qui est au contraire particulièrement ancré dans une réalité agricole d’aujourd’hui, tas de fumier compris, avec l’évocation de titres des faits divers dramatiques que sont les disparitions de femmes façon serial-killer.

Le cadre principal des deuxième et troisième actes est celui d’un salon qui pourrait être le salon de n’importe quel palais avec sur la droite en reproduction géante les titres de la presse à scandale ou de la presse du cœur qui relate les histoires des princes et des princesses. Là aussi, le réalisme domine dans la représentation car Pelly inscrit l’histoire dans un cadre, avec ses références et ses rapports au quotidien, d’où ensuite les décalages créés dans la loufoquerie. L’opposition de la presse locale de faits divers et la presse “people” donne aussi une idée de la distance qui existe entre les deux univers.
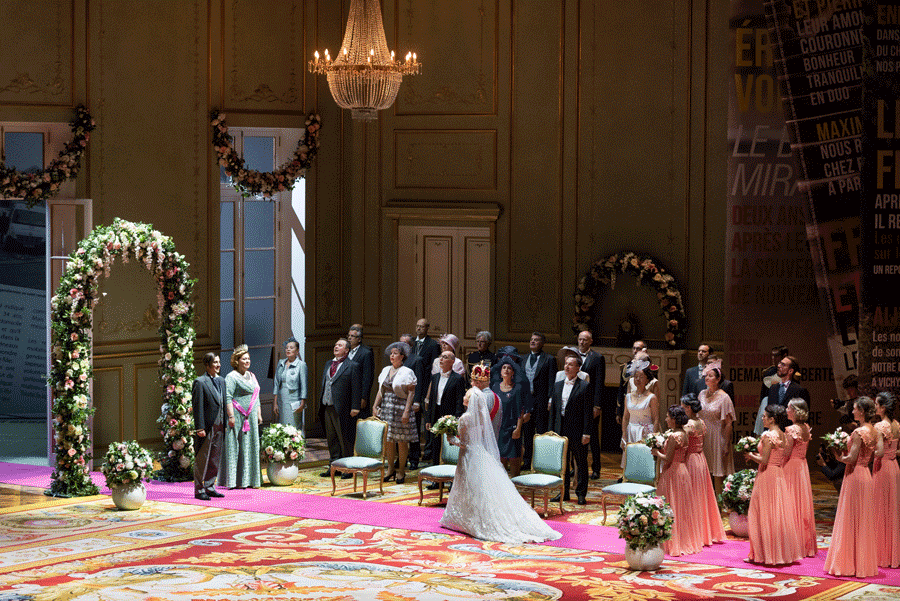
La nature d’Offenbach comme l’a souligné Barrie Kosky dans son interview publiée dans Wanderer est d’être en prise directe avec son temps pour tourner en dérision les manies ou les personnages politiques ou mondains de l’époque, avec en premier lieu un regard acéré sur les jeux du pouvoir. Il affirme d’ailleurs le rôle d’aiguillon de l’opérette, qui parce qu’elle est populaire se permet une grande liberté de ton qui va de l’ironie sur le pouvoir aux grivoiseries marquées.
Les courtisans au début du deuxième acte chantent d’entrée
« Notre maître va paraître,
au Palais nous accourons,
force grâces force places,
voilà ce que nous voulons »
Ils sont ridiculisés dans leur manière de saluer : quand Bobèche entre, sa première réplique est « ils sont plus bas qu’hier… parfait ! ». La dénonciation de la cour et de ses petits travers est permanente. Pour rendre un peu l’effet qu’Offenbach pouvait avoir sur les spectateurs du temps il suffirait de faire de Bobèche et de son épouse une imitation d’Emmanuel Macron et de Brigitte ou de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni : les phénomènes de cour sont récurrents ; quant à Barbe-Bleue on pourrait lui donner les traits de quelque séducteur invétéré et infatigable profitant de sa position… il y en a eu dans le monde politique récent…. On verrait alors si le pouvoir le supporterait. On se rappelle que Les Grenouilles d’Aristophane dans la mise en scène de Luca Ronconi à Syracuse affichait tous les personnages du personnel politique berlusconien de l’époque et leurs effigies furent retirées par l’action légale d’un obscur et imbécile berlusconien local.
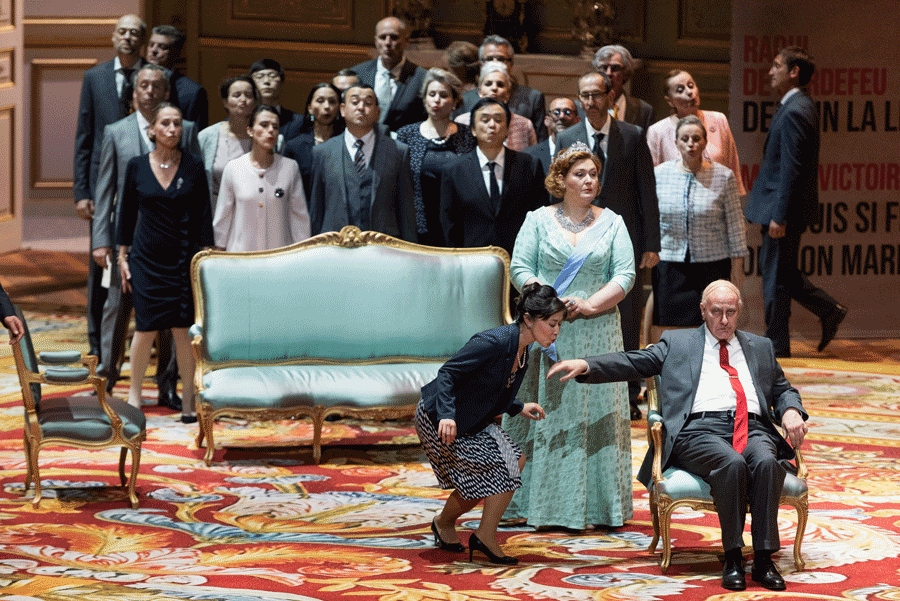
La question du rapport à l’époque n’est pas posée en des termes aussi directs par Pelly qui reste plus sage à cet égard mais la satire est bien claire et bien des excellences qui gravitent autour du pouvoir pourraient se reconnaître sous la figure des courtisans. La loi du genre est celle du comique et de la gentillesse et ainsi la monstruosité de Barbe-Bleue est-elle compensée par l’astrologue Popolani et celle de Bobèche par le comte Oscar; Offenbach met en scène des monstres parallèles: d’une part le roi jaloux de son pouvoir et de rivaux éventuels auprès de sa femme qu’il fait tuer et d’autre part Barbe-Bleue épouseur et meurtrier.
Voilà qui ne valorise ni le pouvoir ni la classe aristocratique; il faut toujours voir derrière ces histoires loufoques une lecture de la société du temps. Le genre opérette en France n’a pas survécu à l’affadissement de ses œuvres les plus traditionnelles tout comme d’ailleurs la culture des chansonniers : l’heure est au consensus mou et télévisuel, pour aseptiser les spectacles et anesthésier le spectateur. Et la véritable opérette ne mange pas de ce pain fade.
Il est clair qu’Offenbach s’adresse à un public averti qui sait lire entre les lignes, un public plutôt urbain, voire exclusivement parisien. Laurent Pelly reste en-deçà d’une satire trop directe et préfère travailler à la mécanique comique et à une vision plus générique et moins ciblée, même si le premier acte est vraiment inscrit dans une réalité socialement dégradée. Il travaille donc plus directement sur la question des classes sociales et sur la manière dont les paysans/agriculteurs sont exploités par les aristocrates/patrons ( les puissants du coin) comme on le ressent dans la relation de Barbe-Bleue aux paysannes et à la question de la « Rosière » : il s’agit simplement d’une resucée du droit de cuissage déjà dénoncé par Beaumarchais de Le Mariage de Figaro.
Par ailleurs, la relation du « prince charmant » Saphir déguisé et de la bergère Fleurette, au-delà du lien à l’univers des contes de fées (dont Barbe-Bleue est d’ailleurs aussi issu), est une allusion claire au monde de la Pastorale et aux bergers d’Arcadie, une image de paradis dont Pelly se libère en insérant le premier acte dans la dure réalité du travail agricole.
Il y a en effet une culture classique et mythologique largement partagée à l’époque dont les références aujourd’hui ont disparu et qui nécessitent adaptation, même si les interventions d’Agathe Mélinand sont limitées.
Il est vrai que la culture classique et ses références étaient naturelles à l’époque d’Offenbach , elles sont aujourd’hui moins claires au public. Si Fleurette est une allusion probable à l’expression « conter fleurette », le nom qu’on lui donne à la cour, Hermia, est issu du Songe d’une Nuit d’été de Shakespeare et c’est le nom de la fille du Roi Égée. En revanche le roi et la reine au-delà des assimilations modernes dont pourrait rêver sont vus comme des rois et reines de contes de fées pris à rebours en quelque sorte: loin d’être bienveillant le roi Bobèche est lâche, vaniteux, cruel et la reine un peu cruche ; ainsi le personnage de Boulotte est-il essentiel à la trame parce qu’il rompt tous les usages policés de la Cour notamment dans les rapports hommes-femmes (le baiser sauvage à Saphir), par son absence totale de retenue.
Boulotte est une nymphomane aux formes avantageuses « c’est un Rubens ! » chante-on d’elle à l’acte I . Elle rompt tous les codes, c’est le ver dans le fruit ou le loup dans la bergerie. Il est donc essentiel que le rôle soit interprété une chanteuse-actrice qui remplisse la scène car c’est sans conteste le rôle principal (confié à la création à Hortense Schneider). Boulotte, c’est ce qu’elle est (bien en chair) et c’est aussi ce qu’elle fait car elle boulotte les hommes par sa nymphomanie permanente. Elle est en quelque sorte le versant féminin de Barbe-Bleue. On peut supposer que le couple qu’elle formera au final sera assez explosif.
Comme on le voit l’ensemble n’est pas si simple. C’est une œuvre à plusieurs entrées qui peut donner cours à des mises en scène très diverses. ; aussi Barbe-Bleue n’est-elle pas une œuvre secondaire comme on a pu l’écrire, même si elle est peu jouée. Et la vision de Pelly n’est pas une vision au premier degré, mais reste relativement loin de lourds symboles : elle laisse l’imaginaire du spectateur vagabonder.
Musicalement les choses ne sont pas si simples non plus.
Offenbach a beaucoup étudié Mozart et beaucoup écouté Rossini et lu ses partitions. Il ne faut jamais oublier que Rossini, même après avoir renoncé à écrire des opéras, reste le compositeur le plus célèbre et le plus joué en Europe, et surtout une référence qu’on retrouve soit chez un Donizetti ou un Auber, soit dans le Grand Opéra qu’il a créé avec son Guillaume Tell. Or Offenbach est à l’écoute des modes du temps, et connaît parfaitement son Rossini et les grands compositeurs qui ont essaimé depuis 1830.
Comment ne pas reconnaître Rossini dans la tempête du début du deuxième tableau de l’acte II par exemple. Ou dans la scène entre Barbe-Bleue et Boulotte au bord de la mort un écho des drames du Grand Opéra, avec ses excès et sa grandiloquence? Et ce qui fait la difficulté de l’approche musicale c’est qu’il peut être à la fois mozartien avec un orchestre assez léger et puis passer à un mode symphonique plus lourd comme dans ce deuxième tableau de l’acte II dans les caves du château qui ressemblent à l’antre d’un médecin légiste. On trouve donc à la fois des ruptures de style (on peut passer de Mozart à Meyerbeer), des ruptures de tempo très nombreuses, ce qui rend l’approche délicate, où seuls les chefs qui ont la précision, les impulsions, le nerf et une musicalité accomplie peuvent réussir à dominer un style où l’on retrouve sur le mode parodique Rossini Donizetti et Meyerbeer tout à la fois.
Cette maîtrise, le jeune chef milanais Michele Spotti la possède déjà à 26 ans : dès le départ on sent une impulsion, un rythme, une nature: il fait apparaître les différentes couleurs de la partition et surtout fait entendre son épaisseur sonore variable, de la légèreté de l’ouverture à des moments plus imposants dans le deuxième ou le troisième acte. Tout cela en fait l’artisan principal de la réussite de la soirée : il y a longtemps que l’on n’avait pas entendu un Offenbach si raffiné et si juste, dans le style, dans la couleur mais aussi dans l’ironie et la parodie. Un chef italien pour Offenbach, cela paraît évident quand on sait où puisait sa veine parodique le génial « Mozart des Champs Elysées » comme Rossini lui-même l’avait appelé. Et pourtant ils ne sont pas si nombreux les chefs de la Péninsule qui s’y sont frottés. L’orchestre excellent le suit et fait tout entendre, sans une seule scorie, avec une rare dynamique.
Voilà un nom à retenir, qui s’ajoute à la liste déjà longue des jeunes chefs italiens qui émergent depuis quelques années, et qui constitue une génération très riche d’avenir. C’est aussi le signe de la qualité de la formation à la direction d’orchestre dispensée au Conservatoire Giuseppe Verdi de Milan.
Nous avons déjà évoqué le chœur excellent dirigé par Karine Locatelli, rompu à l’exercice par une longue fréquentation des mises en scène de Pelly et de cette musique. Le chœur de Lyon, un peu comme celui d’Amsterdam, est très perméable aux mises en scènes et s’adapte avec engagement à toutes les situations, tout en gagnant régulièrement en qualité.
Du côté de la distribution voisinent des vieux routiers d’Offenbach et des jeunes, les jeunes plutôt du côté des voix féminines et les vieux routiers du côté des hommes, si l’on excepte le très bon prince Saphir de Carl Ghazarossian. Offenbach, pas plus qu’il n’est facile à diriger, n’est pas facile à chanter. Yann Beuron, excellent Barbe-Bleue, très efficace, possède l’abattage (c’est le cas de le dire…) vraiment désopilant dans son rôle de « parrain » des faubourgs ou des fermes, mais avec quelques rares problèmes sur les suraigus; la voix garde néanmoins sa souplesse, et compose le personnage délirant (et un peu inquiétant) qu’on attend.

Christophe Gay est le « gentil » astrologue Popolani, qui ne fait rien d’autre que de récupérer à son profit (ou au profit de son « Popol ») les femmes que Barbe-Bleue a condamnées, en les gardant dans un salon capiteux, à l’atmosphère de maison close (très close en l’occurrence), voix claire, très expressive, agilité sur scène et jeu très naturel et fluide.
Christophe Mortagne est le roi Bobèche ridicule et odieux, qui fait tuer les courtisans qui courtisent sa femme de trop près. C’est une caricature de souverain autoritaire (un peu comme le Roi Carotte qu’il a joué à Lyon justement), mais plus que celle de Napoléon III, c’est celle de tout pouvoir abusif et lâche, comme si l’un n’allait pas sans l’autre. Bobèche a tous les défauts du genre, d’autant plus autoritaire qu’il n’a point d’appui pour garantir son pouvoir, d’où sa manière rapide de vendre sa fille à Barbe-Bleue qui est quant à lui une réelle menace armée. C’est ainsi que s’expliquent les comportements du Comte Oscar (Thibault de Damas, voix bien timbrée de baryton basse, avec un bonne diction, utile dans un rôle très parlé) et de Popolani pour Barbe-Bleue: ils essaient de limiter la casse en « trahissant » à leur profit.
Le Prince Saphir est dans ce quatuor une (in)utilité au départ. Le personnage est fade, c’est Hermia (Fleurette) qui va le chercher et l’impose, les personnages féminins semblent plus décidés et dynamiques que les personnages masculins. Il s’oppose néanmoins en duel à Barbe-Bleue, qui n’en fait qu’une bouchée: il est donc quand même chevaleresque. Carl Ghazarossian n’a pas une voix très puissante, mais s’en tire avec un bon phrasé et une bonne projection, tout comme la reine Clémentine d’Aline Martin.
La jeune Hermia/Fleurette (Jennifer Courcier) a une voix claire et juvénile, au volume cependant limité, mais c’est une interprète fraiche et engagée scéniquement.
Enfin, Boulotte, rôle principal, mené tambour battant par la jeune Héloïse Mas, qui a à la fois la présence et le dynamisme, dans un rôle qui pourrait vite sombrer dans la vulgarité et pour lequel elle garde un entrain joyeux et jamais graveleux. La voix est puissante, homogène, contrôlée avec de beaux aigus et des graves bien timbrés. Elle donne à ce rôle une belle personnalité et l’incarne avec bonheur. Il faudra la réentendre dans d’autres rôles. Elle a triomphé et ce n’est que mérité.
Au total, la soirée a laissé le public ravi, souriant, qui chantonnait souvent en sortant. Offenbach avait opéré, dans la maison qui l’a le mieux servi depuis des décennies. Au vu de la manière piteuse dont ce bicentenaire est fêté en France, ce sont les maisons de région, pas seulement Lyon d’ailleurs, qui portent le flambeau. Ce Barbe-Bleue est à revoir à L’Opéra de Marseille en décembre et janvier.
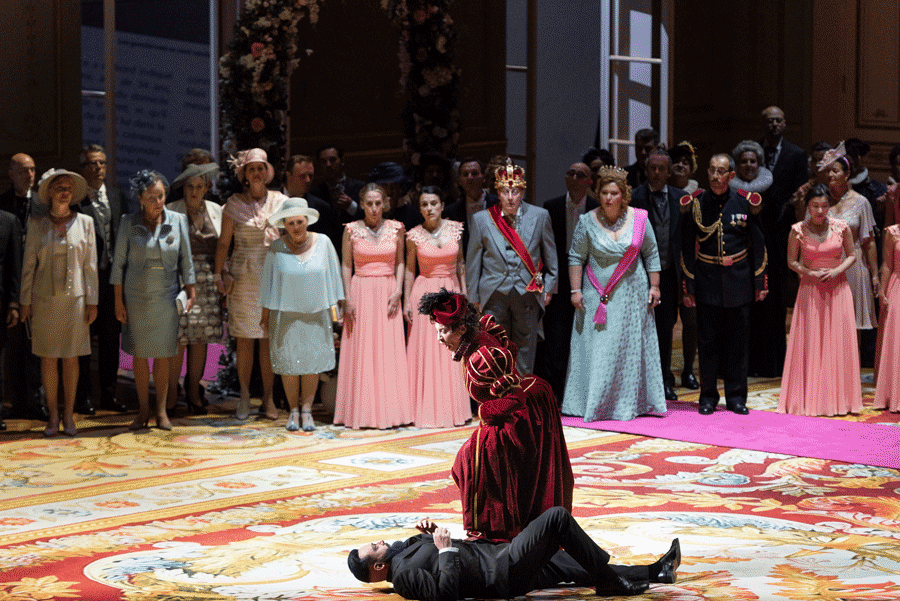
La représentation:
Jacques Offenbach (1819-1880)
Barbe-Bleue (1866)
Opéra-Bouffe en trois actes de Henri Meilhac et Ludovic Halévy
adapté par Agathe Mélinand
Direction musicale: Michele Spotti
Mise en scène et costumes: Laurent Pelly
Adaptation des dialogues: Agathe Mélinand
Décors: Chantal Thomas
Lumières: Joël Adam
Barbe-Bleue: Yann Beuron
Le Prince Saphir: Carl Ghazarossian
Fleurette: Jennifer Courcier
Boulotte: Héloïse Mas
Popolani: Christophe Gay
Le roi Bobèche: Christophe Mortagne
Le Comte Oscar: Thibault de Damas
La reine Clémentine: Aline Martin
Orchestre et Chœurs de l’Opéra de Lyon
Chef des choeurs: Karine Locatelli