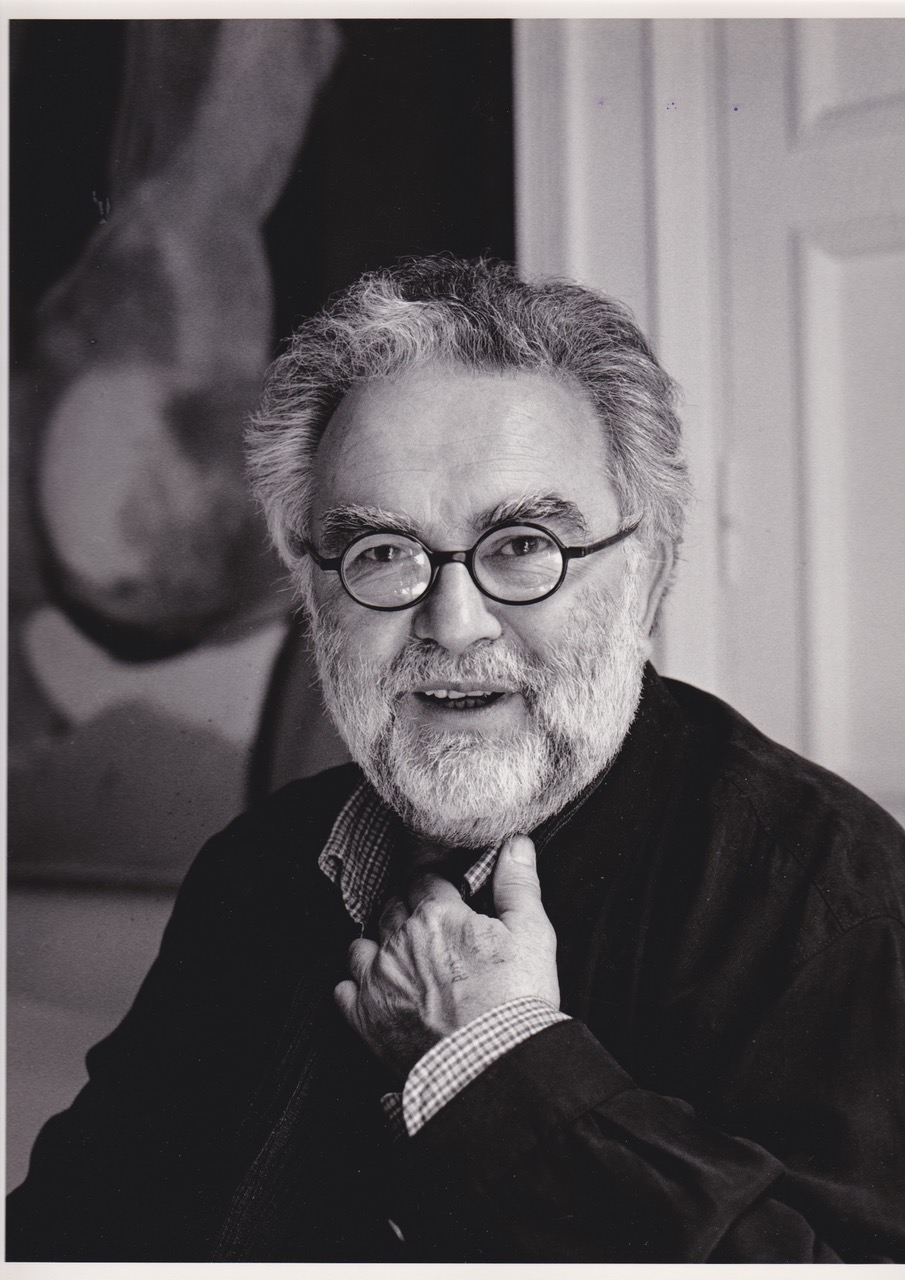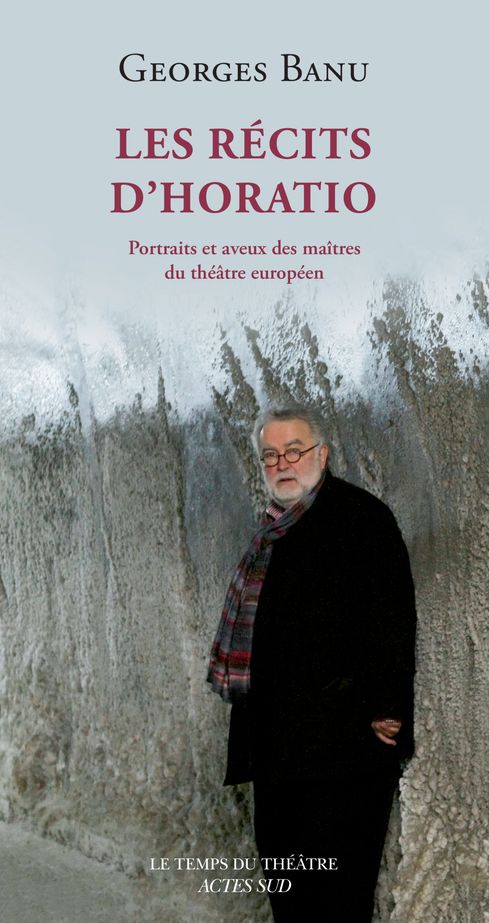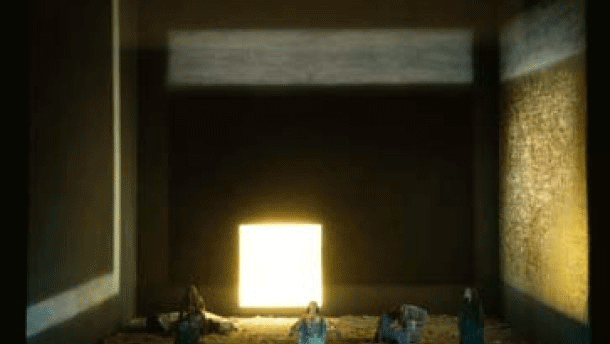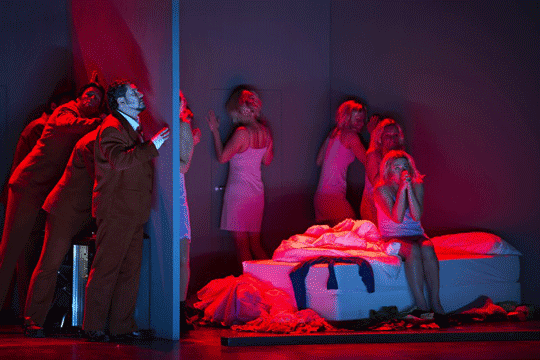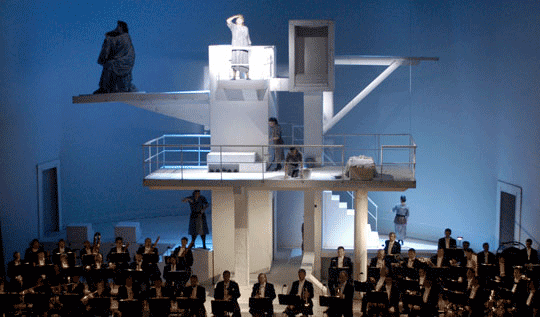SABLES MOUVANTS
L’exercice est périlleux. La période est instable. Nous avons évoqué la question de Stéphane Lissner, qui a attaqué l’État italien pour l’interruption brutale de son contrat, à cause du Décret-loi du 4 mai dernier et nous avons aussi évoqué la position pour le moins fuyante de la municipalité de Naples qui a pris acte du départ forcé du Sovrintendente. Le site du théâtre porte encore comme Sovrintendente et Direttore artistico Stéphane Lissner, en attendant développements ultérieurs, le décret-loi n’est pas encore devenu loi, mais …
En tous cas, le seul départ attesté est celui de José Luis Basso, chef des chœurs, qui dirigera à partir du 1er septembre le chœur du Teatro Real de Madrid, ce qui est indicatif de la situation fragile du grand théâtre napolitain à plusieurs niveaux.
– D’une part les derniers développements ont évidemment posé de nombreux points d’interrogation sur l’avenir de la programmation construite par Stéphane Lissner et sur la pérennité de ce qu’il a commencé à construire.
– D’autre part, le départ brutal de Lissner a créé un appel d’air dans lequel les syndicats se sont engouffrés et les travailleurs du théâtre ont déclenché des grèves et une agitation qui a amené à de récentes annulations entre mai et juin 2023.
– Enfin le talon d’Achille de ce théâtre n’est pas tant sa force de production que ses forces artistiques, chœur et orchestre, qui n’ont pas le niveau requis pour les ambitions affichées qui sont celles d’égaler au moins L’Opera di Roma et un jour le Teatro alla Scala, même s’il faut reconnaître que leurs dernières prestations s’étaient très nettement améliorées par rapport à ce qu’on avait l’habitude d’entendre. Ambitions légitimes au regard de l’histoire glorieuse d’une institution qui a sans doute plus contribué encore à l’art lyrique et à la gloire du répertoire italien que la Scala elle-même : la liste des premières mondiales napolitaines donne le vertige.
L’Opera di Roma est une institution récente, qui remonte à la fin du XIXe et dont l’identité était d’être l’opéra de la capitale de la nouvelle Italie, Milan et Naples étant les opéras de l’Histoire, auxquels on ajoutera le Teatro La Fenice de Venise, construit en 1792 (c’est le plus récent des théâtres historiques) resté au long du XIXe siècle un théâtre de référence, dans une ville qui a créé le théâtre d’opéra public dès le XVIIe.
Bref, aller au San Carlo est une plongée dans une histoire riche, prestigieuse, représentant une ville qui trouve ses racines dans l’antiquité et qui fut pendant des siècles la seule vraie capitale italienne, restant aujourd’hui encore l’une des villes européennes les plus fascinantes.
À ce titre, et au-delà de toutes les polémiques qui ont entouré Stéphane Lissner pendant les dernières années, l’entreprise qu’il a commencé d’édifier au San Carlo se justifie pleinement, mérite qu’on s’y intéresse et qu’on la salue, même s’il ne faut pas négliger le travail de remise à plat patient effectué par celle qui l’a précédé à ce poste, Rosanna Purchia, l’une des grandes représentantes du management théâtral en Italie, restée de 1976 à 2009 directrice de l’organisation et de la réalisation de la production artistique au Piccolo Teatro, celle qui a accompagné toutes les directions, Giorgio Strehler, Jack Lang, Luca Ronconi et rendu possible la continuation de la production dans ce théâtre de légende.
Car le San Carlo est une institution depuis longtemps sur le fil du rasoir, qui a besoin de travaux de réfection et de restauration dont certains entamés en 2023, qui a besoin d‘une réflexion sur ses forces artistiques, et qui a aussi besoin d’une politique artistique sur le long terme, les trois ensemble formant un « en même temps » très délicat à combiner et à tisser sur un terrain aussi mouvant que le terrain napolitain. Quand on possède le plus beau des palais, si les fondations sont fissurées, le risque, c’est l’écroulement.
C’est là toute l’histoire des dernières décennies de ce Théâtre merveilleux, un des grands joyaux de l’architecture théâtrale italienne, né 41 ans avant la Scala, en 1737 et qui reste pour tout amoureux de l’art lyrique un lieu d’émotion pure. Et quel que soit le futur immédiat de l’institution, les successeurs, s’ils trouvent des saisons construites, auraient bien tort de les détruire (au nom de la politique bien connue des dépouilles), même si elles sont signées Lissner. Son ombre portée sera encore là, mais les futurs gestionnaires du lieu pourront officiellement s’en parer, ce qui est de bonne guerre. Reste à savoir s’ils seront des gens intelligents ou des sbires, ce qui est une autre histoire au vu de la main politique qui se saisit de la culture (dont elle se soucie comme d’une guigne, dans la bonne tradition née sous Berlusconi) en Italie…
Nous présentons la saison napolitaine telle qu’elle a été annoncée il y a déjà quelques mois, elle sera sans doute réalisée. Dans le cas contraire les uns accuseront la politique « dispendieuse » de Lissner (c’est pour le moins discutable on va le voir), les autres l’incapacité à maintenir un niveau digne au plus vieux théâtre d’opéra en Italie. Mais si les contrats artistiques ont été signés, il n’y pas de raison de douter car les rompre coûterait plus cher… Une autre question est de savoir si les artistes qui avaient envie de dire oui à Lissner (qui a du réseau et de l’influence) diront oui aux successeurs… à eux de jouer.
LA SAISON LYRIQUE
Les productions lyriques 2023-2024
13 opéras dont 11 en version scénique. Dans les compositeurs, le répertoire italien en prend la moitié avec 5 compositeurs sur les 10 proposés où Verdi se taille la part du lion (4 opéras). On remarque immédiatement que les nouvelles productions « en propre » du San Carlo sont limitées à la Turandot inaugurale, les autres sont des coproductions (Vespri siciliani, La Gioconda, Maria Stuarda), des productions louées ailleurs (Le château de Barbe Bleue/La voix humaine, Norma) et des reprises de productions marquantes du San Carlo, manière de rappeler que ce théâtre a aussi en magasin des productions de grand niveau (Don Giovanni, La Traviata, Elektra, Carmen), deux opéras enfin sont proposés en version de concert et particulièrement bien distribués, Luisa Miller et Simon Boccanegra.
Bien sûr ce sont des solutions claires pour moins dépenser, de montrer habilement que l’on tient compte de budgets resserrés, sans renoncer à la qualité. Et il faut reconnaître que bien des titres valent le voyage.
Bartok : Le château de Barbe-Bleue/Poulenc : La voix humaine
Bellini : Norma
Bizet : Carmen
Donizetti : Maria Stuarda
Mozart : Don Giovanni
Ponchielli : La Gioconda
Puccini : Turandot
Verdi :
I vespri siciliani
Luisa Miller (Concertant)
La Traviata
Simon Boccanegra (Concertant)
Strauss : Elektra
Analyse de la saison
Décembre 2023
Giacomo Puccini : Turandot
7 repr. du 9 au 17 déc. – Dir : Dan Ettinger /MeS : Vasily Barkhatov
Avec :
(A) [9, 12, 15, 17]
Sondra Radvanovsky, Yusif Eyvazov, Rosa Feola
(B) [10,13,16] Oksana Dyka, Seok Jong Baek, Amina Edris
et
Nicola Martinucci, Alexander Tsymbalyuk, Alessio Arduini, Gregory Bonfatti Francesco Pittari Nouvelle production Teatro San Carlo.
Le seul nom d’Oksana Dyka est un repoussoir pour la distribution B, qu’on évitera donc.
Tous les rôles de complément sont bien distribués, et on notera la présence de Nicola Martinucci, classe 1941, en Altoum, lui qui fut un des fréquents Calaf des années 1980 et 1990. Yusif Eyvazov sera sans doute un solide Calaf pendant que Madame est à la Scala pour Don Carlo, Rosa Feola la seule Liù possible aujourd’hui, et évidemment la grande Sondra Radvanovsky, lirico spinto de référence saura sûrement donner à la Princesse de glace une couleur plus moirée que les voix métalliques qu’on entend le plus souvent. Au pupitre, Dan Ettinger, chef polymorphe au large répertoire, nouveau directeur musical.
Le metteur en scène russe Vasily Barkhatov est l’un des noms qui émerge ces dernières années. On lui doit la très belle production de « L’Enchanteresse » à l’Opéra de Francfort dont Wanderersite a rendu compte. Tout cela laisse bien augurer de cette production.
Une bonne suggestion serait de coupler Scala et Naples. L’inauguration romaine du 27 novembre (Mefistofele) se poursuit jusqu’au 5, c’est un peu juste pour les dates mais quelques jours en Italie hors saison sont toujours à prendre.
Janvier – Février 2024
Giuseppe Verdi : I vespri siciliani
5 repr. du 21 janv. au 3 févr. – Dir : Henrik Nánási /MeS : Emma Dante
Avec Mattia Olivieri Piero Pretti Alex Esposito Maria Agresta etc…
Nouvelle production, Coprod. Teatro Massimo di Palermo/Teatro Comunale Bologna/Teatro Real Madrid
On a vu à Palerme cette somptueuse production, sicilienne en diable (normal vu à la fois le titre et les origines d’Emma Dante), où l’on parle d’antimafia et Wanderersite en a rendu compte. Malheureusement, si Palerme a osé la version originale en français, Naples ne s’y risque pas et propose I Vespri Siciliani dans une distribution de très bon niveau, avec Mattia Olivieri en Monforte, Maria Agresta en Elena et surtout Alex Esposito en Procida. En Arrigo (Henri), le très bon Piero Pretti sans doute plus à l’aise dans la version italienne que la française qui exige un ténor à la Raoul des Huguenots… Dans la fosse, le chef Henrik Nánási, excellent dans bien des répertoires, qu’on n’attendait pas forcément dans Verdi. Ceux qui adorent cet opéra (dont je suis) prendront le train.
Février 2024
W.A.Mozart : Don GiovannI
6 repr. du 16 au 27 févr. – Dir : Constantin Trinks /MeS : Mario Martone
Avec Andrzej Filończyk Antonio Di Matteo Roberta Mantegna, Bekhzod Davronov Selene Zanetti Gianluca Buratto Valentina Naforniţa Tommaso Barea
Reprise prod.2002
Il est si difficile de trouver une distribution adéquate pour Mozart aujourd’hui qu’un Don Giovanni excite immédiatement la curiosité. La production est une reprise maison de Mario Martone, largement présentable, le chef fait partie de la génération des chefs allemands solides, qui proposera un Mozart de tradition et sans bavures, et la distribution présente quelques choix particulièrement intéressants, en premier lieu Andrzej Filończyk, baryton-basse polonais qui fait largement carrière en Italie dans le rôle-titre, parce que c’est vraiment un excellent chanteur avec face à lui, le Leporello de Gianluca Buratto qui vient de l’univers baroque et qu’on commence à voir sur toutes les scènes. Roberta Mantegna plus entendue dans Verdi que Mozart sera Donna Anna, la voix puissante saura répondre aux exigences techniques du rôle, mais saura-t-elle l’incarner ? Et Selene Zanetti sera Donna Elvira, délicieux soprano d’une autre couleur qu’il sera intéressant d’écouter dans ce rôle redoutable. Notons aussi le moins connu Bekhzod Davronov qui a si favorablement impressionné dans le rôle du prince Kouraguine dans Guerre et Paix de Prokofiev (Bayerische Staatsoper), assez à l’opposé du caractère d’Ottavio qu’il incarnera à Naples. Dans l’ensemble une reprise qui excite la curiosité.
Mars 2024
Vincenzo Bellini : Norma
4 repr. du 16 au 26 mars – Dir : Lorenzo Passerini /MeS : Justin Way
Avec Anna Pirozzi, Ekaterina Gubanova, Freddie De Tommaso, Alexander Tsymbalyuk etc…
Prod. du Teatro Real Madrid (2021)
La production de Justin Way avait en 2021 à Madrid laissé quelques doutes (théâtre dans le théâtre), mais il est difficile de trouver aujourd’hui une production satisfaisante, tant l’œuvre reste rare sur les scènes et difficile à monter. Le chef Lorenzo Passerini est l’un des chefs les plus en vue de la jeune génération et donc c’est un vrai plus. La distribution est solide, mais pas vraiment belcantiste, ni PIrozzi ni Gubanova ne sont des Belliniennes d’origine contrôlée, et Norma n’est ni Tosca, ni Nabucco, ni Aida. Tsymbalyuk, basse bien connue, sera sans doute un bon Oroveso, et toute notre curiosité ira au Pollione du jeune Freddie De Tommaso, lancé désormais sur les scènes internationales, ténor au timbre chaleureux et plutôt intéressant.
C’est louable de monter Norma de toute manière, alors, bon vent.
Avril 2024
Amilcare Ponchielli : La Gioconda
6 repr. du 10 au 17 avril – – Dir : Pinchas Steinberg /MeS : Romain Gilbert
Avec
(A) 10, 13, 16 avr. : Anna Netrebko, Jonas Kaufmann, Ludovic Tézier, Anita Rashvelishvili, Alexander Köpeczi, Kseniia Nicolaieva
(B) 11, 14, 17 avr. : Liana Haroutounian, Giorgio Berrugi, Ernesto Petti, Yulia Matochkina,
Alexander Köpeczi, Kseniia Nicolaieva
Nouvelle production, Coprod. Gran Teatre del Liceu, Barcelona
Ce sera la ruée, vu le trio de tête Netrebko/Kaufmann/Tézier. Je ne parie pas trop sur Anita Rashvelishvili en Laura mais bien plus en Yulia Matochkina qui chante dans la distribution B, intéressante aussi avec Liana Haroutounian, sans doute titulaire en B et doublure en A.
On ne commente pas : il faut pour Gioconda un mythe. J’entendis (la seule fois, en scène) Callas en fin de parcours dans Suicidio et noyé dans mes larmes, je compris en « live » pourquoi elle était un mythe, alors que la voix était détruite.
Tézier et Kaufmann seront là aussi pour compléter la fête, une de ces soirées à ne pas manquer.
Production du jeune français Romain Gilbert qu’on commence à voir sur les scènes et qui fera sans doute un travail spectaculaire, mais sûrement pas révolutionnaire, d’ailleurs, l’œuvre ne s’y prête pas et le public qui viendra ne l’attend pas. En fosse, Pinchas Steinberg, très grand professionnel, une assurance pour l’orchestre. Réservez vos places…
Mai 2024
Béla Bartók : Le Château de Barbe Bleue
Francis Poulenc : La voix humaine
4 repr. du 24 au 30 mai – Dir : Edward Gardner/MeS Krzysztof Warlikowski
Avec (Bartók) Elīna Garanča, John Relyea/(Poulenc) Barbara Hannigan
Prod. Opéra national de Paris/Teatro Real Madrid
Duo de stars pour cette production phare qui a fait les beaux soirs de l’Opéra de Paris et du Teatro Real de Madrid. Après Rome, Krzysztof Warlikowski arrive à Naples, le sud italien s’ouvre plus que le nord à la mise en scène d’opéra, mais historiquement (et contrairement à ce qu’on croit) le sud italien était le lieu de l’innovation économique et artistique et le nord en a tiré, sucé la substantificque moelle.
En fosse, l’excellent Edward Gardner, connu désormais partout mais pas en Italie, à qui l’on doit un magnifique Peter Grimes à Munich et sur la scène, à côté du solide John Relyea en Barbe Bleue, Elīna Garanča en Judith qu’on ne doit manquer sous aucun prétexte. Quant à Barbara Hannigan, la production a été créée pour elle, c’est une des chanteuses fétiches de Warlikowski, et dans l’œuvre de Poulenc, elle sera sans doute époustouflante…
Vous savez ce qui vous reste à faire.
Juin 2024
Giuseppe Verdi : Luisa Miller
2 repr. (version concertante) les 5 et 9 juin – Dir : Daniele Callegari
Avec Nadine Sierra, Gianluca Buratto, Michael Fabiano, Valentina Pluzhnikova, Artur Ruciński, Krzysztof Bączyk
Il est un peu curieux que cet opéra créé au San Carlo ne fasse pas l’objet d’une production, sans doute parce qu’il est un peu moins populaire que d’autres Verdi. Il bénéficie en revanche de la direction de Daniele Callegari, un excellent chef d’opéra, actuel directeur musical de l’Opéra de Nice et pas toujours considéré à sa juste valeur, ainsi que d’une distribution de haut niveau dominée par Nadine Sierra et Michael Fabiano, très connus (et avec raison) et entourés d’Artur Ruciński, Gianluca Buratto, Krzysztof Bączyk, excellents professionnels. Ajoutons la présence en Federica de la jeune mezzo Valentina Pluzhnikova, issue de l’Accademia del Teatro alla Scala, et remarquée l’an dernier à Bergamo dans Chiara e Serafina, à l’orée d’une carrière qui s’annonce bien.
Gaetano Donizetti : Maria Stuarda
4 repr. du 20 au 29 juin – Dir : Riccardo Frizza/ MeS : Jetske Mijnssen
Avec Pretty Yende, Aigul Akhmetshina, Francesco Demuro, Carlo Lepore, Sergio Vitale etc…
Nouvelle production, coprod . avec Dutch National Opera, Palau de les Arts Reina Sofia Valencia.
Désormais demandée dans pas mal de scènes lyriques européennes, Jetske Mijnssen vient de mettre en scène avec un relatif succès semble-t-il Anna Bolena à Naples, première brique de la trilogie qui se poursuit donc la prochaine saison avec Maria Stuarda dont le rôle-titre est confié à Pretty Yende, voix séduisante et émouvante, personnalité peut-être moins convaincante en scène. Face à elle l’Elisabetta d’Aigul Akhmetshina, astre montant très rapidement dans le ciel des mezzo-sopranos, tant on voit son nom sur pas mal de distributions un peu partout. Elle avait impressionné dans Polina de Dame de Pique à Baden-Baden en 2022. Autour, une distribution de bonne facture (Demuro, Lepore, Vitale) et un chef donizettien pur sucre, puisqu’il est le directeur musical du festival Donizetti de Bergamo, Riccardo Frizza. Une production qui a des arguments pour séduire.
Juillet 2024
Giuseppe Verdi : La Traviata
6 repr. du 14 au 30 juillet – Dir : Giacomo Sagripanti /MeS : Lorenzo Amato
Avec Lisette Oropesa, Xabier Anduaga, Luca Salsi etc…
Reprise d’une production maison 2018
L’été lyrique napolitain avait commencé on s’en souvient en 2020 avec de grands concerts en plein air et des stars (Netrebko, Kaufmann) sur la Piazza del Plebiscito alors que le monde était encore secoué par la pandémie (un siège sur deux, masques etc…), l’idée d’un été festif s’est désormais concentrée autour du théâtre, offrant des productions populaires dont la distribution est susceptible d’attirer non seulement le public local, mais aussi le touriste de passage. C’est le cas de cette Traviata qui a tout pour plaire : Lisette Oropesa qui en est aujourd’hui la titulaire incontestée un peu partout, Luca Salsi, le baryton italien le plus célèbre, et Xabier Anduaga, belcantiste à la voix importante et délicate qui visiblement tient à élargir son répertoire. En fosse, Giacomo Sagripanti, qui n’est pas le pire des chefs de répertoire.
Les ingrédients y sont, et si vous passez par Naples en cette fin de juillet.
Septembre-Octobre 2024
Richard Strauss : Elektra
4 repr. du 27 sept. au 3 oct. – Dir : Mark Elder / MeS : Klaus Michael Grüber
Avec Ricarda Merbeth, Evelyn Herlitzius, Elisabeth Teige, John Daszak, Łukasz Goliński etc…
Reprise prod.2003
Une production de Klaus Michael Grüber, même ressorties des placards, même de vingt ans d’âge, même déjà reprise dans l’intervalle, cela ne se manque pas, notamment pour ceux qui ne connaissent pas cette légende du théâtre et de la scène lyrique qui a marqué de son empreinte les trente dernières années du XXe siècle, décédé trop tôt et emporté en 2008 par la maladie. C’est déjà un motif de déplacement. Même si Ricarda Merbeth n’est pas mon Elektra de cœur, c’est une des voix importantes du rôle, et elle voisine avec l’immense Herlitzius qui fut une Elektra phénoménale avec Chéreau, cette fois Clytemnestre, et en Chrysothemis Elisabeth Teige, la dernière découverte de Bayreuth (Der Fliegende Holländer 2022) où elle sera en plus Sieglinde et Elisabeth en 2023. Trio de choc, mise en scène à voir…il est pourtant regrettable que l’entreprise ait été confiée à la baguette sans aucun intérêt de Sir Mark Elder, que je n’ai jamais réussi à trouver convaincant quand je l’ai entendu, à commencer par Die Meistersinger von Nürnberg à Bayreuth en 1981, qu’il dirigea un an seulement…
Octobre 2024
Giuseppe Verdi : Simon Boccanegra
2 repr. (version concertante) les 11 et 13 oct. – Dir : Michele Spotti
Avec Ludovic Tézier, Michele Pertusi, Ernesto Petti, Francesco Meli, Marina Rebeka
Un Simon Boccanegra concertant mais qui au vu de la distribution vaut bien des versions scéniques ; le couple Tézier-Pertusi, deux astres des scènes, qu’on a déjà vu dans le Don Carlo inaugural de la saison présente 2022-2023 se retrouve pour deux représentations, Meli en Gabriele Adorno de très grand luxe, Marina Rebeka en Amelia aura la voix, mais sans doute pas l’émotion attendue dans un rôle qui en demande tant. Mais ne chipotons pas…
En fosse Michele Spotti, qui pas à pas devient l’un des chefs les plus fréquents du répertoire italien : il affronte de plus en plus Verdi, Don Carlos et Rigoletto à Bâle par exemple alors qu’on le considérait comme essentiellement rossinien. Avec Boccanegra, il accède à la cour des grands.
Deux représentations qui sont de réelles promesses.
Octobre – Novembre 2024
Georges Bizet : Carmen
8 repr. du 25 oct. au 3 nov. – Dir : Dan Ettinger/MeS : Daniele Finzi Pasca
Avec Aigul Aktmetshina/Viktoria Karkacheva, Dmytro Popov/Jean-François Borras, Mattia Olivieri/Ernesto Petti, Selene Zanetti/Carolina López Moreno etc…
Reprise prod. 2015
La saison s’achève avec un must, l’opéra le plus représenté au monde (et ici 8 représentations d’une reprise, ce qui veut dire un bon rapport financier pour le théâtre). La Production est signée du tessinois Daniele Finzi Pasca, qui avait ouvert l’ère Aviel Cahn à Genève par une belle réussite, Einstein on the Beach, de Philip Glass.
Deux distributions qui chacune ont leur prix, à commencer par les deux Carmen, incarnées par les deux mezzos qui explosent en ce moment, Aigul Aktmetshina et Viktoria Karkacheva : notez leur nom, elles vont inonder les scènes dans les prochaines années. À Dmytro Popov vaillant sans plus, on préfèrera Jean-François Borras en Don José pour d’évidentes raisons à la fois idiomatiques, techniques et artistiques : le ténor français cultive l’art du chant avant celui du ténor ténorisant. Mattia Olivieri est désormais un des barytons de choix dans les chanteurs italiens, bon acteur, qui devrait convenir à Escamillo, et de son côté Selene Zanetti a tout d’une idéale Micaela. Je conseillerais presque (si vous êtes à Naples) de voir les deux distributions, tant les deux Carmen incarneront deux facettes très différentes du personnage.
En fosse, Dan Ettinger, solide, sûr, mais pas inoubliable.
BALLET
Il y a une grande tradition napolitaine du ballet et celui du San Carlo est dirigé par Clotilde Vayer venue de l’Opéra de Paris où elle était directrice adjointe de la danse. Le ballet du San Carlo essentiellement composé de « precari » (CDD) a été consolidé l’an dernier par la création de 21 CDI, le but étant d’arriver à une compagnie stable d’une quarantaine de membres, le théâtre a donc ouvert un concours où 80% des reçus appartenaient au corps de ballet du San Carlo en CDD. On perçoit là encore les problèmes de gestion d’un théâtre qui n’a pas, comme nous l’écrivions toute la stabilité voulue pour être « en état de marche ».
La saison 2023-24 propose quatre soirées de ballet de répertoire plutôt classique.
Le ballet est dans toutes les maisons un moyen d’engranger de la trésorerie puisque les corps de ballet sont des troupes qui coûtent en salaire et pas en cachets, et qu’en général les soirées affichent complet.
On ne s’étonnera pas de voir à la fois des productions de ballets louées ailleurs sans doute rarement ou pas présentés à Naples et un minimum de six soirées par production. Toujours s’affiche la prudence de gestion dans un théâtre fragile.
Décembre 2023- Janvier 2024
Ludwig Minkus : Don Quichotte
7 repr. du 23 déc. au 4 janv. (Chor : Rudolf Noureev-Marius Petipa/Dir : Martin Yates)
4 repr. « Familles » (à 12h, version réduite, musique enregistrée) les 24 et 31 déc/3 et 4 janvier).
Orchestre et ballet du Teatro San Carlo
Production du Royal Swedish Opera
Un des grands ballets du répertoire académique, une chorégraphie de Noureev ; programme de fin d’année idéal.
Avril-mai 2024
Serguei Prokofiev : Romeo et Juliette
6 repr. du 28 avr. au 5 mai (Chor : Kenneth McMillan/ Dir : Paul Connelly)
Orchestre et ballet du Teatro San Carlo
Production du Royal Birmingham Ballet
Un autre des grands piliers du répertoire de ballet, créé au Royal Ballet de Londres en 1965 par Rudolf Noureev et Margot Fonteyn. Et cette chorégraphie est devenue un mythe, reprise sur toutes les scènes du monde, signée de Kenneth McMillan mort en 1992, qui allie modernité et classicisme.
Juillet 2024
Soirée Jérôme Robbins
5 repr. du 19 au 28 juillet ( Chor : Jérôme Robbins/Dir : Philippe Béran/Piano : (Chopin) : Aniello Mallardo Chianese ; (Ravel) : Alessandra Brucher)
Orchestre et ballet du Teatro San Carlo
Autre chorégraphe mythique, popularisé par sa chorégraphie et sa mise en scène de West Side Story à Broadway en 1957 puis par le film de Robert Wise en 1961 dont sont présentés trois pièces courtes mais très symboliques :
In the night, ballet en quatre mouvements, sur les musiques des Nocturnes n° 1 op. 27, n° 1 e n. 2 op. 55, n° 2 op. 9 de Fryderyk Chopin
Afternoon of a faun, du poème symphonique Prélude à l’après-midi d’un faune, de Claude Debussy
En sol , Concerto en sol majeur pour piano et orchestre de Maurice Ravel
Septembre 2024
La danse française de Serge Lifar à Roland Petit
6 repr. du 7 au 11 sept. (Chor : Serge Lifar- Roland Petit/Dir : Philippe Béran)
Orchestre et ballet du Teatro San Carlo
Production du Teatro dell’Opera di Roma
Suite en Blanc, Extrait de Namouna d’Édouard Lalo
Chorégraphie : Serge Lifar reprise par Charles Jude
L’Arlésienne, musique de Georges Bizet
Chorégraphie : Roland Petit reprise par Luigi Bonino
Le jeune homme et la mort, musique de Jean-Sébastien Bach
(Passacaille en do mineur, BWV 582)
Chorégraphie : Roland Petit reprise par Luigi Bonino
Une soirée composée de trois ballets piliers du répertoire parisien qui clôt une saison à la fois réduite mais diverse par les styles combinant petites formes et grands ballets.
CONCERTS ET RÉCITALS
Dans une ville qui au contraire de Rome n’a pas une offre musicale très étoffée en dehors du San Carlo, le rôle d’une saison symphonique est déterminante, nous l’avons d’ailleurs déjà évoqué. La suppression en 1992 de l’Orchestra Scarlatti de la RAI puis le regroupement en un seul orchestre à Turin a mis en difficulté la vie musicale napolitaine. La naissance de la Nuova Orchestra Scarlatti dès 1993 a tenté non sans vaillance de combler le vide. Il reste que le San Carlo reste le centre musical de référence.
Ainsi sont programmés en 2023-2024 15 concerts et récitals (exactement 6 récitals et 9 concerts, sur l’ensemble de l’année dont trois concerts du directeur musical Dan Ettinger. Souvent, les chefs invités de la saison lyrique dirigent un concert symphonique en complément, mais on trouve aussi d’autres noms. Chaque concert est donné une seule fois, signe que le public n’est pas encore tout à fait reconstitué pour ce type de manifestation.
Il reste qu’il manque à cette programmation une meilleure lisibilité (séparer les concerts des récitals de chant par exemple). En revanche la programmation des récitals est visiblement destinée à attirer le public (par exemple, la chanson napolitaine, qui gagne à être connue par ailleurs), exclusivement ciblée sur les airs d’opéra populaires. Notons de Luca Salsi fait la part belle au Verdi français, ce qui est une excellente idée.
Un étalement plus clair des concerts symphoniques tout au long de la saison serait aussi souhaitable.
20 Décembre 2023
Concert de Noël
Orchestra e coro del Teatro San Carlo
Dir : Dan Ettinger
Schubert : Symphonie n°5 en si Bémol majeur D.485
Mozart : Grande messe en ut mineur K.427
Nadine Sierra, soprano
Ana Maria Labin, soprano
Attilio Glaser, ténor
Adolfo Corrado, basse
26 Janvier 2024
Orchestra del Teatro San Carlo
Dir : Pinchas Steinberg
Nikolai Lugansky, piano
Rachmaninov : Concerto n°3 en ré mineur pour piano et orchestre, op.30
Chostakovitch : Symphonie n°5 en ré mineur, op.47
2 février 2024
Jonas Kaufmann
Orchestra del Teatro San Carlo
Dir : Jochen Rieder
Extraits de The Great Caruso, Love Story, Gladiator, Once Upon a Time in America, West Side Story, South Pacific
Musiques de Nino Rota, Bernard Herrmann, Max Steiner, Franz Waxman, Leonard Bernstein
24 février 2024
Orchestra del Teatro San Carlo
Dir : Ingo Metzmacher
Adriana di Paola, mezzosoprano
Francesco Castoro, ténor
Dario Russo, baryton
Stravinsky, Ballet avec chant en un acte
Beethoven Symphonie n°7 en la majeur op. 92
14 mars 2024
Orchestra del Teatro San Carlo
Dir : Marco Armiliato
Lucas Debargue, piano
Matilda Lloyd, trompette
Beethoven, Egmont , ouverture en fa mineur op.84
Chostakovitch, Concerto n°1 op. 35 pour piano et orchestre à cordes accompagné de trompette op.35
Mendelssihn, Symphonie n°4 en la majeur op.90
20 avril 2024
Maria Agresta, hommage à Naples
Orchestra del Teatro San Carlo
Dir : Antonio Sinagra
Maria Agresta, soprano
Raffaele Viviani, “Bammenella”
Ernesto De Curtis / Edoardo Nicolardi, “Voce ’e notte”
Totò, “Malafemmena”
Ernesto Tagliaferri / Nicola Valente / Libero Bovio, “Passione”
Eduardo Di Capua / Vincenzo Russo, “I’ te vurria vasà”
Mario Pasquale Costa / Salvatore Di Giacomo, “Era de maggio”
Rodolfo Falvo / Enzo Fusco, “Dicitencello vuje”
Salvatore Cardillo / Riccardo Cordiferro, “Core ’ngrato”
Filippo Campanella / Raffaele Sacco, “Te voglio bene assaje”
Ernesto De Curtis / Giambattista De Curtis, “Torna a Surriento”
Gaetano Lama / Libero Bovio, “Reginella”
Eduardo Di Capua / Alfredo Mazzucchi / Giovanni Capurro, “’O sole mio”
Enrico Cannio / Aniello Califano, “’O surdato ’nnammurato”
Ernesto De Curtis / Libero Bovio, “Tu ca nun chiagne”
Alberto Barberis / Michele Galdieri, “Munasterio ’e Santa Chiara”
Francesco Paolo Tosti / Gabriele D’Annunzio, “’A vucchella”
10 mai 2024
Orchestra del Teatro San Carlo
Dir : Edward Gardner
John Relyea, basse
Berlioz, le carnaval romain, ouverture op.9
Moussorgski, Chants et danses de la mort, cycle de quatre chants pour voix et orchestre
Brahms, symphonie n°4 en mi mineur op.98
11 mai 2024
Récital
Barbara Hannigan, soprano
Bertrand Chamayou, piano
Zorn, Jumalattaret
Scriabine, Sélection d’extraits pour piano seul
Messiaen, Chants de Terre et de Ciel
24 mai 2024
Récital
Nadine Sierra, soprano
Vincenzo Scalera, piano
Gounod, Roméo et Juliette, “Ah, je veux vivre”
Gustave Charpentier Louise, “Depuis le jour”
Richard Strauss
“Allerseelen”, op. 10 n. 8
“Ständchen”, op. 17 n. 2
“Morgen”, op. 27 n. 4
“Wiegenlied”, op. 41 n. 1
“Cäcilie”, op. 27 n. 2
Giuseppe Verdi La traviata, “È strano… Sempre libera”
Gaetano Donizetti Don Pasquale, “Quel guardo il cavaliere… So anch’io la virtù magica”
Heitor Villa-Lobos “Melodia Sentimental”
Ernani Braga “Engenho Novo!”
Joaquín Rodrigo Cuatro madrigales amatorios
“¿Con qué la lavaré?”
“Vos me matasteis”
“¿De dónde venís, amore?” “De los álamos vengo, madre”
Gerónimo Giménez El barbero de Sevilla, “Me llaman la primorosa”
7 juin 2024
Récital
Luca Salsi, baryton
Nelson Calzi, piano
Bizet “Pastel” “Voyage”
Hahn “Si mes vers avaient des ailes”
Martucci Notturno, op. 70 n. 2
Rossini Guillaume Tell, “Sois immobile”
Donizetti La favorite, “Léonor, viens, j’abandonne“
Verdi
Les vêpres siciliennes, “Au sein de la puissance”
Macbeth, “Honneur, respect, tendresse”
Martucci Notturno, op. 70 n. 1
Verdi Don Carlos, “C’est moi, Carlos… C’est mon jour… Carlos, écoute”
22 juin 2024
Orchestra del Teatro San Carlo
Dir : Dan Ettinger
Leonidas Kavakos, violon
Ravel, Tzigane, Rhapsodie de concert pour violon
Sibelius, Sérénade n°1 en ré majeur pour violon et orchestre op. 69
Chausson, Poème pour violon et orchestre op.25
Schumann, Symphonie n°4 en ré mineur op.120
28 juin 2024
Orchestra del Teatro San Carlo
Dir : Dan Ettinger
Gregory Kunde, ténor
Liszt, Eine Faust-Symphonie d’après Goethe pour soliste, chœur d’hommes et orchestre S.108
4 juillet 2024
Orchestra del Teatro San Carlo
Dir : James Ga ffigan
Lisette Oropesa, soprano
Schubert, Symphonie n°3 en ré majeur D.200
Mozart
“Vado, ma dove? Oh Dei!”, K. 583
“A Berenice… Sol nascente”, K. 70
Tchaikovski, Romeo e Giulietta, Ouverture-fantaisie en si mineur
6 octobre 2024
Jonas Kaufmann/Ludovic Tézier
Orchestra del Teatro San Carlo
Dir : Jochen Rieder
Jonas Kaufmann, ténor
Ludovic Tézier, baryton
Giuseppe Verdi
La forza del destino, Ouverture
“Solenne in quest’ora”
“Morir! Tremenda cosa!”
“La vita è inferno all’infelice”
“Invano Alvaro ti celasti al mondo”
Giuseppe Verdi
I vespri siciliani, Ouverture
Amilcare Ponchielli La Gioconda,
“Enzo Grimaldo, Principe di Santafior”
Danza delle ore
“Cielo e mar!”
Giuseppe Verdi Otello, “Tu?! Indietro! Fuggi!”
Giacomo Puccini La bohème, “O Mimì, tu più non torni”
Giuseppe Verdi Don Carlo, “Dio, che nell’alma infondere”
28 juin 2024
Orchestra del Teatro San Carlo
Dir : Mikko Franck
Anna Tifu, violon
Sibelius, Concerto pour violon et orchestre en ré mineur, op. 47
Bruckner, Symphonie n°7 en mi majeur
FESTIVAL DE PIANO
Quatre rencontres avec des pianistes de renom à la fin du mois de mai forment le « Festival de piano ».
Samedi 25 mai 2024
Gregory Sokolov
Programme à annoncer
Mardi 28 mai 2024
David Fray
Bach, Aria avec 30 variations, en sol majeur pour clavecin, BWV 988 “Variations Goldberg”
Liszt,
Années de pèlerinage. Deuxième année: Italie, S. 161
Sposalizio
Années de pèlerinage. Troisième année, S. 163
Les jeux d’eaux à la Villa d’Este
Années de pèlerinage. Deuxième année: Italie, S. 161
Sonetto 104 del Petrarca
Après une lecture de Dante
Mercredi 29 mai 2024
Mikhail Pletnev
Scriabine, vingt-quatre préludes, op. 11
Chopin, vingt-quatre préludes pour piano, op. 28
Vendredi 31 mai 2024
Francesco Piemontesi
Beethoven
Sonate n° 21 en ut majeur pour piano, op. 53 “Waldstein”
Sonate n° 30 en mi majeur pour piano, op. 109
Debussy, Préludes pour piano – Livre II, L. 131
MUSIQUE DE CHAMBRE :
Comme à la Scala, dont nous avons salué l’initiative, le théâtre propose une programmation spécifique de musique de chambre, 9 concerts très variés avec des membres de l’orchestre du San Carlo, une fois par mois, le dimanche à 18h à un tarif plutôt séduisant aussi bien pour le public local que les touristes de passage.
Les dates sont :
Dimanche 7 janvier : Andante appassionato
En ouverture du cycle, en grande formation de chambre (« I reali Filarmonici ») dans un programme Saint-Saëns, Fauré, Rimski-Korsakov, Rachmaninov, Respighi
Dimanche 4 février : Mozart
Deux pièces de Mozart, le Divertimento pour cordes en mi bémol majeur « Grand trio » K.563 et le Quatuor n°1 pour flûte et cordes en ré majeur K.285
Dimanche 10 mars : Bach/Haydn/Ries
Un parcours du XVIIIe au XIXe pour cordes, flûte et clavecin
Dimanche 21 avril : Violoncelles du Teatro San Carlo
Les ensembles de violoncelles sont toujours spectaculaires, ici dans un programme Bach, Aeschbacher, Forino, Elgar, Rachmaninov, Villa-Lobos
Dimanche 12 mai : Stravinski/Khatchaturian/Bartók
Programme de trois trios pour violon, clarinette et piano qui commencera par l’Histoire du Soldat de Stravinsky.
Dimanche 16 juin : Omaggio alla lirica italiana
Des arrangements d’airs célèbres de Rossini, Verdi, Puccini pour vibraphone, violon, alto, contrebasse
Dimanche 15 septembre : Real Cappella del Teatro San Carlo
Formation baroque du Teatro San Carlo (violons, alto, violoncelle, contrebasse, orgue) dans un programme Pergolèse, l’un des plus grands représentants de l’école napolitaine, avec soprano et contralto :
Salve Regina pour soprano, quatuor à cordes et basse continue,
Salve Regina pour contralto, quatuor à cordes et basse continue,
Stabat Mater pour soprano, contralto, quatuor à cordes et basse continue.
Dimanche 20 octobre : Rossini/Mendelssohn
Programme pour cordes
Rossini,
Sonate à quatre n°1 en sol majeur pour deux violons, alto et violoncelle
Sonate à quatre n°2 en la majeur pour deux violons, alto et violoncelle
Mendelssohn, Octuor en mi bémol majeur pour cordes op.20
Dimanche 10 novembre : Mahler
Direction musicale : Maurizio Agostini
Mahler, Symphonie n°4 en sol majeur (arrangement d’Erwin Stein pour formation de chambre)
Conclusion
Au total, la programmation du San Carlo a une grande cohérence, elle est sensible aussi au public local, par sa prudence dans les choix de répertoire, mais aussi par une certaine variété de l’offre à tous niveaux. La programmation lyrique est loin de manquer d’intérêt, la programmation symphonique assez ouverte et les concerts de musique de chambre ont un programma souvent séduisant, ils sont aptes à attirer un public moins habituel, curieux de pénétrer dans cette salle mythique, à un tarif particulièrement avantageux (15 Euros).
En somme, cette programmation démontre une activité, une ambition, et déjà un bilan car les deux saisons précédentes n’ont pas fait rougir.
C’est pourquoi voir l’État italien déstabiliser brutalement l’institution pour des motifs qui n’ont rien à voir avec l’artistique a quelque chose de désolant, voire d’imbécile mais hélas habituel.
Il reste à espérer qu’une solution pour le théâtre soit trouvée qui le consolide, et que cette merveille ne retombe pas dans les sables mouvants du passé.