
2017 a été une année faste pour l’Opéra de Lyon, tour à tour récompensé aux Opera Award et par le mensuel allemand Opernwelt, où un jury de 50 critiques l’a désigné comme « Opernhaus des Jahres » c’est à dire Opéra de l’année. Cette dernière distinction, peu connue en France, a une grande importance en Allemagne, et il est rarissime qu’une maison non allemande soit distinguée. Cela consacre évidemment la politique artistique novatrice menée par Serge Dorny, qui a su imposer son théâtre comme une référence internationale et fidéliser le public autour de choix sans concessions et d’un répertoire large qui a fait découvrir des œuvres souvent inconnues en France.
Le public de Lyon reste un public particulier, formé au lait du TNP de Planchon, mais aussi à l’opéra par la longue période Louis Erlo/Jean-Pierre Brossmann qui avait déjà donné une couleur particulière à cette maison, qu’il faut rappeler – la mémoire est toujours trop courte. C’est ce qu’on appelle un public averti. Autre particularité de l’Opéra de Lyon, la présence inhabituelle de jeunes, même en ce soir de première, grâce au dispositif Lycéens et apprentis à l’Opéra, financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui permet à des lycéens ou des apprentis même très éloignés géographiquement et préparés de se rendre à une représentation d‘opéra.
Enfin, après 9 ans de loyaux services, Kazushi Ono quitte Lyon : on doit saluer le travail effectué auprès de l’orchestre aujourd’hui remarquable, qui a toujours eu la chance d’être dirigé par des chefs qui ont forgé un son et une tradition : John Eliot Gardiner et Kent Nagano sont des noms qu’on ne présente plus aujourd’hui et qui ont fait la réputation de l’orchestre de l’Opéra de Lyon. Pendant cette période, le chœur est devenu aussi un des meilleurs chœurs d’opéra en France et même au-delà des frontières, à la fois pour son engagement musical, mais aussi pour ses qualités d’adaptation scénique, importantes parce que Lyon a une vraie politique en matière de mise en scène.

À Kazushi Ono succède Daniele Rustioni, aussi flamboyant que Kazushi Ono était réservé. Le jeune chef italien fait partie d’une nouvelle génération vraiment digne d’intérêt. Formé en Italie (il est milanais) et surtout à Londres auprès d’Antonio Pappano dont il fut l’assistant, il a acquis un répertoire large et riche, et une expérience au pupitre dans toutes les formes (des petites formes au grand répertoire symphonique). C’est une grande chance pour Lyon que d’avoir tant de cartes dans son jeu actuel.
Alors il y a un revers de la médaille : les forces de l’opéra remarquables dans leur ensemble, doivent suivre un rythme soutenu, notamment au moment du Festival où cette maison typique de « stagione » doit s’adapter à un rythme presque semblable à celui du répertoire allemand, avec une alternance serrée. Les maisons françaises (Paris à part) sont peu habituées à ces rythmes et n’ont pas toujours le personnel adapté, et sans doute ce rythme et la qualité exigée pour répondre aux normes internationales génèrent-ils des tensions internes dont l’intervention initiale de la CGT lors de cette première est le symptôme, à laquelle Serge Dorny a répondu en appelant à une pacification des esprits en cohérence avec l’œuvre qui allait être jouée.
Lors de grandes productions, les opéras doivent faire appel à du personnel supplétif (les intermittents) car leur structure ne permet pas de répondre à ce type de pression. C’est la conséquence des choix français autour de l’opéra qui déterminent des personnels en nombre plus limité (sinon les budgets explosent): il y a en France une quinzaine de maisons, quelquefois en difficulté, qui proposent au mieux une trentaine de soirées d’opéra dans l’année pour la plupart (à Lyon on affiche autour de 80 soirées d’opéra, toutes scènes confondues sans compter le ballet ni les concerts, Toulouse affiche 82 levers de rideau mais moins de 40 soirées d’opéra, Strasbourg tourne autour de la cinquantaine (avec l’obligation de jouer à Mulhouse et quelquefois à Colmar), des chiffres qui n’ont rien à voir avec les maisons allemandes comparables qui dépassent très largement les 100 voire deux cents soirées annuelles).
Les opéras ne sont pas responsables de la situation, due au système (stagione) et aux subventions versées souvent limitées et à la charge quasi exclusive des villes, donc aux limitations en personnel, et ce qui a abouti à une stabilisation de l’offre mais aussi quand même à de réelles difficultés pour certaines maisons. Dans l’ensemble pourtant, les choses fonctionnent et ces dernières années on a vu des opéras (Dijon, Lille) offrir un travail de grande qualité et très diversifié, à l’intérieur de budgets très raisonnables .
Dans ce paysage, Lyon est un territoire singulier, évidemment, avec sa ligne affirmée de mises en scènes toujours novatrices, de choix de répertoire très audacieux avec cette année entre autres, Germania, Le cercle de craie, War requiem, Mozart et Salieri, autant d’œuvres soit nouvelles soit rares, qui feront sans doute presque toujours salle comble, grâce à un public disponible, éduqué et curieux, et d’une qualité musicale constante : Serge Dorny, né en Flandres, au pays de Gérard Mortier sait que l’homogénéité d’un plateau de très bonne qualité sans stars vaut mieux que la danse avec les stars qui sont souvent l’arbre qui cache la forêt : c’est le modèle qui prévaut à Bruxelles comme à Anvers et Gand.
Ainsi donc la saison ouvre avec War Requiem de Britten, un choix triplement surprenant. Surprenant parce que l’œuvre est rare, surprenant parce qu’elle est ici représentée en version scénique, alors qu’elle est plutôt représentée en forme traditionnelle et concertante, surprenant enfin pour ce choix d’ouverture de saison d’un nouveau chef italien, qu’on attendrait sur son répertoire « traditionnel » plutôt que sur un Britten mal connu.
C’est surprenant, et donc pleinement justifié : faire commencer Rustioni par Britten, c’est affirmer d’emblée l’éclectisme du chef et son ouverture, alors que traditionnellement et dans tous les opéras du monde les jeunes chefs italiens sont appelés sur Rossini ou Verdi (voir Sagripanti, Bisanti, Mariotti, Battistoni par exemple). C’est aussi réaffirmer une ligne programmatique qui pose une réflexion politique sur le monde (War Requiem, comme son nom l’indique, est une œuvre directement critique sur les guerres en général, dont la dernière qui a provoqué la destruction de la cathédrale de Coventry). C’est enfin montrer toutes les forces musicales de la maison en ordre de marche, orchestre, chœur, maîtrise.
La surprise faisant partie de l’art de la programmation, proposer War Requiem, absent de Lyon depuis des décennies entre pleinement dans la cohérence d’une politique artistique qui ne se place jamais dans le sillon des sentiers battus, mais dans la forêt touffue des œuvres hors standards. C’est bien la couleur de l’Opéra de Lyon, sa marque de fabrique, ce qui lui a valu la reconnaissance du monde lyrique international.
—
Il y a ces dernières années une tendance (une mode ?) à proposer des grandes œuvres chorales en version scénique ou semi-scénique. On l’a vu encore la saison dernière à Zürich avec le Requiem de Verdi. Les orchestres proposent aussi des concerts en version semi-scénique d’œuvres chorales, cela commença il y a quelques années avec les Passions de Bach, et Peter Sellars, par exemple, a proposé avec Simon Rattle un certain nombre d’expériences en ce sens. Personnellement, je ne suis pas toujours convaincu des résultats, même si la plupart du temps les spectacles sont de grande tenue.
Celui de Lyon est sans conteste d’une très haute tenue, dont la puissance s’impose, avec des images d’une grande force et souvent d’une grande beauté. En appelant Yoshi Oida, Dorny garantit un travail épuré, réfléchi, dans la grande tradition du théâtre de Peter Brook avec lequel Oida a fait un bout de chemin, mais aussi d’une culture théâtrale japonaise (Oida a travaillé sur le Nô) qui fascine le théâtre occidental. De plus, né en 1933, Oida a vécu les ravages de la guerre au Japon, dont l’arme atomique, et en connaît directement les blessures. L’œuvre lui sied donc parfaitement car elle se prête à un travail sans fioritures et hiératique.
Le War Requiem est une œuvre de grande envergure où chaque élément du plateau prend en charge une couleur de l’œuvre, née d’un mélange entre les parties traditionnelles du Requiem chrétien et de poèmes d’un poète mort quelques jours avant la fin de la première guerre mondiale, Wilfred Owen, qui a crié son amertume dans des textes écrits à la fin de la guerre, alors qu’il s’était engagé volontairement.
L’œuvre est donc très structurée : la voix de femme et le chœur accompagnés de l’orchestre chantent la partie liturgique du Requiem. Les deux solistes masculins accompagnés d’un orchestre de chambre chantent les textes de Owen, le chœur d’enfants et l’orgue, spectateurs et victimes des temps, représentent la partie plus spirituelle et transcendante. Lors de la création, Britten voulait que les solistes représentent les pays engagés dans la guerre : Allemagne (Dietrich Fischer-Dieskau), URSS (Galina Vichnevskaia), Royaume Uni (Peter Pears), mais Moscou n’a pas permis à Vichnevskaia de participer à la création et c’est Heather Harper qui a créé l’œuvre. C’est en revanche Vichnevskaia qui a participé à l’enregistrement consécutif, sous la direction du compositeur, avec le London Symphony Orchestra. C’est un peu le même principe qui a guidé le choix de Serge Dorny qui a appelé le soprano Ekaterina Scherbachenko (Russie), le ténor Paul Groves (USA) et l’estonien Lauri Vasar (Baryton). L’Estonie est en effet une victime directe de la deuxième guerre mondiale : après son indépendance en 1918, elle retombe sous le joug soviétique après la 2ème guerre mondiale, après que ses élites (souvent germanophones) eurent flirté avec le nazisme.
Le chœur d’enfants (l’excellente maîtrise de l’Opéra de Lyon dirigée par Karine Locatelli) est vu par Oida comme spectateur de ce spectacle : il arrive de la salle juste avant les premières notes, monte sur scène et s’installe à cour, regardant ce qui se passe sur la plateau, comme s’il appartenait à une communauté religieuse spectatrice (Karine Locatelli est vêtue en religieuse), avec derrière lui l’orgue qui l’accompagne. On connaît aussi l’importance des voix d’enfants dans la liturgie anglicane.
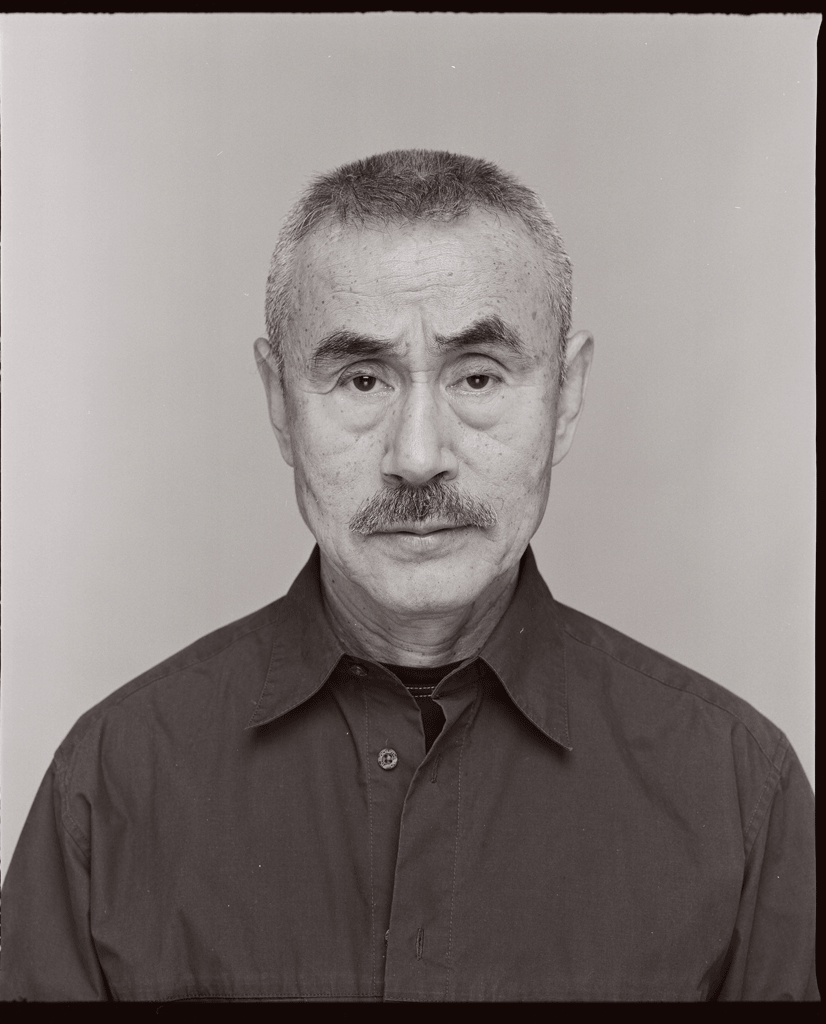
Le dispositif conçu par Yoshi Oida est assez simple, construit autour d’un praticable central, à jardin l’orchestre de chambre, au fond le chœur, à cour, les enfants, avec un fond de scène mouvant et argenté, sur lequel vont se projeter quelquefois des images. Le chef dirige l’ensemble du dispositif, notamment les deux orchestres alors qu’en principe il y a deux chefs.
La mise en scène consiste en un immense rituel funèbre conçu dans l’esprit de l’œuvre où devant la mort et la guerre, il n’y a plus d’ennemis. Replaçant l’œuvre au temps de Wilfred Owen, de la première guerre mondiale (une indication 14-18 sur la scène le souligne), et donc en cohérence avec les manifestations autour du centenaire de la Première Guerre Mondiale, il va sur l’espace vide central placer les solistes, qui enterrent leurs morts de manière symétrique, habillés de manière plus ou moins semblable, seuls se distinguent les casques : on reconnaît à droite les casques à pointe germaniques et à gauche le casque traditionnel anglais « Brodie ». Chaque soldat porte en écharpe son drapeau national, mais tout évidemment devient dérisoire quand chacun est face à ses pertes, ses morts, et la même dévastation.
Les deux soldats (Paul Groves et Lauri Vasar) disent les poèmes de Owen : ils sont ces représentants de l’humanité déchirée et entraînée, de cette humanité victime des « Somnambules » qui portèrent à la guerre.
le soprano (Ekaterina Scherbachenko), représente d’une certaine manière la synthèse de cette humanité, elle exprime l’universel, et les enfants restent en retrait, victimes des conflits sans l’avoir voulu. Ainsi donc en un seul tableau global Yoshi Oida expose à la fois les résultats et les contradictions de tout conflit, qui se résout toujours de la même manière par l’enterrement des morts. Au-delà des symboles, drapeaux, poupées de chiffon figurant les morts anonymes ou les marionnettes humaines, cercueil devant lequel se recueille le soprano, mais aussi les cadavres anonymes enveloppés qui peuplent la première scène, au-delà des images qui quelquefois défilent sur le fond, au-delà du décor géométrique qui n’est pas sans rappeler certaines images wagnériennes de Wieland Wagner ou de Günther Schneider Siemssen, dans lequel s’insèrent les images, comme si les formes et les images se fondaient en un seul imaginaire, on ne retient guère qu’une totalité où tous célèbrent la mort, à laquelle nul n’échappe, et devant laquelle vainqueurs et vaincus sont égaux.
C’est bien cette dernière notion, qui efface le résultat « politique » au profit du bilan humain qui est ici soulignée, et dominante. On voit bien que la Première Guerre Mondiale est l’emblème de toutes les guerres qui ont émaillé le siècle qui nous en sépare. Un « plus jamais ça » tellement ritualisé qu’il en devient presque sarcastique : le rituel se repropose à chaque guerre, tout comme le « plus jamais ça ». D’ailleurs, ce War Requiem composé pour la reconstruction de la cathédrale de Coventry détruite pendant la deuxième guerre mondiale, appuyé sur les poèmes écrits pendant la première, montre à la fois une universalité et une terrible vérité, presque sarcastique : le rituel n’est rituel que parce qu’il se répète : le « plus jamais ça » est en fait un « toujours », et cette émotion qui traverse l’œuvre et les images que nous voyons n’empêche ni n’empêchera rien. Même si Britten voulait composer un Requiem à la Guerre, celui-ci reste hélas à écrire, 55 ans après la création.
L’idée d’une mise en scène est donc pleinement justifiée pour une œuvre à la géométrie sonore et spatiale très complexe, mais la forme architectonique de l’Opéra de Lyon est peut-être un obstacle à sa pleine réalisation : une salle trop à l’italienne, trop étroite et impossible à moduler pour une spatialisation et une respiration sonores de l’œuvre telle qu’on la rêverait. Il faudrait sans doute une salle plus ouverte, une Philharmonie de Berlin, une halle aux grains de Toulouse, pour permettre à l’œuvre de frapper encore plus le spectateur. Il manque à ce travail un espace qui lui corresponde vraiment. Je mesure la vacuité de la remarque : on fait avec ce qu’on a.
Il reste que la mise en scène de ce Requiem lui donne une chair et une présence que peut-être le concert ne lui donnerait pas, même si au concert c’est l’imaginaire de l’individu qui est sollicité, alors qu’ici, l’imaginaire nous est en quelque sorte imposé. Mais la vision de Yoshi Oida touche à l’universel, au temps et à l’espace („Zum Raum wird hier die Zeit…“ comme chez Wagner pour définir la cérémonie du Graal dans Parsifal), avec des allusions à la Bible (le sacrifice d’Abraham) à la première et à la seconde guerre mondiale, dans une sorte d’imagerie générique de tout conflit qu’il l’enlève à son contexte propre.

Au total, ce travail est empreint de grandeur et aussi de simplicité comme cette magnifique idée des parapluies qui s’ouvrent, image de protection face à un événement extérieur, mais une protection légère et fragile qui devient presque image de la fragilité humaine, image pascalienne de la situation humaine prise entre les infinis et entre des cataclysmes qu’il ne peut maîtriser .
A cette grandeur visuelle, à ce rituel déchirant parce qu’il marque la fragilité de l’humain correspond une réalisation musicale de très haut niveau, dont la grandeur fait vibrer le spectateur.
Les trois solistes sont remarquables de simplicité et de vérité : Paul Groves, le soldat « britannique », le ténor, Lauri Vasar, le baryton soldat « allemand » et Ekaterina Scherbachenko, qui se découvrira à la fin comme la veuve du poète Owen portant son portrait, comme le chœur porte les portraits des morts en un rite qui ressemble aux rites funèbres de l’antiquité romaine où les portraits des défunts étaient portés, et à l’origine du culte orthodoxe des icônes), mais qui représente toutes les veuves : son salut émouvant au cercueil visant évidemment à l’universel et non à l’histoire particulière d’Owen qui n’était pas marié et en outre ouvertement homosexuel.

Paul Groves à peine plus jeune que l’œuvre qu’il chante à la voix au départ un peu engorgée, révèle de nouveau et très vite toutes ses qualités : ductilité, savant dosage entre les mezze voci et les aigus triomphants, timbre qui garde une étonnante pureté, intensité dans les moments les plus dramatiques.
Lauri Vasar confirme les belles qualités qu’on connaît (il fut récemment Gloster déchirant dans le Lear salzbourgeois), beauté du timbre, belle diction, belle projection, mais moins d’intériorité peut-être que son collègue ténor.
Ekaterina Scherbachenko, est comme on l’a dit, une sorte de veuve universelle qui en enterrant le poète salue tous les morts. Une prestation sans défaut technique, bien dominée, mais sans particulière émotion, un peu extérieure. La voix manque d’expressivité et un peu de projection notamment à l’aigu, alors qu’elle se montre plus concernée dans les moments plus intimistes.
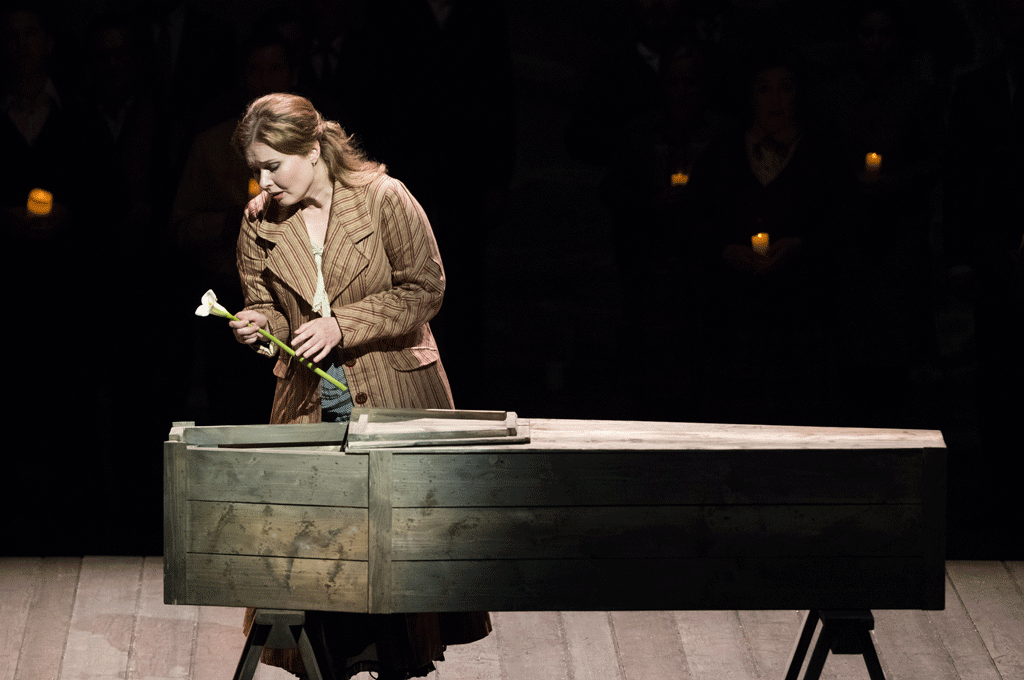
Mais ce sont les masses chorales et orchestrales qui sont ici les maîtres de l’espace : un chœur immense, renforcé (ce ne sera pas la seule occasion cette année…) très bien préparé par Geneviève Ellis, avec des moments très subtils, un réel travail des contrastes et une belle diction, et qui surtout chante de mémoire, et participe avec engagement à la mise en scène en envahissant l’espace à la fin : beaucoup de couleurs dans ce chant où les voix explosent (Dies irae), mais aussi montrent une retenue qui va jusqu’au murmure (derniers moments), en des contrastes vraiment conduits de manière exceptionnelle. Une de ses prestations les plus impressionnantes.
La Maîtrise aussi avec ces enfants extérieurs, témoins et aussi victimes dirigés par Karine Locatelli montre un belle capacité d’émotion, et aussi une véritable expressivité. Tout cela est remarquable et montre le degré d’engagement des personnels artistiques qui justifient pleinement les récompenses internationales reçues.
Mais l’architecte et le maître d’œuvre c’est Daniele Rustioni qui réussit à diriger l’ensemble impressionnant de ces masses, et notamment les deux orchestres, avec une énergie et une fougue à souligner, mais aussi une capacité à retenir le son, à lui donner sens aussi notamment dans les moments les plus sarcastiques et les plus grinçants, qui ne cherche pas à s’imposer, mais qui accompagne : la manière dont l’orchestre accompagne les solistes quelquefois aux limites du parlando s’apparente presque à un dialogue intime. Les écarts de dynamique, les passages les plus intérieurs mais aussi les moments les plus spectaculaires, sont pris à bras le corps par un orchestre sans aucune scorie, parfaitement concentré, dynamisé par le chef qui semble être partout. Une très grande prestation, un accompagnement orchestral exceptionnel grâce à des musiciens tendus et attentifs, mais aussi visiblement très engagés autour de leur nouveau directeur. Une inauguration parfaitement réussie et dont le résultat exceptionnel montre la pertinence du choix et qui surtout laisse augurer de grands moments futurs.




