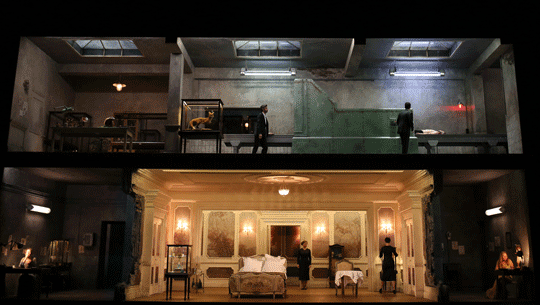
Après Ariodante l’an dernier, Andrea Marcon et le Freiburger Barockorchester présentent cette année Alcina, l’opéra magique de Haendel, l’histoire de la magicienne Alcina et de sa sœur Morgane, qui séduisent les hommes et les transforment ensuite en animaux sauvages, en arbres et en rochers. Mais voilà, Alcina tombe amoureuse de Ruggiero qu’elle a attiré dans ses filets au point qu’il en a oublié sa fiancée Bradamante. Bradamante ne s’en laisse pas compter, vient chercher son aimé, et cherche à l’arracher aux trop doux sortilèges de la magicienne.
Pour ce spectacle phare du Festival 2015, Bernard Foccroule a réuni une distribution de très haut niveau, composée de chanteurs qui tous abordent le rôle pour la première fois, dont Patricia Petibon (Alcina), Philippe Jaroussky (Ruggiero), Anna Prohaska (Morgane) et Katarina Bradić (Bradamante). Il a confié la mise en scène à Katie Mitchell, qui en est à sa quatrième production à Aix. Elle a marqué par son travail sur Written on Skin de George Benjamin en 2012. La structure de son décor rappelle d’ailleurs ce spectacle, comme si se créait une sorte de style, bien que le décorateur en soit en 2015 Chloe Lamford et en 2012 Vicki Mortimer. Ainsi donc, est représentée une sorte de maison en coupe, de type maison de poupée, avec au centre un salon bourgeois, éclairé, lambrissé, et de chaque côté et au premier étage, dans un éclairage glauque et froid, les espaces cachés, les coulisses de la magie, qui abritent en haut la machine à transformer les hommes en animaux empaillés qui le mieux leur correspondent (qui ressemble étrangement à la machine à corned beef de Tintin en Amérique avec son tapis roulant) et en bas les « antres» de Morgane à jardin et d’Alcina à cour, où elles apparaissent vieillies et décaties. Elles passent d’un espace à l’autre par des portes qui sont des seuils à transformation puisque très habilement elles apparaissent jeunes et désirables dans l’espace central et passent de l’ombre à la lumière par un sas magique : magnifique travail de théâtre où les héroïnes vieillies et celles qui sont désirables s’enchaînent avec une précision qui va jusqu’au moindre geste. Ce mécanisme se grippera à la fin quand les pouvoirs magiques s’atténuent et s’épuisent au 3ème acte, non sans une jolie ironie.

Katie Mitchell revendique le « féminisme » de ce travail, qui glorifie le désir féminin dans ses manifestations diverses, Morgane plutôt SM et Alcina plutôt autoérotique, et l’homme objet, Ruggiero devenant une sorte de machine à donner le plaisir sans grande personnalité : le héros Ruggiero a perdu tous ses pouvoirs et tout son héroïsme au contact des mains expertes d’Alcina. Mais le désir de la magicienne se meut en amour de plus en plus exacerbé à mesure que Ruggiero va s’éloigner, car Haendel – et c’est l’un des prix de cet opéra – travaille particulièrement les ressorts psychologiques des personnages, qui ne sont pas des stéréotypes sortis des romans du Tasse ou de l’Arioste (en l’occurrence), mais des âmes qui vibrent et qui aiment.
La magie qui fait mouvoir l’histoire, c’est le désir et ses sortilèges, un désir ritualisé avec un lit central et des servants multiples qui gèrent les personnages et notamment Ruggiero comme des objets qu’on habille et déshabille à plaisir et qui ne font rien d’autres que se laisser faire. Au lit central qu’on fait et défait, qui ne sert à dormir qu’au lever de rideau, d’ajoutent des vitrines qui abritent soit des animaux empaillés, soit des végétaux, soit les produits qui servent à préparer la transformation: on pense aux expériences du XVIIIème siècle où l’on injectait des produits dans les cadavres (ou dit-on dans les corps vivants des serviteurs – à Naples notamment) pour des expériences « scientifiques », mais il y a quelque chose aussi d’expériences à la Mengele dans ces rituels où l’on injecte la mort lente à ces personnages, et une claire allusion à la mort par injection létale, c’est à dire les diverses barbaries de notre époque, sans parler de références plus littéraires (H.G.Wells).

Les animaux en vitrine rappellent d’ailleurs les cabinets de curiosité qui essaimaient les maisons aristocratiques européennes. Ainsi donc les deux sœurs s’inscrivent emblématiquement dans les occupations d’une aristocratie oisive qu’on connaît bien au XVIIIème, servies par une domesticité abondante, silencieuse, industrieuse où hommes et femmes s’affairent indistinctement dans la joie du transgenre.
Bien sûr les allusions directes au plaisir, la crudité de certaines scènes qui font penser à un porno soft et chic, l’utilisation des vocalises pour mimer le plaisir font rire ou sourire le public, mais ce sont des artifices désormais fréquents : les vocalises mimant le plaisir ici ou ailleurs les effets de la drogue existent depuis le Don Giovanni de Peter Sellars à la fin des années 80.
Au milieu de ce petit monde inoffensif à la « Histoire d’O », surgissent habillés en soldats d’intervention de type GIGN Bradamante et Melisso : gilets pare balles, petite valise contenant les outils de sabotage. Ils tranchent dans le paysage policé et glacé installé par la mise en scène, mais c’est aussi ce qui va exciter le désir de Morgane. Des hommes, des vrais ! Et le mâle Bradamante (très bien personnifié par Katarina Bradić) tranche avec la féminité d’un Ruggiero amolli : les schèmes sont inversés dans ce monde un peu isolé dans sa bulle que nous propose Katie Mitchell. Bradamante d’ailleurs est un peu l’élément perturbateur d’une histoire qui pourrait durer : Ruggiero l’a oubliée, il coule des jours tranquilles en dansant un tango éternel chez Alcina.

La magie est vécue à minima dans l’histoire que raconte Katie Mitchell, c’est une magie mécaniste (la machine à empailler, qui, on va le voir, employée à l’inverse, sert aussi à ressusciter) ou chimique (les injections d’un produit vert dans le corps des victimes). Le seul élément vraiment magique est le passage d’une pièce à l’autre, car – ce qu’on découvre bientôt- l’espace central est illusion et les autres espaces (premier étage et espaces latéraux) ceux plus gris du réel, hic et nunc, où Morgane et Alcina plus mûres et plus fripées mais pas cacochymes regardent les effets de leurs pièges ou méditent, assises à leur petite table, comme dans les coulisses d’une représentation qui a lieu au centre.
Certains moments sont à mon avis mieux réglés que d’autres : la transformation de Bradamante de soldat en charmante jeune femme par exemple, plus fraiche et plus spontanée que les deux magiciennes, un peu artificielles ou sophistiquées, ou bien l’exécution de la même Brdamante et sa transformation en petit oiseau, devant un Ruggiero prisonnier attaché à un pilier qui rappelle un peu Ulysse attaché au mât pour résister au chant des Sirènes. Le dérèglement de la magie dans la toute dernière partie où le rythme s’accélère et où plus rien ne fonctionne pour les deux femmes qui ne savent plus si elles apparaissent dans la splendeur de leur beauté ou dans la réalité de leur âge, joue à un « qui est qui » désespéré très bien construit dans son ironie et sa distance.
En revanche, les moments où Melisso et Bradamante posent des dispositifs électroniques destinés à bloquer les machines et les portes magiques me paraissent moins inspirés, dans leur allusion aux séries télévisées ou aux films « à sauvetage » d’inspiration américaine : bien sûr, Katie Mitchell cherche à transposer les aventures des héros de L’Orlando Furioso avec les moyens du jour et à l’aide de notre imaginaire embrumé par la TV ou les films de série B, mais c’est tellement grossier que l’effet d’ironie s’estompe, tout comme m’est apparue une facilité la mise sous vitrine des deux femmes, naturalisées pour l’éternité.
Au total, ce travail habile, qui commence en porno chic et finit en film de guerre US, est irrégulier et manque d’une certaine idée force. L’approche de Christof Loy à Zürich en 2014 (Alcina à Zürich) , qui jouait sur l’espace scénique, sur le baroque et sur la magie du théâtre rendait de manière plus évidente l’ambiance particulière de la partition entre retenue et feu d’artifice, en faisant de l’espace théâtral un espace des âmes tiraillées entre réel et représentation.
Mais ce qui frappe ici, c’est la cohérence entre le plateau et la musique : il y a clairement une adhésion entre l’espace musical et l’espace scénique, et un véritable engagement des chanteurs au service de la production : chacun joue le jeu, chacun est à sa place, avec des fortunes diverses au niveau du chant, mais une impeccable cohésion scénique. Dans cet opéra de femmes, il faut souligner d’abord la performance de Katarina Bradić en Bradamante, performance scénique car elle est impressionnante de justesse dans Bradamante travesti en soldat et performance vocale grâce à une voix homogène, au timbre riche, aux agilités dominées et aux graves sonores aux aigus puissants. Une découverte faite pour interpréter les nombreux travestis du répertoire.
Anna Prohaska est en revanche une déception. Certes, les agilités, les mezze voci, les notes filées sont là, avec des aigus quelquefois plus fragiles. Mais il manque d’abord la projection: la voix passe mal (il est vrai que l’acoustique du Grand Théâtre de Provence n’est pas idéale). Ensuite le timbre n’est pas très agréable, un tantinet acide, et les graves sont complètement opaques. Les récentes prestations de cette chanteuse désormais populaire sur le marché lyrique ne m’ont pas convaincu. Il manque quelque chose à cette voix pour s’épanouir et emporter l’adhésion. Et tornami a vagheggiar exécuté avec soin mais sans vraie intensité en souffre .
Reste Patricia Petibon, qui comme les autres faisait ses débuts dans le rôle d’Alcina : elle domine le plateau, très largement, d’abord par ses qualités d’interprétation et d’actrice, puis par une voix particulièrement expressive : elle entre complètement dans la mise en scène, est complètement engagée en contrôlant chaque geste, chaque expression et avec un sens extraordinaire de la nuance et de la couleur; elle n’a aucun problème technique, ni dans la projection, ni dans le contrôle de la voix, ni dans les agilités : son ombre pallide est anthologique. Elle est très différente de Bartoli, peut-être plus intérieure, mais elle propose une Alcina qui ne se résigne pas, un vrai personnage tragique et tendu. Nous sommes à un niveau d’excellence à jeu égal.

Du côté masculin, un Melisso (Krzysztof Braczyk) de bon niveau, au physique impressionnant de soldat d’intervention, dont la voix de basse sonne, bien posée, bien projetée, apparaît bien plus présent que l’Oronte un peu léger et sans personnalité marquée d’Anthony Gregory.
Philippe Jaroussky promène son extraordinaire facilité vocale, se jouant des agilités et des autres difficultés du rôle. Mais scéniquement, il n’entre pas vraiment dans le personnage : certes il est un homme-objet au départ et la mise en scène lui demande une certaine passivité, mais lorsque ses amis lui apportent ses habits de soldat et de héros (en réalité un habit d’officier et non d’intervention comme Melisso), il n’en fait pas plus et reste plutôt apathique en scène. Entre une Bradamante énergique et une Alcina passionnée, il reste un peu prostré, peut-être paralysé par ces femmes exigeantes.
Notons enfin l’Oberto magnifique qui nous est offert par Elias Mälder, le jeune chanteur du Tölzer Knabenchor : des interventions limitées au début (l’intrigue d’Oberto recherchant son père reste très secondaire) mais frappantes, voire stupéfiantes, qui ont emporté l’enthousiasme justifié de la salle.
Tout se passe comme si Katie Mitchell avait demandé à sa distribution masculine une relative discrétion, une modestie dans le jeu destinée à exalter la partie féminine. C’est ce qu’a fait Haendel dans la partition, réservant des rôles de complément aux voix masculines, et l’essentiel des airs spectaculaires au castrat et aux voix féminines : l’homme ici s’efface pour n’être qu’outil au service des passions des autres.
Le plateau et la mise en scène,sont soutenus avec attention par une fosse magnifiquement conduite par Andrea Marcon à la tête d’un Freiburger Barockorchester plus convaincant dans Haendel que dans Mozart (Die Entführung aus dem Serail). Marcon propose une interprétation très raffinée, soignant les équilibres sonores, jamais trop énergique, ni trop rapide, plutôt retenue et même souvent mélancolique. Il en résulte une ambiance quelquefois mystérieuse, quelquefois feutrée, et toujours très colorée, qui donne à la partition une vraie épaisseur, voire une vraie profondeur, en s’appuyant notamment sur de très belle cordes. Dans un style moins énergique et peut-être moins brillant que Giovanni Antonini à Zürich, il est tout aussi convaincant en ne recherchant jamais l’effet mais toujours le sens et la vérité du texte.
Ainsi cette production est-elle emblématique de la politique menée à Aix-en-Provence par Bernard Foccroule : chaque année une œuvre du répertoire baroque, chaque année un effort pour revisiter ce répertoire garanti à la fois par l’excellence musicale, incontestable ici malgré un cast un peu irrégulier, et par une mise en scène plutôt novatrice, mais sans excès : un début un peu hard qui peut faire frémir, puis un travail d’actualisation assez cadré sans bouleverser le regard sur l’œuvre. « Du plaisir sans peur », comme dirait Tartuffe.
Et puis, revoir Alcina fait toujours plaisir à Aix-en-Provence : l’œuvre est inscrite dans l’histoire du Festival, qui pour ses 30 ans en 1978 s’était offert Alcina avec une Teresa Berganza de légende en Ruggiero et une grande Christiane Eda-Pierre (dont on ne rappelle pas suffisamment la carrière) en Alcina, sous la direction de Raymond Leppard et dans une production marquante de Jorge Lavelli. C’était le début d’une grande carrière pour cet opéra devenu l’un des plus populaires du répertoire baroque. Il est réconfortant de penser que 37 ans après, c’est toujours vrai, et c’est encore à Aix. [wpsr_facebook]













 Quel souvenir! la Horne sur son cheval, avec son casque à plume et sa cape rouge! Et quel souvenir musical!
Quel souvenir! la Horne sur son cheval, avec son casque à plume et sa cape rouge! Et quel souvenir musical!