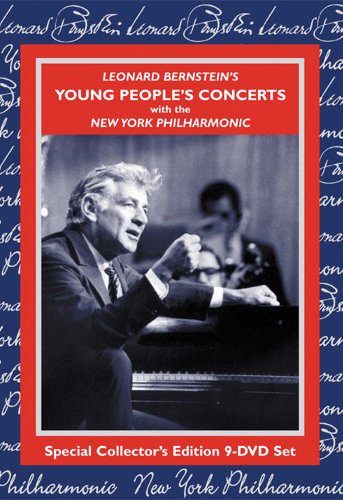UNE NORMALITÉ DE TRÈS HAUT NIVEAU
UNE NORMALITÉ DE TRÈS HAUT NIVEAU
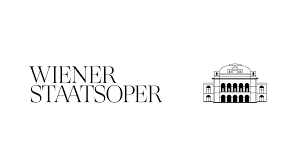
Après une première saison 2020-21 tronquée par la pandémie, mais dont nous avons pu voir quelques moments clefs en streaming ou même en salle, la saison 2021-22 s’annonce un peu moins explosive. Cinq nouvelles productions et quelques « Wiederaufnahmen » de productions de répertoire rafraichies, et pour le reste des productions de répertoire plus ou moins habituelles font une année presque normale, que nous allons détailler.
La Wiener Staatsoper est une maison de grande tradition, et pour sûr le modèle du système de répertoire, nous l’avons souvent souligné. Dominique Meyer en avait fait d’ailleurs le pilier de sa politique, garantissant un niveau moyen élevé de ses représentations « ordinaires », plus élevé en tous cas que celui de son prédécesseur Ioan Holender.
Le nouvel intendant Bogdan Roščić devait donc marquer une ligne de rupture, notamment au regard de la politique de mises en scène menée depuis des années, qui faisait de Vienne un temple très traditionnel, ce qui n’est pas problématique, mais aussi d’une certaine médiocrité scénique, ce qui l’est plus. Un seul exemple, la production musicalement fabuleuse de Die Frau ohne Schatten en juin 2019 dirigée par un Christian Thielemann des grands soirs avec un cast à faire pâlir, dans une mise en scène plan-plan et sans aucun intérêt de Vincent Huguet, dont nous avions rendu compte dans le site Wanderer.
Bogdan Roščić a donc suivi une double ligne : des nouvelles productions faisant appel à des metteurs en scène plus inventifs, comme le Parsifal signé Kirill Serebrennikov dont Wanderer a rendu compte, et d’un autre côté là où c’était nécessaire rafraîchir le répertoire rapidement en achetant des productions qui avaient marqué ailleurs, c’est le cas de l’Eugène Onéguine vu par Dmitry Tcherniakov, ou du Faust de Frank Castorf, dont Wanderer a aussi rendu compte, mais aussi de l’Incoronazione di Poppea (de Jan Lauwers) pris à Salzbourg et du Macbeth (dont Wanderer a rendu compte en juin dernier) signé Kosky qui vient de Zurich (Wanderer a aussi rendu compte de la production zurichoise) sans jamais renoncer à l’excellence musicale, voir à l’exceptionnel (cf. Parsifal) qui fait partie de l’ADN de la maison, au moins pour les Premières et les grandes reprises. Le public viennois est en effet l’un des plus sensibles qui soient aux équipes musicales et aux voix.
Tout cela doit demander à Bogdan Roščić, et à ses équipes, notamment à son responsable-casting Robert Körner (qui officiait naguère à Lyon) un jeu subtil d’équilibres qui devrait à terme permettre à ce public d’évoluer dans ses habitudes et attentes. Un retournement de la sorte se fait progressivement et lentement.
C’est pourquoi cette deuxième année apparaît comme un peu moins bouleversée, mais avec des nouvelles productions qui stimulent les envies du mélomane voyageur…
Nouvelles productions :
Les cinq nouvelles productions donnent une belle visibilité sur les intentions de la direction du théâtre, qui loin de négliger le répertoire, veulent au contraire l’asseoir et le « ravaler » avec des productions correspondant un peu plus à notre modernité : Rossini (Il Barbiere di Siviglia), Mozart (Don Giovanni) Berg (Wozzeck), Wagner (Tristan und Isolde), Monteverdi (L’Orfeo) sont des productions-emblèmes qu’il faut à la fois considérer en soi, de simples nouvelles productions d’une saison, mais surtout par ce qu’elles disent derrière, entre les lignes, des intentions artistiques.
Septembre 2021/Juin 2022
Rossini, Il barbiere di Siviglia
(6 repr. du 28 sept au 14 oct/4 repr. du 4 au 12 juin) (MeS : Herbert Fritsch)
Avec
- Dir : Michele Mariotti
Florez/Berzhanskaja/Bordogna/Abdrazakov/Luciano/Brauer-Kvam - Juin Dir : Stefano Montanari
Florez/Molinari/Bank/Kellner/Olivieri
La production de Gunther Rennert a fait son temps, qui fut particulièrement long (depuis 1966), mais elle n’a pas été reprise depuis 1990, ce qui est surprenant pour un titre aussi populaire. La nouvelle production est confiée à Herbert Fritsch, qui a fait ses classes chez Castorf à la Volksbühne de Berlin jusqu’en 2007. Voilà qui promet.
Du côté de la distribution, en octobre, du beau monde, avec Florez et Vasilisa Berzhanskaya (remplaçant Crebassa), mais aussi Bordogna et Abdrazakov, avec le Figaro d’Etienne Dupuis à découvrir remplaçant Davide Luciano, le tout sous la direction experte de Michele Mariotti, né dans les langes de Rossini.
En juin un autre chef, Stefano Montanari, aussi excellent que Mariotti, sinon encore plus inventif, et une distribution où les basses sont celles de la maison (Bankl, Kellner) et où Etienne Dupuis laisse la place à Mattia Olivieri, l’un des meilleurs jeunes barytons de la péninsule qui vient de triompher dans le rôle à la Scala. Pour le reste, Florez répondra aussi présents en juin. Florez a été Faust dans la production de Frank Castorf, il peut affronter Herbert Fritsch dans Almaviva. Quant à Crebassa elle sera remplacée par Cecilia Molinari. Le public viennois n’est pas au bout de ses (bonnes) surprises.
Décembre 2021
Mozart, Don Giovanni
(Dir : Philippe Jordan/MeS : Barrie Kosky)
Avec Ketelsen/Sly/de Barbeyrac/Anger/Kellner/ H.E.Müller/Lindsey/Nolz
Attention! Piège. La durée relative de la mise en scène fameuse de Franco Zeffirelli de 1972 à 1990 ne doit pas masquer les successives, Bondy (plutôt pas mal) dura deux saisons, puis De Simone pas beaucoup plus. La dernière, celle de Martinoty dura l’ère Dominique Meyer mais n’était pas de celles qu’on garde pour l’éternité.
L’échec récent de Castellucci à Salzbourg nous indique combien l’œuvre de Mozart est piégeuse.
Comme c’est la mode aujourd’hui, on confie la trilogie Da Ponte à un seul metteur en scène, Barrie Kosky, qui se lance dans l’aventure. S’il y réussit, tout le monde courra à Vienne pour voir.
Du côté musical, pas de risque en fosse où Philippe Jordan, mozartien devant l’Éternel, assure la direction musicale, mais sur scène, un plateau inhabituel avec Kyle Ketelsen en Don Giovanni, lui qui fut un extraordinaire Leporello, et en Leporello, Philippe Sly, qui ne fut pas un Don si convaincant. Un Ottavio de grand style, Stanislas de Barbeyrac, et deux dames qui devraient convaincre, -mais qui sait? – Hanna Elisabeth Müller en Anna et Kate Lindsey en Elvira. Sachant la difficulté à monter Mozart aujourd’hui, rien n’est assuré. Attendons.
(6 repr du 5 au 20 déc/5 repr. du 3 au 15 juin)
Mars 2022
Berg, Wozzeck
(Dir : Philippe Jordan/MeS : Simon Stone)
Avec Gerhaher/Kampe/Panikkar/Schneider/Belosselsky
La mise en scène de Dresen a duré jusqu’à 2014, et c’était une très belle production dont il existe une vidéo avec Grundheber, Behrens et Abbado. Plusieurs dizaines de représentations plus tard, il peut s’avérer nécessaire de produire une nouvelle production, confiée à Simon Stone, dont l’Opéra de Vienne propose en début de saison la Traviata parisienne, avec Pretty Yende, Frédéric Antoun et Ludovic Tézier.
La distribution de ce Wozzeck est superbe, Gerhaher et Kampe ont déjà fait les beaux soirs de Munich dans ces rôles. Cela devrait valoir le voyage.
(5 repr. du 22 mars au 3 avril)
Avril 2022
Wagner, Tristan und Isolde (5 repr. du 14 avril au 1er mai)
(Dir : Philippe Jordan/MeS : Calixto Bieito)
(Avec Schager, Serafin, Pape, Gubanova, Paterson)
Trois productions depuis 1967, Everding, qui a duré jusqu’à 2003, puis Gunter Krämer (celui qui commit le Ring parisien) et enfin depuis 2013 David McVicar, dont on connaît les productions sans sel ni poivre.
Cette fois-ci ce sera Calixto Bieito, qui peut être va réveiller un peu l’histoire des productions de l’œuvre à Vienne. Au fond, le travail de Bogdan Roščić est aisé pour le choix des metteurs en scène, comme aucun des noms importants de la mise en scène n’ont travaillé à Vienne depuis des années, il lui suffit de distribuer des productions à la bande des quatre ou cinq habituels, Bieito, Stone, Kosky, Tcherniakov et quelques autres et le tour est joué. En un an on aura aussi vu Castorf, Serebrennikov … L’Opéra de Vienne se « normalise », il rentre dans la ronde des opéras d’Europe qui ont depuis longtemps des spectacles signés de ces artistes, mais il faudra aussi trouver des noms nouveaux…
Du côté musical, on connaît le Wagner de Philippe Jordan, garantie de solidité, et la distribution est sans reproche, là aussi habituelle : Schager, Pape, Paterson, Gubanova : que de bons chanteurs. Bien sûr, c’est hélas Martina Serafin qui chante Isolde, mais on ne peut pas tout avoir.
Juin 2022
Monteverdi, L’Orfeo
(4 repr. du 11 au 18 juin 2022)
Dir : Pablo Heras Casado/MeS Tom Morris)
Avec Nigl, Lindsey, Zámečníková, Mastroni, Bock
Après L’Incoranazione di Poppea venue de Salzbourg (Lauwers) qui a très bien marché auprès du public, c’est au tour de L’Orfeo ; c’est Munich qui a à mon avis la meilleure production actuelle (David Bösch), et Bogdan Roščić table sur un autre style, celui de l’imagination anglo-saxonne, entre marionnettes et émerveillements scéniques de Tom Morris.
Wait and see, mais musicalement, même si je ne suis pas toujours convaincu par Heras Casado, c’est une distribution très séduisante, dominée par Georg Nigl, l’autre baryton (à côté de Gerhaher), qui devrait être très stimulant car l’autrichien Georg Nigl est l’un des plus intéressants de sa génération.
_____________________
Juin-Juillet 2022
Rossinimania
Du 28 juin au 8 juillet
Une nouveauté, une révolution même à l’Opéra de Vienne qui va rester ouvert après sa fermeture… pour accueillir une tournée de l’Opéra de Monte-Carlo et surtout Cecilia Bartoli, qui tenez-vous bien, n’a jamais chanté à l’Opéra de Vienne. Alors, c’est une semaine Bartolimania aussi bien que Rossinimania
28 juin
La Cenerentola
(Repr. semi-scénique)
Dir : Gianluca Capuano/ Real.sc. Claudia Blersch
Avec Bartoli, Rocha, Alaimo, Chausson, Coca Loza, Bove, Olvera
Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo
Les Musiciens du Prince Monaco
Une réalisation qui a beaucoup tourné, toujours avec le même succès, avec les costumes de l’opéra de Zurich, et une distribution hyper-rodée. Ce devrait être le triomphe mérité habituel avec Capuano au pupitre des excellents Musiciens du Prince-Monaco.
Il Turco in Italia
(3 repr. les 3, 5 et 7 juillet 2022)
Dir : Gianluca Capuano/MeS : Jean-Louis Grinda
Avec Abdrazakov, Bartoli, Alaimo, Banks, Romeo ; Lo Monaco, Astorga
Les Musiciens du Prince-Monaco
Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo
La production qui sera créée en janvier à Monte-Carlo est présentée à Vienne pour trois soirs avec une distribution dominée par Cecilia Bartoli et Ildar Abdrazakov, et avec Barry Banks qui n’a pas convaincu à Pesaro.
Aucun souci du côté de l’orchestre, avec Capuano et Les Musiciens du Prince. On sait aussi déjà que la mise en scène de Jean-Louis Grinda ne sera pas révolutionnaire, cela reposera les viennois un peu secoués ces deux dernières années.
Rossini-Gala
8 juillet 2021
Dir : Gianluca Capuano
Les Musiciens du Prince-Monaco
Avec : Bartoli, Abrahamyan, Villazón, Levy-Sekgapane, Corbelli, Abdrazakov
Fin en feu d’artifice rossinien. Faisons confiance à Cecilia Bartoli pour animer la soirée et mettre la salle en délire avec cette brochette de chanteurs et remarquons la présence de Levy-Sekgapane, ténor aux aigus stratosphériques et au timbre lumineux. À suivre.
Voilà une saison aux Premières un peu plus normalisées que la saison dernière, avec des poids lourds du répertoire Barbier, Don Giovanni, Wozzeck, Tristan… Bogdan Roščić poursuit son travail de rafraichissement, voire de nettoyage et il faut reconnaître que cette maison en avait un peu besoin.
L’initiative rossinienne est aussi une excellente opération de communication envers le public viennois, l’impression produite par cette deuxième saison est celle d’une consolidation des principes affichés la saison dernière avec une sorte de rythme normal retrouvé.
Même si elles sont entrées au répertoire, certaines productions 2020, à cause du Covid, n’ont pas encore été vues en public, mais éventuellement en streaming, c’est le cas de Das verratene Meer, de Traviata et de Parsifal, nous les signalons en priorité, et puis il y a des Wiederaufnahmen, des reprises retravaillées (alors que les titres de répertoire ne le sont pas)..
Reprises post Covid de productions réalisées mais non représentées en public
Septembre 2021
Giuseppe Verdi, La Traviata (Dir. : Nicola Luisotti/Ms : Simon Stone)
Avec Pretty Yende, Ludovic Tézier, Frédéric Antoun…
En ce début de saison, des titres d’appel, dont Falstaff et Tosca, pour réamorcer la pompe et attirer le public et puis la nouvelle production du Barbier de Séville en fin de mois. Ce spectacle est la production parisienne vue à Garnier avec comme à Paris Pretty Yende et Ludovic Tézier, mais avec Frédéric Antoun, nouveau venu en Alfredo. Distribution qui garantit des soirées de haut niveau vocal.
(5 repr. du 5 au 18 Septembre)
Coproduction Opéra de Paris
Septembre 2021
Hans Werner Henze, Das verratene Meer (Dir.: Simone Young/Ms : Jossi Wieler/Sergio Morabito)
Avec Vera-Lotte Boecker, Bo Skovhus, Josh Lovell…
“La mer trahie”, titre du drame musical de Henze créé à Berlin en 1990 n’est pas le plus connu des opéras de Henze, tiré du roman de Mishima « Le marin rejeté par la mer » de 1963. Désespoir, déchirement face aux valeurs, bouleversement des individus, violence, tous les ingrédients de Mishima sont là, mis en musique par Henze qui a vécu les mêmes déchirements en faisant des choix opposés.
3 repr. les 19, 23, 27 septembre
Décembre 2021
Richard Wagner, Parsifal (Dir. : Philippe Jordan/Ms : Kirill Serebrennikov)
Avec Brandon Jovanovich, Anja Kampe, Wolfgang Koch, René Pape
Reprise de la mise en scène dont Wanderersite a rendu compte, mais sans Elina Garanča ni Jonas Kaufmann ni Georg Zeppenfeld, mais avec Jovanovich, Kampe et Pape, ce qui n’est pas si mal non plus. A noter que Wolfgang Koch chante Amfortas ET Klingsor, ce qui va encore accentuer la mise en abyme du travail de Serebrennikov. À voir évidemment, d’autant que la production succède à celle si médiocre d’Alvis Hermanis.
(5 repr. du 12 au 26 déc.)
A noter : avec le Don Giovanni de Kosky qui commence le 5 décembre, les Wanderer du lyrique devront jouer des dates pour combiner une riche virée viennoise car décembre est sans doute le mois le plus adapté à un voyage dans la capitale autrichienne si on y va pour l’Opéra.
Les « Wiederaufnahmnen »
Dans le système de répertoire, il y a des reprises directes, avec très peu de répétitions et puis les « Wiederaufnahmen » qui sont les reprises retravaillées scéniquement et musicalement, en général de productions qu’on n’a pas l’intention de remplacer à court terme.
On va donc retrouver des productions de l’ère précédente et de l’ère Holender, avec de nouvelles distributions et de nouveaux chefs. Il y a neuf reprises retravaillées, et une reprise retravaillée seulement musicalement (Capriccio).
Septembre 2021
Giuseppe Verdi, Falstaff (Dir : Nicola Luisotti/Gianpaolo Bisanti/Ms : Marco Arturo Marelli)
Avec Wolfgang Koch/Gerald Finley, Josh Lovell/Frédéric Antoun, Boris Pinkhasovich, Eleonora Buratto…
Deux chefs italiens solides, dont le second (Bisanti) commence à être invité un peu partout en Europe, et une double distribution plutôt stimulante, notamment les deux Falstaff.
9 repr. (5 en sept 2021) /4 en juin 2022 (du 14 au 24 juin 2022)
Novembre 2021
Rihcard Wagner, Der fliegende Holländer (Dir. : Bertrand de Billy/Ms : Christine Mielitz)
Avec Anja Kampe, Bryn Terfel, Eric Cutler, Franz Josef Selig
Production de 2003 (de la période Holender), avec déjà 58 représentations au compteur. Distribution de très haut vol, à peu près ce qui se fait de mieux aujourd’hui.
5 repr. du 17 nov. au 2 déc. 2021
Décembre 2021
Giuseppe Verdi, Don Carlo (ital.) (Dir : Franz Welser Möst/Ms Daniele Abbado)
Avec Ain Anger, Boris Pinkasovitch, Fabio Sartori, Anita Rashvelichvili, Asmik Grigorian
Petite histoire : Franz Welser-Möst revient au pupitre d’une production qu’il a créée en 2012, avant de laisser la fonction de GMD en 2014. La distribution, correcte, vaut surtout par les deux dames, Gubanova et surtout Grigorian, Qui ne devrait pas manquer d’exciter toutes les curiosités des fans.
(4 repr. du 16 au 25 déc. 2021)
Notons qu’avec Parsifal et Don Giovanni, ce Don Carlo est une raison de plus d’un voyage à Vienne en décembre 2021, à vos agendas.
Janvier 2022
Tchaïkovski : La Dame de Pique (Dir. : Valery Gergiev/Ms : Vera Nemirova)
Avec Dmitry Golovnin, Boris Pinkasovitch, Elena Guseva, Olga Borodina
Reprise de la production de 2007, alors créée par Seiji Ozawa qu’on n’a pas vue à Vienne depuis 2015. C’est Valery Gergiev qui sera dans la fosse, voilà donc une reprise alla grande, d’autant que Gergiev est assez rare à Vienne car on ne l’a vu que pour Parsifal en 2019 et Lohengrin en 2020. Belle distribution avecla très intense Elena Guseva en Lisa.
(4 repr. du 21 au 30 janv. 2022)
Britten: Peter Grimes (Dir.: Simone Young/Ms: Christine Mielitz)
Avec Jonas Kaufmann, Sir Bryn Terfel, Lise Davidsen
Reprise de la première production viennoise de l’Opéra de Britten, entré au répertoire en 1996, par une étincelante distribution avec la prise de rôle de Jonas Kaufmann. Cela devrait fortement stimuler le public à voir ou revoir cette œuvre, qui en sera le 26 janvier 2022 à sa 42e représentation à Vienne.
(5 repr. du 26 janvier au 8 février 2022)
Février 2022
Giacomo Puccini : Manon Lescaut (Dir. : Nicola Luisotti/Ms : Robert Carsen)
Avec Asmik Grigorian, Brian Jagde, Boris Pinkasovich.
Se souvient-on que Carsen émergea à l’international par Manon Lescaut à l’Opéra-Bastille tout neuf, en 1991, dans une production venue de l’Opéra des Flandres, qui reste l’une de ses meilleures. Le solide Nicola Luisotti en fosse, mais vaut évidemment par la Manon de Asmik Grigorian, plus connue pour ses rôles de répertoire germanique du XXe siècle. Grande curiosité …
(5 repr. du 1er au 13 février 2022)
Erich Wolfgang Korngold : Die tote Stadt (Dir. :Thomas Guggeis/Ms: Willy Decker)
Avec Klaus Florian Vogt, Vida Miknevičiūtė, Adrian Eröd, Monika Bohinec
Production de 2004, sous le mandat Holender, pas reprise depuis 2017, ici avec une belle distribution, Vogt, l’un des Paul de référence aujourd’hui, et dans le rôle de Marietta, la voix qui monte, qui vient de triompher à Salzbourg dans Chrysothemis Vida Miknevičiūté. En fosse, Thomas Guggeis, l’un des jeunes chefs remarqués à Berlin autour de Daniel Barenboim. Ce devrait être solide.
(4 repr. du 6 au 14 février 2022)
Gaetano Donizetti : Anna Bolena (Dir.: Giacomo Sagripanti /Ms : Eric Genovèse)
Avec Erwin Schrott, Diana Damrau, Ekaterina Sementchuk, Pene Patti, Virginie Verrez
Une des productions réussies de l’ère Meyer, il est vrai qu’à la première en 2011, les deux dames étaient Anna Netrebko, déjà star et Elina Garanča à l’aube de sa gloire. Au pupitre Giacomo Sagripanti, un chef italien qui conduit une belle carrière à l’international. Diana Damrau et Ekaterina Sementchuk ne devraient pas décevoir. À noter le ténor Pene Patti qu’on commence à voir un peu partout.
(3 repr. du 12 au 19 février 2022)
Mai 2022
Modest Mussorgski : Boris Godunov (Dir.: Sebastian Weigle/Ms: Yannis Kokkos)
Avec Ildar Abdrazakov, Vitalij Kowaljow, Dmitry Golovnin, Thomas Ebenstein, Tamuna Gochashvili
Production classique de l’ère Holender (2007). Kokkos avait déjà mis en scène Boris Godunov à Bologne. Distribution solide dominée évidemment par Ildar Abdrazakov.
(5 repr. du 11 au 27 mai 2022)
Reprise musicale
Juin 2022
Richard Strauss : Capriccio (Dir.: Philippe Jordan/Ms : Marco Arturo Marelli)
Avec Maria Bengtsson, Adrian Eröd, Daniel Behle, André Schuen, Christof Fischesser, Michaela Schuster.
C’est une reprise musicale, ce qui signifie que la mise en scène n’est pas retravaillée, il est vrai que la production Marelli qui remonte à 2008 (avant-dernière année de l’ère Holender) est passe-partout et ne nécessite pas forcément d’être revue. À noter que ce fut la première apparition de Philippe Jordan au pupitre de la Wiener Staatsoper. 13 ans après il en est le directeur musical. Distribution équilibrée, et de qualité.
(4 repr.du 20 au 30 juin 2022)
On le constate, tout ce qui est proposé est solide, bien distribué et devrait garantir un haut niveau moyen de représentations. Mais le cœur, l’ADN de ce théâtre est le répertoire, c’est à dire l’alternance serrée de représentations avec peu de répétitions, quelques « guest-stars » et la troupe. On joue pratiquement tous les soirs à Vienne et il y a toujours un opéra à voir, chaque soir différent.
Cependant, la nouvelle direction a limité le nombre de titres à 40, ce qui n’est déjà pas mal et dépasse la plupart des maisons comparables. Voici la liste des titres présentés, en dehors de ceux que nous avons détaillés :
Octobre 2021 :
Otello
L’Incoronazione di Poppea
Eugène Onéguine
Adriana Lecouveeur (Octobre et novembre) (à noter Elina Garanča en princesse de Bouillon)
Novembre 2021 :
Faust (première le 31 octobre)
Nabucco (ce devait être la prise de rôle d’Anna Netrebko en Abigaille, il faudra attendre parce qu’elle a annulé à cause d’une opération d’urgence, il reste Placido Domingo en Nabucco pour la dernière, les autres étant assurées par Amartuvshin Enkhbat) et les Zaccaria du remarquable Roberto Tagliavini, la basse italienne de référence aujourd’hui)
Carmen
L’Elisir d’amore (Novembre, décembre, février, mars)
Décembre 2021 :
Don Pasquale (Décembre 2021, avril, mai 2022)
Tosca (Décembre, février, mars)
Die Fledermaus (Décembre, janvier)
Janvier 2022 :
La Bohème
La Cenerentola
Werther
Macbeth
Février 2022: Voir ci-dessus Wiederaufnahmen
Mars 2022:
Salomé
Die Entführung aus dem Serail
Rigoletto
Wozzeck (mars-avril)
Avril 2022
Der Rosenkavalier
Tristan und Isolde (avril-mai 2022)
Lucia di Lammermoor
Mai 2022
Le nozze di Figaro
Das Rheingold
Die Walküre
Siegfried
Götterdämmerung
Juin 2022
I Puritani
Il Barbiere di Siviglia
Die Zauberflöte
Dans cette liste abondante, on remarque la Tétralogie de Richard Wagner, qui sera donnée deux fois au mois de mai dans la production bien connue de Sven Eric Bechtolf (2007-2008)
Nous donnons les principaux éléments de la distribution
Direction musicale : Axel Kober
Avec John Lundgren, Daniel Behle, Monika Bohinec, Jochen Schmeckenbecher, Stuart Skelton, Lise Davidsen, Nina Stemme, Michael Weinius etc…
Cela mérite peut-être un petit voyage.
Vienne qui avait un peu disparu des radars, non pour le niveau musical, toujours haut, mais par les choix de productions et de mises en scène, revient sur le devant de la scène. Sans proposer des choix d’une originalité marquée, l’Opéra de Vienne propose un choix de nouvelles productions comparables aux théâtres européens de même importance avec des distributions de très haut niveau. En deux saisons même tronquées, on reparle de Vienne et on a vraiment envie d’y découvrir des spectacles. Donc on ne peut qu’encourager à bien étudier les périodes qui permettront à l’amateur de faire le plein d’opéra et en particulier décembre 2021.
Pour plus de détails, regarder le site très clair de la Wiener Staatsoper (https://www.wiener-staatsoper.at) et notamment la page de tous les titres présentés dans la saison (https://www.wiener-staatsoper.at/spielplan-kartenkauf/werke/)en cliquant sur le titre, vous y découvrirez les distributions notamment pour le répertoire)
Et dans quelques jours sur Wanderersite.com une interview passionnante de Bogdan Roščić, Directeur de l’Opéra de Vienne.


 L’Opernhaus Zürich est une de ces maisons très solides qui déçoivent rarement. On avait craint au départ d’Alexander Pereira pour Salzbourg que la régularité et la qualité en pâtissent, et Andreas Homoki a prudemment mené une politique faite d’idées remarquables, et d’un souci de préserver répertoire et public. Ainsi y-a-t-il à Zürich des productions que chacun devrait avoir vu, comme le Macbeth de Barrie Kosky, ou des productions de Tcherniakov notables, dernière en date, l’Affaire Makropoulos, mais aussi de Bieito (Die Soldaten) ou de Christof Loy (Alcina), ainsi qu’une politique musicale équilibrée où l’on entend des stars comme par exemple Cecilia Bartoli (c’est son incontestable maison) ou Anja Harteros, voire aussi Nina Stemme et des chefs notables: Franz Welser-Möst, Daniele Gatti, Fabio Luisi et bientôt Gianandrea Noseda sont les directeurs musicaux qui se sont succédé. Un orchestre solide fait de deux entités, la Philharmonia Zürich pour le répertoire XIXe et XXe, et L’Orchestra La Scintilla pour le répertoire baroque, un chœur de bon niveau et un plateau technique enviable constituent les forces incontestables de ce théâtre, situé au bord du lac de Zürich.
L’Opernhaus Zürich est une de ces maisons très solides qui déçoivent rarement. On avait craint au départ d’Alexander Pereira pour Salzbourg que la régularité et la qualité en pâtissent, et Andreas Homoki a prudemment mené une politique faite d’idées remarquables, et d’un souci de préserver répertoire et public. Ainsi y-a-t-il à Zürich des productions que chacun devrait avoir vu, comme le Macbeth de Barrie Kosky, ou des productions de Tcherniakov notables, dernière en date, l’Affaire Makropoulos, mais aussi de Bieito (Die Soldaten) ou de Christof Loy (Alcina), ainsi qu’une politique musicale équilibrée où l’on entend des stars comme par exemple Cecilia Bartoli (c’est son incontestable maison) ou Anja Harteros, voire aussi Nina Stemme et des chefs notables: Franz Welser-Möst, Daniele Gatti, Fabio Luisi et bientôt Gianandrea Noseda sont les directeurs musicaux qui se sont succédé. Un orchestre solide fait de deux entités, la Philharmonia Zürich pour le répertoire XIXe et XXe, et L’Orchestra La Scintilla pour le répertoire baroque, un chœur de bon niveau et un plateau technique enviable constituent les forces incontestables de ce théâtre, situé au bord du lac de Zürich.