
Il y avait en ce début d’année trois productions de Parsifal, à Toulouse, à Strasbourg et à Palerme. J’ai choisi Palerme pour des raisons qui m’apparaissent évidentes : c’est à Palerme que Wagner a terminé la composition de son opéra d’une part, et d’autre part le Teatro Massimo n’avait pas affiché Parsifal depuis 65 ans, enfin, c’est une (quasi) prise de rôle pour notre wagnérienne nationale, Catherine Hunold, appelée à chanter Kundry, puisque la Kundry prévue à l’origine a déclaré forfait.
Pour un théâtre comme le
Massimo de Palerme, Parsifal est un défi : d’une part, le symbole de Richard
Wagner achevant son Parsifal à Palerme fait évidemment regarder une production de Parsifal
à Palerme d’une manière particulière, qui donne une singulière
responsabilité aux équipes du théâtre, et d’autre part, excite la curiosité du
public qui fait que les représentations ont toutes été très bien remplies.
Il y a en ce moment un réel effort de ce théâtre de sortir d’une routine
aimable, et de proposer un répertoire plus ouvert et des productions plus
stimulantes, une volonté de donner au public une qualité et un regard
nouveaux, d’autant que la salle immense est faite pour accueillir des grosses
machines. Le Massimo est un très beau théâtre qui mérite l’attention et mérite
aussi la qualité.
Le Ring
de Wagner a été bouclé il y a peu, et c’était déjà une belle entreprise,
confiée aussi à Graham Vick, qui signe la production de ce Parsifal.
Il y avait donc bien des motifs de venir en Sicile, outre la joie de retrouver une ville aimée et une douceur ineffable en plein cœur de l’hiver.
Graham Vick travaille beaucoup en Italie : dans un paysage lyrique où l’art de la mise en scène reste traditionnel, plus esthétique que dramaturgique, avec un public souvent rétif à l’innovation, son théâtre semble accepté comme un symbole de modernité, ici sur un répertoire qui n’est pas italien, sur lequel on peut « tenter » du neuf ou de l’inhabituel.

Ainsi de ce Parsifal « multipolaire », tant il brasse des concepts divers, qui s’entrecroisent, tantôt séduisants, tantôt rebattus voire recuits, tantôt indifférents. Comme si Parsifal œuvre syncrétique s’il en est où se croisent Moyen Âge, Chrétienté, Orient, mais aussi la magie des épopées de la Renaissance du Tasse ou de l’Arioste…Klingsor et son royaume magique n’est que l’avatar de celui d’Alcina et Parsifal un lointain héritier de Rinaldo ou d’Orlando : c’est d’ailleurs amusant que Wagner ait achevé son œuvre au pays des marionnettes siciliennes qui ne cessent de représenter ces épopées médiévales ou de la Renaissance.
Que la Sicile, une île où se sont croisées les civilisations et cultures grecques, romaines, arabes, franques ou espagnoles, accueille une œuvre aussi touffue dans ses sources est aussi intéressant, et donc que Vick produise un Parsifal qui soit melting pot culturel ici ne peut choquer. La Sicile étant l’un des plus beaux carrefours des cultures qui soient.
S’il y a quelque chose de séduisant dans son approche, c’est d’abord la volonté d’insérer l’action dans la nudité du théâtre, qui laisse voir tout ce qu’on cache, les murs nus, les dispositifs scéniques, les machinistes faisant du plateau central celui d’une cérémonie qui prend sa forme sur un large plan incliné (décor de Timothy O’Brien) et qui utilise les trucs de théâtre simples, des rideaux qu’on tire à la main, des fonds suspendus accrochés aux cintres, des outils élémentaires qui ignorent les manies du jour, vidéo, laser, projections. Le théâtre est le décor lui-même et l’immense arche du fond qui ouvre sur l’arrière-scène a quelque chose d’une arche de cathédrale (Sienne ?). Cette mise en scène est un hommage à l’artisanat théâtral -tel que Kosky le vantait il y a peu dans sa dernière production berlinoise (Frühlingsstürme). La cérémonie théâtrale agit. Il n’y a point besoin de décor, les costumes sont s’une simplicité rare, (costumes de Mauro Tinti) le théâtre et ses mécanismes se suffisent : le théâtre, c’est cette surface sur laquelle tout se joue, un espace vide cher à Peter Brook (on voit où Graham Vick puise ses sources). Ainsi, ce Parsifal installé dans cet immense espace ne manque pas d’allure.
Mais Graham Vick remplit aussi l’espace d’idées nombreuses tantôt intéressantes, tantôt rebattues (notamment ces dernières années) qui nuisent à la cohérence de l’ensemble. Il part du concept de moine-soldat ou de soldat-moine, en se posant la question, où sont les moines-soldats aujourd’hui et que défendraient-ils ?
Dans ce concept, on se projette au Proche Orient, mais pas tout à fait à la mode de Laufenberg dans la production de Bayreuth, parce que la production de Laufenberg se veut précise jusqu’au détail géographique. Ici, l’espace vide nous rattache à l’abstraction, comme si on assistait à un drame sacré (il s’agit après tout d’un Festival scénique sacré), détaché d’un lieu.

Cependant, l’arrivée de Kundry voilée de noir comme à l’acte II une partie des filles fleurs, rappelle furieusement le travail de Laufenberg, tout comme l’Amfortas christique presque nu avec sa couronne d’épines. Ces voiles noirs, ces niqab deviendraient-ils pour Parsifal un lieu commun lassant et une fausse bonne idée, sinon une provocation inutile qui pointe une religion par un fantasme négatif (vu de l’occident), aucun intérêt sinon se faire peur à peu de frais. Mais on comprend bientôt que ce n’est pas l’Islam qui est visé, parce que même Gurnemanz pour prier adopte la position du musulman et s’accroupit, comme d‘ailleurs plus tard des soldats, et ainsi les gestes religieux se mélangent et se stratifient. Gurnemanz porte d’ailleurs au lever de rideau une écharpe qui fait penser au talith juif, ce qui laisserait penser que Vick vise dans ce Parsifal les trois religions révélées, leurs rituels, leurs excès, leur violence et leur clôture. Car c’est bien d’un univers clos et sur la défensive qu’il s’agit. La vision d’un Gurnemanz racontant l’histoire à ces deux jeunes Knappen, l’un couvert d’une sorte de kippa et l’autre d’un vague Kefieh renforce l’idée d’une diversité réunie autour du combat du Graal, encore faut-il définir – et Vick le suggère – de quel combat il s’agit et si ce combat du Graal n’est pas vain. Les deux autres soldats qui s’attachent à insulter ou agresser Kundry ont eux aussi des silhouettes bien construites, plus individualisés que ce à quoi on est accoutumé dans un Parsifal « ordinaire ». Ce souci de donner aux rôles de complément des attitudes très individualisées est d’ailleurs une des particularités heureuses de cette mise en scène
Culturellement Vick en appelle d’ailleurs à tous les éléments de la culture occidentale, y compris des références à l’antiquité : lors de la « Verwandlungsmusik », il représente derrière le rideau blanc en ombre chinoises une série d’éléments qui sont des signes, femmes dénudées, cortège de soldats, mais aussi joueurs de musique, on reconnaît presque au passage un joueur d’aulos grec, cette flûte à double tuyau, du moins une évocation, en un défilé qui semble presque une représentation de personnages qui peuplent les vases grecs ou dans un autre tradition ce cortège qui suivrait le joueur de flûte de Hameln. Il y a là une vision globale d’une culture qui se réunit à la cérémonie du Graal comme si elle était l’Alpha et l’Oméga de l’existence : en quelque sorte, la cérémonie du Graal devient une sorte de lieu de régénérescence de notre monde dans la globalité culturelle, et aussi ses dérives, le rendez-vous des aimés et des damnés de la terre.
Vick d’ailleurs aime à parsemer son travail de signes non dénués d’ironie, en travaillant beaucoup sur les détails de comportement des figurants qui prennent une importance singulière en ce premier acte. Durant la cérémonie du Graal, ce pauvre Amfortas en Christ décrucifié (merci Laufenberg) se traîne et les soldats bien rangés ne cessent de bouger, de le regarder de manière oblique, de se retourner, bref, de déranger le bel ordonnancement qu’on a l’habitude de voir. Encore merci à Laufenberg et Tcherniakov d’avoir fourni l’idée du sang de la plaie (qu’Amfortas ouvre lui-même selon le vieux principe qu’on n’est jamais si bien servi que par soi-même) qui est versé dans un calice (un gros gobelet) et que les soldats se repassent de main en main pour en prendre quelques gouttes, puis se scarifier à leur tour pour partager les souffrances (Mit-Leid) – c’est la variation de Vick- pendant que le jeune Parsifal circule incrédule dans les rangs : bref, depuis Schlingensief (avec plus de sens à mon avis), Tcherniakov et Laufenberg, le sang coule, et on s’en repait, rien de bien nouveau sous le soleil.

Que Titurel apparaisse en complet sombre, avec une pochette assez voyante, nous indique simplement que le vrai criminel dans l’histoire n’est peut-être pas Klingsor, mais Titurel, le dictateur exigeant qui tel le Moloch, exige sa part de sang filial pour survivre et épuiser son fils. Dans ce monde de soldats prêts au combat, il est la figure du politique, du dictateur, de celui qui se sert des autres pour sa propre survie…c’est dans l’air du temps.
Dans ce monde étrange, qui est théâtre c’est à dire représentation et artifice, Parsifal apparaît évidemment en décalage, il est jeune, un peu marginal, en tous cas complètement en dehors de ce combat et de ces peurs, il est naturel, c’est l’enfant rousseauiste qui a vécu des offres de la nature, de l’état de nature, quand la société du Graal est bien proche de ce que serait un état de culture au bord du dévoiement.
L’enjeu de toute mise en scène de Parsifal se lit essentiellement dans les premier et troisième actes, pratiquement jamais dans le deuxième. On peut souligner que seuls, parmi les très grandes mises en scènes de Parsifal, Tcherniakov a donné un sens au deuxième acte, avec ce Klingsor pédophile (joué et chanté merveilleusement par Tómas Tómasson (qui est ici Amfortas), ainsi que Herheim à Bayreuth indiquant en Klingsor l’horreur nazie.
Dans la plupart des autres, le deuxième acte se contente plus ou moins de suivre le livret. Vick invite à quelques précisions et donne quelques signes, mais ne va pas bien loin non plus. Espace vide, c’est à peu près le même qu’au premier acte (et de fait le royaume de Klingsor est une copie en négatif du royaume du Graal), et très vite, Klingsor baisse son pantalon pour apparaître en slip, un slip taché de sang là où il faut pour montrer la blessure définitive qu’il s’est infligé pour rester chaste. Il apparaît d’ailleurs presque comme un double d’Amfortas. Amfortas et Klingsor, les deux victimes du Graal titurelesque…

Kundry dans cette vision, n’a rien de la bête sauvage qu’on y voit quelquefois. Elle est séductrice, sous une icône de Marie-Madeleine, l’une de ses nombreuses identités, mais sous cette icône, elle est plus Marie que Madeleine, si l’on peut me permettre cette image. Elle a une douceur et une force de persuasion « maternelle » qui ne la quittera presque pas de tout l’acte, même dans la dernière partie.
Et l’acte se conclut en étrange manière : Klingsor envoie ses soldats attaquer Parsifal, des soldats qui furent du Graal et qu’on a déjà vus au début de l’acte à moitiés nus poursuivre des filles-fleurs. En cela il respecte le livret. Comme on l’a dit le royaume de Klingsor est un royaume du Graal en négatif, là où l’un est chaste, l’autre est sexuel, là où tout s’ordonne, l’autre est un charivari, là où il n’y a que des hommes, l’autre est rempli de femmes : la cérémonie du Graal était presque ordonnée autour des soldats, là les soldats sont soumis et ce qui règne dans la cérémonie des filles-fleurs (le pendant klingsoresque de la cérémonie du Graal) ce sont les femmes, dans un ordonnancement double. D’une part le groupe le plus important, en niqab, comme Kundry au premier acte qui semble être l’uniforme féminin de l’armée de Klingsor (symbole du mal ? ou de la valeur de soumission que le niqab semble avoir aux yeux occidentaux ?), pendant que les filles fleurs qui chantent « Des Garten’s Zier » ou « Komm holder Knabe » chargées de séduire Parsifal sont en paréo multicolore, comme en « service commandé » et adoptant l’habit de séduction nécessaire, sous les yeux de leurs compagnes. Du côté de Klingsor comme de celui du Graal, une organisation, une armée des ombres. Mais, là encore rien de bien neuf sous le soleil.
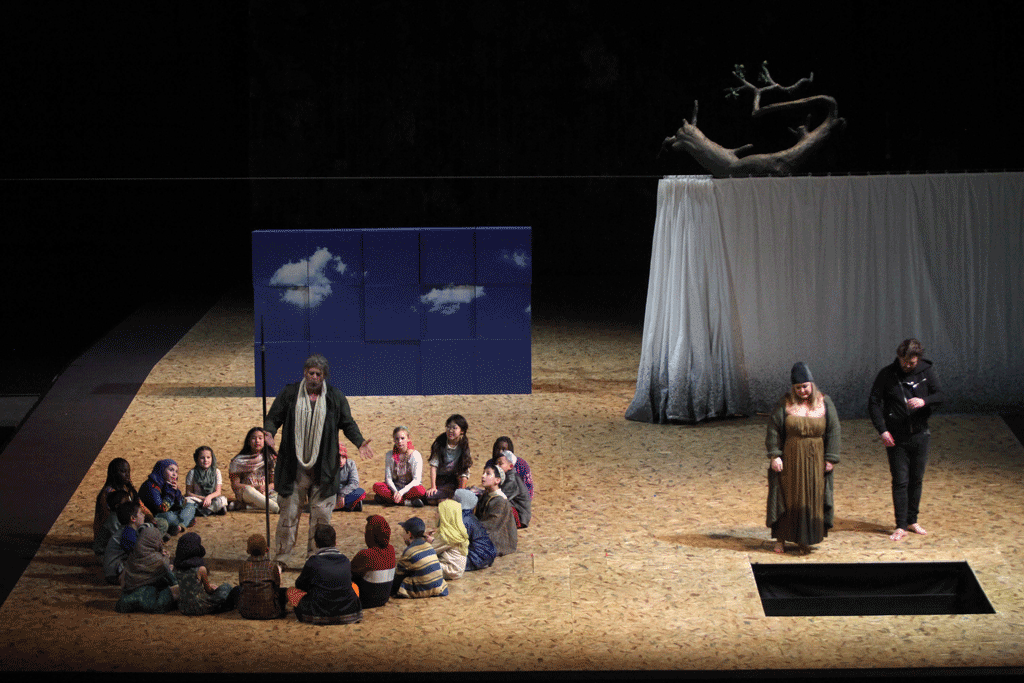
C’est souvent le troisième acte qui est résolutif, et qui donne son sens à tout ce qui précède. Dans les mises en scène de Parsifal qui ont marqué les dernières décennies, c’est celle de Götz Friedrich à Bayreuth en 1982 qui me semble avoir ouvert la voie : elle représente un Parsifal libérateur, qui ouvre au peuple, à tous, un royaume du Graal devenu un lieu fossile et clos, et qui vivait séparé du monde.
Entre les Parsifal qui pacifient (Herheim, Warlikowski) qui fuient (Tcherniakov), qui unissent les religions (Laufenberg), celui de Vick est sans doute plus proche de l’esprit de Friedrich en 1982 et un peu de Laufenberg (que, je pense, Graham Vick a vu…).
Toute la première partie du troisième acte est à peu près conforme à la tradition, jusqu’au baptême où Gurnemanz, Kundry, Parsifal se retrouvent dans une sorte de bain lustral et où très vite des enfants envahissent la scène et jouent avec l’eau. L’idée centrale du troisième acte est celle du « grand remplacement » d’une génération épuisée par une autre, faite d’enfants qui jouent, qui se moquent du rite, ouverte, neuve, et surtout libre : elle abat les cubes qu’on leur donnait sorte de puzzle reconstituant un ciel d’azur à peine traversé de nuages, elle envahit la cérémonie du Graal, funèbre, où les soldats sont devenus des épaves, où Amfortas à la blessure refermée parce que jamais plus ouverte, mais à la souffrance toujours vive et insupportable, ouvre violemment le cercueil de Titurel et le fait rouler sur le sol. Ce monde-là, mortifère, fait de contrition et de souffrance est étouffé par ces enfants style « United colors of Benetton » joyeusement destructeurs, qui reconstruisent autre chose, Amfortas guéri par la lance s’en va, au loin – ce monde-là n’est plus sien. Kundry qui veut « dienen » (servir) se met en souriant au service des enfants, encore une fois maternelle, et Parsifal devient le conteur qui va raconter à ces enfants assis autour de lui une belle histoire des temps anciens qui pourrait aussi être celle de l’avenir, libérée des règles qui étouffent la vie, et qui sont les règles établies des religions, qui sont ici vues comme freins à la vie, à la liberté et au bonheur. Parsifal est vu comme un homme nouveau, au parfum presque nietzschéen. Ce que la blessure lui a appris, c’est la vanité des Amfortas et des Klingsor, c’est la vanité des rites, c’est la vanité du religieux dans la mesure où le religieux étouffe et fossilise. Il devient presque ce joueur de flûte de Hameln, dont il était question plus haut, qui emmène derrière lui les enfants comme un « bon petit diable ».
Comme on le voit, Vick puise
dans les dernières traditions parsifaliennes, dans la vulgate des mises en
scène de l’œuvre où Wagner a réuni tellement d’éléments divers que tout semble
possible, et propose la vision symbolique d’un Festival scénique sacré où le
sacré – dans la mesure où il est lié au religieux – cède la place au profane,
qui semble être la seule voie possible au monde pour faire cesser la peur, la
violence, la haine. Le Graal est en nous en quelque sorte.
Ce travail irrégulier qui cède aussi aux peurs actuelles, aux idées préconçues
actuelles (pour les dénoncer) qui évoque aussi les différents travaux qui l’ont
précédé (et l’histoire de la mise en scène de l’œuvre est riche) est un
millefeuille de mille idées, avec ce qu’il faut de provocation et quelques
idées force qui ne sont pas forcément à écarter, mais qui ne font pas forcément
un travail de référence. Il reste que c’est une production honorable qui d’une
certaine manière fait le point sur les lectures de l’œuvre et surtout honore le
théâtre, son cadre et son architecture.
Au niveau musical, les choses sont aussi plutôt honorables voire plus solides.
Il faut prendre en compte la situation d’un orchestre certes valeureux, mais
qui n’a pas toujours l’habitude de ce type de répertoire, qui demande une
exposition instrumentale particulière notamment du côté des cuivres et des
bois. Cela veut dire préparation, travail approfondi, qui a deux conséquences
majeures, d’une part, une représentation vraiment digne, d’autre part un
« apprentissage » qui fait grandir l’orchestre. À ce titre, il faut
saluer le travail d’Omer Meir Wellber, qui par sa précision et sa clarté, par
son côté aussi un peu didascalique, permet sans doute à l’orchestre de mieux
prendre ses marques, d’être plus à l’aise avec un Wagner particulièrement
délicat. À cela il faut ajouter aussi qu’exceptionnellement, on a joué Parsifal
deux soirs de suite (les 30 et 31 janvier) sans changements de
distribution ; pour une œuvre de cette durée et de cette épaisseur ce
n’est pas indifférent. Et donc il faut saluer la performance des forces du
théâtre, orchestre et chœur , qui ont offert une prestation de bon niveau, qui ne
pâlit pas par rapport à d’autres maisons.
Omer Meir Wellber a été à bonne école wagnérienne auprès de Daniel Barenboim,
et il adopte la mode de son maître en faisant saluer tout l’orchestre à la fin
de la représentation, ce qui est quasiment unique en Italie, et qui est aussi
une bonne manière de valoriser les musiciens et de leur faire honneur. Il est
le directeur musical du Teatro Massimo en début de mandat, et ce type de signe
ne peut qu’être positif.
Son approche est particulièrement précise notamment au premier acte, claire,
scandant les différents moments, sur un tempo pas toujours lent d’ailleurs
(certains motifs sont pris sur un tempo plus vif qu’à l’accoutumé), l’ouverture
laisse se dérouler les différents motifs qui s’enchaînent, sans toujours la
fluidité attendue, mais d’une manière limpide. Les parties dramatiques (et
notamment le deuxième acte, plus théâtral et d’une certaine manière plus
traditionnel) sont bien accompagnées, il veille à ne jamais couvrir les voix.
Le troisième acte est peut-être le plus réussi et le mieux dominé, même si la
partie finale n’a pas la respiration « mystique » qu’on attend
généralement. Il est vrai que la fin profane de la mise en scène pourrait le
justifier. Il reste que cela manque un peu d ‘épaisseur sonore dans les
dernières mesures, et de recueillement. Mais nous sommes au théâtre et pas à la
messe, comme on le croit trop souvent. Dans l’ensemble Omer Meir Wellber s’en
tire très bien, et sans doute mieux que dans d’autres productions notamment de
répertoire italien où il m’est apparu souvent plus superficiel et bruyant. Ici
ce n’est pas le cas, c’est attentif et rigoureux et surtout il ne recherche pas
l’effet gratuit dans un juste respect de l’esprit de l’œuvre.
Le chef des chœurs Ciro Visco prend ses fonctions aussi cette saison, puisqu’il
a échangé son ancien poste à Santa Cecilia, avec l’ancien chef des chœurs Piero
Monti. La prestation des chœurs est plus qu’honorable, on peut simplement
regretter que la mise en scène les place souvent en arrière scène, ce qui nuit
aux effets spectaculaires des grandes scènes chorales.
En somme, les forces stables du Teatro Massimo ont été globalement à la hauteur
de l’événement.

Une attention particulière a été donnée à la distribution, évidemment essentielle pour une telle œuvre, qui alterne des chanteurs jeunes et des artistes beaucoup plus expérimentés dans ce répertoire. Mais on me permettra de marquer la découverte d’une voix qui m’est apparue d’emblée exceptionnelle, et c’est un « petit » rôle de ténor, l’un des quatre Knappe du premier acte, et il s’appelle Nathan Haller, c’est une voix qui immédiatement frappe. Il sera Bardolfo dans le Falstaff de Petrenko cet été à Munich, je pense qu’on en entendra parler très vite.
Dans l’ensemble d’ailleurs, les rôles de compléments sont bien tenus, ce qui est toujours un signe de qualité générale d’une distribution. Les Knappen et et les Gralsritter sont tout à fait honorables et la mise en scène, comme nous l’avons dit plus haut, cherche à individualiser les rôles qui ainsi se font remarquer plus que dans d’autres productions où ils apparaissent plus anonymes. Citons donc outre Nathan Haller, Elisabetta Zizzo Sofia Koberidze Ewandro Stenzowski et les Gralsritter Adrian Dwyer et Dmitry Grigoriev, mais aussi l’ensemble des filles-fleurs, particulièrement bien choisies, et chantant dans une belle respiration et un bel ensemble, très précis et rigoureux, elles méritent aussi d’être citées : Elisabetta Zizzo Sofia Koberidze, Alena Sautier, Talia Or, Maria Radoeva et Stephanie Marshall.
Alexei Tanovitski campe un Titurel à la voix profonde et donne au personnage une allure glaciale et distante.
Klingsor, rôle difficile et souvent approximativement distribué est Thomas Gazheli, baryton-basse qui chante dans la plupart des théâtres allemands : il y a deux types de Klingsor, les subtils et persifleurs (du genre Tómas Tómasson) et les brutaux. Gazheli appartient à cette deuxième catégorie, voix forte, bien posée, expressive, et personnage puissant.

Dans cette distribution, on note immédiatement les chanteurs habitués au répertoire allemand et familiers de la langue, c’est le cas de l’Amfortas de Tómas Tómasson, un chanteur qui soigne tout particulièrement son phrasé, l’expressivité, la précision du verbe, dans tous les rôles qu’il aborde. Son Amfortas est à ce titre une leçon de chant wagnérien expressif, prenant soin du sens et du poids de chaque mot. Ici le rôle christique et douloureux rend le personnage à la fois plein de relief et pitoyable (la fin à ce titre est très emblématique). Tómasson est sans nul doute le plus performant dans cette distribution, à l’égal de John Relyea, habitué des scènes, à la voix particulièrement puissante, chantante, au timbre velouté et chaleureux. Ce n’est pas un Gurnemanz qui sculpte chaque mot à l’instar des grands Gurnemanz germaniques, mais il incarne ce personnage de soldat de Dieu, alerte, assez jeune, de manière très crédible. Il remplit la scène et la salle d’une voix marquante sans jamais faiblir.
Kundry est Catherine Hunold, la wagnérienne française qui a été appelée par Palerme pour remplacer une Eva Maria Westbroek défaillante avant le début des répétitions, ce qui fait qu’elle a pu travailler et approfondir un rôle dont elle s’est bravement emparé (elle avait doublé Anja Kampe à Paris) et elle obtient un succès mérité pour un rôle dont elle se sort avec tous les honneurs, c’est une prise de rôle réussie. Elle est très attentive au texte, articulé avec soin, au phrasé et à l’expression, même si tout n’a pas encore la fluidité qu’elle ne va pas manquer de conquérir avec l’expérience.
Mais la voix est large, homogène sur tout le registre, avec des graves jamais détimbrés, très charnus et des aigus triomphants qui ont même fait sursauter mon voisin. Sans aucun doute une prestation qui non seulement mérite l’intérêt, mais qui est convaincante et riche de potentiel. Du point de vue du personnage, elle n’est pas une Kundry sauvage et aiguisée, elle propose un personnage plutôt humain, plus victime que tueuse, avec une attitude presque protectrice envers Parsifal plus mère que séductrice et dégageant une certaine émotion au troisième acte, par sa seule attitude scénique.
Parsifal est le jeune irlandais Julian Hubbard, qui a pris le rôle pendant les répétitions.

Parce que le Massimo a dû faire face à trois forfaits, la Westbroek et Nikitin qui devait être Amfortas, avant le début des répétitions, et Daniel Kirch, le Parsifal annoncé qui a dû abandonner la production. La direction artistique du théâtre s’en est tirée avec les honneurs, et avec beaucoup de chance car ce Parsifal venu d’Irlande qui arrive à peine sur le marché wagnérien est une voix à suivre. Certes, il lui manque encore une véritable maîtrise du texte qu’il a dû apprendre et approfondir pendant les répétitions, notamment au troisième acte, il lui manque aussi un peu de fluidité et l’aigu (Amfortas die Wunde !) n’a pas encore l’éclat ni la tenue voulus, mais la voix est belle, claire, juvénile, ardente le timbre velouté, le personnage bien campé et bien dessiné. C’est un vrai Parsifal, en devenir, mais déjà sur le chemin. Pour une prise de rôle, et quel rôle – et dans les conditions dans lesquelles il a dû le reprendre, c’est vraiment remarquable.
Comme on le voit, sans être la production ni la représentation de référence, c’est un ensemble valeureux, très honorable et en aucun cas un Parsifal au rabais. L’accueil chaleureux du public et l’émotion dégagée par la représentation montre que le théâtre a eu raison de remonter cette œuvre si emblématique de Palerme qui remet l’institution palermitaine dans les théâtres qui vont compter.
—
Richard Wagner (1813-1883)
Parsifal (1882)
Bühnenweihfestspiel in drei Akten
(Festival scénique sacré en trois actes)
Livret du compositeur
Direction
musicale Omer
Meir Wellber
Mise en scène Graham Vick
Décors Timothy O’Brien
Costumes Mauro Tinti
Mimes Ron Howell
Lumières Giuseppe De Iorio
Amfortas Tómas Tómasson
Titurel Alexei Tanovitski
Gurnemanz John Relyea
Parsifal Julian Hubbard
Klingsor Thomas Gazheli
Kundry Catherine Hunold
Erster Gralsritter Adrian Dwyer
Zweiter Gralsritter Dmitry Grigoriev
Vier Knappen Elisabetta Zizzo, Sofia
Koberidze, Ewandro Stenzowski, Nathan Haller
Klingsor Zaubermädchen Elisabetta Zizzo,
Sofia Koberidze, Alena Sautier, Talia Or, Maria Radoeva, Stephanie Marshall
Stimme aus der Höhe Stephanie Marshall
Orchestre, Chœur e Chœur d’enfants du Teatro Massimo



















