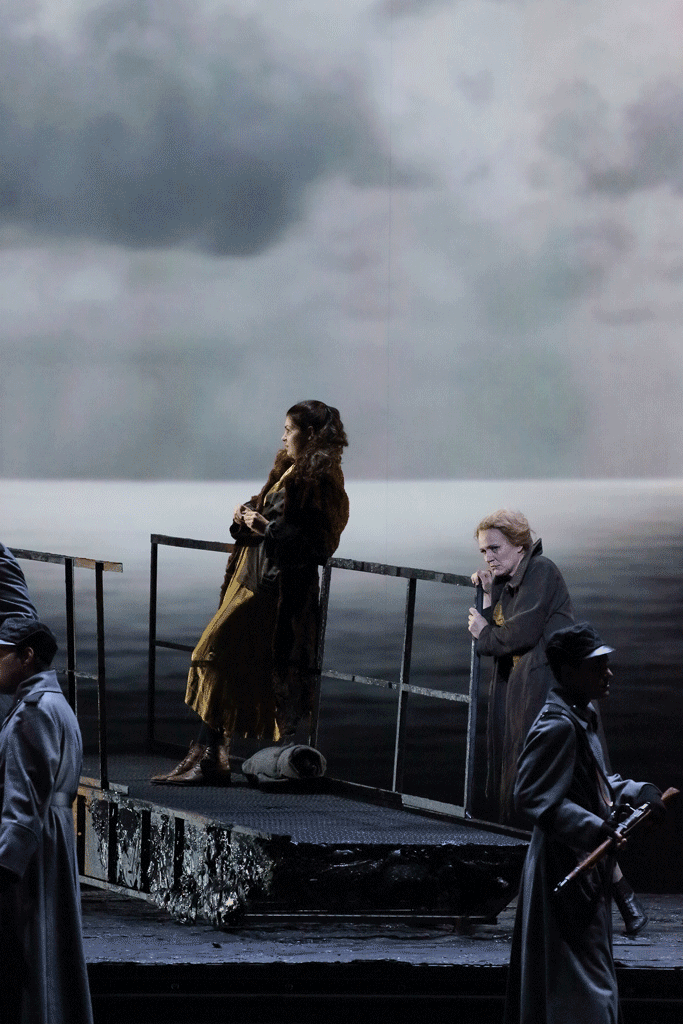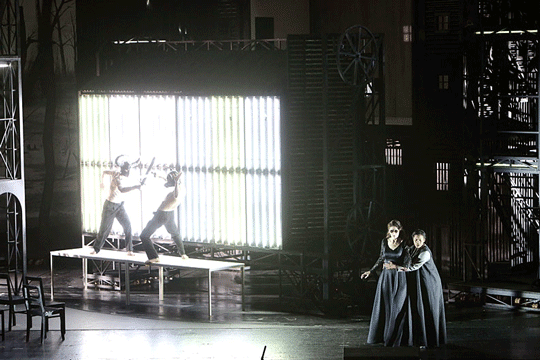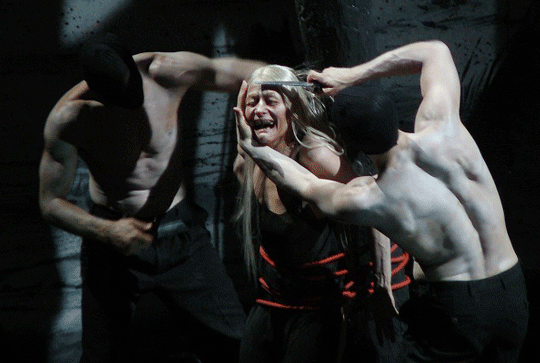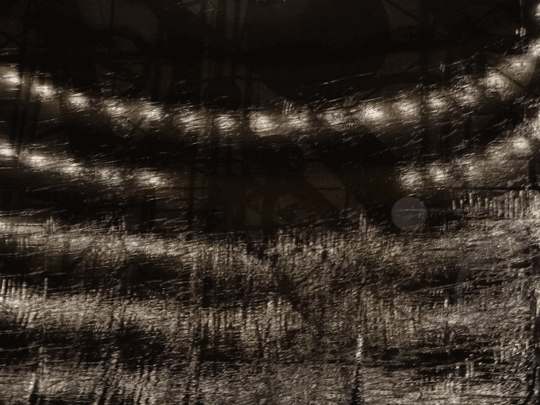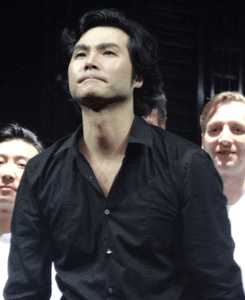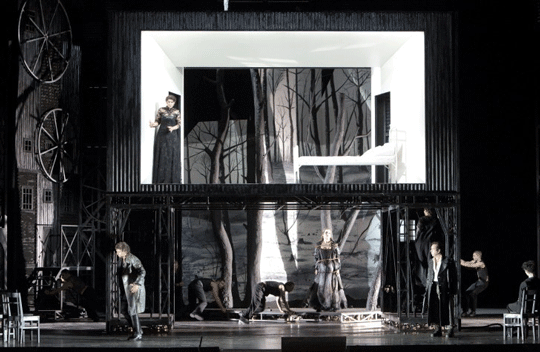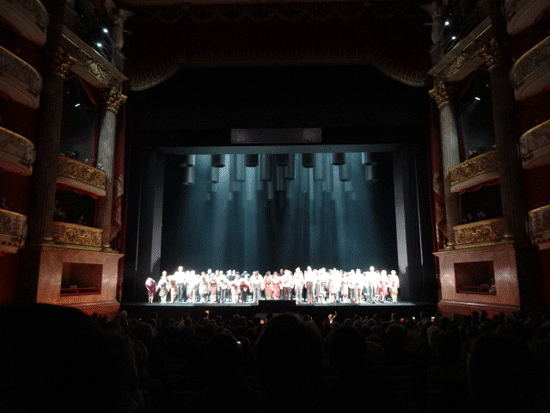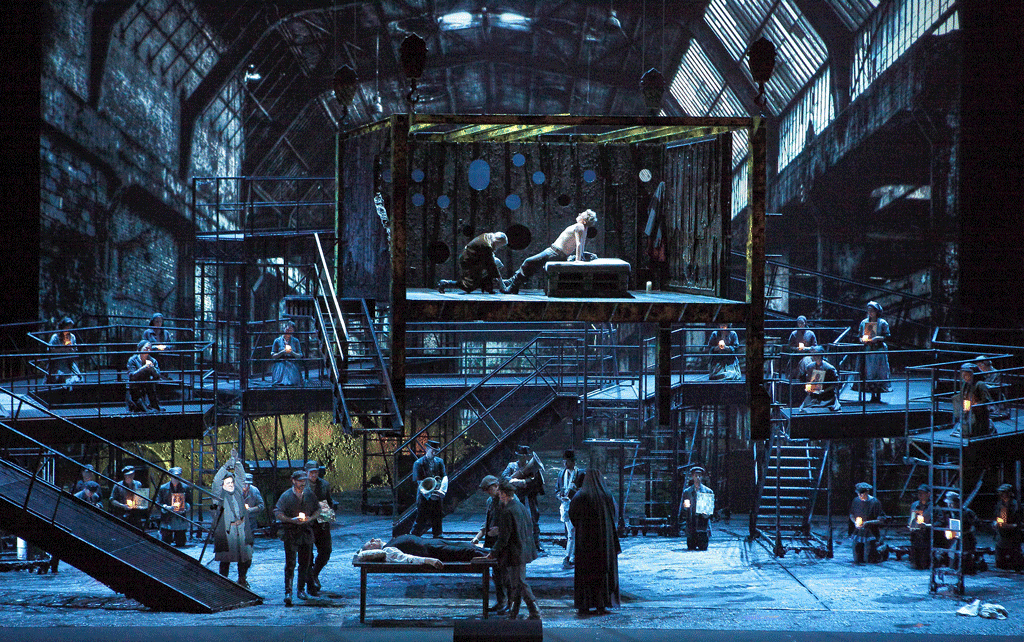
On n’ira pas par quatre chemins : la discussion autour de cette production ne porte ni sur une distribution remarquable, ni sur une direction musicale de Kirill Petrenko hors normes, mais sur la mise en scène de Harry Kupfer. Octogénaire, le metteur en scène allemand continue de produire, à Francfort (Ivan Soussanine), à Berlin (Fidelio), à Salzbourg (Der Rosenkavalier) et maintenant à Munich, alors qu’on va revoir l’hiver prochain à Milan Die Meistersinger von Nürnberg dans sa production de Zurich.
L’opéra de Chostakovitch, qui a mis tant de temps à vraiment s’imposer sur les scènes, est l’objet depuis plusieurs années de productions qui ont impressionné et fait couler bien de l’encre, par exemple celle de Martin Kusej à Amsterdam et Paris, celle de Dimitri Tcherniakov à Düsseldorf, Londres et Lyon (la saison dernière), marquées par le Regietheater.
La production d’Harry Kupfer se situe ailleurs et pose autrement la question de cette femme, par une vision aporétique et indulgent de ce destin, qui doit beaucoup à la tragédie grecque : Kupfer fit jadis une Elektra frappante avec Abbado à Vienne, et cette Lady Macbeth est une tragédie de la solitude et de l’isolement, dans un espace clos, même lorsqu’il respire un peu du ciel des marines du peintre Gerhard Richter : le héros tragique est coincé entre des murs. Quel que soit le contexte, Katerina se heurte au mur invisible du destin, inscrit dans cette solitude initiale du lever de rideau, dans un arsenal, fabrique de bateaux abandonnée, au milieu de la rouille, du cambouis et de la saleté. L’élément marin, visible dans la dernière scène, mais déduit dès les premières, est cet espace infini mais interdit, cette nature au lointain qui finira par être l’échappatoire définitive, qui apparaît progressivement. D’abord limité à ce vaste hangar de verre et de métal, une sorte de gigantesque pavillon de Baltard sans horizon où chacun vit comme il peut sa vie, à la fois clos et pourri, puis au deuxième acte légèrement ouvert (c’est le moment du mariage) où l’on se prend à croire en une possible fuite, enfin complètement ouvert dans la vision paradoxale d’un espace marin immense et libre, mais fait de prisonniers enchainés au premier plan : le possible de cet espace, la seule liberté, c’est la mort qu’on donne ou qu’on se donne.
Harry Kupfer raconte son histoire à travers l’évolution du décor de Hans Schavernoch avec le même langage qui racontait Vienne dans Rosenkavalier, ou la fin de la musique dans Fidelio. C’est à dire la présence écrasante d’un univers qu’on croit réaliste, mais totalement abstrait qui inscrit l’action dans le symbolique et la distanciation. Le décor, image de la vie de Katerina qui l’écœure et la détruit, écrase et créé une correspondance (au sens baudelairien du mot) avec le plateau, et même la fosse.
Sans percevoir l’articulation structurelle entre décor, jeu et musique, on ne peut comprendre la vraie nature de ce travail qui est un chef d’œuvre de l’artisanat du metteur en scène, ou rien n’est laissé au hasard, mouvement, objets, gestes.
Certains y ont vu de manière erronée un travail du passé, à l’esthétique et la gestuelle un peu dépassée : c’est au contraire une déclaration affirmée, une volonté affichée du vieux maître de refuser les facilités du théâtre d’aujourd’hui, ou sa doxa, l’explicite de la violence ou du sexe, ou l’explicitation du contexte pour affirmer un théâtre qui au milieu de ce bric à brac métallique et pourri, reste une épure, avec un minimum de gestes signifiants, dans un espace plus symbolique que réaliste : à ce titre et pour des motifs très différents, la Katerina de Tcherniakov et celle de Kupfer si différentes vivent dans un espace clos, dans une niche séparée du monde et en même temps sous les yeux de tous. C’était l’espace rouge passion chez Tcherniakov, au centre de l’entreprise très clean de Zinovy et Boris. C’est chez Kupfer un espace de bois que der Schäbige (le balourd miteux) en appuyant sur un bouton soulève et abaisse autant que de besoin, un espace minimaliste où le lit est un cageot et où Katerina vit dans une pourriture métaphorique de sa situation. Ce théâtre n’a rien de dépassé, c’est tout au contraire un théâtre sur lequel le temps n’a aucune prise, un théâtre de la concentration et de l’abstraction, presque une œuvre pour toujours, la Κτῆμα ἐς ἀεί chère à Thucydide : Kupfer inscrit cette histoire dans une parabole, celle du destin éternel des perdants, dans l’histoire continue des victimes. La Katerina de Kupfer est une victime qui inspire la compassion.
Dès le lever le rideau. Katerina, seule au milieu des ruines de cet arsenal abandonné, est l’image de l’enfermement définitif et de l’impossibilité. Tout est déjà dit. Et nul besoin de l’espace vide pour marquer l’abstraction, il suffit de ce lieu qui n’en est pas un, de cet arsenal sans bateaux, de cette cabane qui n’est pas une maison, de cette passerelle au-dessus de la scène de mariage qui ne mène qu’au vide, de ce réel irréel qui n’est qu’une forêt de symboles.
C’est à un théâtre distancié que nous avons affaire, où tous les mécanismes sont visibles, à commencer par cette manière dont le décor de la cabane de Katerina se soulève sous l’action de celui-même qui plus tard découvrira le cadavre de Zinovy, une sorte d’ instrument du destin. Dans cette tragédie de la solitude, chacun est à sa place dans la mécanique tragique.
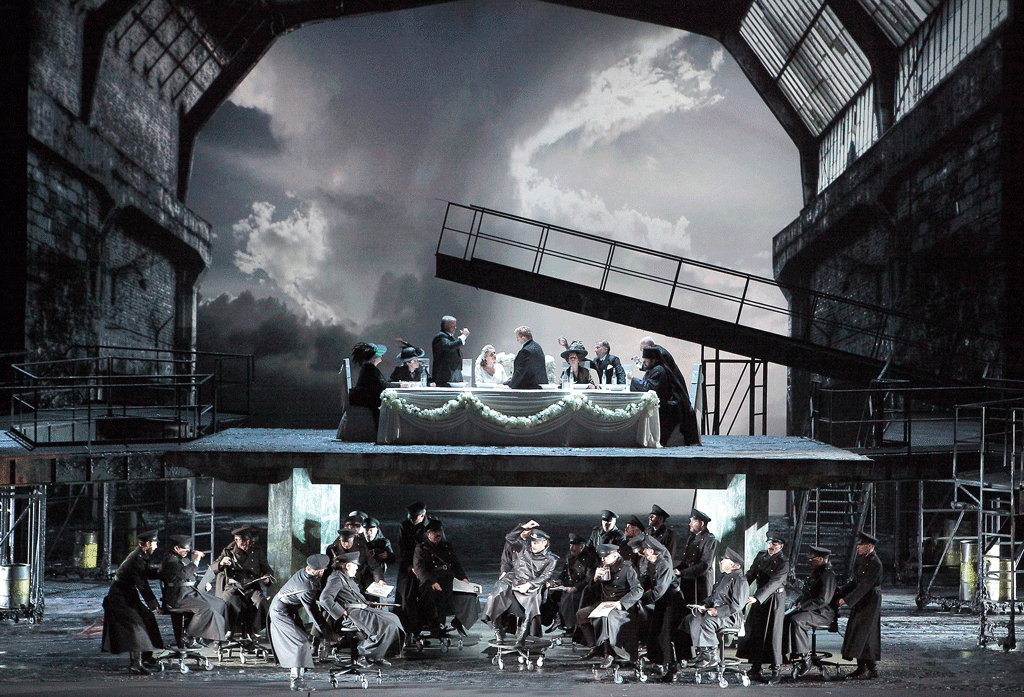 Autre magnifique vision, celle de cette noce qui fait tant penser à la Noce chez les petits bourgeois de Brecht, avec cet arrêt sur image qui laisse en dessous se développer la désopilante scène des policiers, assis sur des chaises de bureau à roulettes, dans une sorte de valse creuse née de l’oisiveté des petits employés, inoccupés, vision administrative d’apparatchiks plus que de policiers qui renvoie l’espace d’un instant au monde stalinien de Chostakovitch qui pourrait être aussi celui de la DDR de Kupfer. Vision à la fois sarcastique et inquiétante, qui elle aussi est une fabrique de mécanique tragique dont le lubrifiant est encore le balourd miteux, der Schäbige. Seul moment où le contexte politique s’introduit furtivement mais qui indique aussi clairement aussi que le grain de sable déclencheur du drame, s’appelle ici l’ennui. L’ennui des policiers comme l’ennui de Katerina, cause unique de la tragédie.
Autre magnifique vision, celle de cette noce qui fait tant penser à la Noce chez les petits bourgeois de Brecht, avec cet arrêt sur image qui laisse en dessous se développer la désopilante scène des policiers, assis sur des chaises de bureau à roulettes, dans une sorte de valse creuse née de l’oisiveté des petits employés, inoccupés, vision administrative d’apparatchiks plus que de policiers qui renvoie l’espace d’un instant au monde stalinien de Chostakovitch qui pourrait être aussi celui de la DDR de Kupfer. Vision à la fois sarcastique et inquiétante, qui elle aussi est une fabrique de mécanique tragique dont le lubrifiant est encore le balourd miteux, der Schäbige. Seul moment où le contexte politique s’introduit furtivement mais qui indique aussi clairement aussi que le grain de sable déclencheur du drame, s’appelle ici l’ennui. L’ennui des policiers comme l’ennui de Katerina, cause unique de la tragédie.
Les gestes, les mouvements, les actions même sont réduites et rapides, sans insister sur la violence, sans scorie, dans une sorte de rigueur qui ne laisse passer que le strict nécessaire, laissant à la musique le soin de l’éclairage et des explications : il suffit de lire le texte d’Harry Kupfer dans le programme de salle pour comprendre son extrême attention à la musique, à ses contrastes, à sa diversité, et à sa manière de représenter le monde multiple et contradictoire qui entoure Katerina.
Le dernier acte est mis en scène à l’opposé du travail de Tcherniakov, qui dissimulait à la vue tout le contexte pour se concentrer sur l’étroit espace d’une cellule où tous les personnages finissaient par se détruire, dont le chœur (invisible) commentait l’action.
La vision de Kupfer est ici plus explicite, avec le cortège des prisonniers dont le chœur fait tant penser à celui de vieux croyants de Khovantchina, eux aussi promis à la mort, avec le côté de Katerina (cour) et celui de Sonjetka (jardin) si cruelle et si juste de Anna Lapkovskaja, dans une géométrie où elles finiront par se rejoindre au centre, sur ce ponton qui est presque un échafaud où toutes deux disparaîtront, pendant que Serguei va se fondre dans la foule, comme envolé dans son inexistence, laissant les femmes à leurs drames et à leur fin. On reste dans une sorte d’abstraction désespérée, de tableau de genre qui porte en lui-même sa fin, avec cette étendue marine au calme prémonitoire, ciel entaché de nuages (une marine de Gerhard Richter), comme si Katerina engloutie par les eaux rendait au jour qu’elle souillait toute sa pureté. Qu’est-ce que cette mort, sinon un épisode parmi d’autres du long voyage vers l’enfer sibérien. Un non-événement dont sont victimes celles qui ont voulu simplement essayer d’exister sans qu’on le leur permette et qui disparaissent dans l’eau sans laisser de traces. Kupfer nous raconte une histoire inutile qui n’a même pas accès à un mythe quelconque, l’histoire d’une non-existence. La longue histoire d’une chute annoncée, dès le début, une parabole ouverte dans l’espace clos d’un arsenal et close dans l’espace ouvert d’un rivage infini qui se referme.
Ce qui frappe dans ce travail, c’est sa linéarité, son refus de l’effet, son implacable mécanique qui conduit à l’instant fatal, où Katerina a voulu reconquérir son destin, a voulu le disputer à une fatalité inscrite dans le décor et dans chaque moment de l’action, en allant jusqu’au bout de sa logique, de son amour et de sa vie.
Voilà une production où une fois de plus la relation entre le chef et le metteur en scène est aveuglante, chacun se chargeant d’une partie de la tâche : rien de plus erroné que de croire que nous sommes face à un travail qui tiendrait seulement par le chef. Petrenko regarde toujours ce qui se passe sur scène pour proposer une ligne de direction musicale et son travail est ici un long lamento dramatique de l’impossible issue. Il fait ressortir de la musique non seulement les moindres détails, l’auditeur familier de son style en a l’habitude, mais d’abord tout le lyrisme et toute la tendresse : il montre dans cette musique tout ce que la tendresse mahlérienne a pu enseigner à Chostakovitch. Cette direction est en effet une sorte d’hommage à cette musique très référencée, qui puise dans les sources diverses, à commencer par Moussorgski, mais aussi l’univers viennois le plus léger, et bien sûr Mahler, à la fois immensément tendre et terriblement sarcastique voire grotesque, le Mahler d’une Neuvième qui serait projetée sur scène, mais aussi quelquefois un univers à la Wozzeck, un univers de la lente désespérance d’une marche au supplice.
Cette retenue, cette volonté d’inscrire en sourdine tout ce qui est soif de tendresse, à l’opposé de l’expressionisme cru, voire exacerbé qu’on retient la plupart du temps de l’œuvre en fait presque une vision romantique, au sens propre du terme, comme l’ont défini les théoriciens du romantisme au XIXème , par ses contrastes violents et son infini raffinement. C’est un immense travail sur la complexité, sur le refus d’un sens univoque, sur le multiple visage de la vie et sur les replis de l’âme humaine.
Deux exemples :
- la disposition théâtrale des cuivres – tuba wagnérien et autres – dans les loges d’avant-scène, à la fois instruments et spectateurs, à la fois musiciens et personnages, qui répondent en écho au bal muet d’un orchestre de mimes, surgissant en arrière scène comme signe de chaque manifestation sexuelle ou de chaque moment de violence, signe de paroxysme musical pour paroxysme de sentiment, de désir, de volonté destructrice.
- Les funérailles de Boris, magnifiquement réglées en marche funèbre clairement inspirée de la marche funèbre de Siegfried, scéniquement et musicalement, dans un rapport évidemment inversé, Boris n’ayant rien du héros wagnérien, et donc la vision d’une marche funèbre d’un anti-héros qui aimait trop les champignons, sarcastique mais non dépourvue aussi d’une certaine grandeur.
Ainsi la musique devient-elle-même mise en scène : extraordinaire Bayerische Staatsorchester qui rutile et murmure, qui s’alanguit et s’énerve, qui se dresse et s’étouffe car Kirill Petrenko et Harry Kupfer parlent ici exactement le même langage : Kupfer travaille une chorégraphie des gestes et mouvements là où Petrenko accompagne par une chorégraphie des sons. On est dans un rapport à la scène voisin de celui des Soldaten de Kriegenburg, autre histoire de déchéance, où il y a une union très étroite sans jamais aucune redondance, un unisson visuel et sonore qui exclut toute complémentarité, comme si à ce qu’on voyait correspondait l’évidence de ce qu’on entendait, comme si ce qu’on entendait trouvait immédiatement sa vision scénique (et non sa traduction). On n’est pas loin non plus de la manière dont Lulu vu l’an dernier sur cette scène était mis en musique et en même temps aussi mis en théâtre. L’évidence scénique en écho ou en osmose avec une évidence musicale.
À chaque fois, Kirill Petrenko nous stupéfie, son génie du détail, son art d’être partout en même temps, par la multiplicité et la précision des gestes, par la profondeur des niveaux de lecture, construction en abyme où l’on découvre à chaque fois une autre phrase, un autre moment, d’autres phrases que jamais aucun enregistrement, aucun chef ne nous avaient révélées, une sorte de tunnel infini de sons et de phrases, une succession de moments découverts qui accentuent encore le foisonnement et la complexité de l’œuvre. Là où Kupfer étudie chaque geste avec une précision chirurgicale, Petrenko répond par un travail qui semble infini sur chaque note : l’un est métaphore de l’autre. Un travail étourdissant.
Munis de ces viatiques à vrai dire monumentaux, les chanteurs constituent une compagnie d’une rare cohérence, d’un vrai caractère, impossible à comparer ou presque à d’autres optionsCe qui caractérise la troupe, les membres du studio et les plateaux des grandes représentations de la Bayerische Staatsoper, c’est d’abord une homogénéité due non pas au niveau individuel des chanteurs, mais à un engagement partagé, chacun avec ses moyens et chacun à sa place : ce qu’on appelle souvent un esprit de troupe qui court tout le plateau et la fosse.
Le chœur, magnifiquement préparé dirigé par Sören Eckhoff, d’une présence très forte est particulièrement touchant au dernier acte qui le met sans doute le plus en relief. Et les solistes sont tous très engagés. Bien sûr la contribution de la troupe est particulièrement notable et il faut citer tous les petits rôles : c’est souvent eux qui donnent à la représentation son niveau d’excellence : Christian Rieger, Sean Michael Plumb, Milan Siljanov, Kristof Klorek, Dean Power, Peter Lobert, Igor Tsarkov, Selene Zanetti sont tous à leur place et contribuent à l’impression d’ensemble ; il n’y a aucun point faible, dans un opéra où tant de personnages évoluent et interviennent. Nous avons signalé plus haut la Sonjetka de Anna Lapkovskaia, rôle réduit, mais interprétation incisive, très expressive, avec une voix très bien posée et projetée et des graves vraiment somptueux. Alexander Tsymbalyuk, à la fois truculent policier en chef, avec sa belle voix de basse jeune et colorée, mais aussi Alter Zwangsarbeiter à qui échoient la dernière réplique de l’opéra, intériorisée, et qui clôt l’œuvre isolé sur le plateau. Tsymbalyuk qui chante aussi à Munich bien d’autres rôles dont Boris Godunov, montre ici une belle personnalité scénique et vocale. Même composition marquante pour le Pope de Goran Jurić, plein de relief, qui obtient un vrai succès personnel. C’est le type même de rôle non essentiel, mais dont la faiblesse gâcherait la fête, alors que la figure un peu grotesque du pope alcoolique (un topos dans le monde orthodoxe) participe de cette ambiance très diverse et très pittoresque du plateau, si nécessaire à l’histoire, qui se déroule sous les yeux du groupe. Très réussie l’Axinja d’Heike Grötzinger, première victime d’un Serguei entrant en scène en s‘attaquant à la plus faible et qui va passer de l’employée à la maîtresse. Enfin, der Schäbige le balourd miteux de Kevin Conners est comme le pope, une figure presque abstraite dans cette mise en scène, présent depuis le début et actionnant le mécanisme qui fait monter et descendre l’espace de Katerina : autre figure d’ivrogne, il est l’instrument du destin qui va décider des événements : découvrant le cadavre de Zinovy en cherchant quelque bouteille à la cave, puis allant dénoncer la chose à la police : il est l’élément déclencheur, ce petit clin d’œil du destin, le fameux grain de sable qui casse la mécanique huilée qui devait inscrire un tout autre avenir au couple Katarina/Serguei. Kevin Conners est vraiment ce ténor de caractère lui aussi très présent et très juste. Toute la troupe ou presque est donc mobilisée au service de cette œuvre pour entourer les quatre protagonistes du drame.

Serguei Skorokhodov, membre de la troupe du Marinski, est Zinovy : rôle ingrat, court et qui doit pourtant être suffisamment présent pour aider à comprendre l’héroïne : c’est le patron sur qui pèse le destin des travailleurs, c’est le mari probablement impuissant, c’est un moteur d’ennui : son départ va déclencher le drame.
On dit qu’un prompt départ vous éloigne de nous, Seigneur. Loin de moi l’idée de rapprocher les rôles de Katerina et de Phèdre, mais plutôt d’évoquer une dramaturgie qui rapproche les deux œuvres, un exemple de mécanique tragique : le départ initial est un ressort tragique parce qu’il libère les paroles et les actes des personnages et de ce point de vue le schéma absence – libération des personnages restant – retour du maître est un schéma dramaturgique typique de tragédie. Ce départ est mis en scène de manière impitoyable et par Chostakovitch et par Kupfer : il s’agit à la fois d’affirmer la soumission de la femme au mari, le soupçon inhérent à la femme restée seule, le risque de bafouer les valeurs sanctionnées par la religion (présente par le pope, qui même alcoolique, n’en est pas moins pope) le tout orchestré par le père, Boris, dont la seule fonction est semble-t-il de surveiller une bru qu’il déteste (sauf, c’est dommage pour lui, quand elle lui cuisine des champignons), avec le décalage que constitue la soumission à Zinovy, un être inodore et sans saveur, que personnifie assez bien y compris dans la voix, Sergey Skorokhodov.
On ne peut éviter de penser non plus aux Atrides et à Agamemnon, à peine revenu de la guerre, à peine assassiné : Zinovy, Serguei et Katerina recomposent en version russe le trio infernal des Atrides : Agamemnon, Electre, Egisthe. Difficile d’échapper à cet autre schéma en version médiocrité : Zinovy n’est pas un héros, Katerina une victime, et Sergueï une bête à sexe arriviste.
Ainsi, le schéma dramaturgique de l’opéra aide à comprendre l’idée première qui m’a frappé d’une Lady Macbeth vue par Harry Kupfer en version tragédie grecque, qui fouille dans les conséquences de l’isolement et de l’ennui ; et qui pose, comme dans Phèdre, la question de l’innocence et de la culpabilité.

Second élément perturbateur de l’histoire et premier dans l’ordre des meurtres, le père, Boris, magistralement interprété par le vétéran Anatoli Kotscherga. Claudiquant et marchant en rythme avec le texte et la musique, avec une voix un peu opaque qui a perdu sans doute quelque chose de sa profondeur ou de sa projection mais tellement expressive : il mastique le texte d’une manière très théâtrale, avec des accents qui donnent à son débit à la fois quelque chose de terriblement froid et en même temps une imperceptible sensation d’impuissance : hors-jeu, réduit à surveiller la nuit la maison et sans doute sa bru, il n’a plus la main, sinon chercher la faille qui lui permettra de montrer à son fils ce que « vaut » sa femme. C’est une composition d’une très grande tenue, d’une très grande intelligence, qui sait jouer de ses problèmes vocaux : comme tous les très grands, Kotscherga sait adapter couleur et interprétation à son état vocal et sait faire plier les exigences du rôle à sa voix : il joue avec ses faiblesses et elles sont d’une force incroyable. Il n’apparaît qu’au premier et second acte mais il a une telle présence qu’on se souviendra longtemps de sa manière de descendre l’escalier étroit qui conduit au plateau, ou d’errer de manière fantomatique autour de la « cabane » de Katerina.
La mise en scène du rôle de Sergueï n’en fait pas la bête sûre d’elle et dominatrice qu’on a pu voir dans d’autres mises en scène (Tcherniakov par exemple) : le personnage a même quelque chose d’ordinaire, quelque peu négligé, mais sans la vulgarité qu’on lui prête quelquefois. Il est presque plus à l’aise dans la seconde partie, dans le rôle du marié déjà patron et propriétaire, manière pour Kupfer d’en faire un arriviste qui sait mimer les habitudes des patrons qu’il a dû tant observer. La voix au timbre clair, bien projetée, s’affirme sans effort mais sans s’imposer. Comme s’il n’était pas exactement ce que Katerina projette en lui. Comme si elle l’habillait d’une nature qu’il n’avait pas vraiment. La composition est intéressante car il ne surjoue jamais et ne paraît pas si antipathique, ce qui donne d’ailleurs à son quatrième acte une cruauté sans nom, dans sa manière de traiter et de rouler Katerina.
Anja Kampe enfin, dans une incroyable création. Pour sa première approche du rôle redoutable, elle ne respire pas la sensualité et elle ne joue pas de son corps comme une Ausrine Stundyte. Elle ne joue pas non plus de sa puissance vocale à la manière d’une Eva Maria Westbroek. Elle est au contraire entièrement concentrée dans sa manière de dire le texte et dans l’expression, avec un soin donné à la couleur, des audaces incroyables dans sa manière d’attaquer certaines notes, avec distance quelquefois et à d’autres une bestialité rare. C’est une vraie performance qui fait voir une incroyable puissance d’interprétation, entre Kundry, Lulu et Electre, monstrueuse et pitoyable. La puissance de certaines notes est inouïe, mais presque décuplée par la manière de dire, par les accents, par le lyrisme : la puissance n’est jamais gratuite, elle est toujours au service exclusif de l’expressivité, changeant de registre par un jeu de modulations et des passages négociés de manière stupéfiante : c’est une prodigieuse incarnation, parce qu’elle utilise toute sa voix – qui est sans doute moins volumineuse que celle d’autres interprètes du rôle, au service du personnage et de son évolution psychologique. Avec sa mémorable Sieglinde de Bayreuth, sa Katerina est sans doute le rôle où elle montre la variété de tons et de styles la plus manifeste. Dans le contexte, avec un Petrenko en fosse toujours attentif à ne jamais couvrir, et à accompagner le chanteur comme un pianiste en récital, toujours pointilleux sur le texte à dire et une mise en scène elle aussi tirée au cordeau, millimétrée dans le geste et réglant chaque mouvement de manière artisanale: Kampe est simplement écrasante.
La série de représentations a été un triomphe total de public, on en sort violemment bousculé. Il y a une session de rattrapage brève (une représentation) en juillet 2017. Vous feriez bien de ne pas la rater.[wpsr_facebook]
PS: Vous pouvez aussi lire la critique de David Verdier dans Wanderer