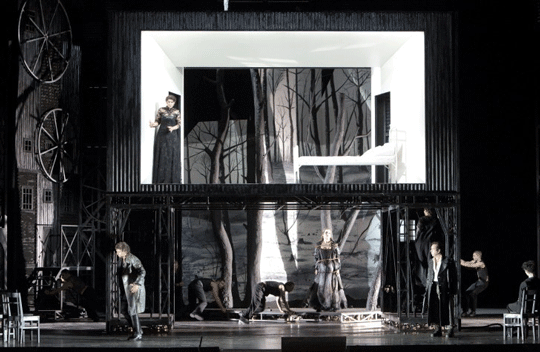Hiver italianissime à Munich avec deux des sopranos germaniques les plus en vue, Diana Damrau pour Lucia et une reprise de Trovatore avec Anja Harteros.
C’était ce soir Trovatore, une production d’Olivier Py encore récente créée par le couple Kaufmann/Harteros l’été 2013.
Après le magnifique Trovatore salzbourgeois, il était intéressant d’entendre l’autre soprano, Anja Harteros, après qu’ Anna Netrebko nous eut bluffés à Salzbourg, il est vrai avec un chef…
Il s’agissait hier d’une représentation dite de répertoire, c’est à dire n’ayant pas fait l’objet de répétitions retravaillées. Et la distribution était différente de la première de 2013, puisque et Luna (Vitaliy Bilyy et non Alexey Markov) et Manrico (Yonghoon Lee et non Jonas Kaufmann) et Azucena (Anna Smirnova et non Elena Manistina) et Ferrando (Goran Jurič et non Kwanchul Youn) avaient été changés.
De la Première, il restait le chef Paolo Carignani et Anja Harteros (Leonora), ainsi que l’Inès fort remarquée de Golda Schultz.
J’ai longuement écrit sur la difficulté de Trovatore, moment où Verdi laisse son « premier » style, dit du « jeune » Verdi, encore tributaire de formes et couleurs belcantistes, avec de redoutables épreuves pour les sopranos (Abigaïl, Elvira, Odabella) mais n’a pas encore trouvé les couleurs de la maturité d’à partir de 1859 (Un ballo in maschera). C’est pourtant pendant cette période « entre deux » qu’il compose les trois opéras les plus populaires de sa production, Rigoletto (1851), Il Trovatore (1853), La Traviata (1853),
Signalons pour mémoire (je le signale à chaque fois…) qu’il existe de Trovatore une version française spécifique de type Grand Opéra de 1857, avec quelques modifications par rapport à l’original (cadences, final complètement modifié) et un ballet. On eût aimé que Stéphane Lissner s’en souvienne au lieu de présenter la saison prochaine un Trovatore en italien. Je n’ai pour ma part entendu cette version qu’une seule fois, à Parme. On oublie toujours de penser que l’Opéra de Paris a une histoire, et une identité, comme ailleurs : sans doute est-ce l’effet aéroport international de la salle de Bastille.. Mais les questions économiques et la vie des grands chanteurs font qu’ils-n’ont-pas-le-temps-n’est-ce-pas d’apprendre la version française. On nous a asséné des années durant cette fadaise à propos du Don Carlos en version originale, qui est bien plus intéressant que la version italienne, et bien plus beau. Résultat : depuis quelques années, Vienne, Barcelone, Bâle, ont présenté plusieurs fois le Don Carlos en français, mais toujours pas Paris où il a été fait en septembre 1986, effet du passage de l’italien Massimo Bogianckino, méprisé par le petit monde parisien, qui fut le seul à avoir une politique s’appuyant sur l’histoire de cette maison.
Nemo profeta in patria.
Qu’en était-il donc de ce Trovatore, dont on a un peu parlé en France à cause d’Olivier Py, qui travaillait pour la première fois à Munich. Bien des journalistes français se sont alors souvenus que Munich existait…
La mise en scène d’Olivier Py, soulignons le d’emblée, est nettement plus travaillée que son Aïda médiocrissime présentée à Paris l’automne de la même année. Il y a un propos, il y a une intention, il y a une mise en scène.
Certes, on y retrouve puissance 10 les péchés mignons de notre metteur en scène national : décors monumentaux tout noirs bougeant sans cesse sur des chariots, néons, tournette, ça bouge, ça tourne, ça circule à en perdre l’orientation et même le sens, notamment dans la première partie (Actes I et II), très picaresque, très axée sur le monde du théâtre, de la foire (gitans) et le monde des machines outils du XIXème, engrenages qui tournent, locomotive enfumée, tout est là pour nous rappeler que le Moyen âge du Trovatore est un Moyen âge revu à la sauce bourgeoisie industrieuse du XIXème. Le premier axe est donc ce que j’appellerais la « machinerie » et presque le « machinisme », vu l’aspect macchinoso de cet appareil scénique, comme diraient les italiens.
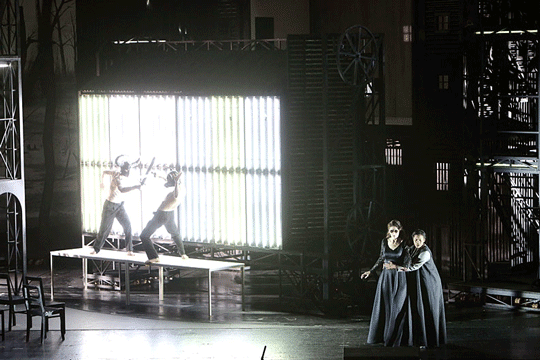
Certains éléments sont intéressants notamment dans la manière dont il traite les personnages secondaires, Ferrando et Inès. Pour une fois, on voit Inès, elle n’est pas une ombre effacée, et Ferrando jusqu’à la fin joue un rôle dans le drame, au départ récitant, à la fin acteur, puisque c’est lui qui assassine Manrico. Pour le reste, cela reste dans la convention à laquelle on est habitué.

Le second axe est le théâtre, je veux dire le théâtre dans le théâtre : cela commence dans un décor qui rappelle un théâtre élisabéthain qui pourrait être le Globe et Ferrando commence à raconter son histoire sur scène devant les spectateurs qui commentent comme à Guignol. Vu l’histoire c’est presque de Grand Guignol qu’il s’agit. Et vont défiler devant nous des niches-décor dans lesquelles les personnages sont lovés, une salle d’hôpital toute blanche et un lit de fer sur lequel Manrico est étendu, une petite boite dans laquelle à la fin Manrico et Azucena sont enfermés, et toute une série de scènes dans la scène où se déroulent certains moments de l’action. Un théâtre qui serait presque un théâtre de foire, de bateleurs au moment du chœur des gitans, où s’affiche Azucena en chapeau haut de forme, sorte de madame Loyal de l’histoire qui défile.
C’est bien une construction en abime qui voit d’abord Ferrando, puis la bohémienne entamer des récits qui s’enchâssent.
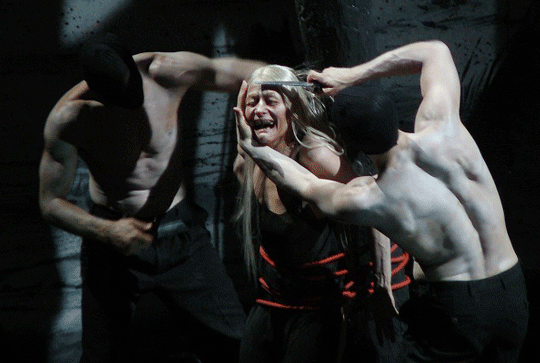
Et justement, le récit de la Bohémienne est en fait, souligne Py, une sorte d’image obsessionnelle de sa mère au bûcher, de sa mère torturée qu’on va voir tout au long de l’opéra, et et toujours évoqués des bébés abandonnés, brûlés (on voit de nombreux bébés ensanglantés, et même à un moment des sortes de marionnettes géantes, putti monstrueux dans une des boites dont il était question plus haut). C’est là le troisième axe, celui des obsessions, des montées d’images qui donne au drame sa ligne et sa couleur.
Un monde en désordre, vaguement orgiastique (la locomotive sert d’objet érotique à une dame qui danse et exhibe ses formes plantureuses, qu’on verra ensuite accoucher d’un bébé évidemment sanguinolent) où circulent çà et là, devant, derrière des personnages peu identifiables et qui donne cet aspect picaresque et un peu too much que j’évoquais plus haut.
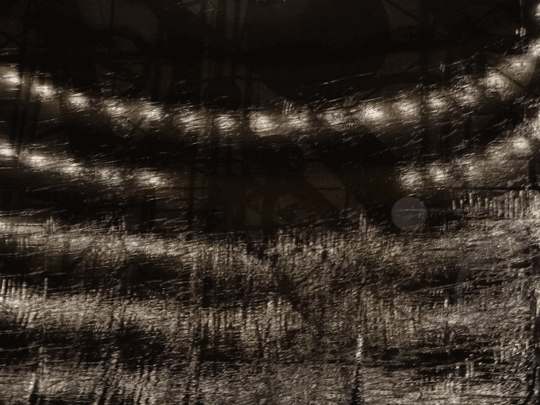
Et puis, après un entracte où la mère (aux mille douleurs), cette figure qui traverse tout l’opéra, frappe sur le rideau de plastique translucide où se reflètent les lumières de la salle et les transforme par le jeu des reflets en une sorte de feu d’artifice (fort bien fait d’ailleurs) pendant que le public sort, sorte d’image de l’explosion tragique et désespérée, mais aussi de dilution du théâtre, on passe à des actes III et IV complètement différents par l’ambiance, plus concentrée sur les drames humains, sur les personnages isolés, dans un univers sombre, noir, plus marqué par le religieux :

la pira est figurée par une croix qui brûle, Luna finit par briser la croix, les décors bougent à peine, le plateau est nu : naissance de l’espace tragique. Plus de médiation par les images et par le décor construit et déconstruit. C’est clair, la musique des deux derniers actes est plus soutenue, plus continue, plus dramatique et plus spectaculaire, et ici, la mise en scène laisse la musique s’épanouir.
Ce n’est pas ma vision de Trovatore que je trouve haletant dès le départ, enchaînant avec bonheur les moments de tension, les airs, les ensembles. En ce sens la mise en scène d’Hermanis à Salzbourg, qui n’allait pas bien loin non plus, respectait cette cohérence qu’ici, aussi bien à l’orchestre que sur le plateau, on semble ne pas prendre en compte.
Car Paolo Carignani réussit dans la première partie à laisser froid, dans une œuvre où rien n’est froid. Sans êtres alanguis, les rythmes sont assez mous, les tempis n’ont pas la variété à laquelle on s’attend. Paolo Carignani n’est pas un mauvais chef, tout est « en place » comme on dit et surtout il aide les chanteurs notamment lorsqu’ils sont en réelle difficulté (Goran Jurič dans Ferrando par exemple), il ralentit les tempis, il abaisse le volume, il suit le plateau.
C’est un peu plus senti dans la seconde partie, sans doute aussi à cause des chanteurs et notamment d’Anja Harteros, inspirée.
Je regrette quand même que la partition ne nous dise rien sous cette baguette : un seul exemple, les accords initiaux du dernier acte, mous, sans aucun accent, répétitifs. Bien entendu aussi, pas de Da capo pour la pira, parce qu’il faut laisser au ténor le temps de respirer pour tenir le contre ut (qui a d’ailleurs commencé en contre ré) aussi longtemps que possible (et là la note fut particulièrement tenue au grand délice du public qui adore les notes non écrites pour ténor en vitrine). En somme, une direction musicale qui est plus un accompagnement qu’une direction. Mais il est vrai que les chefs pour Verdi, c’est à dire qui révèlent quelque chose de la partition, qui lui donnent couleur et cohérence, sont assez rares sur le marché.
À cette direction musicale sans véritable intérêt sinon technique, correspond un plateau assez contradictoire.
Que les quatre chanteurs ne soient pas les quatre meilleurs du monde comme le voulait l’autre (on ne sait plus qui, il y au moins quatre noms qui revendiquent la paternité de la déclaration), c’était évident rien qu’à lire la distribution. Il reste que globalement le plateau était de bon niveau, et évidemment dominé par Anja Harteros.
Du côté masculin, plusieurs points à relever :
Le Ferrando de Goran Jurič (qui appartient à la troupe) est un exemple clair des difficultés du chant verdien. Ferrando est un de ces rôles auxquels on ne prête pas toujours attention sauf quand l’artiste décroche. Quand c’est Kwanchul Youn, tout le monde est content et on passe rapidement. Goran Jurič a un beau timbre de basse, il sait ouvrir le son, il a les aigus, mais malheureusement, dès que le rythme s’accélère , dès que les paroles sont à prononcer rapidement et que la voix doit descendre, ça part en capilotade. Plusieurs fois, les mêmes causes produisant les mêmes effets, la voix s’étiole, le son ne sort plus. Problèmes de diction, de prononciation, d’émission. Même quand le chef ralentit à dessein le tempo, il n’y a plus de souplesse ni de ductilité.

Vitaliy Bilyy (Luna) est un baryton ukrainien de très bonne facture, un timbre somptueux, riche en harmoniques, des aigus larges, une belle présence. Mais dès qu’il faut alléger, dès qu’il faut moduler, dès que l’air demande de la subtilité et une vraie couleur, il reste le son, mais il n’y plus ni sens ni interprétation. Le test ? Il balen del suo sorriso, qui doit être éthéré, allégé (c’est le seul air d’amour de la partition, un vrai chant d’amour qui devrait contribuer à rendre le personnage un peu sympathique), et surtout interprété de manière polychrome. Ici il y a la voix, un peu forte pour mon goût, mais jamais la couleur, mais jamais un vrai style. Il reste que l’artiste a mérité les applaudissements, même si ce n’est pas à proprement parler du chant verdien, sauf peut-être à la fin.
Le cas de Yonghoon Lee est différent. Vocalement, il n’y a rien à dire (même si au début, il attaque avec de sérieux problèmes de justesse), ce chant est très contrôlé, l’aigu est large (j’ai parlé de son ut-ré interminable à la fin de la Pira), il sait alléger, il émet de jolies notes filées. C’est parfait, comme souvent chez les chanteurs coréens qui sont parmi les asiatiques ceux qui sont le mieux adaptés au chant italien.
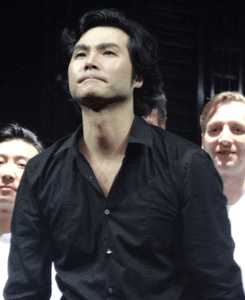
Le seul problème, qui est de taille, c’est que malgré toutes les qualités techniques de cette voix et malgré un timbre séduisant, son chant est totalement inexpressif, monotone, sans aspérités, sans accents. Il n’évoque rien, ne fait jamais rêver, cela ne décolle jamais : un bloc lisse qui ne semble pas comprendre ce qu’il chante. Son Ah si ben mio bien exécuté sans jamais faire craquer un bouton de guêtre, laisse complètement froid. Un chant autoroutier, en place et sûr. Avec l’érotique d’une autoroute.
C’est plus convaincant du côté féminin :

Anna Smirnova est une Azucena en voix, une voix large, chaude, solide, présente, en volume elle dépasse tous ses collègues. C’est une belle prestation, c’est une voix solide, c’est sans conteste un mezzo de poids.
Mais là aussi, elle a tout ce que n’a pas Lemieux entendue à Salzbourg, mais elle n’a pas ce que Lemieux possède : sens de l’à-propos, distance, belle possession du texte, subtilité. Smirnova, c’est un ouragan, dont le volume plaque contre le mur. Mais après ?
Bien sûr, je ne voudrais pas qu’on m’accuse de faire la fine bouche, mais tout de même : le texte a de l’importance, la couleur a de l’importance surtout chez Verdi, c’est ça qui fait chavirer le public, qui a mis du temps à chavirer après Stride la vampa. On est dans une expression scénique forte, mais sans qu’on ressente derrière l’âme, la sensibilité, dans un rôle qui en demande (Ah ! Cossotto…) .
Mais là aussi, il y avait une telle présence scénique et sonore qu’on ne peut qu’applaudir, malgré les remarques.
Seule Anja Harteros portait quelque chose d’autre.

Même si elle était elle aussi victime d’une première partie un peu en retrait, avec des suraigus un peu courts, avec un certain manque de rondeur. Mais il en va autrement en deuxième partie et notamment dans sa longue scène qui commence par d’amor sull’ali rosee, se poursuit par le Miserere puis par le duo avec Luna. Il y a certes toujours un peu problème à tenir les notes très hautes, mais pour le reste, c’est une leçon de chant, avec surtout une tenue de souffle exemplaire, des trilles à faire pâlir, des agilités sans scories, un sens du crescendo qui va en s’élargissant et qui stupéfie, avec en plus cette figure très bien éclairée (par Bertrand Killy) qui en fait une figure tragique, presque callasienne, qui va directement au cœur. Cette présence scénique (la manière dont elle meurt !), cette figure émaciée d’où sortent des sons aussi pathétiques, est totalement bouleversante. Harteros, c’est toujours grand, c’est la plupart du temps émouvant et très senti. Je me demande tout de même si elle a intérêt à garder ce rôle (où elle excelle) à son répertoire. Je la voix bien mieux en Aïda aujourd’hui.
Dernière concession au cirque lyrique : quid du match entre Netrebko et Harteros sur ce rôle ? L’une a une voix large, charnue, d’une diaphane pureté, et s’est formée à l’art du bel canto, l’autre a un sens tragique et une technique de fer, tout en diffusant l’émotion dès qu’elle arrive en scène. Je crois que Netrebko est plus homogène sur l’ensemble (Tacea la notte placida par exemple) avec quelques petits problèmes de prononciation, que n’a pas Harteros tellement immense, tellement bouleversante à la fin…
De gustibus…je me refuse à choisir. Il y a sans doute des soirs où je suis Anna et d’autres où je suis Anja.
Bien sûr je suis content d’avoir vu ce Trovatore, un peu m’as-tu vu pour la mise en scène carte de visite, où l’intelligence est là, mais aussi la volonté de trop en faire. Bien sûr je suis content de vérifier qu’Anja Harteros est toujours grande dans Verdi (même si son Elisabetta et sa Leonora de Forza m’ont plus secoué sur l’ensemble de la soirée à mon avis), mais j’ai pu encore une fois vérifier qu’il est plus difficile, bien plus difficile de faire passer Verdi que Wagner, et que même avec de bons chanteurs, et c’était le cas hier soir, pas un seul n’était mauvais, cela ne part pas toujours.
Triomphe et rappels infinis, c’était une soirée de répertoire à Munich. [wpsr_facebook]