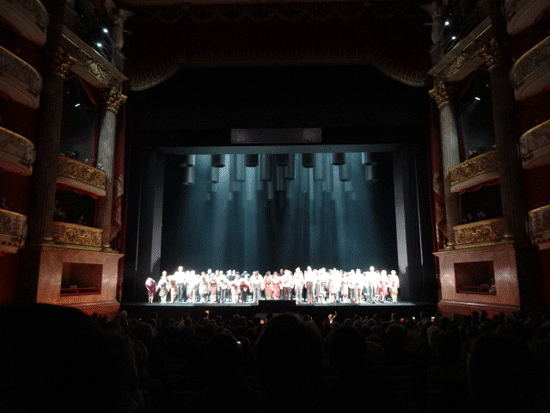Guillaume Tell (1829) a été créé pour l’Opéra de Paris qui ne lui a pas rendu cet honneur : une seule production récente (il y a douze ans environ) et jamais reprise pour cette œuvre essentielle dans l’histoire et le débat sur l’art lyrique . Elle clôt la période productive de Rossini et tout ce qui rattache le « genre opéra » aux formes du XVIIIème, pour en ouvrir une autre, dont Rossini sera la référence, celle du grand opéra et du melodramma romantique. Inutile de revenir sur l’incroyable gloire de Rossini dans l’Europe musicale de l’époque, il suffit de savoir que des saisons entières de la Scala sont construites autour de titres du cygne de Pesaro et ce pendant des années.
Guillaume Tell est une œuvre aux dimensions importantes, aux formes variées, airs, bel canto, ballet mais aussi chœurs gigantesques, grands ensembles, concertati : elle dure plus de 4h – même si le bistouri est passé à Munich pour la réduire à 3h… et c’est un mauvais point car pour des œuvres aussi rarement données, on peut s’interroger sur le sens des coupures. Il faudrait au contraire présenter les raretés in extenso et notamment avec les musiques de ballet.
Il reviendrait à l’Opéra de Paris d’en proposer une version de référence, si les éditions le permettent parce qu’avec Rossini, la dernière édition à la mode n’est jamais la définitive, et surtout si les programmateurs de cette maison avaient des idées et surtout si on commençait à prendre en compte son histoire et ses traditions. Mais je viens de m’apercevoir que j’ai utilisé deux mots, histoire et tradition, qui font très mal. Mieux vaut pour Paris prononcer les mots standard et gestion. C’est donc Munich qui fait cet honneur à une œuvre qui est l’une des deux nouvelles productions des prestigieux Opernfestspiele 2014, dans une mise en scène assez surprenante du jeune Antú Romero Nunes, un des metteurs en scène très en vue de la jeune génération allemande (il est né à Tübingen) et qui plus est spécialiste du théâtre de Schiller, dont les librettistes de Rossini, Étienne de Jouy et Hyppolite Bis, se sont librement inspirés.
Il signe là sa première mise en scène d’opéra.
Il faudrait longuement disserter sur Rossini et son rôle moteur dans la production musicale de l’époque. S’il a su diversifier son écriture en italien, en produisant aussi bien des opéras bouffe que des opéras seria, il va conquérir rapidement à Paris ses galons de compositeur de référence, et conçoit des nouvelles versions en Français d’opéras déjà écrits comme Il Viaggio a Reims dont il reprend la musique pour faire Le Comte Ory, ou Maometto II dont il fait Le Siège de Corinthe, ou Mose’ in Egitto dont il fait le superbe Moïse et Pharaon avec une écriture qui s’élargit et qui correspond à l’Opéra de Paris, déjà perclus du fantasme de l’énormité. Il a compris qu’à Paris, la grandeur est la nourriture quotidienne : incontestablement à l’époque Paris est la capitale de la musique…tempus fluctuat.
Guillaume Tell constitue une réelle nouveauté : Rossini s’essaie à des formes nouvelles, notamment dans les ensembles, dont toute la période romantique va s’inspirer, tout en gardant les caractères de sa musique, les fameux crescendo dont la scène finale est un exemple parfait à la fois de fidélité et de réadaptation, les acrobaties vocales sont moins gratuites et démonstratrices, et plus liées à des ressorts psychologiques : il s’y montre plus proche d’un Verdi par exemple. Et il va aussi rompre avec l’air qui arrête l’action, suspendu, pour l’insérer mieux dans la trame générale.
L’intrigue de Guillaume Tell , directement inspirée du drame de Schiller Wilhelm Tell (1804) plonge dans la légende de la conquête de l’indépendance des Cantons suisses sur l’occupant Habsbourg. Un souffle de liberté court l’opéra, et là aussi Rossini sent les aspirations du présent (on est en 1829, et Charles X qui le protège d’ailleurs et lui a versé une pension royale au propre et au figuré, n’en a plus pour très longtemps).
Abondance de personnages, mais peu de voix solistes : un baryton pour Tell, un ténor (à aigus…) pour Arnold et un soprano lirico colorature (un peu spinto quand même) pour Mathilde. Si Guillaume Tell est le titre de l’ouvrage, et la scène la plus spectaculaire la fameuse épreuve de la pomme, l’opéra est construit sur deux couples, Guillaume Tell et son fils Jemmy, un rôle de Travesti héroïque, et Arnold fils du Pasteur Melcthal et Mathilde, fille de l’empereur, qui s’aiment malgré la distance sociale et politique entre eux..

On pourrait penser que l’horrible Gessler, qui gouverne au nom de l’Empereur et exerce sur les suisses un pouvoir tyrannique, ait un rôle essentiel. Il n’en est rien : il apparaît essentiellement dans la seconde partie, et notamment dans la scène de la pomme.
Si la voix de Tell et celle de Gessler sont assez bien définies (beaucoup de barytons peuvent chanter Tell, beaucoup de basses peuvent chanter Gessler), il en va tout autrement d’Arnold et Mathilde, qui constituent le nœud de toute distribution de Guillaume Tell.
Arnold est un rôle de ténor, demandant une certaine épaisseur vocale, une voix douée d’une bonne assise, mais surtout des aigus ravageurs. Un type de ténor qu’on a déjà un peu rencontré dans l’Aménophis de Moïse et Pharaon, il faut là-dedans un Gedda (style, diction, aigus), plus qu’un ténor rossinien traditionnel de type Florez.
Nicolai Gedda, Chris Merritt, Luciano Pavarotti l’ont chanté : Merritt et Gedda avaient le style (en français) Pavarotti les aigus, mais pas tout à fait le style (encore que pour la version italienne…). Arnold, c’est Henri des Vêpres Siciliennes de Verdi doublé d’Enée des Troyens. Soit le ténor impossible.
Au disque Mathilde a été chantée par Caballé (en Français) et par Cheryl Studer et Mirella Freni(en italien). Caballé avait les aigus, la ductilité et la largeur voulue (n’oublions jamais que Caballé a aussi été une Sieglinde), Cheryl Studer n’était colorature que dans sa tête. Il faut une chanteuse capable d’agilités, capable de contrôle sur la voix, capable de notes filées, capable de chanter pianissimo, mais aussi fortissimo. Freni est Freni, mais elle ne restera pas la Mathilde du siècle.
Le dernier enregistrement est celui de Antonio Pappano avec l’Accademia di Santa Cecilia et Gérard Finley dans Tell, John Osborn, dont c’est le répertoire, en Arnold ; Mathilde est Malin Byström, peu compréhensible et sans grand intérêt. Quant à Antonio Pappano, ce répertoire lui va bien : vivacité, finesse, rondeur.
Certes, le rôle de Mathilde peut être chanté en italien et on pourrait trouver quelques voix possibles, mais c’est une œuvre qu’il faut afficher en français, car elle installe un genre qui fera florès dans les années qui suivent, le Grand Opéra à la française.
Bref, que d’aiguilles à chercher dans la même botte de foin.
Comme je l’ai souligné, la représentation munichoise, en français (c’est bien) a été sérieusement coupée (c’est mal). Les coupures, quand elles sont si importantes procèdent le plus souvent d’un accord entre le chef et le metteur en scène. Elles concernent la plupart du temps (c’est le cas ici), le ballet. On aurait pu trouver des solutions semblables à celles trouvées pour Don Carlos, de Bieito à Bâle où la musique de ballet avait été exécutée en flonflon à l’entracte dans le foyer, ou mieux, celle de Konwitschny qui avait fait du ballet une pantomime désopilante « Rêve d’Eboli ». Rien de tout cela ici. Le ballet, rupture dramaturgique, n’a sans doute pas les faveurs de Antù Romero Nunes
Les coupures concernent aussi des reprises non faites, des airs raccourcis etc…
Pour des opéras longs à la dramaturgie lâche, le metteur en scène désire le plus souvent éviter de diluer l’intrigue et préfère la muscler en raccourcissant, d’autant quand il veut construire un concept .
Antù Romero Nunes dont c’est la première mise en scène d’opéra a fait un travail typique de Regietheater : lecture du livret, analyse de situation, liens possibles avec l’actualité ou possibilités d’actualisation, élaboration d’un concept dramaturgique appuyé sur la situation mais pas forcément sur le livret. La lecture de l’œuvre se propose d’en révéler des possibles, pour éviter d’être illustrative et paraphrastique.
J’ai lu ailleurs que ce spécialiste de Schiller n’en respectait pas toujours le texte ou les vers. Comme Castorf, il plie le texte à une problématique que le théâtre doit illustrer : voilà un théâtre dramaturgique et conceptuel, un théâtre œuvre autonome et non serviteur d’une œuvre .
Avec un matériau comme Tell, il dispose de la Suisse et sa nature, élément essentiel dans le travail de Rossini, d’une occupation totalitaire sadique et violente, d’un amour impossible entre un suisse et une princesse issue de la famille impériale et donc de l’occupant, et d’un Guillaume Tell apparemment issu d’une famille bien ordinaire , une famille de « braves gens » au sens de Brassens, avec une femme , très mère suisse à défaut d’être mère juive, remettant son nœud de cravate lors des fêtes, s’occupant de son enfant, un peu hyperactif et GuillaumeTell, affligé de pulls over assez croquignolesques dont tout enfant redoute de voir sa grand mère en tricoter…

Le propos est clair : il s’agit de projeter l’action à l’éclairage d’une Suisse d’aujourd’hui, qui vient de faire parler d’elle pour quelques votations isolationnistes et vaguement xénophobes qui serait remplie de familles tranquilles et bien pensantes, et entourée par des puissances extérieurs agressives (l’Europe, nous est suggéré un drapeau étoilé qu’on agite à l’apparition de Gessler, mais une Europe déjà noire et fascistoïde). Ainsi est suggéré qu’à la situation de Tell, libérateur d’une la Suisse réellement envahie, se superpose la situation d’aujourd’hui d’une Suisse se vivant comme agressée par l’extérieur, Tell devenant porteur non plus de liberté, mais de clôture, d’où la vision petite bourgeoise de la famille (désopilante Madame Tell de Jennifer Johnston) et du petit peuple de bonnes gens autour de leur Pasteur Melcthal qui chantent le Seigneur, les cieux, le travail et les amours : Travail Famille Patrie.
Nunes suggère évidemment une nation confinée autour de valeurs de petits blancs. L’image initiale de ces couples de mariés qui chantent leur bonheur dans le giron de Dieu, et l’air de Ruodì accours dans ma nacelle, timide jouvencelle du genre pastorale, devient un air de mariage, fondement de la famille : on le verra aussi dans la caricature qu’est la famille Tell.
Ce peuple suisse gentillet est donc un peu rabougri et au final dangereux. Dans cette vision, les bons ne sont pas si bons (Tell est très dur avec Arnold) et le couple Mathilde/Arnold (Mathilde ne chante pas dans l’ensemble final) finit dans l’ambiguïté : Mathilde s’éloigne seule, mais Arnold la retient d’une main, pendant qu’il chante avec les autres « liberté redescends des cieux »…on ne sait ce qu’il adviendra…
Est-il pertinent de substituer aux Habsbourg l’Union Européenne qui serait oppressive et qui empêcherait les vaillants petits suisses de vivre pleinement leur liberté ? Nunes a une vision très radicale de l’affaire, et veut réellement détruire le message inscrit dans l’œuvre, qui est évidemment pour Rossini qui sent le vent tourner, une manière d’évoquer l’esprit révolutionnaire français : quelques mois plus tard, c’est 1830…et déjà sur la scène on chante « liberté redescends des cieux »…
Au service de ce message au total ambigu parce que personne ne se sauve vraiment, une construction particulièrement complexe, qui veut mettre au centre la scène de la pomme, qui achève dans le suspens la première très longue partie (près de 2 heures) : Tell tire, l’enfant s’écroule, rideau.
La deuxième partie s’ouvre sur l’ouverture traditionnelle, déplacée au climax de l’œuvre : elle s’accompagne de changements d’ambiances rapides dans le décor, comme si le ballet du décor racontait l’histoire, comme si Jemmy qui vient d’être sauvé par l’habileté du père s’arrêtait une fraction de seconde (du genre Les Choses de la Vie de Claude Sautet) pour voir défiler sa courte vie. L’Ouverture célébrissime devenant un concentré d’histoire.
Fallait-il déplacer l’ouverture et la mettre au centre de l’œuvre comme un moment suspendu, j’en doute, d’autant que la musique de Rossini est très claire dans l’ouverture et présente la problématique de l‘ensemble de l’œuvre, le début en solo de trois violoncelles, place la nature sereine comme élément porteur de l’œuvre. La deuxième partie renvoie à la nature sauvage, la tempête (comme dans beaucoup d’opéras de Rossini, il y a une tempête, à la fois dans l’ouverture et dans la dernière partie de l’œuvre : la tempête semble avoir englouti Tell mais il s’est sauvé, comme les vrais héros) et la troisième partie (la cavalcade) renvoie évidemment à la guerre et aux hommes. Nature sereine, nature troublée, humain serein, humain guerrier. C’est une histoire en elle-même : était-il besoin de la faire glisser ailleurs pour raconter à peu près la même histoire, pour donner de l’épaisseur à Jemmy (du genre tempête sous un crâne…). Un Jemmy souvent négligé et qui ici devient un personnage central, vivant, extraordinairement interprété par la magnifique Evguenyia Sotnikova, d’une confondante vérité, d’une fraîcheur inouïe (et quelle voix !).

Car tout commence à rideau ouvert et salle discrètement éclairée, dans le silence, puis, brutalement, sans crier gare, un assassinat dans une lumière aussi crue que l’ambiance précédente était douce, puis sans transition, en contraste, les couples de mariés chantant Quel jour serein le ciel présage. Tout cela en à peine 30 secondes. Oui, c’est incontestablement du bon théâtre, avec ses effets, sa virtuosité, mais peut-être aussi inutile.
Nunes est sans doute un excellent metteur en scène : d’emblée, il construit avec des éclairages de Michael Bauer très efficaces et remarquables de netteté, de vraies ambiances, de vraies ruptures, une vraie dramaturgie. Il sait aussi parfaitement gérer les foules, le chœur compose des mouvements particulièrement étudiés, parfaitement antinaturels aussi : il ne s’agit pas de faire comme si on était dans la vie, mais composer une image de théâtre ; il travaille aussi sur la manière de dire le texte, demande aux chanteurs d’insister sur certaines syllabes, d’appuyer sur certains mots, c’est le cas pour Michael Volle (à la diction parfaite…), enfin s’il ne travaille pas trop sur les interactions entre personnages, il travaille quand même beaucoup sur les attitudes, très étudiées : nous sommes sans conteste au cœur de la cérémonie théâtrale, celle qui se donne à voir, d’une manière presque maniériste et alors qu’il modernise l’action, il propose d’une manière syncrétique Tell le petit bourgeois à lunettes qui va tirer sur son fils non au pistolet comme chacun s’attend à le voir faire dans cette ambiance complètement modernisée, mais avec une arbalète, conformément à la légende : là aussi on oscille entre l’histoire, son interprétation et le regard sur l’histoire : Tell en vieux pull tirant à l’arbalète, c’est à la fois incongru et conforme, inquiétant et rassurant. Comme l’ensemble de ce travail.
Enfin, le décor envahissant et fascinant de Florian Lösche, occupe bonne part de l’attention, un décor en perpétuel mouvement, fait d’ énormes tubes, je dirais de tuyaux d’orgues disposés en maison, en cathédrale (magnifique) en forêts, mais aussi en montagnes : manière d’être le plus antiréaliste possible et en même temps fortement évocateur, notamment à l’aide des éclairages de face ou d’arrière, vers la salle, englobant le théâtre dans l’ensemble. Au passage, quelle perfection technique, des mouvements énormes qui bouleversent l’espace sans cesse, mais dans un incroyable silence ! Un décor en mouvement de tubes parallèles ou qui se croisent, des tuyaux d’orgue qui sont autant de pièces isolées, fermées les unes aux autres, qui enferment, sans libérer, qui bougent fascinent et écrasent sans jamais vraiment être invitantes, comme autant d’obstacles : des pièces de métal glacé porteuses du pessimisme ambiant.
Et pourtant au total, pouvons nous suivre Nunes dans sa vision ? Avec toutes ces qualités, conceptuelles et techniques, avec son sens du mouvement et de la vision, avec son sens profond de ce qu’est le théâtre, il a péché par excès : trop de choses, trop d’enjeux derrière les yeux, pas assez de simplicité. Chercher les degrés de profondeur et les possibles d’une intrigue fonctionne jusqu’à un certain point. J’ai évoqué plus haut l’ouverture et sa double valeur illustrative avec un discours musical et un discours scénique, le décor impressionnant qui envahit trop la scène : on passe son temps à chercher à identifier les formes qui se construisent et se déconstruisent souvent d’ailleurs au rythme de la musique. À trop vouloir signifier, même avec une virtuosité technique et théâtrale impressionnante, à trop tirer la corde à la fin elle se casse. Qu’emporterons-nous de cette vision ? De belles images, quelques jolies idées : l’idée qu’Europe et Suisse aujourd’hui sont plongées dans la même violence, qu’au rabougri suisse correspond l’assèchement humain d’une Europe trop étouffante, que tout le monde est dans le même sac, que même l’amour s’étiole, ou survit à peine. Que Tell et Gessler exercent tous deux la même violence, l’une identifiée et totalitaire, l’autre tout aussi totalitaire, mais pire encore car elle se cache sous le masque de la bonne conscience. La bonne conscience contre l’absence de conscience de l’ennemi.

À ce titre je crois que Nunes eût pu s’intéresser plus à Mathilde qui finit par trahir l’occupant-l’Empereur son père- non pas au nom de son amour, mais au nom de l’humanité (envers Jemmy).
Beaucoup de subtilité, trop sans doute pour une œuvre qui demandait d’abord à être écoutée et lue du public : le message est brouillé.
Cette extrême complexité du propos (il faudrait aussi relever les traces schillériennes de cette lecture) refuse totalement l’idée de nature profuse, si présente dans la musique de Rossini. Luca Ronconi à la Scala, avec ses vidéos gigantesques de cascades, de lacs, d’eaux en mouvement et de prairies, et son décor en forme de parlement bernois, inscrivait la Suisse et ses clichés comme élément porteur de l’œuvre. Antù Romero Nunes lui a préféré la Suisse en creux, celle cachée par les clichés et il nous dit qu’elle n’est pas bien belle, mais en même temps le non-Suisse ne l’est pas non plus ; personne n’est à sauver…la musique peut-être.
La musique justement, emmenée par Dan Ettinger. Le chef israélien propose une lecture techniquement en place, et claire, avec un souci de ne pas imposer de vision monolithique. C’est un bon chef , mais qui n’est pas là à mon avis dans son répertoire.
En effet, le son est souvent trop fort, sans beaucoup de place pour la légèreté, pour la douceur, pour la souplesse. Cette musique est bien plus fluide, que ce que nous avons entendu et qui manquait de legato, et singulièrement de ligne. Il a subi quelques huées, injustes, qui lui reprochaient sans doute d’avoir déplacé l’ouverture. Une direction sans couleur, sans doute plus scandée que rythmée, pleine d’aspérités. Une direction plutôt premier degré, qui n’essaie pas d’accompagner la mise en scène dans sa manière de creuser le propos. Pourtant, on voit à quelles sources Verdi a puisé certains moments de son Nabucco, et le dynamisme de certains ensembles, et Ettinger ne fait pas grand chose pour révéler tout ce que cette musique peut avoir de novateur sous ses airs faussement ronflants : c’est une musique alternant énergie et légèreté, subtilité et force, fragilité et solidité, avec un extraordinaire dynamisme, et souvent une très grande poésie.
Il reste qu’Ettinger est un chef d’opéra, très attentif aux voix, et les voix sont sans doute ce soir ce qui a été le plus convaincant, comme souvent à Munich, avec son cortège de petits rôles parfaitement tenus notamment par la troupe : le Walter Furst de Goran Jurić par exemple, à la voix sonore et chaude, le Rodolphe de Kevin Connors avec ses faux airs de Mussolini des Alpages, le Leuthold sonore de Christian Rieger, l’excellent Ruodì d’Enea Scala, au timbre séduisant et suave, même si la technique d’attaque des aigus a été un peu malmenée au début , l’Hedwige de Jennifer Johnston, un « type » fagoté en tailleur rouge, très naturelle en scène, très disponible pour le jeu et l’ironie.

Le Melcthal père de Christoph Stephinger impose une voix forte, bien projetée, bien timbrée aussi, sans beaucoup d’harmoniques mais très correcte pour le rôle.

Le Gessler de Gunther Groissböck n’est pas aussi impressionnant que d’habitude, sans doute à cause de la langue avec laquelle il a un peu de difficulté. Lui qui d’habitude dit les textes avec une justesse et une clarté exceptionnelle s’en sort mal avec le français, mais il impose scéniquement un vrai personnage, avec des attitudes d’une grande force, et une manière de marcher très particulière à la fois martiale et hésitante qui m’a séduit.
Evguenia Sotnikova est un Jemmy exceptionnel, par le jeu d’abord, enfant insupportable, du genre salle gosse hyperactif et qui se glisse partout, on a peine à reconnaître un soprano derrière cette figure d’enfant mal degrossi mais surtout avec une voix éclatante, qui s’impose à l’aigu avec une extraordinaire facilité et domine les ensembles, qui sait aussi être émouvante, une vraie découverte que cette chanteuse qui a fait ses classes à Saint Petersburg puis dans l’opéra-studio du Bayerische Staatsoper.

Marina Rebeka, qui vient de Riga en Lettonie est encore un soprano peu connu en France, mais qu’on commence à entendre aussi bien au Royaume Uni qu’en Allemagne : elle est Mathilde. Cette voix plus habituée à Traviata et aux rôles plus légers de lirico-colorature, n’a pas une prononciation française claire, ni d’ailleurs une diction exemplaire, mais malgré le français le chant passe quand même avec beaucoup d’élégance. La voix n’a peut-être pas suffisamment d’assise, manque de largeur pour le rôle, mais aussi bien les agilités que les notes filées, aussi bien le bel canto que le plus héroïque réussissent à imposer un personnage peut-être fragile, mais cohérent. J’ai l’habitude de Mathilde plus imposantes physiquement et vocalement, mais Marina Rebeka, dont le timbre n’est peut-être pas exceptionnel, arrive à émouvoir et à chanter avec beaucoup de sensibilité.
Bryan Hymel lui non plus n’a pas un timbre à faire rêver, la voix ne se distingue pas par des beautés spécifiques, mais, technique américaine oblige (pour moi, il n’y pas de formation plus solide que la formation anglo-saxonne), il y a tout : d’abord une diction exemplaire, le seul dont on comprenne chaque mot, prononcé clairement, projeté avec élégance, ensuite, une grande facilité à l’aigu, bien ouvert, sûr, et un beau contrôle sur la voix et sur le souffle qui permet des filati, des notes tenues. Bref, un Arnold comme il se doit, avec les qualités et la vocalité du rôle. Même si la présence en scène reste un peu frustre, c’est un magnifique artiste, à réserver pour tout rôle de ténor impossible du répertoire français, qui en a tout un rayon à offrir.

Enfin, Michael Volle est un Guillaume Tell en grande forme vocale, avec une voix large, sonore, dont l’amplitude remplit avec facilité la salle du Nationaltheater. Lui aussi est doué d’une diction exemplaire, peut-être juste un peu moins claire qu’Hymel, mais avec un sens des mots, et de la couleur qui stupéfie. On sait bien que Volle est un immense baryton ; il prend ici le public presque à contre emploi tant on le pensait éloigné de ce type de répertoire. Le rôle est imposant, mais stylistiquement moins problématique qu’Arnold. Volle s’en empare, en fait un personnage étonnant, avec ses cravates tordues, ses pulls impossibles et ses lunettes qu’il enfile (avec juste raison) au moment du tir sur la pomme, personnage étonnant dont le look ne correspond pas à la voix, d’une incroyable noblesse. Grandiose prestation.
Voilà, vous avez peut-être trouvé mon propos très développé, mais on ne rencontre pas Guillaume Tell tous les jours, et vous l’avez compris, j’ai pour Rossini une grande admiration et pour cette œuvre une immense tendresse. Pour l’écouter, je vous renvoie à Freni, Pavarotti, Milnes, Ghiaurov avec Chailly, pour la version italienne un peu en technicolor (mais il faut vendre), et pour la version française, un Lamberto Gardelli un peu trop plan-plan, mais Gedda, mais Caballé, mais surtout notre grand Gabriel Bacquier. Vous voulez des surprises ? plongez-vous dans ce Rossini-là. [wpsr_facebook]