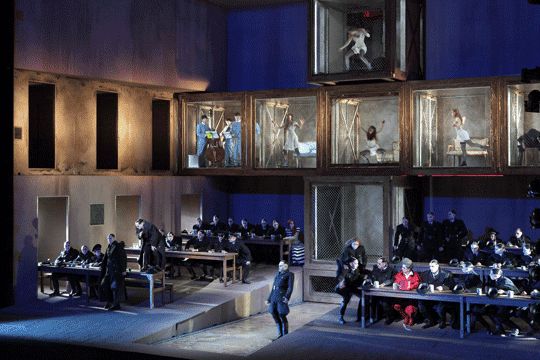
_____________________________________________________________
L’envie était trop forte de repartir à l’assaut de ces Soldaten munichois, de réentendre Kirill Petrenko, de revoir la mise en scène de Andreas Kriegenburg après avoir vu cet été son magnifique Don Juan kommt aus dem Krieg (Don Juan revient de la guerre) sur lequel je reviendrai prochainement.
L’occasion l’hiver prochain sera bonne pour aller à Milan revoir la production de Alvis Hermanis vue à Salzbourg et ainsi mettre ces trois productions récentes en perspective (je n’ai pu voir celle de Willi Decker à Amsterdam) d’un opéra qu’il est scandaleux, proprement scandaleux de n’avoir vu à Paris qu’une fois depuis l’ouverture de Bastille (en 1994-95) et pour 6 représentations dans la production de Stuttgart (H.Kupfer). Je l’avais oublié, et c’est un lecteur attentif qui me le rappelle, ce dont je le remercie. Il reste que 6 représentations en plus de 20 ans…
Certes, ce serait sans doute risqué pour la caisse de programmer un opéra contemporain : vous pensez, il a presque 50 ans, à peine moins que l’âge de Wozzeck quand je le vis pour la première fois à Garnier avec Abbado pendant la saison 1979-80, mais je ne me souviens plus qu’on appelât alors Wozzeck opéra contemporain, sauf pendant longtemps encore dans les rayons de la FNAC.
Ce soir à Munich, la salle était bien pleine, mais n’affichait pas complet, et l’on peut trouver des places pour les deux prochaines représentation. Avis aux amateurs.
Une fois de plus en effet, force est de constater le très grand niveau de cette production, musicalement et scéniquement. Et le fait d’avoir revu à Berlin la production Bieito permet aussi de mieux comprendre les choix esthétiques et dramaturgiques qui ont conduit à des approches si radicalement différentes.
Alvis Hermanis à Salzbourg a raconté une histoire, en profitant du cadre spatial exceptionnel de la Felsenreitschule, dans une sorte d’hyperréalisme, non sans images stupéfiantes (la funambule, la scène finale avec Marie perchée sur le décor), si stupéfiantes d’ailleurs qu’on se demande comment la Scala à l’espace plus réduit et plus contraint va pouvoir les rendre.
Calixto Bieito à Zurich et à Berlin a choisi de rapprocher au maximum le drame du spectateur, et à faire de l’orchestre un acteur, à intégrer visuellement la musique dans le drame, il en résulte un immense choc visuel et émotionnel .
Andreas Kriegenburg choisit au contraire la distance que l’opéra favorise, puisque le spectateur est à l’opéra, séparé de l’action par l’orchestre. À Salzbourg aussi, le dispositif faisait de l’orchestre une barre gigantesque, mais le spectateur était pris dans le spectaculaire, du lieu, de l’orchestre déployé comme jamais, d’un décor époustouflant.
Ici, le spectacle reste dans le cadre scène-salle d’un opéra traditionnel, même si l’orchestre déborde un peu dans les loges et ailleurs.
Kriegenburg joue sur la notion de représentation, sur l’absence de réalisme, ou plutôt d’un réalisme pictural qui renverrait à des images expressionnistes, à la Max Beckmann ou à la Otto Dix (dont le dispositif scénique de Harald B.Thor, on l’a dit précédemment, est fortement inspiré), mais aussi aux scènes religieuses qu’on voit au Moyen Âge dans les retables, ou, de manière plus contemporaine, qui renverrait à un monde caricatural qui pourrait être celui de la bande dessinée dont toutes ces cases du décor pourraient être des vignettes. En tous cas, un monde qui refuse le réalisme cru, et qui propose une médiation par l’art et par l’image. Les uniformes par exemple ne sont pas des uniformes SS, mais les rappellent avec ce décalage ironique qui fait qu’on y croit sans y croire. Il y a sans cesse dans cette mise en scène quelque chose de théâtral au sens presque négatif du terme : on est au théâtre et cela se voit, on est dans l’image et cela se voit. D’où évidemment un refus de l’émotion directe, mais une émotion médiatisée par sa représentation. C’est tout le contraire de ce que cherchait Bieito. La démarche de Bieito se voulait charnelle et directe, elle se voulait à fleur de peau. Celle de Kriegenburg se veut intellectuelle, elle passe par la distanciation brechtienne, une distanciation rigoureuse, soignée, ordonnée par les géométries des personnages par exemple, dans l’avant-dernière scène, toutes les femmes de l’œuvre à jardin, et tous les hommes à cour, séparés par la fosse « à ordures » où est jetée Marie, par les jeux d’ombres et de lumières, par le dispositif même formé de ce polyptique inspiré d’Otto Dix et d’un plateau séparé en deux espaces de jeu à jardin et à cour,

par la disposition même des « cages » du polyptique où l’on voit par exemple en une ligne verticale la mère de Wesener et Wesener, juste en dessous la mère de Stolzius et Stolzius, et en dessous encore enfin Charlotte (la soeur de Marie, sorte de substitut maternel, encore que…) avec à côté Marie et Desportes qui s’ébattent : une sorte de paradigme des mères en somme,. Un autre exemple de cette construction rigoureuse, la répétition de motifs comme le déshabillage de Marie: par son père en une des scènes les plus ambiguës et les plus terribles de la soirée, puis par Desportes, et par Mary, mais aussi, esquissé, celui du jeune Comte par sa mère
Mais ce qui m’a frappé, encore plus que la première fois est l’importance que Andreas Kriegenburg accorde au religieux. L’image première est celle du corps de Marie, en croix, emportée par les soldats. Marie au nom prédestiné, une sorte d’image de la dormition de la (non) Vierge.
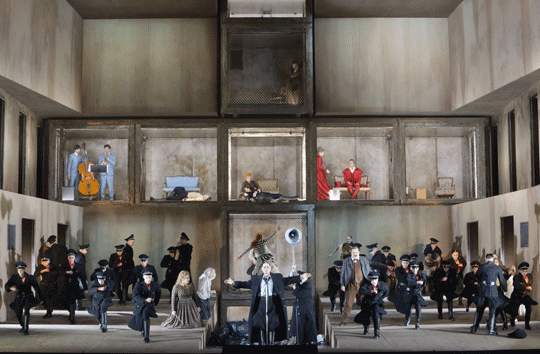
Puis le polyptique en forme de croix, qui avance, recule, se désarticule, mais qui reste toujours une croix, dominant le plateau, enfin les deux scènes finales, lancées par le discours du prêtre (micro et portevoix), puis l’image finale qui est une messe noire avec dans le Polyptique le corps de Stolzius et de Desportes, mais aussi celui du jeune comte étranglé par sa mère.
Kriegenburg représente une Passion, les stations vers la ruine, la course à l’abime, comme une sorte de Mystère. On imagine qu’il pourrait mettre en scène Jedermann un peu de la même manière.
Ainsi l’émotion ne peut être de la même violence physique que chez Bieito. Ici elle naît comme émotion esthétique devant un spectacle aux multiples qualités, aux multiples perfections dirais-je, et devant des images dont la valeur est démultipliée par la musique.
Comme toujours Kirill Petrenko est soucieux de l’harmonie rythmique entre plateau et fosse. Son tempo est moins urgent, peut être moins dynamique que celui de Marc Albrecht (Zurich) et Gabriel Feltz (Berlin), avec un son plus clair (qui s’explique aussi par la disposition de l’orchestre), je dirais même cristallin tant chaque pupitre est entendu : il faut d’ailleurs souligner la qualité de la réponse de l’orchestre, la précision du son, l’exactitude rythmique.
Plus qu’en mai dernier, j’ai écouté avec attention les premières scènes de la seconde partie (les scènes de la Comtesse de la Roche) où Petrenko impose une sorte de son minimaliste, à peine perçu, une approche d’une incroyable légèreté, qui rappelle un peu les Six pièces pour orchestre de Webern et certains moments des pièces pour orchestre de Berg. Cette légèreté, qui tranche, donne évidemment à la scène, où se joue (un peu) l’avenir de Marie une force encore plus tendue, grâce à l’exceptionnelle prestation de Nicola Beller Carbone dans la Comtesse de la Roche, à la fois d’une très grande élégance et très vaguement déjantée (bien meilleure que Noemie Nadelmann à Zurich et Berlin, qui composait un magnifique personnage, mais dont la voix avait de très sérieuses éclipses), et qui chante le rôle avec un magnifique contrôle dans toutes les inflexions.
C’est en écoutant de tels moments qu’on se désole qu’une telle œuvre n’ait pas la place qu’elle mérite, l’une des toutes premières.
Si la bande son est bien présente dans la scène finale (ce qui n’était pas le cas à Salzbourg), on peut peut-être regretter que dans la scène du cabaret, les sons naturels se limitent aux bruits des chopes et des objets sur les tables, et que le reste soit remplacé par des percussions, mais la scène est si forte scéniquement (avec son orchestre de jazz vêtu comme les Beatles) que l’on peut ne pas (trop) s’y arrêter.
Il reste que musicalement, ce travail est un sommet, difficilement égalable à mon avis, d’autant qu’il s ‘étend aussi à un travail totalement inédit sur le chant, une vraie leçon de technique, grâce à une distribution de très haut niveau, et surtout très engagée, et donc très homogène, rangée derrière le chef et la protagoniste Barbara Hannigan.

Barbara Hannigan est une authentique showwoman. C’est une femme qui fait spectacle, elle est douée d’une personnalité scénique irradiante qui fait qu’à peine elle est en scène, elle éclipse les partenaires. Des gestes minuscules, précis, des expressions du visage, toujours enfantin ou adolescent, mais tantôt naïf (comme l’utilisation de sa chevelure et le jeu qu’elle en fait), tantôt pervers et aguicheur, tantôt mangé par le désir, tantôt apeuré: un visage sadien – une lointaine parente de Justine. Une composition comme on en voit peu sur scène, avec une souplesse corporelle qui fait presque de ce corps un objet en soi. on en oublierait que ce corps chante aussi.
Car ce n’est pas seulement le corps et le jeu, c’est aussi la voix, une voix prête à tout comme ce corps, qui utilise tout les registres du soprano colorature, avec une facilité dans les scalette, dans les ruptures de tessiture, du plus haut au plus bas ou l’inverse, dans l’utilisation du rubato, dont elle abuse presque dans ses interprétations rossiniennes ou mozartiennes (voir cet été à Lucerne) et qui ici est utilisé à bon escient, avec une justesse et un à-propos étonnants.

Bref, c’est, j’ose le dire, une perfection. Je ne pense pas qu’on puisse faire mieux, plus vivant et surtout plus vécu, plus juste, et plus en phase avec ce que voulait le metteur en scène. Hannigan est quelquefois manipulée comme ces poupées désarticulées remplies de paille ou de tissu qu’on se lance à loisir, elle se chosifie, c’est stupéfiant.
À ses côtés un plateau remarquable de cohésion, à commencer par la Charlotte d’Okka von der Damerau, l’un des phares de la troupe, magnifique d’intensité, avec cette voix large, grave, sombre, lancée avec force et en même temps avec subtilité, là aussi une performance, et une vraie présence.
Nous avons parlé de la Comtesse de Nicola Beller Carbone, au chant attentif, millimétré, aux inflexions à la fois chaleureuses et distanciées, presque ironiques, à la présence physique prodigieuse.
Heike Grotzinger en mère de Stolzius ressemble étrangement à Hanna Schwarz plus jeune, elle en a presque la voix caverneuse et expressive, tandis qu’Hanna Schwarz elle-même est peut-être encore meilleure qu’en juin dans la vieille mère de Wesener, en tous cas, la voix est plus sûre.

Michael Nagy en Stolzius, avec son beau timbre de baryton, est presque trop propre dans son chant, trop « distingué », trop élaboré par rapport au Stolzius un peu brut et si bouleversant de Michael Kraus à Zurich, mais quelle sûreté et quel beau chant.
Daniel Brenna m’a semblé fatigué, notamment à la fin : son Desportes est toujours impressionnant par le chant presque bel cantiste qu’il nous offre avec ses montées à l’aigu sur le fil de la voix, avec ces ruptures, mais cette fois, il cale souvent, la voix déraille, et racle quelque peu, et plusieurs fois notamment dans la deuxième partie : moins de sûreté qu’en juin, malgré une performance honorable.
Enfin le Wesener de Christoph Stephinger dans son personnage de bourgeois sans noblesse si insistant avec sa fille est très solide et très sûr vocalement, très présent aussi, comme tout le reste de la troupe qui fait honneur au théâtre.
Au total, un spectacle qu’on reverra(it) encore avec plaisir, une grande soirée, incontestablement : c’est une reprise de répertoire. Mais quelle reprise, et quel répertoire ![wpsr_facebook]
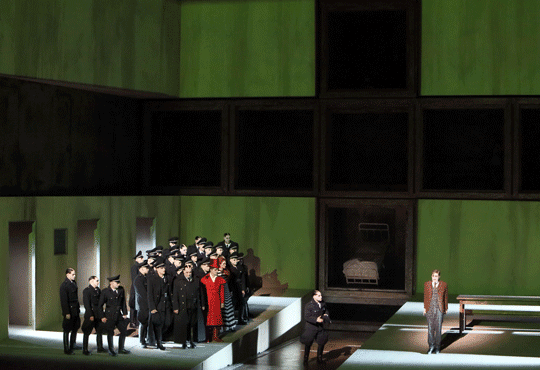

Bonsoir,
Pour information, Die Soldaten a été donné à la Bastille en 1994-1995. Par ailleurs je signale l’existence du livre de Laurence Helleu “Les Soldats de Zimmermann, une approche scénique”. Il permet de se faire une idée sur différentes manières de représenter cet opéra majeur.
Amicalement,
Benjamin
Merci cher ami d’avoir remis de l’ordre dans mes souvenirs et d’avoir donné cette précision. j’ai aussitôt modifié le texte. En précisant cependant à qui je dois la modification.Je vous dirai pourquoi je suis totalement impardonnable. Merci en tout cas.
Bonsoir,
Je vous dois le voyage à Munich et la découverte live de Die Soldaten.
Merci pour vos textes, pour l’enthousiasme et la curiosité qui les guident.
Merci pour votre appréciation, je me réjouis que vous ayez pu découvrir cette production remarquable.