
Séduit par la Fantastique entendue à Paris par le National, j’ai voulu entendre Daniele Gatti diriger la même œuvre par le Royal Concertgebouw Orchestra, avec toujours le même handicap : une interprétation hors norme d’Abbado avec les Berliner Philharmoniker en 2013, sur laquelle je me suis arrêté, et qui vient de paraître en disque, produisant encore chez moi la même ferveur et la même admiration éperdue.
Le programme très « romantique » proposait l’ouverture de Tannhäuser dans la version de Dresde (1845), la poème symphonique Orpheus de Liszt (1854) et la Symphonie Fantastique « épisodes de la vie d’un artiste » (1830). Le fil du programme, c’est évidemment l’artiste dans sa confrontation tragique (et créatrice) avec le monde, et les visions successives du poète ou du musicien (Orphée et son lointain descendant Tannhäuser sont l’un et l’autre) quant à l’artiste de Berlioz, c’est un musicien. Mais tous trois vivent une aventure tragique avec la femme dont ils sont amoureux. Deux meurent, Eurydice pour Orphée, inconsolable qui se met à composer chant et musique déchirantes pour évoquer l’absence et la souffrance, Tannhäuser vit parce qu’Elisabeth s’est offerte en martyr pour sa rédemption, et l’artiste de Berlioz désespéré de l’absence de réponse à son amour se livre aux délires de l’opium et de la diablerie qui sont évidemment des délires créateurs : Berlioz est trop intelligent et trop sensible pour ne pas composer sa musique la plus neuve dans ses trois derniers mouvements.
Même si des raisons techniques peuvent avoir donné des motivations au programme, il me paraît avoir un sens particulièrement cohérent autour du du héros romantique qui n’a jamais rien de « fleur bleue » mais se trouve au contraire souvent écartelé, violent, en proie aux fureurs et pourquoi pas aux Furies.
Ainsi de l’ouverture de Tannhäuser. Souvent chez Wagner le son émerge comme d’un néant (voir Lohengrin, voir Rheingold, voir Parsifal) c’est le cas dans Tannhäuser, au moins dans celui voulu par Gatti : une ouverture qui émerge très lentement d’un néant, où les modulations des cuivres et les différents pupitres s’entrelacent de manière presque magmatique, donnant une couleur particulièrement sombre, y compris quand le thème est repris aux cordes, presque hésitantes à rentrer en jeu, avec une respiration large et tendue, avec un sens du crescendo marqué mais d’une lente fluidité telle qu’elle s’apparente non à un fleuve, mais à une coulée de lave continue. C’est cette tension initiale et cette obscurité d’où émerge le son qui m’ont fasciné ici. Le choix est clair : il s’agit de donner une couleur à l’ensemble qui n’a rien de cette musique triomphale qu’on entend quelquefois, mais une couleur presque parsifalienne. Gatti n’oublie pas que Wagner a voulu, encore huit jours avant sa mort, revoir son Tannhäuser de fond en comble, que l’œuvre attendait, évoluait en fonction de Tristan (révision de 1860) et allait encore évoluer au contact cette fois de Parsifal : ce début si sombre, c’est l’antichambre de l’œuvre, celle à qui sa vraie couleur sera donnée. Alors du même coup, la suite, plus aiguë, plus lumineuse, plus claire peut apparaître ce qu’elle est : un leurre, un leurre comme le Songe d’une nuit de sabbat peut être un leurre pour l’artiste de Berlioz, le leurre d’une musique qui, si on s’y concentre bien, a des accents vaguement inquiétants.
L’œuvre d’une vie, voilà ce qu’est le Tannhäuser, une œuvre d’une vie à laquelle il n’a pu revenir, d’où cet accent dramatique et massif, merveilleusement architecturé à l’orchestre au son si impressionnant, avec ses crescendos à double entrée, des cordes et des vents d’un côté aigus, mais de l’autre des percussions inquiétantes et des decrescendos construits de la même manière, puis les sortilèges du Venusberg, avec ses cordes si fines, mais aussi ses bois inquiétants : les bois sont toujours poétiques mais annoncent souvent des tensions (voir le cor anglais dans la Fantastique) : cette ouverture avec ses imperceptibles silences dans les crescendos de la partie finale, qui créent un rythme presque haletant, est en fait une ouverture sur l’angoisse, sur l’inquiétude, comme sa fin en orgie amère, un tourbillon. Gatti tend l’arc entre le Berlioz de la Fantastique et le Wagner de Tannhäuser. Je reste fasciné des decrescendos de la partie finale annonçant la musique du chœur des pélerins, si sombre, doublée par des cordes devenues un arrière fond si lisible et si peu rassurant. Et si on va un peu plus loin dans l’écoute, on comprend que l’architecture tient non par la mélodie du chœur des pélerins (si célèbre, aux vents), mais par la vague modulée des cordes et que c’est elle qui éclaire l’ambiance, et donne la couleur. Tout cela est d’une clarté incroyable, comme une sorte de mise en scène sonore d’un drame qui est déjà tout dans une ouverture pourtant archi rebattue, installée comme un apéritif auquel on ne prendrait pas garde et qui nous dit déjà par son pessimisme structurel que nous sommes au cœur de la tragédie de la musique qui va se jouer les autres oeuvres du concert. Une approche réfléchie par Gatti jusqu’aux moindres détails.
C’est le noir qui va si bien à cette matinée dominicale.
Orpheus commence par un discret appel aux vents, comme Tannhäuser, auquel s’enchaînent des harpes (Orphée…), puis la musique s’élargit et s’éclaire, d’une indéniable et d’une lumineuse poésie, d’un optimisme mesuré qui répond au pessimisme précédent. Gatti garde une lenteur de tempo manifeste qui permet de bien détacher chaque pupitre, les harpes , très présentes, toujours même, et aussi le chant singulier et solitaire du premier violon. Le chant, car la musique lente et contemplative m’est apparue singulièrement proche de certains moments du chant wagnérien, notamment par ses crescendos (on se met à faire des ponts aussi avec ce qui précède), et l’alternance de voix solistes (hautbois) et celle des harpes particulièrement présentes et du violon. Wagnérien aussi le long accord final qui semble conclure un opéra de Wagner, sur lequel insiste Gatti et grâce auquel il obtient un silence du public à la fin de la pièce. Une pièce toute de fluidité, d’un intérêt renouvelé parce qu’alors se construit une évident système d’échos entre l’histoire d’Orphée, l’histoire de la musique, et la construction de ce concert même. Gatti réussit à rendre ce poème symphonique bien plus passionnant qu’on ne le dit dans les encyclopédies, en construisant un système d’échos évidemment avec Wagner, presque « naturellement » par les relations artistiques, puis familiales que les deux artistes entretiendront : Liszt n’est il pas, comme Orphée, l’artiste à la fois créateur et interprète, peut-être encore plus célèbre dans l’Europe entière et jusqu’en Turquie comme interprète et que comme créateur ou compositeur. Mais c’est là aussi une double postulation, car Gatti s’ingénie, comme souvent, à marquer dans cette musique des échos, des échos surprenants, presque straussiens : on peut identifier où le jeune Strauss puisa quelques éléments de son inspiration pour ses poèmes symphoniques, mais par ricochet, comme cette musique est moins « sage » et plus inventive qu’il n’y paraît à première vue, plus ouverte, elle aussi en quelque sorte plus « musique de l’avenir ». Daniele Gatti, en amoureux du post-romantisme, en chercheur de la musique, en dessinateur de fils ténus ou non entre les œuvres et justement ces œuvres-là, cherche à démêler justement cet écheveau-là des intertextualités musicales, seule manière à mon avis de percevoir tous les possibles d’une musique, de la musique.
Alors évidemment, ce travail de recherche, cette volonté d’aller jusqu’au bout d’intuitions ou de certitudes, c’est dans une Symphonie fantastique très différente qu’à Paris par le son et par les intentions qu’il apparaît, d’une manière qui éclaire bien le travail du chef.
Il est d’abord très attentif à la tradition de jeu des musiciens qu’il a en face de lui. À Paris, il avait cherché à déconstruire patiemment non une tradition de jeu, mais des habitudes qui ne faisaient plus problème, comme si on devait jouer « comme ça » sans autre forme de procès. D’une Fantastique jouée dix jours auparavant avec un autre chef, il en avait fait, lui, une autre, pleinement heurtée, avec ses luttes de masses sonores, comme pour conjurer les tendances un peu brahmsiennes de l’interprétation traditionnelle. Il en avait fait quelque chose de parfois tellurique.
Il a ici en face de lui un orchestre de toute autre tradition, un orchestre qui excelle justement dans le post-romantisme, de Mahler à Stravinski, qui a fait sa gloire internationale pendant les premières années du XXème siècle. Et Daniele Gatti va travailler avec ce son là pour proposer une Symphonie Fantastique qui aura ces échos-là du futur, pour proposer en elle une “musique de l’avenir”, elle-aussi.
Je ne suis pas de ceux qui édicteraient une doxa interprétative pour les œuvres françaises, (élégance, clarté, fluidité). J’entends souvent parler de la musique française comme on parle du classicisme à la Boileau, « ce qui se conçoit bien s’énonce clairement », une sorte de vision musicale calée sur le discours préfabriqué du classicisme. Moi j’aime le classique quand il dit « je ne fais pas le bien que j’aime et je fais le mal que je hais » (Racine), j’aime ce classicisme non de « fleur heureuse », mais de fleur ravagée et déchirée, à la Pascal, à la Racine, et pourquoi pas à la Corneille, mais le dernier Corneille « Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir ». Quand j’entends parler de musique française, j’ai toujours l’impression qu’il y a une sorte de jeu français qui ferait de tout une sorte de fleur heureuse et élégante, une fleur de cour aimable. Oh, certes, je fantasme un peu sans doute, mais il y a une manière franchouillarde quelquefois de penser la musique qui m’agace, quand la musique est l’art qui transcende la notion même de frontière ou de nation. Quand Berlioz compose sa Symphonie fantastique, en 1830, on est dans l’agitation politique, et artistique, avec l’avènement du romantisme, et il vient quelques années auparavant de découvrir Beethoven. Berlioz, je l’ai écrit il y a quelques temps, c’est vers Gluck, vers Beethoven, mais aussi vers le Grand Opéra à la Rossini ou à la Spontini qu’il regarde, rien que des français. Il y a certes une culture et une éducation françaises, sans doute des modes aussi de jeu, de facture d’instruments, il y a un champ musical français, mais que signifie en revanche musique française, de quelle France ? les 130 départements napoléoniens ? Celle sans Nice ? Sans la Savoie ? Sans l’Empire colonial ? Cessons donc pour cet art éminemment international qu’est la musique, de parler de musique française ou allemande ou autre quand l’art et le monde intellectuel depuis le Moyen âge sont en échange permanent, quand les idées traversent les frontières avec une déconcertante facilité, voire rapidité. Donc Berlioz s’interprète en fonction d’une pensée, d’une intuition, d’une démarche intellectuelle et non en fonction de sa nationalité, et en fonction aussi des influences qui l’ont marqué, et de celles qu’il a pu avoir dans le futur. Quand Berlioz, en 1830, s’amuse à des cassures de rythmes, à des heurts de son, à des phrases qui sont à la limite de l’atonalité, il s’amuse, mais en même temps nous savons, nous, qu’il est prophétique et nous devons en tenir compte. Quand il imite un instrument déglingué, il anticipe le Siegfried de Wagner et son appel au cor, quand il use du grotesque, il anticipe Mahler etc..etc..
C’est au contraire rendre justice à Berlioz que de voir comme tout au long du XIXème les plus vénérés compositeurs de cette époque l’ont écouté, et avec quelle attention. C’est bien d’abord ces filiations que Daniele Gatti fait entendre, avec un orchestre qu’il a merveilleusement en main et qui le suit avec gourmandise : on voit les regards, on voit quelques gestes qui ne trompent pas quand à son passage les contrebasses frappent en souriant sur leur instrument. Il fait apparaître des liens qui semblent même inattendus : dans le premier mouvement, on entend par moment Weber, si fameux en 1830, et ça c’est plutôt « normal », mais aussi subitement, au détour d’un son la Nuit transfigurée de Schönberg, comme si de nouveau Gatti plaçait Berlioz sur une immense frise, un immense arc où les deux bouts marquent des cheminements de lectures, des échos possibles. Dans Un bal la couleur sombre des premières mesures font apparaître non la légèreté mais des nuages, puis une fin en allègement séraphique voire un peu maniéré après une valse légère, aérienne, presque impalpable mais obstinément inquiétante. Dans Aux champs, on est dans le drame noir (percussions initiales et finales, mais en même temps dans une sorte de contraste mahlérien,voire tristanesque, avec des bois ahurissants.
C’est que Gatti cultive un discours sur la Fantastique où la question dramatique domine, non pas seulement au sens commun, mais surtout au sens théâtral : ce que fait voir Gatti c’est une dramaturgie, c’est presque une pantomime ; une musique dramatisée et théâtralisée qui en fait un drame sans paroles mais avec seulement une musique. C’est une Fantastique qui se raconte non comme un programme mais encore plus comme un opéra sans voix, un oratorio sans paroles, très dramatisé, très lent au début mais très tendu, tout au long implosif, très en-dedans, comme un drame intérieur insupportable, où il n’y pas pas un moment de relâchement, un monologue intérieur au bord du gouffre.
Le travail de l’orchestre est proprement ahurissant pour trouver le ton juste correspondant aux propositions sans doute inattendues du chef, qui justement travaille avec les pupitres (fabuleux) qu’il a à disposition notamment une petite harmonie de rêve. Avec cet orchestre, Gatti ose: il ose des heurts, il ose des tempos surprenants, des heurts de tempo, très rapides, puis très lents, presque des anacoluthes, des ruptures de construction, où il installe une instabilité structurelle. Il est sûr que pour un public français habitué dans la Fantastique à une relative ligne « classique », policée, c’est très déstabilisant. Gatti travaille ici sur le tissu même de la musique, sur la couleur en la faisant miroiter et moduler: on voit défiler Bruckner, Mahler, Wagner, Schönberg tout en préservant les sources webériennes et beethovéniennes de cette musique. Alors dans la Marche au supplice, la tension déjà présente depuis le début s’accentue : il en résulte une ambiance pas romantique du tout comme on l’attendrait, un Berlioz tendu très tourné vers l’introspection qui tend le spectateur à l’extrême et qui lui donne comme on dit le cœur battant. Avec d’autres moyens et une autre fluidité, Abbado recherchait une impression similaire, mais Gatti aime le tellurique, il aime sentir la masse sonore comme volcanique qui va se déchaîner, un dérèglement ordonné, mais orgiastique et presque stravinskien. Une interprétation seuil de tout un XIXème qui se terminerait au pied des années 20. Du drame, du burlesque, du grotesque, du sarcastique, de l’amertume, mais jamais du bonheur : on croirait décrire quelque symphonie du Mahler des dernières années, alors que c’est un Berlioz des premières années qu’il s’agit, un Berlioz théâtral et prophétique, un Berlioz moins hugolien que Shakespearien (et on sait comme Berlioz aimait Shakespeare), qui secoue les forces naturelles, qui les dérange, mais avec la distance due, un Berlioz qui serait une source intarissable de l’inspiration symphonique du futur. C’est un travail prodigieux sur le sens musical, sur l’intelligence musicale, sur l’histoire de la musique symphonique et surtout sur les intuitions du futur, mais aussi d’une sensibilité à fleur de peau. Une lecture de Berlioz d’une incroyable modernité, qui éclaire du même coup les deux pièces précédentes et qui donne à ce concert une homogénéité intellectuelle de grande profondeur, qui fait voir enfin quelle complicité est déjà née avec les musiciens, qui comprennent à fleur de peau ce que Gatti veut d’eux dans l’harmonie comme la fêlure.[wpsr_facebook]
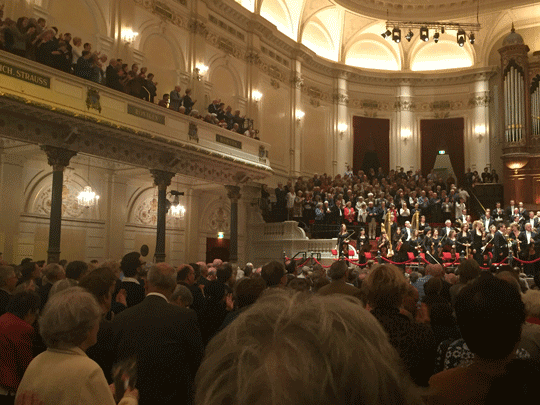








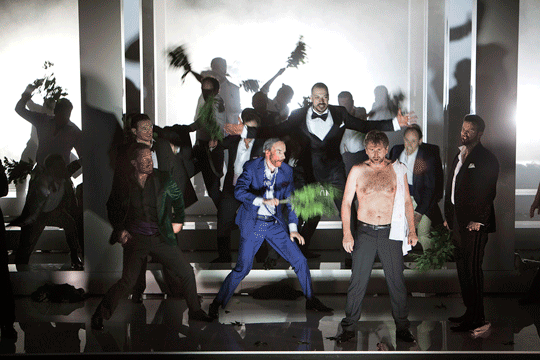



































 Salut de Ingo metzmacher
Salut de Ingo metzmacher Peter Seiffert (second plan Nina Stemme et Michael Volle)
Peter Seiffert (second plan Nina Stemme et Michael Volle)