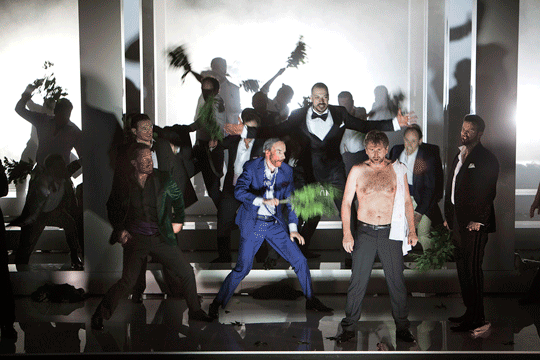« On annonce alors le retour imprévu du Roi dans la rade et on décide d’aller en cortège de masques à la rencontre du souverain bien-aimé afin de le convaincre que le sombre puritanisme germanique n’est pas fait pour la brûlante Sicile car il est dit : “les fêtes joyeuses rendent son peuple plus heureux que vos tristes lois.” Friedrich ayant Marianne à son bras ouvre la marche, suivie du deuxième couple, Luzio et la novice, perdue à jamais pour le couvent. »[i]
C’est ainsi que Richard Wagner dans Ma vie termine le résumé de l’œuvre, lui donnant son sens, d’abord une volonté d’opposer à l’instar de Goethe le nord et le sud, puis faire quelque peu exploser les frontières de la bienséance et de la religion . C’est ainsi qu’il justifie le changement de lieu (Palerme au lieu de Vienne dans l’original shakespearien) et de nom du héros – Angelo devient Friedrich, « afin, écrit-il, de caractériser sa nationalité allemande »[ii] – donc triste et rigide).
De l’Allemagne il va être question dans la mise en scène puisque le retour final du roi de son voyage à Naples est matérialisé par l’arrivée d’un Airbus de la Bundesrepublik Deutschland d’où descend…Angela Merkel, image finale réconciliatrice de l’opéra non teintée d’ironie..
On a longtemps laissé de côté les premiers opéras de Wagner, d’une part bien peu les connaissent, d’autre part les enregistrements sont rares et pas toujours bon marché, et enfin ils sont difficiles à monter dans un théâtre: ils exigent des choeurs et un orchestre importants et des voix nombreuses, d’un niveau technique notable.C’est pour un théâtre un investissement dont le retour n’est pas si sûr auprès du public. Les représentations de 2013 à Bayreuth ( à l’extérieur du Festspielhaus) se sont soldées par un échec cuisant. La proposition du Teatro Real, en coproduction avec le Royal Opera House et le Colon de Buenos Aires, en est d’autant plus méritoire.
Entre Die Feen, long, peu passionnant et horriblement difficile à chanter et Rienzi tout aussi long, tout aussi difficile à chanter mais plus intéressant, Das Liebesverbot (la Défense d’aimer) dont le livret reprend Mesure pour Mesure de Shakespeare constitue une voie médiane, avec une musique proche de l’opéra comique d’Auber, et quelques moments qu’on va reconnaître (directement ou indirectement) dans les opéras futurs (Tannhäuser surtout); Das Liebesverbot se laisse voir (avec quelques coupures), et mériterait à mon avis d’entrer dans les répertoires des théâtres. On représente actuellement des œuvres souvent moins intéressantes, même si plus populaires.
Le Teatro Real propose cette production dans le double cadre d’une volonté d’offrir «tout » Wagner et du 4ème centenaire de la mort de Shakespeare en avril 1616. Associer Shakespeare à ces représentations semble logique, mais en même temps un peu osé, tant l’ambiance imposée par la musique de Wagner est assez loin de la comédie douce amère qui constitue la trame du livret où s’abordent les thèmes de la justice, du bon gouvernement, des hypocrisies qui se masquent derrière l’ordre moral, ainsi que les arrangements avec le Ciel imposés par la vie et donc de la fragilité des choses humaines.
La représentation madrilène est loin d’être intégrale, environ 50% du livret plein de reprises et de dialogues dans la tradition de l’opéra comique d’alors ont été coupés et depuis la première (difficile) à Magdebourg, il ne me semble pas qu’une intégrale ait été présentée sur une scène. Même le disque de Sawallisch qui fait autorité en propose une version sérieusement écornée.
La question est toujours de savoir si tout cela vaut le coup. Wagner a 23 ans et il travaille à son opéra depuis l’âge de 21 ans. Il cherche à se faire connaître et écrit des opéras à la mode, proches de l’univers de Weber ou de Schubert (Die Feen), ou de celui de Rossini et plus encore de Auber (Das Liebesverbot). Entre 1830 et 1840, la mode, c’est Rossini, c’est Auber, c’est Donizetti. On joue encore aujourd’hui Rossini et Donizetti, mais très peu Auber qui fut pourtant avec Meyerbeer l’une des grandes gloires de l’époque et qui mériterait sans doute mieux que l’ostracisme dont il fait l’objet aujourd’hui (Fra Diavolo est plutôt une œuvre intéressante). Mais j’ai confiance : pour élargir le répertoire des théâtres, après avoir épuisé le XVIIIème, on va se lancer dans le XIXème et revenir à Auber, mais aussi à Dietsch, Marschner, Mercadante, Coccia, Cui, et à tous ces noms de l’opéra européen oubliés aujourd’hui. Déjà Meyerbeer fait un retour remarqué…

Le jeune Wagner puise plus directement dans Auber son inspiration musicale, c’est particulièrement net dans l’ouverture ( qui se déroule devant le portrait de Wagner “animé” qui suit la musique) avec son orchestration légère et dansante, ses deux parties traditionnelles et sa reprise. Il s’est chargé lui-même du livret, sans doute par défaut car il est difficile pour un jeune inconnu de trouver un librettiste. Il y a une mélodie qui fait indéniablement référence à Auber, mais la manière d’écrire les airs, la longueur des ensembles et l’importance des chœurs ferait plutôt penser à des influences wébériennes. En réalité, Wagner puise dans toute la musique de l’époque, qu’il connaît bien, qu’il va pratiquer en tant que directeur musical, et qui va faire le lit de sa réflexion dramaturgique.
Par rapport à l’original shakespearien, Wagner a donc déplacé le lieu de la comédie de Vienne à Palerme, changé quelques noms, simplifié l’intrigue à cause de l’absence du Duc (Isabella épousera Luzio qui dans l’original épouse la prostituée Kate Keepdown, un nom peu idoine pour une prostituée..). Outre le méchant Angelo qui devient chez Wagner Friedrich (on a vu plus haut pourquoi), Miss Overdone, la maîtresse du bordel, devient Dorella à la fonction de femme de chambre aux mœurs un peu légères, the Provost devient Brighella (personnage bien connu de la Commedia dell’arte) tandis que les héros, Isabella, Mariana, Claudio, Luzio gardent leur noms originaux, et les amis Antonio, Angelo, Danieli et Pontio Pilato sont inventés par Wagner pour résumer l’ensemble des personnages secondaires de la pièce de Shakespeare. Friedrich est donc l’étranger, le non italien, celui qui n’est pas du Sud.
Wagner cherchant le succès a délibérément choisi le monde de la comédie, supprimant le personnage du Duc, un peu encombrant, et le remplaçant par un fantomatique souverain probablement allemand absent, dont on annoncera simplement le retour prochain à la fin.

C’est pourquoi Kasper Holten a emprunté la route de la comédie et du burlesque pour cette production colorée et vive, dans un décor unique (de Steffen Harfing), changeant à l’aide de lumières (de Bruno Poet) ou de projections bienvenues (de Luke Halls), fait d’escaliers qui rappellent Maurits Cornelis Escher, un monde labyrinthique où tout est possible, où tout se cache ou se voit, ce qui est plutôt intéressant, dans une Palerme envahie de tous les objets de la communication moderne, de Whatsapp à Twitter, et où le téléphone mobile est l’objet du monde le mieux partagé, ce qui est bien moins intéressant et plus passepartout.
Il y a donc de bonnes idées et de moins bonnes, et des complaisances pour gagner les faveurs du public, qui au Teatro Real m’a surpris par sa mauvaise éducation : discussions vives entre spectateurs, applaudissements timides ou inexistants pour des airs pourtant qui les méritaient. Un public qui ne semble pas entrer dans la logique de la pièce, ou sans doute aussi prévenu : ce Wagner-là n’est pas Wagner, alors, prenons d’emblée nos distances.
Certes, en dix ans, Wagner va passer de Liebesverbot à Fliegende Holländer et surtout à Tannhäuser : un océan, un abîme semblent les séparer. Et pourtant cette musique alerte, au rythme marqué, à l’orchestration cristalline, avec un usage très novateur des percussions (castagnettes, qu’on va retrouver dans la Bacchanale de Tannhäuser) et des ruptures rythmiques, présente aussi des moments de suspension poétique et de vraies réussites mélodiques. Il y également des personnages bouffes bien marqués (la basse Brighella, héritière des basses bouffes rossiniennes) et des caractères déjà trempés, à la morale élastique: Isabella est une novice déjà au couvent ; le sous-titre de l’opéra est d’ailleurs Die Novize von Palermo, proposé pour échapper à la censure qui n’aurait pas manqué de frapper le titre Das Liebesverbot pour une première prévue à la veille de Pâques où l’on ne devait représenter que des pièces sérieuses. La novice sort du couvent, promet au lubrique Friedrich de lui concéder ses faveurs en échange de la libération de son frère condamné à mort, puis se jettera dans les bras du jeune et déluré Luzio…la jeune Isabella a un avenir prometteur et pas très religieux. La question de la morale et de la liberté sexuelle est centrale dans cette œuvre et les personnages sont bien libérés. D’ailleurs, Wagner lui-même dans Ma vie parle de « situations scabreuses »[iii].
Du point de vue du chant, le jeune Wagner s’éloigne des acrobaties vocales rossiniennes, sa vocalité demande tension et endurance, mais pas d’acrobaties pyrotechniques, on est là plus proche d’un chant wébérien ou schubertien, qui demande de l’endurance et un spectre vocal large, notamment chez les femmes. En revanche l’écriture pour les ténors, difficile, est plus traditionnellement “italienne”, notamment pour le personnage de Luzio qui exige une très belle technique et aussi, mais de manière plus perlée, pour Claudio.
Kasper Holten propose une vision résolument bouffe, de cette histoire, qui voit Friedrich, à qui le roi a laissé provisoirement le gouvernement de Palerme, imposer un ordre moral où l’adultère est puni de mort, où le carnaval, la période où traditionnellement tout est permis, est interdit, ce qui provoque des remous dans la population, dans laquelle, comme toujours on voit apparaître des compromissions et des compromis, et où ordre moral et désordre réel se confrontent. Friedrich, fou de désir pour la novice Isabella, venue demander grâce pour son frère Claudio, condamné pour avoir couché avec sa fiancée avant le mariage qu’il lui a promis, n’hésite pas à lui proposer un marché déshonorant et pour la jeune femme qui doit sacrifier son corps et pour lui qui se dédit, montrant ainsi son hypocrisie tartuffière.
De cette situation Kasper Holten ouvre l’opéra par une vision colorée et folle du carnaval (couleurs, néons, argent, casino, femmes et chorégraphies de Signe Fabricius) aussitôt interrompue par les sifflets de la police menée par Brighella en Bobby au service de Friedrich, loin d’être insensible au charme de Dorella, une jeune femme aux mœurs, dirons-nous, libérées.

La deuxième scène (au couvent) s’ouvre sur une phrase bien connue reprise plus tard dans Tannhäuser et marque un univers plus poétique; dans la cellule prient Mariana et Isabella ; Mariana épouse délaissée par Friedrich et Isabella la sœur de Claudio. Mais vision buffa oblige, Mariana dans la mise en scène est boulimique, et Isabella essaie de réguler son amour immodéré des pommes-chips : dès qu’Isabella chante, Mariana en profite pour replonger dans le paquet qu’Isabella s’obstine à cacher sous un oreiller. Au deuxième acte, le trio Luzio/Dorella/Isabella se déroule sur un tapis roulant obligeant les personnages à marcher à contresens…ou Friedrich passant la nuit avec celle qu’il croit Isabella muni d’un masque en forme de cygne (Lohengrin ? Parsifal ?)…Voilà le type d’humour souvent inutile dont Holten va parsemer la pièce.
Il fait ainsi de Friedrich le juge inflexible d’un tribunal moral, mais qui va se coucher avec un nounours en peluche, et le terrible Friedrich montre ses dessous (des caleçons) à la jeune Isabella fort (?) choquée. Le duo où Isabella va rendre visite à Claudio dans sa prison (début du deuxième acte) se déroule désormais au téléphone (mobile), chacun parlant dans son smartphone. Dans la scène finale, où se déchaine le carnaval malgré les interdits Brighella le policier est costumé en Walkyrie de carton pâte (il fallait bien rappeler qu’on était chez Wagner) et subit les avanies de Dorella. En bref, Holten rajoute des signes de comique, qui font sourire, rarement rire, et qui tombent à plat dans le public, parce que souvent ce comique tourne à vide, et semble artificiellement plaqué. Le personnage de Friedrich est apparemment terrible, mais en réalité inoffensif, parce que faible et soumis à la dictature du désir caché. Il est vêtu comme un juge, avec de lourdes lunettes, une sorte de vieillard lubrique (fort bien interprété par Christopher Maltman) et n’impressionne jamais.

En bref, ce monde ne paraît pas sérieux, parce que la musique de Wagner ne semble pas le prendre au sérieux, et parce que cette dictature de la morale semble être de pacotille ou du moins terriblement fragilisée par les comportements individuels irrépressibles (Friedrich lui-même) et par la pression des comportements sociaux. Couvents, justice, police, tout cela vole en éclat face au désir de carnaval et de saturnales, un monde de plaisir et de désir, un monde libéré où l’individu serait livré à ses instincts. Un monde du sud où la liberté sexuelle semble effrénée, que l’on découvre notamment par les textes de voyages en Italie de Goethe, à un moment où Wagner lui-même est rempli du désir de séduire et conquérir l’actrice Minna Planer ; bref, Das Liebesverbot décrit un monde de la sève montante où ce n’est pas tant d’amour que de sexe qu’il est question, Sexesverbot en quelque sorte.

Il y avait sans doute d’autres possibilités de traiter l’intrigue : Holten la rend inoffensive, pensant que le ridicule tue, mais en éloignant tout sérieux, il s’éloigne de la référence shakespearienne, et de certaines idées que Wagner va reprendre : le pouvoir et ses excès seront traités dans Rienzi à peine quelques années après, la morale et la libération sexuelle seront l’un des thèmes du débat de Tannhäuser : il y a de l’Isabella dans Elisabeth, et le Wagner politique prendra part à la révolution de 1848. Bref, il y a ici en germe des thématiques qu’on retrouvera dans des œuvres bien plus « sérieuses », comme la pureté, la rédemption, le pouvoir, la justice qui parsème toute l’œuvre dite « sérieuse » de Wagner et qu’Holten ne prend pas vraiment en considération, sinon par la dérision, ce qui rend son approche apparemment burlesque plutôt superficielle parce que son burlesque ne vise rien, ne dénonce rien, et cet univers évoque plutôt la gentille comédie musicale que l’œuvre d’art de l’avenir .
Si cette mise en scène se laisse néanmoins voir et ne fait pas de mal à une mouche, la musique qui émerge de la fosse est plutôt digne d’intérêt. Ivor Bolton est le néo-directeur musical du Teatro Real et son arrivée a été accueillie avec réserve par les mélomanes espagnols. Un chef plutôt terne, plutôt spécialisé dans un répertoire limité (le XVIIIème) ne semble pas convenir à un public au goût plutôt belcantiste, et qui a déjà été heurté par Gérard Mortier qui ne lui ménageait pas ses sarcasmes. Bolton est effectivement un chef qui est le plus souvent appelé pour travailler sur du baroque (c’est le cas lorsqu’il dirige à Munich) et qui n’est pas réputé pour son originalité, mais plutôt pour sa sagesse.
Mais dans Liebesverbot, le travail musical m’est apparu contredire nettement la grise réputation du chef. D’abord, il y a dans cette direction du rythme, de la vivacité, de la couleur, mais aussi une certaine poésie, avec un soin tout particulier donné à la mélodie (les qualités de Wagner mélodiste se remarquent de manière toute particulière dans cette œuvre) avec une attention aux chanteurs, en veillant à ne jamais les couvrir et en les soutenant par le tempo dans les airs les plus délicats. Ensuite, le son est cristallin, cela sonne quelquefois comme une fantaisie mozartienne, quelquefois comme du Schubert, ailleurs on entend la palpitation théâtrale des opéras comiques d’Auber, mais toujours avec une ductilité orchestrale et un sens de la couleur qui rend l’orchestre du Teatro Real exemplaire. Pas une scorie, une précision des attaques et un sens des rythmes qui séduisent. Il fait entendre la subtilité, l’ironie même de cette musique sans jamais la rendre emphatique (Rienzi s’en chargera…) et en soulignant l’apparence de la simplicité. C’est fluide, enjoué, et très bien construit, avec des équilibres sonores et une mise en évidence des pupitres qui rendent réellement justice à la partition dont il propose une approche « possibiliste », c’est à dire libérée de tout choix d’un point de vue, laissant venir qui Donizetti, qui Weber, qui Mozart, qui Auber, quand la situation et la musique l’exigent. Ce n’est pas de l’opportunisme, c’est une manière de laisser à la musique exprimer sa propre variété, c’est laisser Wagner jouer avec son clavier.
Le chœur enjoué du Teatro Real, dirigé par Andrés Maspero a démontré aussi de belles qualités d’engagement et de justesse.
Pour une œuvre si rarement proposée sur les scènes, il n’est pas facile de construire une distribution car peu de chanteurs sont disposés à apprendre des rôles qu’ils n’auront pas l’occasion de reprendre fréquemment. Aussi la perspective de la coproduction (avec trois théâtre qui plus est), aide-t-elle fortement. Si un chanteur a la certitude de jouer une dizaine ou une quinzaine de fois, il sera sans doute plus enclin à accepter la proposition ; de plus la présence d’une distribution B (sur les rôles de Friedrich, Isabella, Luzio, et Brighella) assure des remplacements en cas d’accident de parcours. Ainsi, la compagnie réunie avec peu de vedettes mais des chanteurs assez sûrs, est suffisamment équilibrée et homogène pour ne pas faire apparaître de faiblesses majeures, non plus que des révélations définitives.

Christopher Maltman est Friedrich. C’est un Friedrich de grand luxe qui surprend presque dans ce rôle tant le personnage est moqué par la mise en scène. On le connaît dans des rôles plus puissants et plus dramatiques. Il a un rôle de personnage « serioso » disent les italiens, qui se prend au sérieux et qui est plutôt ridicule. Vocalement il est vraiment à l’aise, la voix est large, porte haut, mais elle est presque trop noble et « respectable » pour un personnage qui doit être traité avec plus d’ironie. Une ironie que l’on ne sent pas tellement dans son chant. Il faudrait là-dedans un Beckmesser (auquel Friedrich ressemble par certains côtés, son aspect « juge », son goût de la règle, de l’interdit, et son ridicule face à l’amour), un Adrian Eröd me semblerait plus adapté, voire un Hawlata, même sans voix. Il reste que la prestation est très correcte, mais ne permet pas aux qualités dramatiques de Maltman de s’épanouir.

Manuela Uhl est Isabella, un rôle de soprano colorature dramatique à la Cheryl Studer, qui exige une voix large, ductile, avec un centre solide et des aigus assurés et puissants (c’est Christiane Libor qui le faisait à Bayreuth en 2013), une Karita Mattila l’eût sans doute jadis assumé sans problème. Manuela Uhl a un timbre clair, un centre assuré et large, mais les aigus sont tirés et difficiles, la voix se resserre, et passe toujours de justesse. Il reste que la chanteuse, entendue à Amsterdam il y a quelques années dans Der Schatzgräber de Franz Schreker, est valeureuse et se tire de ce rôle difficile avec les honneurs. Le duo initial Marianna/Isabella est lyrique, émouvant, avec une mélodie prenante où l’on reconnaît le Wagner de l’avenir. Elle est un personnage vif, juvénile, enjoué, très à l’aise dans les ensembles (nombreux). Sans être exactement la voix voulue, elle conforte la distribution et demeure une Isabella réussie et séduisante.

Le Brighella du croate Ante Jerkunica est sans doute l’un des profils les plus réussis de la soirée, jouant le chef des sbires en Bobby fidèle et soumis à Friedrich, mais incapable de réfréner ses désirs (comme à peu près tous les hommes de cet opéra, tous un peu priapiques) et donc lui aussi en proie à des contradictions; le type d’humour et de personnage rappelle l’Osmin de Entführung aus dem

Serail. Déjà apprécié dans le Landgrave (Tannhäuser de Bieito à l’opéra des Flandres l’automne dernier) ou dans Stefano Colonna de Rienzi au Deutsche Oper en 2010, Ante Jerkunica a une voix large, profonde, douée d’aigus solides. Il est là un personnage plutôt bouffe qu’il assume avec beaucoup d’entrain, à plat ventre, à genoux ou en Walkyrie. La voix est toujours aussi solide et large dès qu’elle s’envole, mais le rôle sollicite surtout le registre central et la « conversation », c’est un pur rôle de composition dans lequel il montre des qualités notables. C’est décidément une basse qui devrait compter dans les prochaines années.

Du côté des ténors, c’est un peu plus difficile. Les parties pour ténor des opéras de cette époque sont toutes périlleuses, car il faut des qualités de belcantiste accompli. C’est le cas indiscutable du Luzio du danois Peter Lodahl, rompu au répertoire XVIIIème, mais aussi aux rôles belcantistes. Luzio est un rôle difficile, qui demande une belle extension, des aigus tenus, des cadences. D’ailleurs Wagner l’avait confié à un ténor rompu à Auber (Fra Diavolo) et à Hérold (Zampa) comme il le rappelle dans Ma vie[iv]. Peter Lodahl s’en sort vraiment remarquablement, il en domine les aigus, les agilités, les passages, et il est techniquement l’un des plus accomplis du plateau, encore sans doute un ténor du futur. Ce qui est accompli pour Peter Lodahl dans Luzio ne l’est pas encore pour le Claudio de Ilker Arkayürek, qui exige à peu près la même voix avec les mêmes écueils. C’est un clin d’œil de Wagner que de proposer à peu près la même vocalité pour les deux amis Claudio et Luzio, comme s’ils étaient interchangeables, et comme si Isabella s’amourachait du double de son frère (sans doute le syndrome Sieglinde…). Le jeune ténor turc, un peu trop jeune sans doute, n’arrive pas toujours à dominer les exigences du rôle, avec une personnalité vocale plus pâle, des attaques moins assurées, des aigus peu sûrs quelquefois.

La Mariana de Maria Mirò montre une voix bien posée, bien projetée, avec une belle technique, et une ligne sûre, bien appuyée sur le souffle. Son air (assise sur un croissant de lune) est l’un des meilleurs moments de la soirée. Dans l’ensemble, les airs de Mariana et d’Isabella sont musicalement plutôt réussis.
La troisième soprano est Dorella, la femme de chambre (et plus…) chantée par la jeune Maria Hinojosa, au départ un peu stridente dans les ensembles de la première scène et qui semble avoir une voix fragile dans les aigus, mais au fur et à mesure que l’opéra avance, les chose s’arrangent et cette voix typique de soubrette s’empare des situations avec engagement.

Tous les autres s’en sortent avec les honneurs : le troisième ténor à la jolie couleur rossinienne David Alegret (Antonio), et les personnages de complément Angelo (David Jerusalem), Daniel (Isaac Galán) et Pontio Pilato, le bien nommé dans une œuvre sur la mauvaise justice, chanté par Francisco Vas.
Au total, ce rendez-vous avec une des œuvres les moins jouées et les moins connues de Richard Wagner est plutôt positif, et la confrontation avec l’œuvre fait évidemment plonger dans l’univers wagnérien avec d’autres armes : dans Wagner, tout est à prendre pour construire une vraie connaissance de la complexité de cet univers, dont le parcours ne commence pas au Vaisseau Fantôme. Ici, le Wagner libertaire, désireux de liberté et assoiffé d’amour libre est central, et fait mieux comprendre les situations de Tannhäuser. Wagner est certes encore tributaire des formes traditionnelles (il faudra attendre Lohengrin, voire Tristan pour qu’il s’en libère complètement) mais bien des thématiques des œuvres futures sont en germe dans son jeune travail, et surtout, ce qui frappe, c’est sa connaissance de l’intérieur des partitions des grands contemporains : chef d’orchestre, directeur musical de différents théâtres, il lui fallait tout jouer, et il devait donc connaître le répertoire le plus large possible.
Il raconte avec des détails intéressants la naissance de cet opéra dans Ma vie, et on sent combien cette aventure artistique est entremêlée des aventures plus personnelles avec Minna Planner, combien les situations personnelles tissent avec l’intrigue des échos singuliers.
Cette représentation, dans l’ensemble plutôt réussie malgré les réserves sur l’approche scénique, est à mettre au crédit de ce beau théâtre qu’est le Teatro Real de Madrid dont les efforts restent notables pour proposer un répertoire ouvert malgré un public de tradition, ce qui à l’opéra est hélas fréquent. Elle induit le public curieux à se plonger dans un Wagner moins connu, mais tout aussi important à connaître. Connaître le début pour mieux comprendre et mieux aimer la fin. Il n’est pas interdit d’aimer la Défense d’aimer. [wpsr_facebook]
[i] R.Wagner, Ma vie, Tome I, Paris, Plon, 1911, p.198
[ii] R.Wagner, Ma vie, Tome I, Paris, Plon, 1911, p.192
[iii] R.Wagner, Ma vie, Tome I, Paris, Plon, 1911, p.156
[iv] R.Wagner, Ma vie, Tome I, Paris, Plon, 1911, p.191