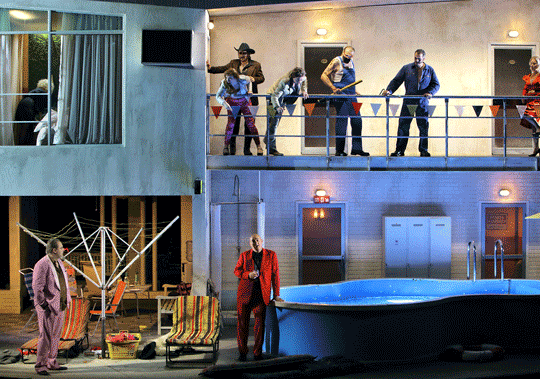Après Parsifal et Der Fliegende Holländer à Stuttgart, Calixto Bieito aborde à l’invitation de l’Opéra des Flandres (Opera Vlaanderen) Tannhäuser, en alternance à Gand (en septembre) et à Anvers (en octobre). L’Opéra des Flandres est une institution très vivante: la scène flamande, que ce soit au théâtre, en danse ou à l’opéra, est en Europe l’une des plus intéressantes depuis une quinzaine d’années, stimulée aux origines par le plus glorieux des hommes de culture et de spectacle vivant, un flamand né à Gand du nom de Gérard Mortier qui, depuis qu’il a dirigé la Monnaie de Bruxelles, a imposé au spectacle en Belgique et aux Pays Bas (puis ailleurs) une couleur particulière, très ouverte, imposant une qualité des productions inconnue jusqu’alors. Sa disparition en mars 2014 n’a pas effacé son souvenir, et on découvre chaque jour quelle influence il a pu avoir là où il est passé et quelles traces il a laissées.
Calixto Bieito ne faisait pas forcément partie de ses artistes favoris, mais c’est un metteur en scène qui là où il passe interroge les œuvres d’une manière cohérente et chirurgicale, d’aucuns diraient provocatrice.

À part en France, où il a fallu attendre la saison dernière pour voir une de ses productions (Turandot à Toulouse), Bieito est un des inévitables du Regietheater, dont les grandes productions sont visibles en Espagne, son pays d’origine, mais surtout à Bâle, à Stuttgart, à Berlin, et même en Italie.
La question posée par Tannhäuser est complexe, sans doute plus complexe que d’autres opéras de Wagner comme Lohengrin ou Fliegende Holländer. Elle est sans doute aussi plus complexe que celle posée par Parsifal. Un des indices de cette complexité est que Wagner est revenu continûment sur l’œuvre, en la révisant régulièrement, et pas seulement pour la première parisienne : on pense qu’il y a une version de Dresde et il y en a deux et une version de Paris, mais il y a aussi une version de Vienne et Munich, et Wagner, dans les dernières années de sa vie, envisageait d’y revenir, voire de refaire entièrement l’opéra :il meurt le 13 février 1883 et le 5 février, Cosima dans son journal note « il déclare par ailleurs vouloir donner d’abord Tannhäuser à Bayreuth ; s’il établit solidement cette œuvre, il en aura fait plus, dit-il, que s’il donne Tristan ». Si l’on s’en tient à Dresde et Paris, puisque ce qui nous est présenté à Gand est un habile mélange entre version de Paris (Acte I) et version de Dresde (Actes II et III), se pose déjà la question de l’évolution créatrice de Wagner, dont la version dite de Paris prend place au moment où a déjà composé Tristan (les orages Wesendonck sont récents) qui va être créé en 1865 et où sa vision du drame musical est assise. Le Wagner du Tannhäuser parisien n’est plus tributaire du grand opéra romantique, et au contraire cherche à construire l’identité nouvelle de la musique de l’avenir.
En ce sens, l’histoire de Tannhäuser est plurielle, comme on dirait aujourd’hui, c’est d’abord l’histoire d’un homme, face à ses contradictions et à ses désirs profonds, qui expose ses déchirements, et c’est l’histoire d’un artiste, qui puise dans son expérience personnelle pour créer, et qui finit par s’opposer à la doxa locale en cours (et en cour) à la Wartburg. On oublie aussi souvent de lire le titre qui nous renseigne sur cette dualité : Tannhaüser und (et) Der Sängerkrieg auf der Wartburg et non oder (ou). La deuxième partie du titre n’est pas un sous-titre. Comme si d’une certaine manière, der Sängerkrieg auf der Wartburg était un épisode de la vie d’un artiste, d’un parcours artistique.

Même ambiguïté sur les personnages féminins : le fait même que l’on ait confié quelquefois à la même chanteuse (à la santé vocale solide) Venus et Elisabeth conduit à se poser la question (assez hoffmanienne) de l’identité des ou du personnage féminin : deux visages d’un même Janus ? Deux femmes différentes, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre ; deux manières d’aimer, mais aussi deux désirs, exprimés, et vifs. Baudelaire en défendant Tannhäuser défendait aussi ces visions plurielles de la femme, sensuelle ou sensible, Jeanne Duval ou Apollonie Sabatier, parfum exotique ou parfum parisien. Tannhäuser est une fleur du Mal.
Au moment où Wagner reprend Tannhäuser, après la composition de Tristan, il va forcément en tenir compte dans sa réécriture du Venusberg. Ce Venusberg dans lequel Nike Wagner voit à la fois les désordres parisiens face à la sérénité germanique (personnifiée par le chant du pâtre initiant la scène finale du premier acte), dans lequel on peut voir aussi le monde superficiel des plaisirs face à la profondeur du monde artistique de la Wartburg, mais aussi le monde de la disponibilité et de l’ouverture à la nature, face au monde des règles et des sangles, face à un monde culturellement prisonnier, qui cache derrière un bel ordonnancement des désordres peut-être plus coupables que ceux affichés et revendiqués du Venusberg.

C’est ce dernier chemin que Bieito choisit de suivre, abandonnant résolument le débat esthétique (un chemin que Robert Carsen avait emprunté pour son Tannhäuser parisien), pour poser la question sans doute (apparemment) bien commune de l’opposition nature/culture, en indiquant clairement que toute culture signifie nature domptée, prisonnière, compressée qui cherche sans cesse à sortir par tous les pores.
Autant la vision du Venusberg présente une nature indomptée et sensuelle (très beau décor de Rebecca Ringst, fait de branchages suspendus se balançant au gré du vent dans les feuilles dont on entend le bruit), une nature habitée, vivante, qui caresse les corps et leur donne du plaisir (Venus s’y love sans cesse avec un plaisir onanistique non dissimulé), une nature sûre d’elle même et sereine, qui rappelle le Baudelaire de Correspondances (La nature est un temple où de vivants piliers…) autant la Wartburg est un monde géométrique, en laqué blanc, à la lumière aveuglante mais qui par le fait même qu’elle aveugle, rend invisible les corps torturés de désir et prisonniers de cette géométrie d’un ordre faussé devenus des ombres. Si Venus se laissait aller aux caresses des rameaux, Elisabeth est un corps tout aussi désirant, mais laissé seul au milieu de l’espace, sans la sollicitation d’un rameau bienveillant.

Tannhäuser surgit dans le Venusberg comme un passant, comme par hasard, un Parsifal tombé chez Venus, le Graal du désir, et l’on est bien proche de Kundry et de son jardin fleuri, ou un Siegmund épuisé, qui rencontre la sensualité d’une Venus-Sieglinde laissée seule au milieu des bois. L’allusion à l’un et à l’autre est trop claire pour ne pas interpeller le spectateur. Mais ce monde du désir se traduit dans une sorte de va et vient entre douceur et violence: en témoignent les cheveux qu’on caresse et qu’on tire, les têtes qu’on effleure ou qu’on agrippe, le désir est cette errance entre plaisir de la tendresse et plaisir de la violence que Bieito affronte avec une grande netteté.
Et du même coup, après la fuite de Tannhäuser de cet état de nature vers l’ailleurs, son arrivée au milieu des chasseurs est transitionnelle. Il rencontre d’abord le berger, ici une petite fille à la voix blanche, image de l’innocence et d’un amour serein qui contraste avec le Tannhäuser déjà détruit qui va tomber au milieu des chasseurs. La chasse est la première activité de régulation de la nature (les chasseurs, n’est-ce pas, sont les premiers écolos), d’une nature encore présente (la scène vidée de ses branches est néanmoins entourée d’arbres) : on est sorti d’une sorte d’Eden, d’état de nature au sens illuministe où la sensualité est partout et la culpabilité nulle part, pour tomber ou chuter dans le monde, et dans le monde naturel déjà touché par les hommes (d’où la chasse vue comme jeu humain dans la nature, comme début de domptage).

Et déjà ces chasseurs-mâles jouent à des jeux mâles dès qu’ils reconnaissent Tannhäuser, coups, jeux de combats, frôlements ambigus des corps (notamment évidemment entre Wolfram et Tannhäuser), torses nus, une sorte de sensualité dévoyée par la violence qui finit par un rituel de sang, proche de rituels vaudoo (on pense à Schlingensief à Bayreuth) où l’on est toujours aux bords de la transe, au bord du monde interdit au bord du monde des esprits, un monde du θάμβος (thambos) grec (la terreur sacrée notamment inspirée par la nature)

Ainsi le deuxième acte est fortement marqué par le premier, toujours sous-jacent. Derrière les smokings d’une société policée, se cachent les désirs, la violence, et la culture n’est qu’un habillage maladroit de l’état sauvage. Déjà Elisabeth seule avec son corps et habillée quasiment comme Venus, n’est plus du tout sur le chemin de la sainteté mais sur celui d’une identité humaine et féminine revendiquée, même si son père (qui plus tard ne se privera pas de reluquer la chair fraîche) lui fait endosser une veste légère qui la couvre partiellement et qu’il impose un decorum. Mais tous les autres apparaissent d’abord comme des ombres sous cette lumière aveuglante (éclairages très réussis de Michael Bauer), prêts à surgir derrière les piliers qui les dissimulent à moitié. Tout cela est à la fois très cru, très direct et très juste. Cet acte tout de violence d’abord rentrée puis exprimée pose immédiatement la question de Tannhäuser, mal à l’aise dans son costume d’artiste sage et courtisan qui va bientôt s’arracher ses habits et se singulariser. C’est bien de singularité qu’il est question dans ce travail.
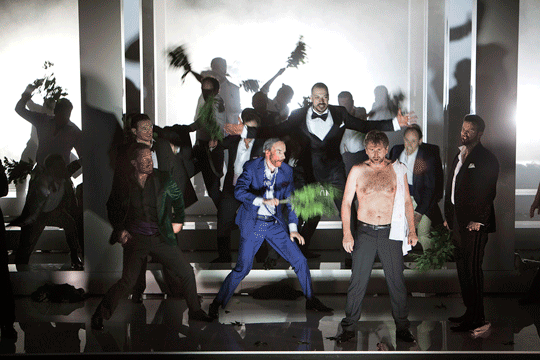
Les singularités brimées de tous les personnages s’opposent à celle affirmée de Tannhäuser. Le monde des courtisans, sortes de bêtes de salons qui assistent sans comprendre à cet hallali, s’efface bien vite et efface le rituel du concours et en fait une discussion violente, presque un bizuthage à la fois esthétique et philosophique d’où tout cérémoniel rigide est absent. Car la discussion devient existentielle, et non plus morale ou religieuse et on en vient aux mains. Le vernis social disparaît, la sauvagerie sous-jacente ne demande qu’à réapparaître sous la forme de cette flagellation rituelle à coup de rameaux (tiens tiens) dont Tannhäuser est victime.
Bieito fait de Tannhäuser le drame intérieur, et non plus une histoire sociale, religieuse ou artistique, mais non pas un drame individuel, mais un drame intérieur collectif dans lequel aucun personnage n’est épargné.

Le troisième acte commence par l’apparition d’un décor du 2ème acte envahi, désaxé, où pénètrent des éléments naturels, où le blanc immaculé est taché et envahi de noir, où les personnages sont eux mêmes prisonniers de ces éléments, comme Wolfram un Wolfram en permanence déchiré, violent, torturé par son amour d’Elisabeth, attiré par Tannhäuser, un Wolfram en permanence bousculé, qui n’a plus rien du poète éthéré qu’on peut souvent voir sur les scènes, et qui finit par chercher la mort et s’ensevelir tandis qu’Elisabeth perdue mange la terre qui jonche le sol, comme le faisait Venus et retourne ainsi à la nature, mais une nature angoissante et envahissante qui n’a rien de la nature vivifiante du premier acte. Dès lors, plus question de rédemption, de sainteté de rachat : c’est la lutte pour la vie, pour le revendication de soi, pour le désespoir existentiel. Wolfram (Daniel Schmutzhard, à la belle présence et très vrai en scène) détruit chante sa romance à l’étoile intensément, en la murmurant, pendant qu’Elisabeth (Liene Kinča) s’efface en arrière scène sans disparaître, et que Tannhäuser (Andreas Schager) revient, plus ravagé encore, plus singulier encore, confirmé dans son désir de retourner à Venus, mais aussi de massacrer ce monde qui l’a détruit et qui a saccagé son amour, et dont le récit de Rome ne fait que confirmer l’hypocrisie du monde et les masques de la société.

Venus apparaît donc, debout, regardant le lointain, et tous peu à peu, personnages, chœur de pèlerins, rampants, se soumettent à sa loi, la loi de la nature et des corps, triomphante.
Une fois de plus dans une mise en scène, Venus triomphe, comme à Bayreuth avec Baumgarten. Une Venus au total plus saine et plus vraie qu’aucun des personnages de l’œuvre .

On reste fasciné par la rigueur de ce travail, qui suit une logique implacable, qui fait du Venusberg un lieu de plaisir sans culpabilité, renvoyant la culpabilité sur le monde construit et artificiel de la Wartburg : un monde qui n’est pas si loin de celui de Parsifal que Bieito a déjà abordé à Stuttgart, la vision du 3ème acte est bien proche de celle d’un royaume du Graal abandonné aux forces naturelles et en ruines, d’ailleurs, Bieito fait offrir par Wolfram l’eau à Elisabeth (comme Kundry à Parsifal) et l’image finale fait de Venus une sorte de Parsifal officiant au milieu d’un peuple aux abois, réunissant (et récupérant) et Tannhäuser, et Elisabeth et Wolfram.
Et cette image parsifalienne finale, loin d’être une fantaisie, est bien amenée par une logique de l’œuvre où les personnages ne réussissent pas à résoudre leurs conflits internes, à cause d’un monde culturel oppressant et stérile, qui devient enfer, et n’ont plus d’autre solution que d’être ce qu’ils sont, dans une nature vue comme solution finale. Venus n’est plus la déesse de nos perversions secrètes, mais de notre soif de vrai et de nos penchants naturels. Nous devenons responsables et surtout pas coupables.
Cette symphonie des corps revendiquée est mise en scène de manière magistrale par Bieito, car au-delà du propos fondamental nature/culture, Bieito gère avec une précision incroyable et une habileté presque magique les mouvements des corps, y compris dans leur plus grande intimité, dans une « Personenführung » dont la précision et la justesse rappellent Chéreau. Et il remplit la scène dans une géométrie des mouvements –des masses- impressionnante, quelquefois ritualisés, quelquefois faussement désordonnées, quelquefois anguleuse : le mouvement de Tannhäuser parcourant la scène du 2èmeacte de cour à jardin, du proscenium au fond de scène, de manière à la fois géométrique, mais aussi vaguement perdue, qui ne cesse d’attirer l’œil malgré le déroulement de l’intrigue au centre du plateau, est vraiment prodigieuse.
Du point de vue musical, comme toujours dans les spectacles réussis, le plateau répond à la sollicitation urgente de la mise en scène, et à la rigueur du plateau répond une fosse bien préparée et dirigée par Dmitri Jurowski qui dans une salle aux dimensions moyennes (l’opéra de Gand est vraiment une jolie salle, avec des foyers en enfilade impressionnants) réussit à ne jamais couvrir les chanteurs. Il a travaillé de manière toute particulière sur les bois, en les mettant en valeur notamment dans les parties plus symphoniques et il isole certains pupitres pendant l’ouverture qu’il fait plus particulièrement entendre en proposant une lecture analytique mais jamais froide, toujours élégante et équilibrée. Une direction colorée, quelquefois chatoyante, jamais plate, et souvent tendue et dramatique (début du troisième acte) qui mérite d’être soulignée et louée. Sans un orchestre de qualité et de bon niveau, avec de menues scories aux cuivres, il n’eût pu proposer une lecture aussi profonde et aussi claire.
Le chœur dirigé par Jan Schweiger est aussi plein de relief et mis en valeur sans jamais être imposant, d’ailleurs la mise en scène le garde la plupart du temps en coulisse : les pèlerins sont en coulisse, et seule la cour est sous les projecteurs, comme si Bieito voulait notamment au premier acte garder le côté évocatoire et lointain du retour des pèlerins, et effacer de la vue toute allusion religieuse, pour mieux préparer la scène finale où ces pèlerins revenus de Rome finiront par entourer Venus.
Le plateau ce soir proposait Andreas Schager dans Tannhäuser (il alterne avec Burckhard Fritz) et la jeune Liene Kinča (au lieu d’Annette Dasch). Tous les autres avaient chanté la première ; globalement, on ne peut que saluer la prestation de chacun et leur ardeur à défendre l’œuvre et la production, car les performances d’acteur de chacun sont notables.
C’est Ausrine Stundyte en Venus qui peut-être impressionne le plus au niveau scénique la soprano lithuanienne, qu’on va bientôt voir dans Lady Macbeth de Mzensk à Lyon, chante avec son corps avec une présence impressionnante; ce soir néanmoins elle m’a semblé un peu en dessous de ses performances vocales usuelles, la voix manquait quelquefois de puissance, mais jamais de couleur, mais jamais d’expression, mais jamais de présence. Et c’est une actrice exceptionnelle, totalement fascinante en scène, d’un naturel et d’une vérité étonnants. On voit rarement un tel engagement en scène.
Face à elle, Andreas Schager chante lui aussi avec un engagement prodigieux. Il n’est pas toujours un acteur exceptionnel, mais il réussit là une vraie performance, car il ose tout avec résolution. Il a une très belle présence, valorisée par la mise en scène qu’il suit avec beaucoup de rigueur. Avec une diction exemplaire, une voix chaleureuse, claire, bien projetée, il est un Tannhäuser de grand style. Un seul problème : les aigus, quelquefois trop volumineux, trop démonstratifs qui étouffent un peu ceux de la partenaire. Un peu de contrôle de ce côté là serait sans doute bienvenu. Mais quelle prestation ! De Erik à Siegmund, Siegfried ou Parsifal, quel rôle de ténor wagnérien pourrait-il lui échapper ?

L’autre fleur de Lithuanie, Liene Kinča, soprano à la voix claire, très bien projetée, est une Elisabeth sans doute plus soucieuse du chant et peut-être à peine moins engagée que ses deux collègues. Il lui manque un peu de maturité pour rendre le personnage d’Elisabeth aussi torturé que le voudrait la mise en scène, malgré une vraie présence en scène. Le chant reste quelquefois un peu trop mat, sans toujours avoir le relief voulu, mais la prestation reste plus qu’honorable.
Daniel Schmutzhard est un Wolfram sans nul doute plus engagé que d’habitude et dont le personnage a visiblement intéressé Bieito. Wolfram est souvent vu comme le mal aimé un peu transi, noble cœur et noble voix, qui contraste avec un Tannhäuser torturé, extériorisant ses espoirs et désespoirs. Il ferait le pendant de Tannhäuser : il en est ici à la fois le concurrent et l’ami, dans une relation ambiguë au héros, et dévoré par le désir et par le dépit d’être dans cette « Liebhaberkrieg » auf der Wartburg le perdant. Son jeu très physique, son engagement, et la voix à la fois très claire (c’est surprenant, c’est presque un baryténor) le placent sur un niveau voisin de Tannhäuser. Belle prestation vocale, belle énergie, grande présence, il m’avait moins marqué en Papageno à l’Opéra Bastille, il est ici un très beau et assez inhabituel Wolfram.

Autre agréable surprise, le Landgrave d’Ante Jerkunica. Une voix à la fois grave et très sonore, une diction impeccable, une présence notable : en bref l’un des Landgrave les plus convaincants vus ces dernières années. Le timbre est incroyablement sonore, avec des reliefs et des couleurs à la Ghiaurov. Seul petit problème ce soir-là, quelques passages à l’aigu un peu plus mats et difficiles, ce qui surprend vu les qualités de cette voix : l’aigu manque quelquefois d’un éclat qu’on attendrait. Mais cela reste occasionnel et véniel au regard de l’impressionnante prestation d ‘ensemble. Avec un tel quatuor et un tel orchestre, rater l’occasion de ce Tannhäuser serait bien étonnant, même si les rôles de complément sont pour certains un peu moins bien ciblés.
Le Walther von der Vogelweide de Adam Smith est notable : le rôle est souvent distribué à un ténor en qui l’on voit un futur Lohengrin. La voix est très présente, bien placée, bien projetée, chaude, et le personnage n’est pas pâle. Le Biterolf de Leonard Bernad est en revanche un peu plus vert, la jeune basse roumaine émerge des concours, et n’a pas encore la pose de voix ni la projection qui s’imposeraient, même dans ce rôle moins exposés. Stephan Adriaens (Heinrich der Schreiber) et Patrick Cromheeke (Reinmar von Zweter) complètent honorablement la distribution.
Incontestablement le spectacle est réussi, parce qu’au delà d’une idée menée jusqu’à son terme – sous la culture perce toujours un état sauvage qui ne demande qu’à s’exprimer – , nous portons avec nous notre côté animal, notre face cachée et dissimulée derrière les rituels sociaux: elle est ce qui reste quand tout est oublié ou quand l’urgence l’exige. Lors de l’image finale, Venus, debout regarde le lointain, tandis que tous, chœur et personnages, héros vainqueurs ou vaincus, se retrouvent à terre et dans une dépendance qui ne fait aucun doute. La Venus de Bieito est une Venus sensuelle, certes, mais d’une fraicheur qui n’a rien à voir avec la maquerelle qu’on voit quelquefois sur les scènes, ou la Kundry de la scène des filles fleurs que d’autres nous proposent. La Venus de Bieito est vitale, et elle alimente notre sève, elle nous enserre et nous enferme dans notre Ordre qui est l’Ordre des corps.

Bieito pose la question de la pulsion, il ose le corps, omniprésent, un corps détruit ou maculé, un corps érotisé, il impose la chair, qui n’est pas si triste, mais qui n’est jamais très loin de la violence, eros, thanatos, souffrance, violence. Tel est le Tannhäuser vu par Bieito qui s’appuie sur la vision wagnérienne toujours ambiguë de la question du désir exprimé et réprimé, chanté et tu, un désir violent présent chez tous les héros wagnériens, sauvages ou policés, éduqués ou éducables, de Senta à Siegfried, de Sachs à Parsifal, d’Isolde à Eva et à Elisabeth, de Siegmund à Alberich, de Sieglinde à Brünnhilde. Bieito nous dit qu’au commencement était le corps, et le corps était l’homme: il pose aussi la complexité d’une œuvre qu’on croyait une fois pour toute classée dans les œuvres « d’avant Tristan ». Wagner songeait une semaine avant de mourir remettre Tannhäuser sur le métier, pour le proposer à Bayreuth, avant Tristan. Il n’y a pas de Wagner simple : on n’en a pas fini avec Tannhäuser. [wpsr_facebook]