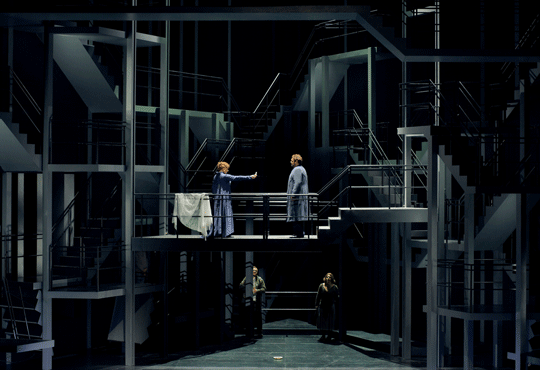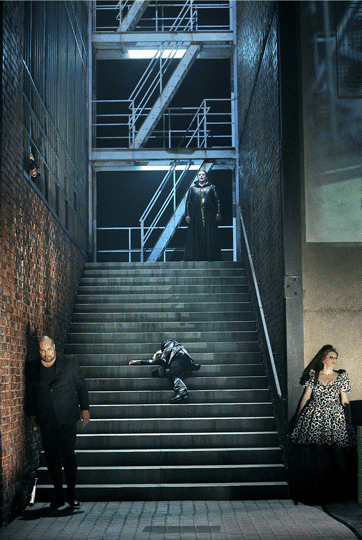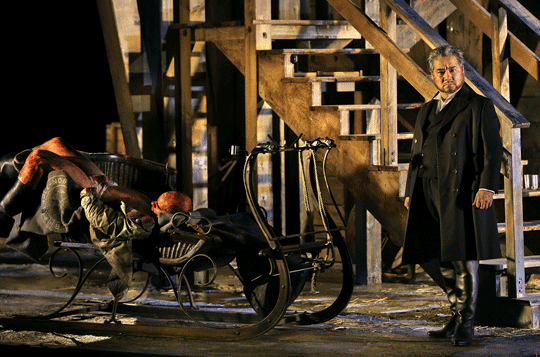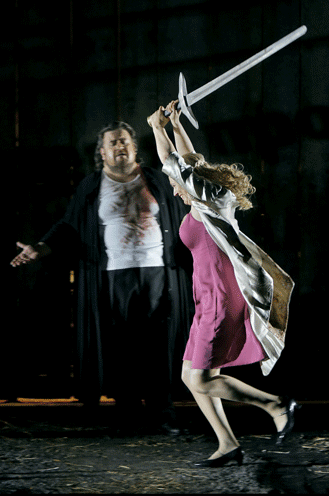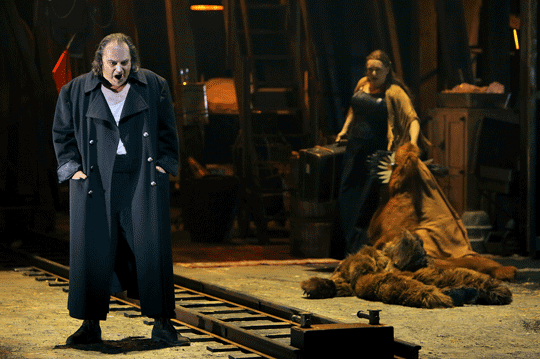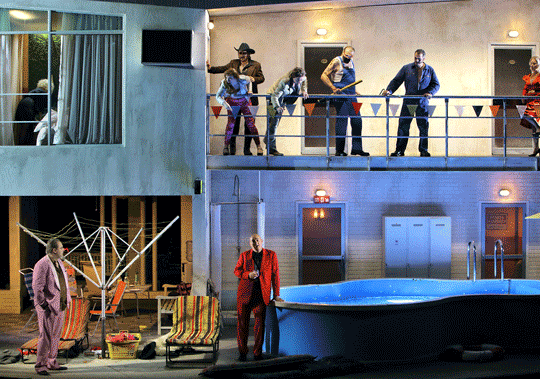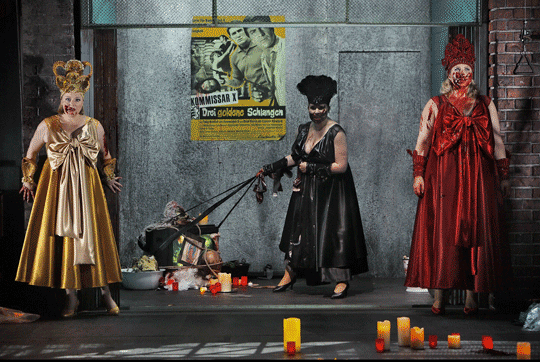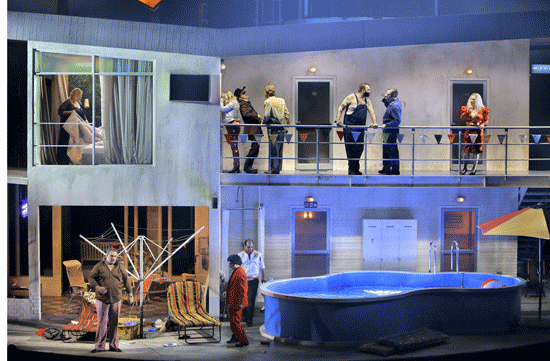Revoir après quelques mois une production qui a marqué est toujours intéressant pour stabiliser les impressions : il était par exemple singulier de constater que tous les amis qui avaient vu la production à sa création ce printemps ont plus apprécié la mise en scène de David Bösch qu’à l’époque, signe qu’elle se stabilise et qu’elle vit. Autre enseignement important : des dizaines d’imbéciles patentés revendaient leur place parce que Jonas Kaufmann ne chantait pas Walther. Or ce n’est pas Walther qui fait Meistersinger, mais Sachs et l’orchestre. Aussi bien le médiocre Walther affiché n’a pas gâché loin de là notre plaisir et nous sommes tous sortis du Nationaltheater enthousiastes et heureux, voire tourneboulés par ce que nous avons entendu.
Une fois de plus s’est appliquée la théorie du trépied : voix, chef et mise en scène font l’opéra, un seul fonctionne et c’est bancal, si deux fonctionnent, cela passe bien, si trois fonctionnent, c’est le nirvâna. Ici nous étions à 2,5 (parce que toute la distribution a fonctionné sauf Eva et Walther) et c’était pourtant le Nirvâna puissance paradis.
Voilà pour donner la mesure (démesurée) d’une représentation qui marque ces Meistersinger comme les plus beaux du moment, et qui déchainent un indescriptible enthousiasme du public (de la masse diraient certains critiques dubitatifs).
A l’évidence, c’est le chef Kirill Petrenko et son orchestre de retour d’une tournée triomphale en Europe qui ont, avec le chœur extraordinaire, emporté le morceau et fait qu’on est passé d’une représentation des Maîtres Chanteurs à LA représentation. Par bonheur elle était retransmise sur staatsoper.tv, le streaming de la Bayerische Staatsoper, et les cyber-spectateurs l’ont pu constater, comme les spectateurs de la salle.
La distribution a un peu évolué depuis juin dernier. On retrouve Wolfgang Koch en Sachs, et c’est heureux, on retrouve aussi Eike Wilm Schulte en Kothner, Benjamin Bruns en David, mais Pogner est cette fois Georg Zeppenfeld, Magdalene Claudia Mahnke, Beckmesser Martin Gantner, tandis qu’Emma Bell était Eva, et Robert Künzli remplaçait Burckhard Ulrich, lui-même prévu initialement pour se substituer à Jonas Kaufmann, malade pour une longue période.
On avait donc une relative curiosité pour découvrir ce ténor venu de Hanovre où il est en troupe. Ce fut une déception. Personne ne s’attendait à un nouveau Kaufmann, et les deux premiers actes (qui ne sont pas il est vrai ceux où Walther s’exprime le plus) se sont passés sans encombre, même si le chant n’était pas très incarné et la voix mal projetée.
Cela s’est gâté au troisième acte, attaques douteuses, problèmes de justesse, aigus dardés sans ligne de chant, graves peu audibles, mais surtout moments très ingrats pour un chant sensé être un modèle…le personnage est moins charismatique que celui interprété par Kaufmann, mais mieux vaut cesser de penser à ce qui a été perdu. Quand on pense que la prestation de Kaufmann a été considérée par certains comme décevante, on constate ici la distance. Avec deux remplacements successifs, pour un rôle aussi délicat que Walther, c’était le risque…mais on rage un peu en pensant que l’avant-veille sur la même scène Klaus Florian Vogt, autre grand Walther, chantait Florestan dans un Fidelio par ailleurs magnifiquement distribué.
Eva était Emma Bell, entendue jadis à la Scala dans l’Elettra d’Idomeneo, une chanteuse valeureuse, à la voix puissante, trop puissante peut-être notamment à l’aigu. La voix est mal contrôlée, les graves manquent de corps, et dès le premier acte les aigus déséquilibrent la prestation. On craignait pour le quintette qui risquait d’être un peu vacillant, mais ce fut son meilleur moment, aidée en cela par un Kirill Petrenko très attentif et accompagnant au millimètre ses chanteurs. Eva est un rôle difficile, donné souvent aux chanteuses wagnériennes ou straussiennes en devenir : Elisabeth Schwartzkopf en fut une inoubliable, mais aussi Gwyneth Jones, Helen Donath et d’autres comme Anja Harteros, initialement prévue qui fut pour moi dans ces quinze dernières années la plus belle (à Genève, aux côtés de Vogt). Le rôle n’est pas vocalement celui d’une frêle jeune fille car il exige du corps, de l’énergie, de la vigueur. J’y attends impatiemment un jour Hanna Elisabeth Müller. Eva n’est pas une oie blanche, c’est une fille qui sait ce qu’elle veut et même un peu perverse, une croqueuse de pomme en quelque sorte. Emma Bell l’interprète avec aisance, mais le chant n’est pas pour moi pleinement celui qu’on attend dans Eva. À une semaine de distance, j’ai entendu à Berlin (Komische Oper) l’Eva de Johanni van Oostrum autrement plus émouvante et juste. Il en sera question dans un article prochain.
Heureusement que Wagner n’a pas prévu pour son opéra-comique de concentrer toute l’intrigue autour des deux personnages, mais au contraire de diffracter la distribution pour équilibrer les rôles. A part Sachs, qui est un rôle écrasant, Beckmesser, Pogner, David, Magdalene, voire Kothner ont une vraie présence vocale et scénique dans l’œuvre, même s’ils n’ont pas une présence égale. Wagner joue les équilibres inévitables de l’opéra-comique, avec sa galerie de portraits mis tour à tour en relief.
Tareq Yazmi, l’un des membres de la troupe de Munich de très grande qualité, est un Nachtwächter de choix, sonore, à la présence vocale marquée sans surchanter pourtant. Notable intervention.
Martin Gantner était Beckmesser y compris en juillet dernier puisque Markus Eiche (qui chantait en juin) était à Bayreuth. On avait en jun loué l’incroyable prestation de Eiche, dont la voix est notable, et qui était sans doute l’un des meilleurs Beckmesser vus ces dernières années. Beckmesser est d’ailleurs très rarement mal distribué, et toujours à des chanteurs aux qualités éminentes : à Bayreuth, Adrian Eröd et surtout Michael Volle furent des Beckmesser de référence, plus loin en arrière, on ne peut oublier Hermann Prey: tous marquèrent le rôle sur la scène du Festival avec tous les mêmes qualités vocales et de diction. Beckmesser demande un chanteur à l’articulation impeccable et si possible un chanteur de Lied (Prey !). Un Gerhaher ne serait pas incongru dans ce rôle.
Ce n’est pas la musique qui fait problème chez le personnage de Beckmesser c’est le rapport texte /musique : son erreur finale vient qu’il est extérieur au texte sans donner à sa musique la couleur qui lui correspond : c’est d’ailleurs pourquoi il faut justement un parfait diseur ; c’est bien là le credo d’un Wagner convaincu que texte et musique doivent procéder du même auteur : là est le secret de la poésie.
Si Martin Gantner n’atteint pas l’aisance scénique de Markus Eiche, s’il n’a pas son timbre chaleureux, il reste que sa composition est vraiment convaincante, et qu’il est à l’aise avec la mise en scène. C’est un Beckmesser qui est loin de déparer dans la distribution et obtient un immense succès très mérité. Sa scène du balcon sur le chariot élévateur, sous la fenêtre d’une Eva-Magdalene qui ressemble à Mélisande aux longs cheveux est un moment délirant et très réussi. Par ailleurs, il dit le texte avec netteté et précision, et le chant n’est jamais problématique ou décevant. La voix ne manque d’ailleurs pas de qualités : clarté, lisibilité, timbre agréable. Tout ce qu’il faut à un Beckmesser.
Georg Zeppenfeld dans Veit Pogner est miraculeux, simplement : clarté, diction, profondeur, humanité : son chant est d’une intelligence rare, le personnage est immédiatement sympathique. Zeppenfeld a une présence forte qui s’impose, et son timbre assez clair convient parfaitement au contexte. Chacune de ses apparitions est l’occasion d’un triomphe.
Eike Wilm Schulte est de nouveau Kothner, plus en voix qu’au printemps. Et donc il impose ce personnage d’ex-Merker, l’ancienne gloire qui joue l’ancienne gloire. Eike Wilm Schulte fut un baryton de caractère, particulièrement apprécié. Il est encore très crédible, la voix est bien marquée, la projection et la diction impeccables et la silhouette particulièrement sympathique.
De nouveau Benjamin Bruns est David : un David bien chantant, si bien chantant que derrière ce David on entend un Walther…Contrôle vocal, diction impeccable, jolie ligne, nuances, couleurs : tout y est et ce David est l’un des meilleurs qu’on puisse entendre aujourd’hui. La voix a gagné aussi en projection et en volume ; utilisée avec intelligence, de couleur presque mozartienne, très raffinée et séduisante: une prestation remarquable, tout comme le printemps dernier.
Claudia Mahnke était Magdalene, un rôle difficile comme celui d’Eva, bien évidemment dans l’ordre des seconds rôles. C’est un rôle qu’il est difficile de faire valoir et de faire exister. Et Claudia Mahnke, dont on va vu la magnifique Brangäne à Bayreuth cette été où elle remplaçait Christa Mayer, a décidé de jouer la fluidité, la simplicité et la fraicheur, et donc une sorte de présence discrète, vocalement bien assise, mais sans insister, sans jamais gonfler le volume. Là aussi, c’est le jeu de l’opéra-comique qui s’impose, le jeu avant le chant, le texte avant la musique, mais toujours avec une singulière présence
Reste Wolfgang Koch : à lui seul il vaut le voyage. Hans Sachs est l’un des rôles écrasants du répertoire, un rôle qui réclame de l’endurance, et qui d’acte en acte a de plus en plus à chanter, si bien que le monologue final du 3ème acte
Verachtet mir die Meister nicht,
und ehrt mir ihre Kunst!
est souvent marqué par la fatigue, voire l’épuisement de l’interprète : c’était le cas chez Michael Volle à Zürich, chez Hawlata à Bayreuth, chez Tomas Tomasson à Berlin il y a dix jours…Seul je me souviens d’un Karl Ridderbusch encore assez vaillant en 1981 à Munich.

Wolfgang Koch n’échappe pas à la règle, mais il a un tel art du dire et de la couleur qu’il sait masquer la fatigue.
Ce qui frappe chez Koch, c’est le naturel de l’expression : il ne chante pas, il joue, il dit, il converse : on n’est jamais dans un chant démonstratif, mais toujours dans un vrai personnage d’opéra-comique sur le fil du rasoir stylistique, jamais vulgaire, d’une aisance confondante, d’une intelligence du texte si fine que c’en est passionnant de l’écouter simplement dire avec des changements de rythme, des couleurs incroyablement variées, des moments d’une très grande intensité jamais surjoués. Il faut l’entendre dire « Wahn überall Wahn » au troisième acte à la manière d’un Falstaff avant la lettre avec une lassitude discrète dans le ton. Si Koch dominait l’italien, il serait d’ailleurs un Falstaff exceptionnel dont il a l’allure et le style. Il n’y a aucun doute, il est Sachs, il n’y en a pas d’autres aujourd’hui sur le marché lyrique ; il domine le rôle à la manière d’un Domingo chantant Otello. On ne voit plus qui pourrait lui disputer le primat.
Ce primat, c’est celui du travail, de la modestie, de l’intelligence. Koch est incomparable, notamment quand il est dirigé par Petrenko (même s’il fut un Sachs splendide à Berlin avec Barenboim) avec qui il partage la respiration et le rythme qui répond mot à mot et note à note aux sollicitations du chef. Qui était à Bayreuth en 2015 se souvient d’un souverain deuxième acte de Walkyrie, où il fut un Wotan époustouflant d’intériorité. On est là dans cette veine, où jamais la relation du texte à la musique n’est trahie, où la relation texte/musique tisse un lien d’une totale évidence. Wolfgang Koch n’est à rater sous aucun prétexte dans ce rôle.
Le chœur de la Bayerische Staatsoper est ici irremplaçable dans une œuvre créée dans ce théâtre il y a 148 ans : il montre, tout comme l’orchestre, que Meistersinger von Nürnberg est dans les gènes ; il fallait pour le comprendre s’arrêter devant ce « Wach auf » dont le point d’orgue est tenu jusqu’à l’impossible et qui donne le frisson. Mais dans la nuance, dans le choral à la manière de Bach, comme dans le grand ensemble final (un défilé des corporations à tomber par terre) il est ici exceptionnel et on peut le dire irremplaçable.
La mise en scène de David Bösch, je l’ai écrit, est apparue plus convaincante à la deuxième vision. Non qu’elle m’eût déplu en juin, mais la mise en scène d’Andrea Moses à Berlin diffusait une émotion d’une intensité qui n’est pas aussi sentie ici. Le travail de David Bösch rappelle l’ambiance particulière de L’Orfeo, présenté au Prinzregententheater il y a deux ans et repris lors de la saison 2014-2015, spectacle poétique, souriant, imaginatif, qui a laissé des traces profondes chez les spectateurs. Il dessinait alors et aujourd’hui un monde un peu marginal, dans un « quartier » un peu déglingué, dont certains ont réussi (Pogner avec sa « belle » voiture marquée à son nom mais néanmoins poussiéreuse) et d’autres moins. Comme pour L’Orfeo, le centre qui focalise l’attention est un véhicule, le Bulli Volkswagen pour Monteverdi, et aujourd’hui la fameuse camionnette Citroën type H qui abrite la cordonnerie de Hans Sachs, dont le nom est affiché au-dessus au néon (qui deviendra « ach » au troisième acte). Bösch joue beaucoup sur l’ironie, une ironie sympathique et chaleureuse, comme ces références permanentes à 1868, la création des Meistersinger à Munich, jusque dans la plaque d’immatriculation de la camionnette.
L’idée du quartier périphérique est plus marquée encore au deuxième acte où le chavirari final finit en opposition police (le malheureux Nachtwächter) et bande de jeunes : le groupe des apprentis autour de David est d’ailleurs toujours légèrement agressif. Ce monde est fermé, et dit ses traditions à travers la tradition des Meistersinger (dont les photos sont projetées), et la tradition des groupes fédérés par une activité, le chant pour les uns, le foot pour les autres, avec la bière pour liant.
La « Festwiese » utilise les modes du temps, la pub, les commentaires en style télévisuel, mais une télévision pauvre en moyens, aux images hésitantes, floutées, brouillées, maladroites, qui font évidemment sourire ou rire. Il faut attendre la dernière image pour comprendre le sens d’une production qui conduit à la fin des Maîtres : Beckmesser revient en scène veut tirer sur Sachs isolé pour se retourner finalement l’arme, pendant que la génération suivante (Eva et Walther) a quitté la fête sans se retourner. C’est bien l’idée qui est ici développée : la survivance des traditions, leur perte de sens et leur fin : calicots et décorations s’écroulent comme un monde de Klingsor détruit, mais sans héros ni croix.
De croix d’ailleurs, il est question dès le premier acte, où le choral initial n’est pas dans l’église, mais apparaît en procession, au travers d’un décor fait d’échafaudages d’une sorte de studio de tournage : l’église n’est plus un monde clos initial où les maîtres officient, elle est dans la rue, dans ce vaste hangar où tous passent et se réunissent.
On comprend pourquoi David Bösch plaît : son théâtre n’est pas idéologique, loin d’un Regietheater qui poserait des questions théoriques et politiques, mais un théâtre de l’humain, avec ses doutes et ses enthousiasmes, avec ses sourires et ses mélancolies. Un théâtre qui cherche des racines populaires (c’était déjà net dans L’Orfeo) ou qui cherche la vérité des personnages, plus que celle du contexte. C’est un théâtre qui utilise des images d’aujourd’hui, mais sans porter jugement et qui devrait convenir à un public large : en tout cas il correspond ici parfaitement au genre : un décor marqué, des objets, une réalité envahissante et pourtant une très nette volonté de la poétiser, une sorte de poétique de l’objet qui n’est pas sans rappeler le « ready made » cher à Duchamp, dans un univers noir, aux couleurs pâles qui contraste avec les fêtes vivement colorées des mises en scène plus traditionnelles. Dans ce cas, « le noir te va si bien » parce qu’il n’est pas triste, mais laisse passer un voile d’uniformité dans un monde hétéroclite et diversifié, alors que le kaléidoscope coloré de travaux plus traditionnels renvoie beaucoup plus à des clichés plaqués et totalement artificiels.
Une mise en scène généreuse, humaniste, mélancolique aussi, qui constate les traces de ce qui fut et qui ne sera plus.
Enfin, ce qui tient ce spectacle et fait qu’on court le voir, c’est, last but not least, l’orchestre et la direction fabuleuse de Kirill Petrenko. Un orchestre totalement dédié, totalement dans les mains de son chef, totalement en confiance, en confidence, qui montre à quel point il fait corps avec son directeur musical. Et quels pupitres ! Un hautbois à se damner, un violon solo doux-amer, des cuivres jamais tonitruants, jamais imposants, mais toujours fluides, toujours en fusion particulière avec le reste de l’orchestre, sans imposer ni volume ni puissance, mais cherchant seulement à faire musique.
Kirill Petrenko prend à revers les partisans d’un Wagner « couillu », il joue à plein le jeu de l’opéra-comique et de la prééminence du texte, l’orchestre accompagnant le texte et le dialogue par une approche pointilliste, d’une clarté inouïe, laissant entendre tout l’orchestre et tous les détails de la partition, mais au service du théâtre, au service du dialogue, au service de l’échange. Il joue le jeu de la « Gesamtkunstwerk », de l’œuvre d’art totale où chacun est à sa place. Pourtant, Petrenko est partout : j’ai écrit quelque part qu’il était une sorte de Shiva de la direction musicale, attentif au moindre détail, et accompagnant le plateau avec un souci de précision tellement rassurant pour les chanteurs : il dirige le quintette en joailler, avec une finesse d’approche incroyable, et un souci des équilibres qui permet la fusion des voix, dans cette distribution où certaines voix étaient un peu hétérogènes. Il réussit à équilibrer le quintette et à en faire un des moments incroyables de la soirée. Même impression pour le final du 2ème acte et surtout la transition vers l’ensemble final, acrobatique et prodigieuse, et peut-être encore plus avec le « concertato » final du premier acte. En bref, on ne sait où donner de l’oreille tant cette musique ne fait pas fresque, mais mosaïque sonore où chaque son est une tesselle qui brille tour à tour, donnant à l’ensemble une vie inouïe, un dynamisme unique, une énergie, une vitalité au service de l’œuvre, tout cela avec une modestie au service de la musique qui étonne et qui met la salle en folie tant l’impression domine de redécouvrir la partition.
Car c’est bien le caractère d’une approche qui apparaît toujours neuve : ayant entendu Petrenko en juin, j’étais « préparé » en quelque sorte : je venais pour la direction et pour Koch, et j’ai été exaucé. Et pourtant, c’est encore la stupéfaction qui domine, l’étonnement de redécouvrir, non, de découvrir ce qu’on croyait connaître, ce qu’on attendait et qui a de nouveau le parfum de l’inattendu, et de la surprise, incroyable et délicieuse, d’une œuvre entendue – dans une belle production pourtant – la semaine précédente à Berlin, et de constater une fois de plus l’insondable nouveauté de notre vieux compère Richard Wagner grâce à ce nouveau prophète de la direction musicale. [wpsr_facebook]