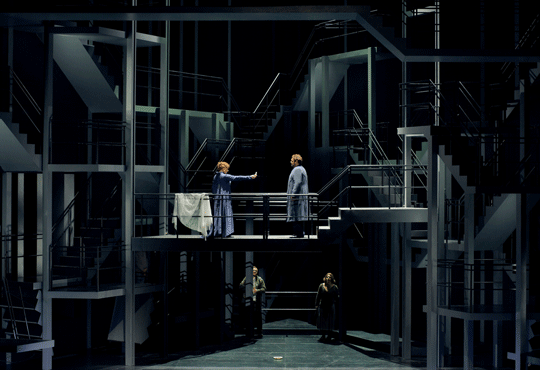
Werkstatt Bayreuth qui est le concept inventé par Wolfgang Wagner pour montrer que le centre du Festival, c’est Richard Wagner et les lectures diverses de ses œuvres. Ainsi reviennent sur le métier les mises en scènes avec un détail de plus ou de moins, voire quelquefois des changements importants (rappelons pour mémoire Chéreaulâtre le Ring 76 et le Ring 77, très différents). Cette année, le Tristan und Isolde de Katharina Wagner, qui n’avait pas enthousiasmé les foules, revient avec une distribution partiellement différente, mais une mise en scène qui ne semble pas avoir trop bougé : adieu Werkstatt ? Ainsi donc, de nouveau un premier acte labyrinthique dans des images à la M.C.Escher ou à la Piranèse, un second acte étouffant dans une cour de prison surveillée par des projecteurs, et un troisième acte fait de brumes et d’images rêvées surgissantes, pour finir de manière brutale et réaliste : plus de Liebestod, rangée au magasin des rêves interrompus, et un Marke bien décidé à emmener son amoureuse femme à la maison. On se reportera à l’article écrit sur ce blog l’an dernier qui rendait compte de deux représentations .
J’ai relu mon texte de l’époque, et je ne vois pas vraiment ce que je pourrais modifier, au moins du point de vue scénique, mais peut-être aussi du point de vue musical, Isolde mise à part.

La distribution réunissait en ce 1er août l’Isolde nouvelle de cette saison, Petra Lang, une nouvelle Brangäne, Claudia Mahnke, remplaçant Christa Mayer malade. Une distribution féminine différente, face à une distribution masculine inchangée, dominée par le Tristan de Stephen Gould, désormais référence dans tous les théâtres où il le chante. Le 9 août Christa Mayer rétablie chantait Brangäne.
Même si globalement le travail de Katharina Wagner n’a pas la force de ses Meistersinger, on peut aimer cette approche qui tend à prendre à revers tout « romantisme ». Dans la mise en scène de Katharina Wagner, tout est dit au lever de rideau : on sait que Tristan et Isolde vivent un amour absolu, éperdu et sans concession, à travers ce labyrinthe étouffant construit ad-hoc pour les empêcher de se voir, ou pour les contraindre à se chercher sans cesse, avec deux serviteurs qui n’ont de cesse d’essayer en vain d’éviter le scandale et qui bougent en tous sens, qui pour fermer un accès qui pour bloquer les issues..

L’absence de rupture entre premier et deuxième acte, où dès le lever de rideau, Isolde et Brangäne jetées aussitôt dans une fosse, qui ressemble à une salle de torture bientôt suivies de Tristan et Kurwenal, montre que tout a été prévu à l’avance, que sans doute on les « cueillis » au débarquement pour les jeter ainsi dans ce cul de basse fosse. Autant Brangäne et Kurwenal cherchaient à bloquer toutes les issues au premier acte, autant au contraire ils cherchent (surtout Kurwenal qui s’y essaie obstinément) toutes les issues possibles au deuxième. L’ensemble de l’histoire a été construite par Marke, désireux de se débarrasser de l’amour mythique pour posséder Isolde sans concurrent. Tout est prêt pour que se déroule le drame : le dispositif fermé, les fausses échelles, et aussi le drap brun laissé-là qui va protéger un temps le couple des projecteurs aveuglants (lumières de Reinhard Traub). Marke a fait ramener Isolde par Tristan par ce qu’il sait leur amour, parce qu’il veut qu’il éclate, tel un abcès, et veut se débarrasser du rival : il construit à l’avance la trame dont il pense probablement qu’elle se terminera à l’acte II. Quand tout est dit, il laisse les basses œuvres à Melot, et quitte la scène, traînant Isolde avec lui. Melot (Raimund Nolte) n’est d’ailleurs pas si à l’aise avec les dites œuvres, il hésite, regarde en arrière vers Marke, ce n’est qu’après quelques secondes qu’il décide de poignarder Tristan, le héros, son ami, dans le dos…L’image finale est bien celle d’un Tristan qu’on croit mort (comme il se doit), et le départ anticipé de Marke avec Isolde laisse insinuer que c’en est terminé avec cette histoire.
Mais non, au troisième acte (image initiale superbe inspirée de Georges de la Tour), les compagnons de Tristan le veillent, attendant l’issue fatale pour laquelle tout est prêt. Et Tristan agonisant dans son délire fait surgir des images d’Isolde inscrites comme dans une voile de navire triangulaire, pour expirer devant l’Isolde réelle. L’arrivée de Marke (image brutale de sa troupe, tache violente jaune dans cet univers gris) montre que même la mort est organisée : les sbires portent un signe de deuil ; le catafalque est prêt et ils se débarrassent des compagnons du héros pour construire une mort pour la galerie, pour l’histoire, une mort officielle et politique, tandis que les cadavres des compagnons gisent en une tache de couleur brune et verte.

La Liebestod n’est plus une Liebestod, mais l’ultime expression d’un amour que Marke laisse s’exhaler en montrant d’ailleurs quelque signe d’impatience, pendant que Brangäne essaie d’assister piètrement Isolde, gâchant par sa présence même l’image traditionnelle d’Isolde seule avec son aimé. Entraînant ensuite Isolde vers la sortie par le même mouvement qu’au final du deuxième acte, Marke sonne enfin la fin du rêve : Isolde sera une morte-vivante.

Katharina Wagner, en faisant de Marke une sorte de Wotan au petit pied, auteur d’une machination, calculée dans ses détails, y compris en laissant les amants se rencontrer et s’aimer, donne au drame une valence politique à laquelle on n’avait pas forcément pensé. En fait, ce qui intéresse Marke, ce n’est pas tant se débarrasser d’un rival en amour, mais plutôt en politique, de se débarrasser d’un potentiel concurrent : quand le meurtre au fond de la fosse a échoué, il organise des funérailles officielles comme on peut en faire pour donner le change après un assassinat politique. Et ainsi tous les discours du Roi sont des pièces politiques à faire inscrire au livre des heures, qui n’ont de fonction que pour les apparences de l’histoire, et pas pour la réalité. Katharina Wagner fait de l’amour de Tristan et d’Isolde une pièce d’un puzzle politique, une « utilité » en quelque sorte qu’elle détourne, comme si elle construisait patiemment une entreprise de dévoiement des intentions de l’arrière-grand-père. L’entreprise de Katharina est une entreprise de déconstruction du fantôme tutélaire. Que sera-ce lorsqu’elle se mettra au Ring ?
Comme je l’écrivais l’an dernier, il reste que le décor du second acte notamment, ces objets métalliques qui brillent dans la nuit ma paraissent excessifs. Cette transformation complexe de l’étrange objet métallique horizontal en tambour de sécurité vertical dont le bruit interfère volontairement avec la plus sublime des musiques, est presque castorfienne dans son intention de rompre la magie en troublant l’attention du spectateur : l’esthétique de Schlößmann ne me convainc pas et la manière dont en use la mise en scène non plus. Malgré tout, et même si je suis en doute quant au concept développé par Katharina Wagner, j’ai été très surpris des huées nombreuses qui ont accueilli son apparition cette année lors de la première, inexistantes l’année précédente. C’est un travail sans doute discutable, comme tout travail scénique, notamment à Bayreuth, mais qui n’est ni absurde, ni stupide : il oriente le spectateur vers des pistes possibles, vers une exploration de thématiques peu exploitées sur Tristan. Bien ou malvenues, c’est toujours stimulant de les ranger dans la malle à propositions théâtrales.
Musicalement, la nouveauté était la prise de rôle de Petra Lang en Isolde. Bien des wagnériens ne voyaient pas vraiment cette artiste, une Ortrud, une Brünnhilde, enfiler le costume de l’amoureuse éperdue. Techniquement, elle tient incontestablement la distance, avec les aigus nécessaires et même encore certains en réserve. Sa Liebestod est très attentive et bien contrôlée et le parcours (encore plus lors de la représentation du 9 août) est sans aspérités en ce qui concerne puissance et endurance.
On connaît néanmoins les défauts qu’elle affiche quelquefois : de fréquents problèmes de justesse, une voix qui bouge, un timbre ingrat et une absence régulière de chaleur et de sensualité dans la voix. C’est une artiste clivante que les amoureux du beau son n’aiment pas. De fait lors de la première, certains moments étaient fort réussis, d’autres mal contrôlés avec des problèmes de justesse et une voix qui bougeait notamment au premier acte et dans certains moments du duo du deuxième ; reconnaissons que la représentation du 9 août fut sous ce rapport mieux contrôlée. Il reste que je préfère pour Isolde une autre couleur un autre timbre et une autre personnalité. L’interprétation, voulue aussi par la mise en scène, travaille beaucoup sur la fureur, favorise le cri, les sons rauques et les explosions, faisant ressembler quelquefois cette Isolde à une Ortrud égarée sur un navire. Il manque de toute manière à cette voix, aussi appliquée et contrôlée soit-elle (et il y a aussi de jolis moments) une certaine sensualité qui à mon goût est indissociable d’Isolde, une sensualité qu’une Herlitzius avec tous ses défauts savait faire percevoir. Tout cela manque singulièrement d’émotion, mais d’une certaine manière, la mise en scène n’y aide pas et aurait plutôt tendance à l’évacuer, tant elle bride la pente naturelle vers les épanchements.
On a aussi découvert Claudia Mahnke en Brangäne, à la faveur d’un remplacement de dernière minute de Christa Mayer souffrante. Et on a tout de suite admiré l’engagement, la tenue du son, la voix brillante et claire : magnifique tout au long de l’opéra, elle triomphe naturellement car c’est une Brangäne exceptionnelle et intense.
Voix plus sombre, moins expansive, Christa Mayer le 9 août retrouve la couleur de sa belle Brangäne de l’an dernier, très engagée aussi, peut-être un peu moins expressive, ou plutôt moins « expressioniste » que Mahnke, elle est une Brangäne plus angoissée, un peu plus intérieure, et elle aussi est remarquable.

Tansel Akzeybek, ein Hirt/Junger Seemann au phrasé magnifique (quelle clarté !!), est sans doute prêt à des parties plus importantes, on retiendra aussi cette couleur étrange qui marque ses interventions en leur donnant une touche mystérieuse fort bienvenue…Kay Stiefermann dans son intervention (Ein Steuermann) brève montre un certain raffinement, tandis que Raimund Nolte en Melot est très expressif, peut-être à la fois plus violent et plus chaud. Il montre un engagement marqué dans le jeu, ce qui n’est pas si fréquent dans ce rôle ingrat. C’est un Melot qu’on remarque et c’est donc un bon Melot.
Georg Zeppenfeld est cette année suremployé à Bayreuth : Gurnemanz, Hunding, Marke. À chaque fois, il obtient un triomphe, c’est sans doute l’un des plus fêtés de cette édition 2016. Son Marke est jeune (rien du vieillard qu’on nous présente quelquefois), vif, mais il a la tâche difficile de transformer par son chant un discours plutôt humain et modéré, celui d’un homme accablé et déçu, en discours sarcastique, ironique et grinçant, celui d’un manipulateur politique. Il effectue un travail sur le texte et l’expression proprement stupéfiant, tour à tour insinuant, marqué de colère froide, cruel, il reconstruit systématiquement le personnage en substituant humanité par monstruosité. Son discours final en forme d’oraison funèbre est aussi glaçant. À cela s’ajoute le spectre vocal large, les aigus triomphants, une science inouïe de coloriste et chaque mot pèse. Il est exactement le Marke qu’il fallait, il a le ton voulu par la mise en scène. Vraiment merveilleusement ciblé pour le personnage élaboré par Katharina Wagner.
Iain Paterson est un très beau Kurwenal, très à l’aise vocalement, avec une diction exemplaire, mais exploitant aussi une palette plus riche de couleurs que dans son Wotan. Ce personnage à la fois dédié, désespéré et si humain lui convient parfaitement, ses interventions au premier acte sont fortes et énergiques avec des expressions cruelles envers Isolde et Brangäne, tandis que son troisième acte est déchirant.

Stephen Gould promène depuis longtemps son Tristan sur toutes les scènes du monde, mais évidemment dans la salle du Festspielhaus, ce chant emporte d’autant plus l’adhésion. Même sans Nina Stemme à ses côtés (il a souvent dit combien cette présence le stimulait), il réussit à imposer ce Tristan lumineux, clair, vigoureux aussi, malgré çà et là quelques signes de fatigue marqués par quelque nasalité au troisième acte. La voix est puissante, héroïque, imposante et riche d’harmoniques et de couleurs. Il fut un grand Tannhäuser, le plus grand peut-être de ces dernières décennies, dans cette salle, avec un fabuleux Thielemann, et l’on sait combien Wagner liait les deux œuvres. Il est naturellement un grand Tristan, qui sait à la fois s’imposer, susciter l’émotion, et aussi jouer. Il en fait peu, mais il fait juste, notamment au premier acte. Il est le Tristan du moment, sans aucune hésitation
Inutile de souligner la présence du chœur dirigé par Eberhard Friedrich, épisodique dans Tristan, mais sonnant juste, énergique, urgent aussi, eu égard à la tension qui règne au premier acte.
On vient de parler d’un fabuleux Thielemann dans Tannhäuser, fabuleux parce qu’il avait su mettre sa science aboutie du son au service d’un drame. Cette science magique de l’agencement des sons, du travail sur l’instrument (le cor anglais !), cette manière de travailler avec les cordes dans la subtilité, dans la ciselure, est proprement stupéfiante et à ce titre, son prélude est un chef d’œuvre de mise en place, produisant une alchimie des notes, alliant précision et brume, par une science de la balance et des équilibres que seul l’expert de la fosse qu’il est pouvait produire. C’est à la fois stupéfiant et tellement précis et léché qu’on est au bord du maniérisme. Il a cette année accentué certains alanguissements, prolongé des silences, allongé la durée de notes tenues (à la fin notamment), il se montre un magicien du son pour drogués de magie wagnérienne.
Et malgré tout je ne suis pas convaincu par son résultat, malgré le délire qui l’accueille au rideau final (et dont il joue en grand professionnel). Malgré la clarté de la lecture, je trouve certains moments notamment au deuxième acte assez plats, certains crescendos seulement rapides et moins intenses qu’attendus, certains moments sonores impeccablement construits mais dépourvus de poésie : il y a un souci permanent du son, mais pas forcément ni du théâtre, ni du drame. Occupé qu’il est à ciseler la masse sonore (et avec quelle maestria), il ne fait pas entendre une intensité émotive, plus préoccupé de la recherche d’effets d’ivresse que de la recherche de vérité du drame. C’est une interprétation de Wagner un peu trop narcissique qui laisse à la fois pantois, mais qui ne réussit pas à faire rentrer au centre de l’œuvre. Pour moi, il ne nous invite pas, comme d’autres, à visiter l’œuvre de l’intérieur en nous disant « regardez ce Wagner-là », il nous invite seulement à dire « regardez ce Thielemann-là. »
Alors, le 9 août en sortant du Festspielhaus, j’avais un sentiment mitigé, celui d’avoir assisté à un vrai Tristan, incontestablement de haute tradition, mais celui de n’être pas allé jusqu’au bout dans l’exploration, dans le plaisir de la musique, dans la redécouverte de l’œuvre. D’autres Tristan récents m’ont bien autrement stupéfié et emporté. [wpsr_facebook]

