
Jérusalem manque à l’Opéra de Paris, pour lequel Giuseppe Verdi l’a composé, depuis 1984 au moment où Massimo Bogianckino avait de manière lumineuse proposé que le répertoire écrit pour cette maison soit remis à l’honneur. Quant à la Scala, la dernière fois où Jérusalem a été proposé, c’est en 2001, dirigé par Zubin Mehta et mis en scène (déjà) par Robert Carsen, à l’occasion d’une tournée de la Staatsoper de Vienne. L’archive du théâtre n’indique pas d’autres présentations et il ne serait pas étonnant que l’œuvre écrite pour Paris n’y ait connu quelques rares représentations que dans sa version italienne « Gerusalemme » qui remonte à 1850. Gianandrea Gavazzeni qui a souvent dirigé I Lombardi alla prima Crociata, a fait Jérusalem à la RAI de Turin avec José Carreras et Katia Ricciarelli, il en reste un coffret ainsi que Gerusalemme à Venise avec Leyla Gencer.
C’est dire que l’initiative courageuse du Theater Bonn comble un vide. Ce Verdi là est encore plus rare que la récente Giovanna d’Arco scaligère et ce seul argument justifiait le voyage sur le Rhin…D’ailleurs c’était à Bonn la création scénique allemande.
Il y a en ce moment un retour de flamme du Grand Opéra: ce genre enterré par le XXème siècle retrouvera-t-il au XXIème le chemin des scènes épuisées par des années de Traviata, de Tosca, et de Bohème, et avides de renouvellement ou d’excavations. Même Paris, lieu bien connu pour les enterrements de son propre répertoire annonce de prochains Huguenots.
D’où l’intérêt de cette résurrection, défendue avec ardeur et qui résulte être un immense succès puisque chacune des représentations depuis la première en Janvier a affiché complet.
J’ai donc assisté à la dernière de la série, dans la salle archi comble de l’Opéra de Bonn (un millier de places disposées frontalement) qui a fêté l’an dernier son 50ème anniversaire.
Verdi a conçu pour Paris un Grand Opéra, en modifiant l’orchestration (qui laisse bien plus de place aux cuivres que I Lombardi et qui m’a semblé avoir aussi quelques échos Cherubiniens), en déplaçant les airs, en modifiant assez profondément le livret et pas seulement en déplaçant l’action de Milan/Palestine à Toulouse/Palestine, mais aussi en le rendant moins touffu et plus linéaire que le livret italien .On connaît les règles du Grand Opéra, rappelées dans ce blog à propos du Prophète ou de La Juive : une intrigue sur fond d’histoire (ici, Les Croisades), une multiplicité de lieux, une abondance de personnages et des chœurs, des intrigues favorables à des tableaux historiés gigantesques qui font la joie du public.

Jérusalem raconte une triste histoire évidemment, celle d’un couple amoureux, Gaston (de Béarn) et Hélène, fille du comte de Toulouse, qui vont se marier avec la bénédiction paternelle pour sceller la réconcilation entre les deux familles. Mais le frère de Roger ne supporte pas cette perspective parce qu’il est incestueusement amoureux de sa nièce : il veut donc éliminer le jeune Gaston. Manque de chance, à cause d’une méprise, c’est le frère, le Comte de Toulouse qui est frappé (mais pas tué); Roger va être ravagé par le remords, mais néanmoins faire accuser Gaston du forfait.
Comme on est en 1095 et que le pape s’agite pour envoyer l’Europe en Croisade, tout se beau monde, poussé par le légat du pape, va se retrouver en Palestine, pour régler ses comptes, vivre en repentance ou conquérir Jérusalem, qui chez les Croisés, qui prisonnier d’un Emir, qui dans un harem. Bref, rien de religieux dans tout cela (malgré les paroles du choeur), mais des aventures dignes de bandes dessinées colorées et pittoresques.
À la fin, tout rentre dans l’ordre après de multiples péripéties et un ballet : Hélène retrouve Gaston, Roger est tué dans la bataille, et Jérusalem est prise par les Croisés.

Le metteur en scène espagnol Francisco Negrin a décidé de refuser toute ambiance de bande dessinée, et dans un décor unique (un tunnel infini) construit une histoire mystique, une sorte d’exercice spirituel où ce qui est en cause, c’est la conquête de la Jérusalem Céleste, le triomphe du Bien contre le Mal, dans une ambiance qui oscille entre les cercles de l’Enfer Dantesque et des images proches de Jérôme Bosch. Une “Carte du Tendre mystique” est projetée au départ, passant par les Limbes, le Purgatoire pour arriver à la Jérusalem Céleste. Ainsi donc le fil rouge en est le couple Hélène/Gaston sur qui s’ouvre l’opéra (en une scène de nuit d’amour et de départ qui rappelle Roméo et Juliette) et la reconquête par Gaston de son honneur perdu, après des souffrances où on le fait apparaître comme un héros christique, souffrant et la haine de la foule, et les trahisons, qui doit sans cesse se déguiser pour agir et triompher. Figures de l’autorité (Le légat du Pape) et de la repentance (Roger), figure du père, le comte de Toulouse (qui a survécu au forfait du frère) se partagent la scène et les grands moments, occupés entre deux batailles à régler le compte du pauvre Gaston.

En fait Negrin cherche à concentrer l’action autour des aventures du couple, qui ouvre l’œuvre au lit et qui la ferme dans un tableau final digne de Die Zauberflöte, couple enlacé contemplant la lumière de la Jérusalem céleste, comme si l’opéra n’était qu’une suite d’épreuves traversées, résolues par une sorte de rédemption : Erlöser quand tu nous tiens ! En somme, la « Passion de Gaston », en autant de stations, comme un Stationendrama. Alors tout se justifie : les danses macabres autour de lui, sur un piédestal, à demi nu, offert à la fureur populaire, des images de Sabbat, des couleurs vives, rouge, vert, jaune, laissant imaginer les pièges d’un Enfer qui guette, un décor qui tremble, qui bouge, qui change de couleur, comme un espace dont les héros sont prisonniers, les attitudes christiques, les méchants qui cherchent à tous prix à le perdre, et d’ailleurs à la fin, si le couple et le peuple contemplent la Jérusalem Céleste, Roger est mort, non au combat, mais par le suicide, et le comte et le Légat, qui n’ont pas été très gentils, sont au proscenium, isolés , chacun d’un côté de la fosse, exclus de la fête. Il y a certes des images assez jolies, un décor (de Paco Azorin) bien fait et suggestif, mais pourquoi assommer ce pauvre livret d’Alphonse Royer et Gustave Vaëz de concepts qu’il ne réclame pas, pourquoi écraser ce roman médiéval à la mode XIXème sous des références citées dans le programme bien trop grandes pour le propos (Dante, Psaumes, Apocalypse). Cela devient prétentieux et peu convaincant, alors qu’un livre d’image eût suffit. Prétendre à partir de cette histoire construire un chemin de croix me paraît à tout le moins excessif, et Francisco Negrin au total a fait d’un propos assez simple une affaire inutilement complexe, au bord du contresens.
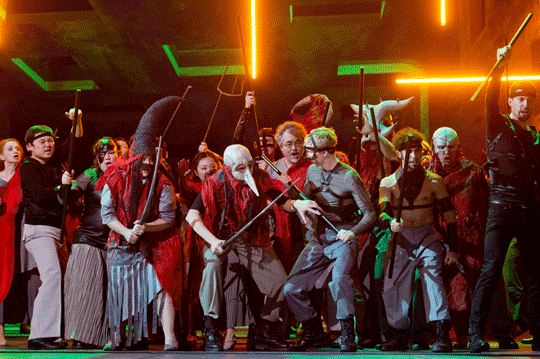
Musicalement, les choses sont différentes : le Beethoven Orchester Bonn dans la fosse est emporté avec vigueur par Will Humburg, un chef peu connu en France que je rencontrai pour la première fois dans une petite ville d’Italie du Nord, Alessandria, pour un concert de musique contemporaine autour d’œuvres de Michèle Reverdy. Il y était directeur artistique du théâtre local et responsable d’un Laboratorio Lirico de Musique contemporaine. La carrière de Will Humburg le porte aussi bien à Catane, où il dirige le Teatro Massimo Bellini qu’à Münster ou maintenant à Darmstadt dont il est Generalmusikdirektor : un parcours qui le porte vers le contemporain (il a enregistré par exemple Divara d’Azio Corghi) et aussi vers l’univers italien, d’où son présent cycle autour du jeune Verdi. Personnalité contrastée, multiple, très intéressée par la théorie, par l’explication, par des publications éclairant les œuvres, c’est un chef que j’ai toujours estimé intéressant. Et sa manière d’aborder Jérusalem le confirme : bien sûr, il met en valeur la couleur volontairement « non italienne » qu’un Verdi facétieux a imposé à son œuvre : comparer I Lombardi alla prima Crociata et Jérusalem, c’est d’un côté plonger dans l’italianità, les rythmes, la pulsation, et de l’autre dans le clinquant (qui sonne faux d’ailleurs) et une certaine pesanteur : l’ouverture spécifique de Jérusalem, à l’opposé des quelques notes de l’original italien, est vraiment solennelle et un peu lourde, Verdi charge une architecture assez élégante au départ. En ce sens, Jérusalem 28 ans avant, est conforme à l’idée que le Palais Garnier donne du genre “opéra” : un produit pour Grande Boutique. Et Will Humburg alterne les moments clinquants et éclatants avec des moments plus légers et plus rythmés, faisant entrevoir les facettes diverses et les couleurs contrastées de ce Verdi là, pas toujours très fluide et quelquefois plus martial que de coutume: une sorte d’exercice de style francisant. Après tout, les compositeurs de Grand Opéra « à la française » , au moins de celui qui survit, si on excepte Berlioz et quelques autres, n’étaient pas français : Rossini, Meyerbeer, Verdi. Seul Halévy…, mais il est fils de bavarois émigrés venant de Fürth. Ils ont tous adapté leur style aux exigences parisiennes, avec des fortunes diverses et surtout, ils ont plié leurs propres habitudes musicales à une tradition que tous connaissaient et admiraient: le Grand Opéra « à la française » est fils de Gluck, de Cherubini et de Spontini, de vrais français.
Will Humburg propose une lecture variée, vive, très contrastée, mettant bien en valeur les cuivres si importants, mais laissant aussi les cordes s’exprimer avec un certain bonheur, il sait varier les rythmes, faire sonner l’orchestre avec la finesse ou même quelquefois la point de vulgarité voulue : c’est un vrai musicien ; mais plongé dans les délices de la fosse, il en a quelquefois oublié le plateau : quelques décalages avec le chœur, vraiment valeureux dirigé par Marco Medved et qui a offert une remarquable prestation, quelques départs imprécis qui valent quelques hésitations, mais au total il sait quand même accompagner les chanteurs, ralentir le rythme quand il faut pour les aider et au total, il est l’un des triomphateurs de la soirée, et dans l’ensemble c’est justifié.

L’ensemble de la distribution est équilibré, assez homogène et plutôt valeureux. Dans les rôles principaux il n’y a pas d’accident. Bien sûr, une troupe ne peut garantir toutes les voix dans un ouvrage aussi rare, et il est obligatoire dans ce cas de faire appel à des chanteurs invités dans un système de répertoire. Le seul problème du système de répertoire c’est la distribution des petits rôles car on ne peut garantir pour chaque rôle un chanteur adéquat, ce que le système stagione peut garantir, puisqu’il renouvelle à chaque production les distributions. Ainsi , l’officier de l’Emir, distribué à un artiste du chœur, était ce soir suffisamment problématique et dans l’émission, et dans la prononciation, et dans le ton, pour avoir provoqué des rires dans l’assistance et aussi quelques grincements. Le rôle est très limité, mais avec suffisamment de petites interventions concentrées en peu de temps pour finir par indisposer .
Ce menu problème mis à part, l’œuvre est incontestablement bien défendue, en témoigne l’accueil très chaleureux du public. Le public allemand est rarement agressif pour les chanteurs, mais ici la satisfaction était visible, avec beaucoup de gens debout pour applaudir et autour de moi un public vraiment heureux .
Dans une œuvre aussi difficile à distribuer, l’idéal n’est pas facile à atteindre, mais dans l’ensemble les chanteurs sont engagés et enthousiastes, et les imperfections quand il y en a ne posent pas trop de problèmes.
L’Émir est un rôle épisodique, mais bien défendu par Daniel Pannermayr.
Le légat de Priit Volmer, qui appartient à la troupe, affiche une voix de basse au timbre clair et sonore, même si quelquefois l’interprétation manque un peu de style, notes lancées ou criées, manque de legato et un peu d’expression.
Le Comte de Toulouse du baryton Csaba Szegedi lui aussi appartient à la troupe locale. La voix est claire, assez puissante et impérieuse, et le français compréhensible, avec une émission claire et une belle projection. Le personnage est bien rendu, incarné, un tantinet vulgaire, à la fois père indigne et chef des croisés. Jolie personnalité, mais quelques maladresses.

Franz Hawlata est bien connu pour ses interprétations wagnériennes (il fut Hans Sachs à Bayreuth) ou straussiennes : il est un Sir Morosus de Die Schweigsame Frau notable et un La Roche (Capriccio) assez remarquable. En Roger de Jérusalem, l’oncle amoureux de sa nièce, meurtrier puis repentant, il est moins attendu et donc plus surprenant, avec une diction française satisfaisante, quelques aigus problématiques, mais un timbre encore somptueux et une belle profondeur. Mais c’est dans l’interprétation du rôle qu’il est vraiment remarquable, notamment dans la dernière partie (la repentance) où son Roger est une véritable incarnation, très émouvante, très ressentie, qui capte l’attention et qui fait oublier les quelques approximations. Franz Hawlata fait partie de ces artistes de grande sensibilité avec une intelligence des textes et ses situations exceptionnelle qui fait oublier une voix quelquefois très irrégulière. Il est vrai que dans Roger, on pourrait attendre un chant quelquefois plus élégant, mais il correspond au personnage, ravagé par la jalousie au début, ravagé par le remords à la fin, et donc à la voix expressive plus que stylée ; dans le contexte, pourquoi pas. Hawlata ne chante pas des notes, il est toujours dans l’incarnation : « Voici de Josaphat la lugubre vallée » est impressionnant par exemple. On se souviendra de ce personnage accablé, vieilli, concentrant les regards, qui en fait presque la référence de la soirée.
Le jeune Sébastien Guèze était Gaston. Il a eu le front d’accepter cette proposition et d’aborder un rôle qu’il n’aura sans doute pas l’occasion de chanter beaucoup. C’est courageux. On connaît les qualités de l’artiste (qui mériterait d’être plus souvent sur une scène française), la jeunesse, l’engagement scénique, voire un certain charisme, un joli timbre et un chant contrôlé : belle diction, belle projection, et une capacité notable à alléger, à chanter piano, à filer. La figure christique que la mise en scène lui demande d’incarner lui va bien, debout sur son piédestal vivant sa Passion.
Mais je ne suis pas sûr que Gaston soit un rôle pour sa voix. Si le registre central ne pose aucun problème, les suraigus demandés par le rôle (contre ut) comme souvent le Grand Opéra les aime, sont difficiles (ils l’étaient même pour Carreras d’ailleurs…) : les passages à l’aigu ne convainquent pas, même si la note est lancée, elle est souvent mal négociée, à la limite de la justesse avec des problèmes d’appui. Sébastien Guèze chante essentiellement des rôles plus tardifs (Bohème, Hoffmann, Roméo) qui ne demandent pas la même technique, notamment dans la manière d’aborder l’aigu. Il y va ici « franco », sans truquer, avec une voix qui passe dans une petite salle, mais qui n’a pas le format du rôle, et quelquefois ça casse. Dans son air du 3ème acte (« Oh douleur..laissez moi mourir », il alterne des moments séraphiques très contrôlés, et c’est très beau, mais l’aigu est difficile : Kaufmann dans des cas similaires s’en tire par ses fameux filati, Guèze ici affronte, mais est-ce bien raisonnable ? Je ne sais s’il a intérêt à chanter ce répertoire, qui demande une autre technique, née chez Rossini, qui n’est pas vraiment son univers et qui est risqué pour sa voix.

Mais cela n’empêche ni une vraie présence scénique ni l’émotion, ni la jeunesse et le public réagit très positivement. Comme je l’ai écrit plus haut, l’un des (rares) points intéressants de la mise en scène, c’est de donner du couple Hélène/Gaston une image de fragilité, de fraîcheur et d’innocence (même si leurs airs ne donnent pas cette idée) qui renvoie à la fin presque à l’univers de Zauberflöte. Du coup les choses s’organisent entre deux pôles, celui de la jeunesse-victime et celui des « adultes » intransigeants et aveugles, avec entre les deux pôles un Roger ravagé. C’est à la fois très clair, pas forcément juste, mais en tous cas émouvant.
Hélène, c’est la jeune soprano russe Anna Princeva, et c’est sans aucun doute la plus convaincante du plateau. On connaît aussi les difficultés des rôles de soprano du jeune Verdi, agilité, puissance, spectre très large avec des graves sonores et des aigus acrobatiques, de l’héroïsme et du lyrisme, des parties très « spinto » et d’autres plus lyriques. Princeva qui chante aussi bien Abigail que Traviata possède à la fois lyrisme et vaillance. Hélène a des moments lyriques et d’autres beaucoup plus héroïques. Elle s’en sort avec conviction, aussi bien dans le lourd que le léger, dans les ensembles que les parties lyriques (L’Ave Maria initial ou le duo final de l’acte II, « une pensée amère… » sont particulièrement réussis). Ses qualités héroïques, on les constate dans le duo final de la sc.I de l’acte III, face à son père (« le ciel s’entrouve »), il y a là de l’énergie, de la puissance (on dirait Odabella), du rythme face au père (Csaba Szegedi) qui cependant lance des « Va ! Va ! » non modulés ni chantés mais criés voire aboyés qui ne sont pas du meilleur effet pour faire fonctionner le duo. Il reste que la soprano s’en sort remarquablement. Même si le français reste approximatif, c’est une prestation qui est de plus en plus convaincante à mesure que l’on avance dans l’œuvre. C’est suffisamment rare dans ce type de répertoire pour le noter.
Voilà une soirée non exempte de scories, mais tout s’efface pour une impression d’ensemble très positive, où chacun est impliqué, qui est menée avec chaleur par le chef et qui finalement emporte le public. Il en résulte qu’on on en sort tous heureux, que l’émotion domine, et que le strict rendu vocal passe au second plan. Le message de Verdi est passé et c’est bien là l’essentiel. Mission accomplie. [wpsr_facebook]


 GTG/Vincent Lepresle
GTG/Vincent Lepresle GTG/Vincent Lepresle
GTG/Vincent Lepresle GTG/Vincent Lepresle
GTG/Vincent Lepresle GTG/Vincent Lepresle
GTG/Vincent Lepresle