
On se réfèrera pour l’analyse de la mise en scène au compte rendu écrit en janvier 2013 http://wanderer.blog.lemonde.fr/?p=4927
Deuxième jour de ce Ring, fin du premier épisode fait de Rheingold et de Walküre et d’emblée s’imposent plusieurs certitudes :
- Kirill Petrenko effectue un travail étonnant en fosse et il remporte un indescriptible triomphe totalement justifié. Il faudrait être sourd, ou insensible, ou étourdi pour ne pas saluer ce qu’on écoute, qui est souvent si surprenant qu’il faut un instant avant de s’habituer. La direction de Kent Nagano il y a deux ans était remarquable, et elle m’a enthousiasmé, celle de Petrenko est radicalement différente, volontairement retenue et elle va ailleurs, en tous cas pas dans les sentiers battus. C’est prodigieux
- Le plateau dans son ensemble est remarquable d’intelligence, tous les chanteurs savent aussi chanter avec leur tête, et certains plus avec leur tête qu’avec leur voix (Evelyn Herlitzius, plusieurs fois en sérieuse difficulté), mais le couple Vogt/Kampe emporte l’adhésion, et l’enthousiasme. Anja Kampe est fulgurante et Vogt chante un long Lied d’une incroyable poésie.
- La mise en scène, qui pour Walküre avait mis un peu de temps à me convaincre il y a deux ans, m’a beaucoup intéressé de nouveau aux premier et second actes. Le troisième acte est pour mon goût un peu en retrait. À noter, comme il y a deux ans, la bronca lors du ballet « hippique » sans musique qui précède la Chevauchée et qui fait brûler d’impatience la foule de plus en plus hurlante et féroce qui lance des hojotoho et des heiaha à sa manière, animale bien entendu. L’ironie de Kriegenburg fonctionne à merveille sur un public qui réagit par réflexe pavlovien…
Je reviens sur le travail de Andreas Kriegenburg, inconnu en France, qui est essentiellement un metteur en scène de théâtre, venu tard à l’opéra (on lui doit les stupéfiants Soldaten dans ce même théâtre). Il travaille sur la construction d’images, souvent assez poétiques, comme dans Don Juan revient de guerre de Horváth l’été dernier à Salzbourg et dirige les acteurs avec beaucoup de précision, comme cela se vérifie aussi bien dans Rheingold et dans Walküre.
À l’issue de cette deuxième vision, je voulais compléter par quelques menues remarques. Au premier acte, j’ai vraiment trouvé très émouvant ce jeu des verres que les servantes se passent de main en main (évidente allusion au philtre de Tristan und Isolde), mais j’ai aussi noté cet éloignement des corps qui n’efface pas l’échange des regards et leur intensité. Giotto à la Capella degli Scrovegni de Padoue a peint une annonciation où Marie est d’un côté et l’Ange Gabriel de l’autre, avec entre deux le vide de l’arcature et de la nef…c’est l’une des plus puissantes que j’ai pu voir. Sans aller jusqu’à dire qu’on est dans Giotto, c’est exactement la même posture : plus on est loin et plus on se regarde, et plus le lien passe, imperceptible et d’une criante réalité.
Le motif récurrent des corps morts qu’on embaume, qu’on nettoie ou qu’on enlève, on le retrouve à chaque acte : c’est évidemment l’image du travail des Walkyries, dont c’est l’office nécrophile, qui revient comme un leitmotiv lancinant, et la chevauchée du 3ème acte se déroule au milieu de corps sur des pals, comme de la viande en attente d’équarissage est aussi une manière de souligner le côté bestial et peu ragoûtant de cette scène.
Le troisième acte laisse les choses à peu près en l’état, dans un espace vide, les deux personnages sont seuls et il faut bien dire qu’il n’y a là rien de nouveau sous le Soleil, sinon l’arrivée finale des « servants » porteurs du feu, qui rappelle en écho la manière dont Alberich se transformait en Dragon dans Rheingold, puisque la mise en scène utilise la même méthode : d’une certain manière, Brünnhilde est gardée par le feu telle l’Or par le Dragon, allongée sur une table circulaire presque sacrificielle.
En tous cas, ce travail qui évacue toute référence à une actualité brûlante ou à une signification est à la fois l’anti-Castorf, puisque l’histoire est livrée telle que, avec une distance poétique qui sied aux mythes, même si Walküre est moins sollicitée que Rheingold sous ce rapport, on sait que c’est l’option de ce travail jusqu’à Siegfried, mais aussi en quelque sorte l’anti Lepage : partant de la même volonté de raconter une histoire, de travailler sur un récit et sa logique interne plus que sur une succession d’événements significatifs, il choisit à l’opposé de l’hypertechnique de Lepage des procédés simples qui semblent en même temps simplistes, les figurants remplaçant machines et effets, et se contentant de « figurer » : leur utilisation au deuxième acte est particulièrement originale où, presque comme chez Cassiers, ils miment le discours de Wotan et Fricka, ou sont leurs sièges ou bien leurs meubles.
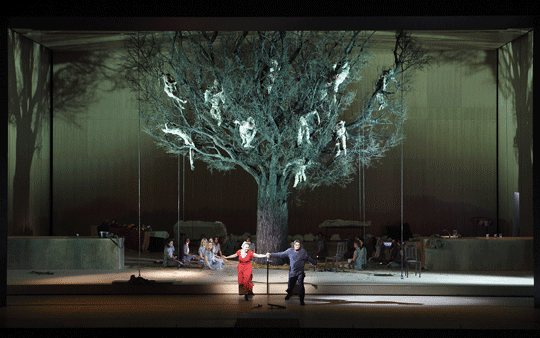
Ainsi chaque acte est un univers en soi, la maison de Hunding, plus maison que cabane, soutenue par l’arbre sinistre au centre du dispositif, l’immense salle du Walhalla, avec ce bureau central et lointain, qui souligne le changement de statut des Dieux, devenus des politiques : Fricka ne force-t-elle pas Wotan à obéir à quelque chose comme une raison d’Etat que Brünnhilde ne peut comprendre. Habituée à obéïr et manier du cadavre au quotidien, c’est Siegmund qui va lui révéler la réalité du monde et la réalité des hommes. Prenant fait et cause pour lui, elle se place évidemment du côté des mortels et anticipe la décision de Wotan.

Kriegenburg évoque ces points, par un geste, par des attitudes, par quelques mouvements (notamment le mimétisme de Brünnhilde au début du 2nd acte, reproduisant les gestes et les attitudes de Wotan). C’est cette distance, quelquefois réellement installée, quelquefois à peine perceptible, qui me plaît dans une mise en scène plus méditative qu’active. J’avais déjà souligné chez Kent Nagano ce refus du spectaculaire et ce suivi scrupuleux du plateau.
Avec des résultats sonores très différents, c’est aussi l’option de Kirill Petrenko.
Le public qui n’est pas forcément fait de techniciens de l’orchestre, même le public un peu mélomane, s’accroche à des gestes du chef et en fait une sorte de métaphore, de transposition gestuelle de ce qu’il entend, et s’arrête à deux éléments : la battue et le tempo.
Évidemment, le travail essentiel de préparation effectué au cours des répétitions, notamment par pupitre, ce travail que les italiens appellent concertazione (sur les affiches de la Scala on lisait souvent « concertatore e direttore d’orchestra ») est le travail invisible et essentiel, c’est le moment où l’on demande aux musiciens tel geste, telle nuance, c’est le moment où les équilibres se construisent, c’est le moment aussi on l’on va travailler ensemble. Etrange voyage que celui du mot concerto, celui d’un mot signifiant combattre, s’opposer, livrer bataille en latin, devenu synonyme de travail construit ensemble, pour trouver l’accord…
Le chef met ensemble des éléments disparates au départ et tout le travail interprétatif répond à la question comment « mettre ensemble » pour faire enfin de la musique.
Ce travail souterrain apparaît ici dans toute sa profondeur : Petrenko n’est pas de ceux qui gesticulent avec le corps, mais c’est quelqu’un qui travaille avec les bras et les mains : il ne cesse d’indiquer, et souvent d’une manière impérative. Il est fascinant de noter que dirigeant l’opéra, il indique les départs à chaque chanteur, tous les départs avec une précision incroyable, de la main gauche.

Et ici, il épouse à sa manière le propos du plateau : il travaille la partition non comme une succession de scènes avec chacune sa loi propre, mais il travaille plutôt un parcours, dans son ensemble, d’où l’impression qu’il n’y a pas de tension. La tension existe bien sûr, mais à la mode de la Gesamtkunstwerk : on est chez Wagner. et tout contribue à la production commune. Si un chanteur chante de manière tendue, comme Wotan dans cet extraordinaire deuxième acte, l’orchestre n’ pas besoin d’être redondant. Si Vogt chante avec la douceur et la suavité d’un Lied, articulant chaque parole, l’orchestre ne peut le couvrir parce que à ce moment là c’est la parole qui prime. Si une mise en scène est d’une certaine manière plus dans le récit que dans l’événement ponctuel, plus dans la continuité, la direction doit évidemment en tenir compte. Petrenko ne dirige pas Wagner-Kriegenburg comme il dirige Wagner-Castorf. L’annonce de la mort où les paroles incroyablement douces de Vogt frappent d’émotion, l’orchestre s’allège, respire, donne au chanteur l’espace voulu tout en faisant entendre des raffinements inouïs. Il en résulte une cohérence interne d’un niveau rarement atteint, avec les qualités habituelles de ce chef que sont la clarté, la transparence, voire ce que j’ai appelé le cristal : on entend évidemment tout, mais surtout on ne cesse d’être surpris par des choix de mise en valeur, par des attaques jamais entendues ainsi, par un miroitement sonore différent d’une partition qu’on croyait connaître : tout parle, et en même temps sans jamais épater, sans jamais se donner en spectacle, ou en vitrine. C’est le flux continu d’un récit conçu comme tel, avec des moments qui m’ont frappés : l’attaque du prélude, installant immédiatement la tension et l’énergie, et en même temps dès l’entrée de Siegmund en scène, quelque chose d’un mystère. Le son est alors souvent sourd, mystérieux, sombre, éclate et explose, puis se dilate en un incroyable lyrisme.

On peut aimer sans doute plus d’urgence, plus de dramatisme, on peut aimer sentir une direction (au sens géographique) et alors Petrenko peut n’être pas le chef pour ce Wagner-là…mais tout est là pourtant, diffracté dans l’orchestre ou sur les voix, ou sur l’ensemble ; a-t-on jamais entendu pareil final du 1er acte, tourbillonnant avec un tempo quasi impossible. Pour ma part je l’ai rarement entendu attaqué à cette vitesse hallucinante, après avoir pendant tout le duo respecté la douceur et la couleur voulues par la voix de Klaus Florian Vogt, et travaillé sur l’épaisseur du son et ses reflets plutôt que sur le crescendo amoureux : voilà une des ruptures surprenantes, qui prend à revers l’auditeur et l’assomme de bonheur.
Petrenko n’aime pas mettre en relief la noirceur d’une musique, il reste toujours disponible et ouvert. C’est pourquoi cette Walküre a le charme des belles histoires tristes sans avoir de couleur sombre même aux moments les plus difficiles, même en regardant ces cadavres qui émaillent chaque acte : en écoutant, je pensais aux épopées italiennes du Tasse et de l’Arioste, je pensais aussi Stendhal, c’est à dire une tristesse et une violence médiatisées par le discours, par la distance, par, étonnant je sais, un certain apaisement: la vérité des choses atténuée mais révélée par la métaphore.
Pour nous révéler ce Wagner-là, un Wagner presque « littéraire » au plus merveilleux des sens, il fallait aussi une distribution qui fût à la hauteur, et elle le fut, malgré les petits hauts et bas et les accidents.
D’abord, où pourrait-on retrouver pareil cast ? Même l’ensemble des Walkyries chante avec un engagement et une énergie rares il est vrai que parmi elles, on remarque Okka von der Damerau, Nadine Weissmann et Anna Gabler qui ne sont pas les dernières venues.
Evacuons d’emblée le cas Evelyn Herlitzius : on dit d’elle ce que j’entendais de Gwyneth Jones jadis. C’est vrai, la voix bouge, les aigus sont mal assurés, et quelquefois ne passent pas, comme au troisième acte où la voix s’est engorgée de manière spectaculaire. Mais il y a d’autres moments éclatants, vibrants, bouleversants, et il y a aussi une allure, une stature, une présence qui reste stupéfiante, même si moins marquée qu’il y a deux ans. Brünnhilde n’est pas Elektra, et ne permet pas toujours à l’artiste de stupéfier de manière démonstrative comme elle le fait dans Strauss, et les Hojotoho entendus restent dans la bonne moyenne sans être une performance.

Il reste que le duo du 2ème acte avec Wotan, le moment clé du Ring où tout est révélé et notamment la menace de « la fin » (Das Ende, répété plusieurs fois dans le duo) est un des moments les plus intenses de la soirée et même de bien des Walkyries des dernières années. Il suffit de se concentrer sur le regard tendu et à la fois fasciné de Brünnhilde pour Wotan pour retrouver certains des regards de Jones (mais cela, c’est pour ma mémoire d’ancien combattant) ; il y a dans le regard d’Evelyn Herlitzius une fraîcheur, une confiance, une force si positive, qu’elle pose le personnage immédiatement comme vital, intense, jeune, et quand on entend ce qui se passe en fosse, on se demande si le chef ne rend pas hommage à ce regard là, tant la musique se colore quand Brünnhilde chante.

Wotan en face (Thomas Johannes Mayer) est plus en forme que la veille : une diction phénoménale, des accents d’une vérité et d’une crudité rares, il est le personnage, déjà assommé, fatigué, perdant, et à l’orchestre, ce futur incertain s’entend, mystérieux, assombri. Entre le regard d’Herlitzius, la voix de Mayer et le son de la fosse, tout se répond et fait naître cette tension qui paraît-il manquerait…Ce sont moments au contraire passionnants qui remettent sur le tapis ce qu’on croyait connaître, savoir, aimer…et qu’on se prend à redécouvrir et aimer encore plus.
Le couple Siegmund/Sieglinde (Klaus Florian Vogt/Anja Kampe) est celui de la première série de représentations, qui retrouve ainsi ses marques, et quelles marques ! Indescriptible triomphe à la fin de l’acte I, un moment bouleversant : foin des aigus, des voix gigantesques, des Siegmund qui nous tiennent de longues secondes sur « Wälse » sans rien nous faire ressentir de « Winterstürme ». On entend tout de suite que Vogt est particulier : il n’est pas Heldentenor, mais il possède cette voix (que certains détestent) en permanence éthérée, avec un sens de la parole, une diction, une science des modulations, de la couleur qui en fait cet être étrange venu d’ailleurs fascinant. Et évidemment Petrenko dirige en fonction de cette voix là, ne la couvrant jamais, ralentissant les tempi pour accompagner le chant de la plus merveilleuse des manières.
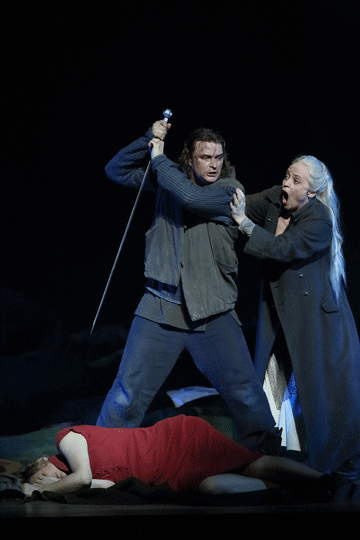
Si le 1eracte est fascinant, l’annonce de la mort du deuxième acte bouleverse par sa vérité, Vogt chante le regard lointain qui semble ne rien entendre, comme mû par un automatisme, et Herlitzius change d’attitude, de mouvements : de lointaine Walkyrie hiératique, elle devient femme qui respire et qui sent : à un moment on a même l’impression qu’en Siegmund elle se progette déjà auprès de Siegfried tellement l’échange est intense. Vogt donne une dimension inconnue à Siegmund, une poésie inouïe, une douceur ineffable, une suavité inexplorée jusque là, modulant le volume sur chaque parole, avec une émission sans faille : quand il chante, c’est tout un univers qui est évoqué, un Lied permanent : oui, malgré des aigus pas tout à fait assurés, mais donnés sans jamais forcer, toujours avec fluidité et naturel, c’est un Siegmund fantastique à entendre, bien plus neuf que son Florestan dans Fidelio où il s’est pour moi fourvoyé à la Scala, et en tous cas le Siegmund le plus touchant et le plus naturellement émouvant qui soit aujourd’hui.

A ce naturel bouleversant du chant de Vogt correspond l’émotion incandescente et la voix chaleureuse d’Anja Kampe, plus émouvante qu’à Bayreuth. La voix est dans une forme extraordinaire, chaude, bien assise, avec des aigus solides et sûrs, mais en même temps une puissance d’incarnation rarement entendue (Meier avec Domingo, dans un autre style peut-être ?) Ils sont le couple, ils sont amour, et nous sommes chavirés. Avec un art de la parole, un art de l’émission et de la projection consommé, elle réussit totalement à faire oublier qu’elle n’a pas tout à fait la voix du rôle. Elle est aux limites et les dépasse en intensité, en investissement, en intelligence du texte. Evidemment la direction de Petrenko est sans cesse à l’écoute, chaque parole est scandée par la musique : c’est une fête de la couleur, une fête du son, et c’est d’une urgence inouïe, avec les moyens du Lied, de la poésie, avec un orchestre retenu…à n’y rien comprendre. Nous sommes là aussi pris à revers. A-t-on déjà entendu cela ainsi?
Les autres protagonistes ne font qu’alimenter notre plaisir et notre émotion. Günther Groissböck était la veille Fasolt, il est Hunding, brutal, sonore, et même, le temps d’un instant, tendre. C’est un merveilleux acteur (ah, quand il coupe la pastèque avec son épée) : Groissböck a tellement l’habitude de chanter les méchants qu’il s’y glisse avec facilité, mais en même temps, il n’est lui non plus jamais démonstratif, laissant la scène se développer, laissant le théâtre se faire. Il est un Hunding vocalement raffiné et surtout a des accents et un ton qui seraient presque du domaine du théâtre parlé….

Quant à la Fricka d’Elisabeth Kulman, elle est égale à elle même, comme à Lucerne, comme il y a deux ans à Munich, avec tout ce qui fait qu’elle est aujourd’hui la plus grande des Fricka : les aigus, l’agressivité, l’ironie, le jeu, la présence scénique inouïe, une diction de rêve avec un texte digéré, mâché, prononcé et plein de couleurs dans la voix ainsi que des gestes d’une vérité stupéfiante. Elle entre en scène, et elle a déjà vaincu. Il est fascinant de constater qu’entre hier et aujourd’hui, ce sont des facettes très différentes qui nous sont montrées. Ce soir c’est une scène, au sens théâtral du terme, quelque chose du duo Philippe II/Grand Inquisiteur. On croise le fer. Et elle est inouïe. Hier dans L’or du Rhin, elle était toute élégance, toute subtilité, avec une technique de chant presque belcantiste, et c’était aussi merveilleux (alors qu’il y a deux ans j’avais été un peu dubitatif devant sa Fricka dans Rheingold).
Il faut se rendre à l’évidence, à la merveilleuse évidence, à deux ans de distance, avec des chanteurs différents et un chef différent, ce Ring continue de nous parler, avec un niveau exceptionnel à l’orchestre et un plateau d’une rare intelligence et d’un rare engagement.
Qu’il fait bon d’être à Munich, l’autre casa wagneriana.[wpsr_facebook]

















 Acte II
Acte II
 Saluts: Bryn Terfel au centre, Eva Maria Westbroek, Deborah Voigt entourés des Walkyries.
Saluts: Bryn Terfel au centre, Eva Maria Westbroek, Deborah Voigt entourés des Walkyries. Le décor du premier acte, centré autour d’une maison qui semble un peu une cage par son géométrisme , ou qui rappelle une maison à la japonaise, sur laquelle des vidéos (une cheminée par exemple) se projettent ou les personnages évoluent en un jeu d’ombres assez fascinant (différences de tailles, d’éloignement etc…). Le deuxième acte, très essentiel, pour le long récit de Wotan, n’a pas grand intérêt scénique (sinon de beaux et longs échanges de regards jusqu’à l’arrivée des jumeaux), dans un décor de toit de temple (derrière un fronton composé de chevaux enchevêtrés – après tout, la chevauchée des Walkyries n’est-elle pas la référence musicale la plus connue du public, thème repris en vidéo de fond de scène au troisième acte. Le reste se déroule dans une forêt très stylisée, verte d’abord (les amants) grise ensuite (l’annonce de la mort) comme on l’a dit. La mort de Siegmund est comme toujours très soignée scéniquement: c’est Wotan qui pousse Siegmund sur l’épée de Hunding, c’est Sieglinde qui se penche sur lui et le serre avant de fuir avec Brünnhilde.
Le décor du premier acte, centré autour d’une maison qui semble un peu une cage par son géométrisme , ou qui rappelle une maison à la japonaise, sur laquelle des vidéos (une cheminée par exemple) se projettent ou les personnages évoluent en un jeu d’ombres assez fascinant (différences de tailles, d’éloignement etc…). Le deuxième acte, très essentiel, pour le long récit de Wotan, n’a pas grand intérêt scénique (sinon de beaux et longs échanges de regards jusqu’à l’arrivée des jumeaux), dans un décor de toit de temple (derrière un fronton composé de chevaux enchevêtrés – après tout, la chevauchée des Walkyries n’est-elle pas la référence musicale la plus connue du public, thème repris en vidéo de fond de scène au troisième acte. Le reste se déroule dans une forêt très stylisée, verte d’abord (les amants) grise ensuite (l’annonce de la mort) comme on l’a dit. La mort de Siegmund est comme toujours très soignée scéniquement: c’est Wotan qui pousse Siegmund sur l’épée de Hunding, c’est Sieglinde qui se penche sur lui et le serre avant de fuir avec Brünnhilde. C’est d’un certain point de vue le troisième acte le plus “kitsch” , avec ces fils rouges sensés représenter les âmes des héros montant au Walhalla, ces estrades enchevêtrées laissant passer les longues crinolines des Walkyries (même si Brünnhilde est en pantalon…), ce feu réduit autour de Brünnhilde à des lampes rouges régénérantes comme des lampes de couveuses, qui vont couver la femme qui va naître le jour suivant, d’où semblent sortir des gouttes d’eau. le corps de Brünnhilde lui-même, montré sur un podium comme un monument, tout cela est juste un peu exagéré, décalé, créant une distance ironique avec l’histoire.
C’est d’un certain point de vue le troisième acte le plus “kitsch” , avec ces fils rouges sensés représenter les âmes des héros montant au Walhalla, ces estrades enchevêtrées laissant passer les longues crinolines des Walkyries (même si Brünnhilde est en pantalon…), ce feu réduit autour de Brünnhilde à des lampes rouges régénérantes comme des lampes de couveuses, qui vont couver la femme qui va naître le jour suivant, d’où semblent sortir des gouttes d’eau. le corps de Brünnhilde lui-même, montré sur un podium comme un monument, tout cela est juste un peu exagéré, décalé, créant une distance ironique avec l’histoire. Ekaterina Gubanova
Ekaterina Gubanova






