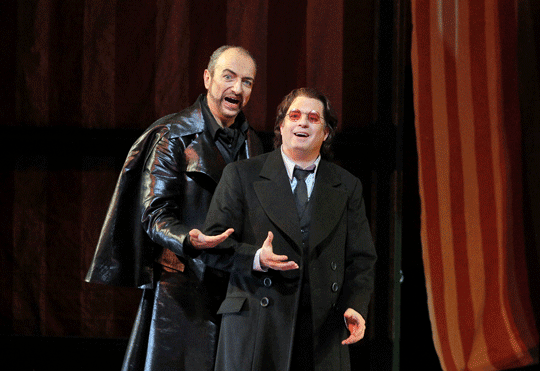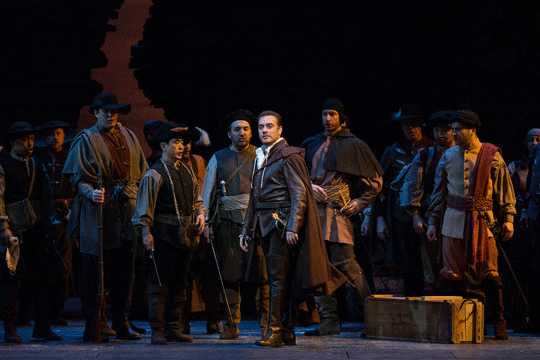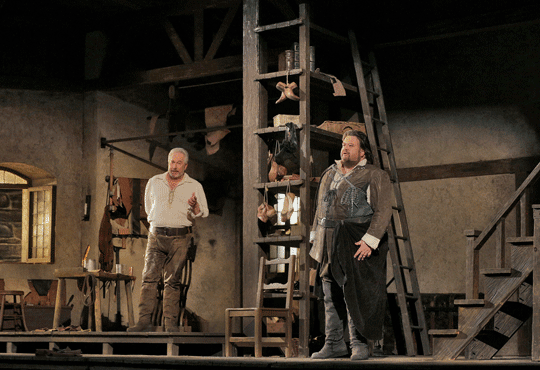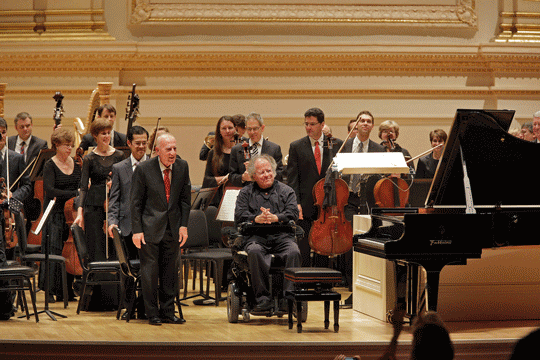Si James Levine n’a jamais appartenu à mon Olympe musical personnel, sa disparition me touche néanmoins profondément parce qu’il est un artiste qui m’a accompagné de loin en loin depuis les années 1970. Je l’ai entendu en direct très souvent et pour la première fois à Salzbourg en 1979, puis à Bayreuth et puis au MET, encore assez récemment.
Je l’ai découvert au disque, à travers ce qui était alors le premier grand enregistrement des Vespri Siciliani de Verdi (Arroyo, Domingo, Milnes, Raimondi)… Rolf Liebermann avait décidé de programmer l’opéra en 1974, dans la mise en scène du MET de John Dexter (sublime décor de Josef Svoboda) où James Levine avait dirigé Caballé et Gedda (il existe un live de ce moment). Comme trois des quatre protagonistes passèrent à Paris dans la production (les spectateurs d’alors découvraient la voix somptueuse, magnifiquement verdienne, de Martina Arroyo, qui fut l’une des habituées de Paris à cette époque, ainsi que l’Arrigo de Placido Domingo, et le Procida de Ruggero Raimondi; ils ne le chantèrent jamais ensemble, mais ils contribuèrent tous à faire de cette œuvre l’un de mes opéras de l’Île déserte sans doute aussi par la nostalgie de cette période où étudiant émerveillé, je découvrais l’opéra.
J’achetai donc le coffret de Levine, et ce fut à cette occasion que je le découvris.
J’ai pu le vérifier au MET aussi bien dans un Ballo in maschera sublime (Radvanovsky, Beczala, Hvorostovsky, Zajick) mais aussi Ernani (Meade, Domingo, Belosselskiy, Meli) non moins extraordinaire. Il avait dans Verdi à la fois la pulsion et la nervosité, mais aussi un son charnu, plein, et un sens dramatique très développé. Son Verdi fut toujours pour moi une référence.
Levine n’a jamais été un inventeur, et d’ailleurs les mises en scène qu’il dirigea ne furent jamais révolutionnaires non plus (comme souvent aux USA), mais il était une assurance d’un niveau musical exceptionnel, d’une connaissance approfondie des partitions et d’un très grand sens du théâtre ainsi qu’un professionnalisme sans failles.
A la tête du MET comme directeur musical de 1971 à 2017, il dirigea toutes les grandes œuvres du répertoire et c’est peut-être cela qui est notable chez lui : il dirigeait aussi bien Mozart que Strauss ou Wagner, Verdi, Puccini ou Offenbach, mais aussi le Wozzeck de Berg où je l’entendis au MET un soir où Matthias Goerne remplaçait (avec quelle classe) le Wozzeck prévu.
Sa présence au pupitre était pour les chanteurs une garantie, car c’était un immense chef d’opéra, mais aussi pour le public, qui était certain d’avoir une représentation de très haut niveau, même si on pouvait pinailler sur l’approche, et même si d’autres chefs étaient ou sont plus inventifs ou plus novateurs ; il était en quelque sorte un super « Konzermeister » de très grand luxe à l’opéra, une référence de classicisme. Je l’ai entendu dans La Clemenza di Tito à Salzbourg, dans Parsifal et le Ring à Bayreuth où il dirigea une vingtaine d’années. C’est lui qui dirigea la jeune Waltraud Meier dans sa première Kundry Bayreuthienne, et son Parsifal était presque aussi long que celui de Toscanini, une lenteur qui quelquefois, il faut bien le dire, pesait un peu.
Dans Wagner au MET, je l’entendis dans le Ring d’Otto Schenk en 2009, superbement distribué, quelques mois avant la naissance de ce blog, parce que les hasards de mon parcours ne m’avaient jamais permis de voir une production « traditionnelle » du Ring, et 2009 était la dernière année de la production d’Otto Schenk qui était référentielle en la matière, montée comme une réponse à Chéreau (qu’elle suivit de quelques années). Je pense que ce fut dans Wagner et Verdi qu’il fut sans doute incontesté, et pour ma part, plutôt dans son Verdi jusqu’à la fin à la fois vivant, profond, dramatique. Son Wagner était peut-être un poil plus convenu, sans rien nier des qualités de solidité, de théâtralité et de splendeur sonore, comme le démontent ses derniers Meistersinger von Nürnberg et Tannhäuser au MET que je vis dans ces années 2014 et 2015 où il dirigea régulièrement malgré la terrible maladie qui l‘avait terrassé et où j’accourus pour l’y entendre le plus souvent possible
Au total j’ai dû assister à une vingtaine de productions sous sa direction et dans plusieurs concerts : il demeure un des grands chefs des dernières années du XXe siècle. Le dernier concert où je l’entendis à Carnegie Hall (voir lien ci-dessous) montrait notamment un Mahler vraiment vibrant.
Il n’ouvrait peut-être pas des abîmes nouveaux à l’âme, et certains musiciens qui jouaient dans ses orchestres s’étaient prodigieusement lassés mais il était un vrai chef qui savait ce que faire de la musique signifiait. On retient de lui le chef lyrique, sans doute là où il montra la plus grande constance, mais il fut un chef symphonique réclamé, très présent des deux côtés de Atlantique, fidèle en Europe au Festival de Verbier dont il fut la référence incontestée, et n’oublions pas qu’il succéda à Celibidache aux Münchner Philharmoniker, qu’il dirigea le Boston Symphony Orchestra en succédant à Seiji Ozawa et aussi qu’il fut candidat malheureux à la succession de Karajan à la tête des Berliner Philharmoniker, face à Claudio Abbado. Il faisait partie – on l’a un peu oublié aujourd’hui- du « top Ten » des chefs, et fut sans aucun conteste le dernier grand chef américain.
Les dernières années furent assombries d’abord par la maladie : il ne pouvait plus diriger debout, mais en fauteuil roulant électronique, avec un podium spécial que l’on avait conçu pour lui, mais c’était fascinant de le voir continuer à diriger et à embraser le public américain : le public du MET lui faisait une incroyable fête à chacune de ses apparitions.
Les dernières années furent aussi assombries par les accusations d’abus sexuels que tous les médias citent aujourd’hui (c’est tellement plus gourmand que de parler de sa musique) et qui firent les unes des journaux en 2017.
Ses goûts que tous faisaient semblant de découvrir étaient connus de tous, et évidemment des autorités du MET. Ce n’était pas un secret… mais on feignit la surprise et l’horreur. Le MET assez lâchement cria haro sur le baudet et non seulement le chassa, mais aussi décida d’enlever son effigie du théâtre et de retirer ses disques qui remplissaient les rayons de la Metopera Shop. Signe de grand courage d’achever un homme à terre qu’on avait porté aux nues pendant 45 ans, où il était la garantie du remplissage des salles et de la gloire musicale du théâtre à travers le monde, par de multiples enregistrements audios et les premières vidéos diffusées à grande échelle après celles de Karajan.
Mais ce n’est pas toujours sain de durer aussi longtemps; il était de toute manière temps qu’il quitte ses fonctions après presque un demi-siècle, d’autant que la maladie l’avait contraint les dernières années à s’éloigner plusieurs fois des podiums au point qu’on avait nommé un directeur musical « pro forma », Fabio Luisi qui assura avec beaucoup d’élégance ses remplacements pendant plusieurs années. Le MET ne savait pas comment le contraindre à partir. L’affaire sexuelle fut donc une bénédiction que le théâtre saisit au vol, occasion de montrer en même temps qu’il savait hurler avec les loups, préserver l’honorabilité de sa façade tout en réglant ses comptes…
Nous vivons une époque formidable où d’aucuns fusionnent les artistes dans leur vie et les œuvres qu’ils produisent. J’ai l’habitude de séparer « l’homme et l’œuvre » comme on m’a appris à l’école, et bien des artistes du passé ne furent pas des exemples de moralité, les vies agitées d’un Caravage ou d’un Borromini n’ont pas amené à brûler les tableaux de l’un et les églises de l’autre. On continue de se délecter des ouvrages de Céline qui fut un salaud. La liste n’est évidemment pas exhaustive.
Ce qui me restera de James Levine est la lumière de sa musique.
Voir les articles du Blog :
Les Contes d’Hoffmann
Ernani
Die Meistersinger von Nürnberg
Concert Mozart-Mahler (Symphonie n°9) Carnegie Hall
Le Nozze di Figaro