
Si vous allez à New York en saison, ne ratez pas un concert à Carnegie Hall. Le lieu est l’un de ceux où souffle quelque chose, un lieu de rituels, de poussière, de souvenirs. Aux murs des photos de chefs, de solistes, de chanteurs légendaires qui ont fréquenté ce lieu, des autographes de compositeurs, des vieilles choses pour un bâtiment vénérable. Enfin tout ce que nos salles de concert ne contiennent pas, tout ce que notre opéra national ne cultive pas, comme si l’histoire de nos maisons se limitait au hic et nunc. Au MET comme à Carnegie Hall, tous les fantômes qui ont hanté les salles sont présents, on a conscience d’être dans l’histoire, une longue histoire, même lorsque les lieux ont changé, comme au MET, dont la salle actuelle remonte à 1966 et qui a assumé le passé de l’autre salle. A Bastille, à part les pubs pour Guerlain ou Chopard, rien de cela, la mémoire ne se cultive pas dans nos lieux musicaux. On a les opéras qu’on mérite.
En parcourant les couloirs de Carnegie Hall, on imagine ce que devait être l’ancien MET. Car Carnegie Hall dont l’acoustique est phénoménale, est une vaste béance de 2800 places, si vaste, si vertigineuse qu’il n’y plus de place pour les circulations latérales, escaliers incroyablement raides et interminables, petits couloirs d’à peine 1,5m de large bars coincés et malcommodes, portes d’accès étroites, ascenseur (un unique ascenseur je crois, hors d’âge) et des queues de spectateurs partout, aux entrées de la salle, à l’ascenseur, aux lieux d’aisance, aux bars. Seul le bar du parterre est un peu plus large. Mais celui des galeries (Dress circle) est minuscule et d’ailleurs le public (des centaines de personnes) ne peut guère s’y mouvoir.
Un public diversifié, troisième, quatrième âge, déambulateurs, fauteuils roulants (dans un lieu guère aménagé pour les personnes à mobilité réduite). Comme partout, le public des concerts est plutôt mur. Mais on croise aussi plus qu’au MET des jeunes, des étudiants des touristes un peu perdus dans ce labyrinthe hanté.
Alors évidemment j’aime beaucoup. Je n’ai guère d’expérience d’une salle de concerts plus évocatrice (même le Musikverein dégage moins d’âme), et en même temps plus malcommode, de cette incommodité parlante, émouvante. On craint comme la peste le jour où l’on décidera de réaménager ou de moderniser.
Oui, Allez à Carnegie Hall. Au plus vite si vous allez à New York.
D’autant que l’on se pressait ce dimanche 12 octobre en matinée (à 15h), où l’orchestre du MET dirigé par James Levine dans l’un de ses rares concerts symphoniques proposait avec Maurizio Pollini en soliste un de ces programmes qui font tilt dans la tête du mélomane, le concerto pour piano n°21 de Mozart, et la Symphonie n°9 de Mahler.
Le concerto pour piano n° 21 de Mozart K.467 en ut majeur est un des piliers du répertoire, notamment le deuxième mouvement. C’est une pièce favorite de Maurizio Pollini, en tournée aux USA qui l’a déjà donnée ce printemps avec Christian Thielemann à Salzbourg. J’avoue avoir été éberlué de l’ambiance extraordinaire qui y est immédiatement installée. Le concerto coule avec une fluidité étonnante, un sens du legato, dans un Mozart volontairement sans accrocs, mais non sans accents. Une force qui va tranquille et joyeuse, comme l’ange de La Mort des amants baudelairienne. J’évoque ce poème à dessein, l’un des rares poèmes du bonheur baudelairien. Nous sommes effectivement dans une sorte d’évocation d’un Mozart heureux : c’est une des périodes de bonheur de sa vie, (« le court bonheur de ma vie », dirait Rousseau) il est auréolé de succès, il entre à la franc-maçonnerie deux mois avant la création de ce concert au Burgtheater. Et la joie se traduit à la fois par un rythme assez vif, mais jamais alourdi (alors que souvent Levine est accusé de l’être), empreint d’une grandeur simple, et par une sorte de continuum, de chasse au bonheur très stendhalienne, une sorte d’évocation édenique qui pacifie. Évidemment, Maurizio Pollini adhère complètement à cette vision, dans une forme éblouissante, mais jamais démonstrative, jamais marqué par la folle rapidité qu’il avait imposée à Salzbourg face à un Thielemann plus retenu… Il y a ici une véritable unité, un système d’écho où très clairement soliste et chef tiennent le même discours. D’ailleurs, Levine s’est placé non face à l’orchestre, mais à l’oblique, pour avoir le soliste dans son champ de vision (il ne peut se tourner). Une profonde entente semble régner sur la conception de l’œuvre, marquée par une sérénité joyeuse qui inonde l’auditeur.
Il faut aussi souligner la qualité de l’orchestre, car au-delà de cette fluidité évoquée plus haut, il y a une approche bien analytique qui met en valeur chaque pupitre, cordes évidemment, mais aussi percussions ou bois. Le son produit a cette luminosité et cette clarté qui me rappellent quelquefois le Mozart de Böhm, qui m’a tant frappé dans ma jeunesse, qui met en tous cas en valeur les recoins de la partition et qui surtout permet à l’auditeur de ne pas rester concentré sur le soliste comme souvent dans un concerto, mais surtout faire des sortes d’aller et retour, favorisant aussi une vision plus globale. Pollini déploie dans le rondo final (que j’aime moins) une virtuosité incroyable, tout en gardant cette délicatesse de toucher sans sacrifier le volume sonore ni la précision du frapper : équilibre subtil dont seul il est capable les jours de grâce.
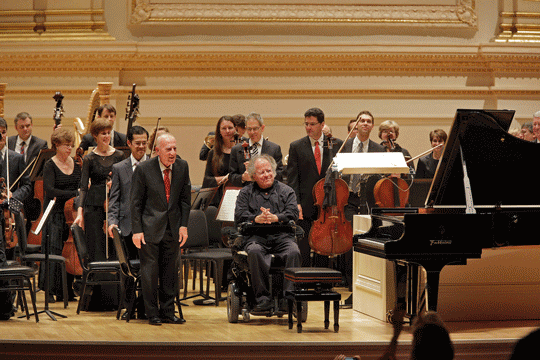
L’univers Mahlérien, et notamment de ce Mahler-là, de cette symphonie-là (la n°9 en ré majeur), pourrait être aux antipodes de la sérénité. Mahler traverse des épreuves, et la période est sombre. Claudio Abbado a souvent interprété Mahler dans le sens de la tristesse nostalgique, du sarcasme désabusé, de l’énergie du désespoir ou surtout d’une sorte d’indicible tristesse. Ses dernières interprétations de la 9ème la tiraient clairement vers cette tristesse fondamentale. D’ailleurs, lorsqu’il évoquait Mahler dans les conversations, il parlait souvent de tristesse ou de souffrance.
J’avoue avoir été un peu désarçonné au départ, par une approche à la fois impeccable au niveau technique, l’orchestre ayant été à chaque moment au sommet, et presque trop « inhumain » dans sa perfection. Cette perfection m’a, je l’avoue, gêné. Je l’ai dans un premier temps attribuée à de la froideur, à une approche à la fois monumentale et distante. Et j’ai eu un peu de difficulté à entrer ainsi dans un univers mahlérien inhabituel pour moi. Quand on a vécu avec Abbado presque systématiquement dans Mahler avec les émotions que l’on sait, dans une sorte de perfection séraphique, il est difficile de pénétrer d’emblée dans un univers différent et surtout si différent : ce n’est pas une question de comparaison, c’est une question d’accoutumance addictive. J’avais cependant été très séduit voire secoué par ce que faisait Daniele Gatti avec la Concertgebouw à Lucerne en 2013, dans une interprétation inhabituelle pour moi très charnelle, très chtonienne et sublimement maîtrisée, dont l’option pourrait se relier à ce que nous avons entendu à Carnegie Hall.
À distance d’une dizaine de jours, les traces de la mémoire parlent, et l’incroyable performance de l’orchestre, alliée à l’option de Levine, qui évite la sensiblerie ou la tristesse, pour donner de l’espace certes à une certaine mélancolie, mais en même temps laisser l’espace à une énergie qui n’est pas celle du désespoir, mais une sorte de force tranquille, de décision. Peut-être cette option n’est-elle d’ailleurs pas étrangère à son retour, après qu’on eut parié sur son retrait, et du MET et des podiums et aux conditions physiques et psychologiques qui doivent l’accompagner.
Autant je suis sorti du concert convaincu par Mozart, autant je suis resté un peu plus dans le désarroi pour Mahler, j’ai ressenti quelquefois une certaine froideur, une sorte de perfection du bloc de marbre, sublime de régularité, mais glacial. Mais, la mémoire du cœur a fait son chemin, j’ai peu à peu reconstruit mes souvenirs, car je ne cessais de penser à ce concert, pour constater que derrière l’option de Levine, il y a quelque chose de vital, de profondément sensible et volontaire. Toute la vision du chef est d’ailleurs à embrasser dès le début, qui prolonge d’un certain point de vue la sérénité du Mozart précédent : il y a là Esprit , quand on saisit, en y réfléchissant, cette vision à la fois sereine et profondément vitale qui irrigue tout le premier mouvement andante comodo, une envie de vie, de nature, d’air, de sève, avec juste un rien de douce mélancolie. Le son est plein, les moments de tendresse très retenus, aussi bien d’ailleurs que le terrible rondo burlesque (si désespérant chez Abbado) abordé ici avec une sorte de distance, de fatalisme mais sans aucune indifférence. Il y a dans cette vision (car plus que d’interprétation, c’est de vision qu’il s’agit) comme chez Mozart auparavant une suprême sérénité, sans joie cette fois, mais une sérénité affichée et affirmée devant l’irrémédiable qu’on sait devoir arriver. En ce sens, ce travail a une incroyable grandeur, une grandeur à la fois apollinienne et tragique, presque nietzschéenne.
Au service de cette approche, un orchestre vraiment époustouflant. On a l’habitude de tordre le nez devant certains orchestres de fosse rarement sollicités dans le répertoire symphonique, mais force est de constater non seulement la qualité exceptionnelle de chaque pupitre (altos d’une rare finesse, contrebasses sublimes, bois à se damner), même si on connaît la technicité extrême des orchestres nord-américains, mais aussi une manière d’engagement, une vraie sensibilité dans le jeu qu’on ressent de manière si vive dans le dernier mouvement. Abbado allait vers le silence final (qui est dans la partition : Mahler a écrit still) avec un decrescendo sonore que seul lui pouvait prétendre des orchestres, comme une succession de spasmes à peine perceptibles vidés de toute sève, de notes qui peu à peu glissaient vers le son, de choses lointaines et vagues peu à peu envahies de néant. Ici, il y a évidemment decrescendo sonore, mais le son reste dessiné, la note est présente : jusqu’au bout, il y a musique, jusqu’au bout, il y a donc vie comme ces corps qui disparaîtraient peu à peu dans l’eau jusqu’à ce qu’on n’en voie qu’un bras, puis une main, puis un doigt. Jusqu’au bout, il y a bribes de musique, jusqu’au bout, on entend et dans un tempo même un peu plus rapide que l’habitude. Et à la fin, il n’y a pas résignation mais bien plutôt un manque : l’addiction à la vie existe même dans ce silence final…
James Levine, que j’ai entendu souvent entre 1980 et 2000 (essentiellement dans Wagner), ne faisait pas loin de là, l’unanimité et je me suis moi-même souvent ennuyé devant des Parsifal étirés au point de perdre tout ressort ou même toute âme, et puis, çà et là, des moments de pur génie. Face à ce que nous avons pu vivre dans cet extraordinaire concert (dont il n’y aura pas trace, hélas), on ne peut qu’encourager les mélomanes voyageurs (les Wanderer ?) qui ont la chance de pouvoir le faire à aller l’entendre : à 71 ans, il reste l’une des baguettes de référence. Et si vous ne pouvez traverser l’atlantique, guettez ses apparitions dans les retransmissions du MET : il fait partie des monstres du podium et il ne faut pas le rater. [wpsr_facebook]

