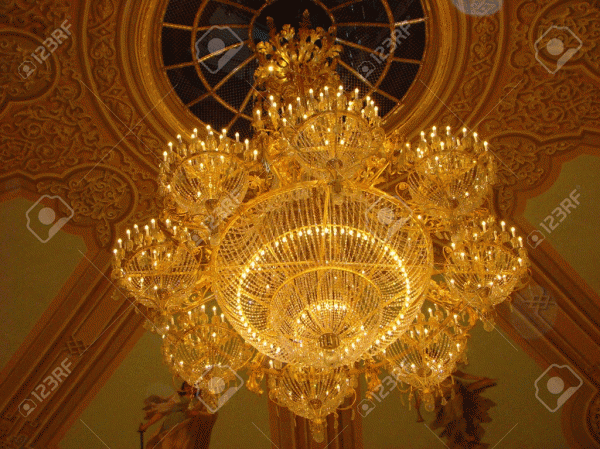Il y a quelques années, en 2020, j’avais publié dans ce Blog un article sur l’Opéra de Paris intitulé « La Valse des Branquignols » qui pointait les errances de l’État dans la gestion de notre Opéra national depuis la fin de l’ère Liebermann.
La toute récente nomination d’Olivier Py au Châtelet a provoqué quelques remous, et m’amène à considérer l’histoire de ce grand théâtre parisien qui appartient à la Mairie de Paris, comme on sait, moins accidentée que son lointain cousin l’Opéra, mais qui semble être devenu un boulet aux pieds de la Ville comme l’Opéra l’est à ceux de l’État.
Un article du Figaro du 3 février dernier est à la fois éclairant tout en suscitant bien des sourires : https://www.lefigaro.fr/theatre/les-dessous-de-la-nomination-d-olivier-py-au-chatelet-20230203
J’y renvoie le lecteur curieux : on y raconte les tribulations de cette nomination qui est fruit d’un choix de nom plutôt que d’un projet.
Comme tout parisien le sait, au centre de Paris, à deux pas de l’Hôtel de Ville (autre théâtre comique), deux théâtres appartenant à la Ville de Paris se font face, chacun à la glorieuse histoire, l’un le Théâtre de la Ville, ex-Sarah Bernhardt actuellement sous échafaudages pour un temps encore prolongé, et l’autre, le Théâtre du Châtelet.
Comme souvent, il est passionnant de se plonger dans leur histoire, c’est un aspect qui est aujourd’hui assez négligé mais qui peut éclairer la permanence de certaines politiques (le mot est hardi) parisiennes. L’histoire de ces deux théâtres construits à la même époque suite aux transformations haussmanniennes, est d’une certaine manière croisée, puisque l’actuel théâtre de la Ville a commencé comme théâtre musical (il portait le nom de Théâtre Lyrique et on y a créé Roméo et Juliette de Gounod et Les Pêcheurs de perles de Bizet entre autres et le Châtelet plutôt comme théâtre de prose.
C’est au XXe siècle que le Châtelet a commencé à accueillir de la danse, de la musique et des concerts, tandis que le théâtre d’en face concédé à la star Sarah Bernhardt va prendre son nom pendant sept décennies (le nom est réapparu à côté de « Théâtre de la Ville ») et donc être dédié au théâtre parlé. Le Châtelet et le Sarah-Bernhardt sont deux théâtres à l’italienne. C’est à la fin des années 1960 que la salle du Sarah-Bernhardt est détruite pour faire place à l’amphithéâtre de béton d’un peu moins de 1000 places qu’on connaît, ode à la laideur bétonnée tant prisée dans ces années-là, et qui va devenir Théâtre de la Ville.
La salle du Châtelet est préservée du massacre, bien heureusement.
Le Théâtre du Châtelet, des années 1930 aux années 1970, fut le temple de l’opérette à grand spectacle et à succès, c’est un théâtre authentiquement populaire qui présente aussi de grandes pièces de théâtre susceptibles de ramener un vaste public. J’y ai ainsi vu au tout début des années 1960 L’Auberge du Cheval Blanc (Mise en scène de Maurice Lehmann) avec Bernard Lavalette, et L’Aiglon d’Edmond Rostand (qu’on ne joue plus aujourd’hui) superproduction avec Pierre Vaneck, Renée Saint Cyr, Jacques Dumesnil. Je peux dire que ces deux productions ont donné au garçonnet de 8 ou 9 ans que j’étais le goût de la musique et du théâtre. C’est dire comme je suis attaché à ce lieu…
C’était le temple de l’opérette et sa transformation en Théâtre Musical de Paris en 1980 a plus ou moins signé l’arrêt de mort du genre en France, relégué dans les matinées dominicales des théâtres en région, ou réduit à Offenbach (certes important) ou Johann Strauss Jr (La Chauve-Souris) et Franz Lehár (La Veuve Joyeuse) au hasard des programmations des grandes institutions. Il n’y a plus de culture de l’opérette, plus de vraie formation, plus de véritables artistes spécialistes du genre et bien peu de metteurs en scène intéressés (à part Laurent Pelly). L’opérette, ça n’est pas chic, on préfère le Musical aujourd’hui plus bankable… Pour voir de l’opérette bien faite et des salles pleines, il faut aller (par exemple) à Berlin voir le travail d’un Barrie Kosky. On en revient édifié.
Au Châtelet au long du XXe siècle, c’est pendant des dizaines d’années Maurice Lehmann qui a donné le ton, et ses successeurs ont suivi son sillon, tablant sur Georges Guétary, Luis Mariano, puis José Todaro qui était la copie du précédent. À mesure que les temps avançaient c’était toujours la même recette et le genre s’encroutait, malgré les succès momentanés de Francis Lopez qui pouvaient faire illusion (comme Gipsy), mais ne pouvaient faire office de ligne programmatique bien longtemps, d’autant que les autres théâtres spécialisés dans le genre, Mogador et la Gaîté Lyrique avaient fait faillite et dû fermer. Les tribulations de ce dernier, une salle importante (1500 places, fosse d’orchestre) qui a littéralement été massacrée par la Ville de Paris (Jacques Chirac) sont un authentique scandale. À la faveur des riches idées de l’époque, la salle à l’italienne a été détruite au profit d’un projet « Planète magique » qui mourra en deux ans (1989-1991). Ce théâtre historique qui remonte au XVIIIe a été éventré par la Ville de Paris sauce Chirac pour devenir un fantôme. Avec l’arrivée de Delanoë, la Gaité Lyrique est devenue un Centre Culturel Arts numériques et musiques actuelles… Il a ouvert en 2011 sans jamais prendre véritablement son envol.
Au moins, le Châtelet a échappé au massacre de béton du théâtre d’en face et à la destruction de la Gaité Lyrique (il est vrai située dans un lieu moins majestueux que le Châtelet) en matière de Branquignols, la Ville de Paris tient aussi son rang .
Vint donc 1980…
1980 est une date charnière qui fait illusion pour tous.
L’Opéra de Paris auréolé du succès de Rolf Liebermann, fait le plein, refuse du monde et ce succès va provoquer des réactions en chaine. D’un côté, au départ de Rolf Liebermann, la succession va être plus accidentée que prévue (3 administrateurs généraux et une administration de transition de 1980 à 1989) et à la faveur des grands travaux mitterrandiens, la construction d’un Opéra plus-grand-plus-beau-plus-fort et surtout plus populaire, pour caser tout ce public qui frappe aux portes, va durer dix ans, c’est long…
De l’autre côté, à la Mairie de Paris, alors dirigée depuis quelques années par Jacques Chirac, premier opposant (de Giscard comme de Mitterrand), on veut faire très vite un opéra-bis, qui puisse montrer que du côté de la Mairie on a une politique culturelle, et qu’on est aussi prêt à accueillir le trop-plein de public lyrique sans attendre la construction de Bastille. Heureuse époque où la culture était même un enjeu politique…
La Mairie de Paris face aux triomphes de l’Opéra par exemple, Lulu de Berg, le dernier grand spectacle mythique, dans la mise en scène de Chéreau, n’avait que Volga de Francis Lopez à afficher au Châtelet la même année (1979). Pour tout édile RPR de l’époque, il fallait évidemment faire quelque chose : Lopez delendus est.
La transformation a lieu à l’occasion de travaux dans le théâtre, qui renaît sous le nom « Théâtre Musical de Paris », bien plus chic que ce « Châtelet » qui au mieux évoquait l’Auberge du Cheval Blanc, au pire Monsieur Carnaval
Le modèle se référait aux heures de gloire du début du XXe, quand les Ballets russes triomphaient et que Gustav Mahler et Richard Strauss venaient y diriger…. On se voulait diversifié, mélangeant tous les genres (opéra, opérette, concerts de divers formats), sous la direction de Jean Albert Cartier – un modèle qui n’a pas si mal marché puisqu’il a duré avec Stéphane Lissner et Jean-Pierre Brossmann jusqu’au début des années 2000, le Châtelet était un pôle alternatif de musique classique, pendant que l’Opéra de Paris gérait la fin de Garnier, les débuts de Bastille avec les hoquets que l’on sait.
C’était un pôle de stabilité et, il faut le dire, d’excellence, même si l’opérette fut de moins en moins programmée. Mais c’était un pôle Chirac, un pôle RPR et quand une majorité socialiste est arrivée à Paris, elle ne pouvait continuer sur ce modèle : il fallait en changer, pour montrer que chez les socialistes, on avait aussi des idées. L’idée force et tellement de gauche (parisienne, ce qui déjà limite un peu le champ) fut celle d’un théâtre qui défendrait les genres populaires, musical et opérette en tête qui eux aussi avaient fait l’histoire de ce théâtre… Le Châtelet revenait à avant 1980, à grosso-modo avant Chirac. Évidemment, la longévité et le succès du modèle Châtelet-Chirac et son succès n’étaient pas à mettre dans la balance. À la Mairie de Paris new-look, on avait des idées, on avait (alors)du pétrole et on défendait évidemment, la qualité pour le peuple..
Alors on a donné les clefs à Jean-Luc Choplin, l’actuel néo-directeur du Lido et bien plus plumes et paillettes que les prédécesseurs. Le Châtelet a renoué avec les grands spectacles de Musical, ou d’opérette (on y a même revu Le chanteur de Mexico ou les grands classiques du Musical comme My fair Lady) un peu d’opéra au début (une Norma du genre calamiteux) mais surtout dans le domaine classique des formes hybrides, plus ouvertes comme des oratorios mis en scène (par Bob Wilson par exemple) ou la présence de grands noms du cinéma comme David Cronenberg.
Ça n’a pas si mal marché, il y avait au moins une cohérence, avec une image du théâtre qui n’était pas contradictoire avec son histoire. On pouvait aimer ou détester mais cela avait une ligne. Quand Jean-Luc Choplin désigné par Bertrand Delanoë, a quitté le Châtelet après plus de 12 ans de présence, l’administration municipale, dirigée cette fois par Anne Hidalgo (même parti, mais pas tout à fait même vision) a voulu donner au Châtelet un nouveau cours. Car dans la tête du politique (?) l’important est de montrer qu’on existe dans chaque domaine, plus que réfléchir à une gestion, à un continuum à une histoire. Il est clair que c’est le hic et nunc qui compte, autrement dit l’opportunisme, jamais la vision. Cette politique-là qui vit sur le court terme, est une insupportable violence pour la pensée et la réflexion.
On confie donc à Ruth Mackenzie la charge du théâtre, un projet touffu, très contemporain (c’est tellement chic et choc). Mais elle a à peine le temps de le mettre en place de 2019 à 2020, qu’elle est licenciée en août 2020. Cette femme à poigne en avait visiblement trop pour la fragile institution parisienne. Et soit dit en passant, tout le milieu connaissait le personnage et sa manière d’être, sauf ceux qui l’ont choisie apparemment. Sans doute y -a-t-il eu d’autres raisons, mais sans épiloguer, on voulait de l’explosif et ça a explosé.
Ruth Mackenzie aussitôt nommée, aussitôt vidée, et depuis le Châtelet vivote, subit comme tout le monde le Covid, et accumule un gros déficit. La nomination d’un successeur est retardée : Anne Hidalgo n’a pas de politique culturelle lisible, comme d’ailleurs la plupart des édiles et politiciens de sa génération. À commencer par le premier d’entre eux, Macron en politique, Micron en politique culturelle. Du coup le Châtelet devient un boulet, on ne sait trop qu’en faire, et la Mairie de Paris n’a pas trop communiqué sur le sujet, ni sa vision en la matière. Quand on n’a plus de pétrole, quand on n’a pas d’idée, il reste Zorro.
Zorro est arrivé, il s’appelle Olivier Py…
Cette nomination, en elle-même pas absurde (Py a fait ses preuves) a provoqué quelques remous du côté d’EELV, ce qui est étonnant quand on connaît la manière dont les grandes villes écologistes traitent leur opéra, et considèrent en général la culture. Voilà donc EELV en réveil culturel, pas sur les projets mais sur le processus de nomination, car deux femmes semblaient tenir la corde, et ont été coiffées sur la ligne d’arrivée par Olivier Py, EELV devrait pourtant savoir qu’Olivier Py ne dédaignait pas naguère les talons aiguilles…
Au-delà du sourire, c’est le fait qu’un homme ait été préféré à deux femmes qui semblaient avoir le vent en poupe qui a réveillé l’intérêt culturel d’EELV. Ouf, on est rassuré, il ne s’agit pas de politique culturelle, inconnue au bataillon…
Dans les services de l’État comme dans ceux de la Mairie de Paris (c’est l’État en plus petit), la question n’est jamais le quoi faire ? Mais le qui mettre ? C’est la question la plus facile, celle qui montre qui a le pouvoir, et la plus creuse dans la mesure où sans idées pour le lieu, on attend d’être séduit par un projet (?) d’autrui. Et quand il n’y a pas de projet, il reste les noms.
Si l’on en croit Le Figaro un pool Théâtre de la Ville / Théâtre du Châtelet sous la présidence d’Emmanuel Demarcy-Mota serait créé. L’actuel directeur au (trop) long cours du Théâtre de la Ville, lecteur passionné du Courtisan de Balthazar Gracian à qui il doit sans doute sa longévité, est certes un administrateur efficace et un bon programmateur, mais il n’a pas frappé comme metteur en scène par des travaux mémorables depuis son installation en 2008 (il est vrai que les directeurs du Théâtre de la Ville ont une certaine longévité). Mais qu’importe : Olivier Py flanqué de la tutelle directe d’un confrère ne semble pas une idée de génie, mais comme on dit wait and see…
Sur plus d’un siècle, il n’est pas surprenant que des théâtres changent de couleur, d’attribution, selon les tutelles et les modes. Il y a cependant des capitales étrangères où la carte du spectacle vivant est plus lisible et stable, mais soit : ce n’est pas seulement la musique classique qui valse avec le goût des tutelles à Paris, mais des institutions privées comme Le Casino de Paris ou surtout Les Folies-Bergère, symboles d’un certain Paris mythique ont aussi changé de destination sans qu’on sache exactement aujourd’hui leur couleur ni leur utilité réelle, puisqu’elles servent de garages à productions de passage et que le groupe Lagardère propriétaire, les a mis en vente en 2020 (avec le Bataclan). C’est un patrimoine qui se perd
Le Châtelet a vécu une cinquantaine d’années avec l’opérette, puis une vingtaine d’années avec de la musique classique. Depuis il a changé de destination et semble aller au gré des flots socialistes de la Mairie de Paris, qui ne sait plus que penser ni qu’en faire : il est vrai que les idées au parti socialiste ont quitté le navire et que la culture est plus un paravent à l’effigie de l’ombre de Jack Lang qu’autre chose.
À la décharge de socialistes, il est vrai aussi que d’un bout à l’autre du spectre politique, on n’affiche plus de ligne culturelle. Seriez-vous capables de citer le nom des onze ministres de la culture depuis 2002 ? Ou même un seul ? Roselyne Bachelot peut-être, une vraie politique et une vraie passionnée, mais qui vient de faire paraître un livre désabusé. La période n’est pas favorable à la définition d’une politique culturelle, et on en reste encore et toujours aux années Lang, sans qu’une politique adaptée à notre temps, à l’évolution des genres et des publics, mais aussi des pratiques et des technologies n’ait fait l’objet d’un approfondissement qui aille au-delà de la petite semaine. Alors, dans ce paysage assez sinistré, les dernières aventures du Châtelet ne sont pas un épiphénomène, mais le symptôme d’une situation parisienne voire nationale désordonnée.
D’abord, il y a dans Paris une abondance de salles sans destination (nous avons évoqué plus haut Les Folies-Bergère et le Casino de Paris), des garages à spectacles de passage, ou des salles d’accueil dites de toutes les musiques, un terme à la mode qui montre que ce qui compte n’est pas une destination ou une ligne, mais une capacité d’accueil, et une volonté locale d’avoir son lieu, comme la toute dernière Seine Musicale., le dernier joujou à la mode, projet du conseil départemental des Hauts de Seine, qui accueille de Jaroussky aux Victoires de la musique en passant par Starmania et qui, comme dit son site accueille tous les genres et tous les formats avec deux salles, l’une d’un peu plus de 1000 places et l’autre de 4000 places au minimum) sans compter d’autres espaces divers (salles plus petites, expositions, promenades, restauration). Projet ambitieux et gigantesque, on lit sur son site que La Seine musicale « concentre en un même lieu des espaces de concert, d’exposition, de promenade, des restaurants et des commerces liés à l’art et à la culture. Fidèle à son ambition fondatrice, elle est la nouvelle destination du spectacle vivant de l’ouest parisien. » qui répond dans un style très différent au Sud-ouest de Paris à la construction de la Philharmonie au nord-est de la capitale. Dans Paris intramuros, il reste notamment Pleyel et le Palais des Congrès. Sur le site de la Salle Pleyel, on lit aussi « Tous les genres », de la Pop à l’humour et au théâtre (sauf la musique classique, bannie par le contrat d’exploitation), et en visitant celui du Palais des Congrès (3700 places) on lit qu’il « accueille les plus grands spectacles : ballets, concerts et comédies musicales mais aussi de beaux événements sportifs . Trois exemples de salles d’accueil aux ambitions et objectifs similaires.
Chaque époque à Paris a eu ses salles d’accueil au large public, en son temps Bercy (aujourd’hui Accor Arena) a accueilli des opéras (Aida) ou le Palais des sports de la Porte de Versailles les grandes machines théâtrales de Robert Hossein… Quant au Palais des Congrès, il accueillit aussi des saisons symphoniques (Orchestre de Paris) voire de grands concerts internationaux comme les Wiener Philharmoniker dans les années 1970).
On trouve donc à Paris de grandes salles d’accueil aux capacités variées (l’éventail est large des Folies-Bergère à la Seine musicale) dont la vocation est l’accueil multigenre, et des salles plus ciblées “musique classique”, même si la Philharmonie affiche aussi officiellement toutes les musiques.
Ainsi l’Opéra avec ses deux salles, L’Opéra-Comique, le TCE, la Philharmonie avec ses deux salles et ses espaces, l’auditorium de Radio France se partagent l’espace classique, avec d’autres espaces plus petits comme Gaveau et la Salle Cortot (qui peinent) et ceux qui ont inscrit la musique comme axe porteur de leur programmation comme l’Athénée, ou comme la salle de l’IRCAM qui vient de rouvrir, dans un domaine très spécialisé. Et je ne compte pas deux salles plus éloignées que sont l’Opéra Royal de Versailles ou l’Opéra de Massy, en panne de programmation (voir son site, éloquent)…
Dans cette forêt parisienne deux remarques :
– D’une part l’offre n’est-elle pas un peu excessive pour un public dont on dit qu’il se réduit ?
– Dans ce paysage, où mettre le Châtelet, qui aurait compté comme salle classique il y a vingt ans, mais dont la destination aujourd’hui reste problématique. Quel profil ? quelle identité ? Garage de luxe multigenre ? Théâtre de production et de création ? Retour au Théâtre musical de Paris ? Retour au Châtelet de Choplin ?
Comme on le voit, la carte parisienne est complexe, en plus des théâtres spécialisés, la plupart des salles multigenres affichent aussi du classique, outre que des salles comme le TCE proposent un programme qui n’est pas vraiment alternatif par rapport aux salles nationales, comme si elles fonctionnaient comme des salles de quartier : si le Châtelet devient un TCE bis, cela n’a aucun sens. Il n’y a ni but ni vision dans tout cela mais seulement du désordre et de l’opportunisme.
De plus en plus de salles livrées au multigenre après avoir eu un passé à l’identité bien marquée, faute de projets pour y construire une programmation qui corresponde au lieu et parce qu’en faire des garages à spectacles est la voie la plus courte pour faire de l’argent tout de suite puis laisser tomber le navire s’il ne rend plus assez (cf. Lagardère avec ses trois salles si particulières dans le paysage parisien), voilà l’évolution actuelle du paysage parisien, embrumé par la com qui masque le vide créatif et conceptuel.
Ce qui frappe l’observateur en effet, c’est que Paris, une des places où le nombre de théâtres et de salles fut historiquement le plus haut et où la création fut la plus active est devenu un lieu de reproductions, de reprises, moins de création. L’Opéra, il est vrai empêtré dans ses problèmes financiers, au lyrique comme au ballet, n’est plus une grande référence internationale, il y a pas mal de temps que la scène française au théâtre ne fait plus rêver, même si ces dernières années quelques noms sortent du lot (Gosselin, Teste).
Dans ce paysage assez terne, le paradoxe reste hélas le même : l’espace parisien (au sens large) propose une offre hyperbolique et pas forcément excitante tandis que l’offre régionale au niveau du classique s’enfonce dans les difficultés (on a beaucoup parlé de Rouen, mais d’autres théâtres sont à la peine). Entre l’argent public et privé englouti à Paris pour le spectacle vivant et les déséquilibres de l’aménagement du territoire en la matière qui restent endémiques, on reste un peu rêveur. Le rapport de Caroline Sonrier « La politique de l’art lyrique en France » remis à Roselyne Bachelot en septembre 2021, en soi excellent, dort dans les tiroirs : il demanderait une mise à plat des politiques locales, une redistribution des rôles des institutions territoriales livrées aux affichages politiques (cf. la nullité, il n’y a pas d’autre mot, de la politique culturelle de la région Auvergne Rhône Alpes ou celles assez douteuses des villes écologistes), la fin de la tutelle des villes sur les opéras, simplement parce qu’aujourd’hui elles ne peuvent plus assumer seules ou presque leur financement, mais cela pose la question de la « compétence culturelle » derrière laquelle certains se cachent. Raison de plus pour tout remettre à plat
Ce travail est long, ingrat et invisible, un crime de lèse com en ces temps de tout, tout de suite, d’autant que les J.O. approchent et qu’il faut afficher (seulement afficher, rassurons-nous) une France cultureuse, culturante et cultivée. Alors on comprend bien pourquoi le destin du Châtelet est emblématique d’une situation plus large, signe de la désertion du politique face à la culture, qu’il préfère limiter à la gestion du quotidien, déjà bien lourde et compliquée : si en plus il fallait penser, ce serait insupportable.
Au terme de cette réflexion dont je sens qu’elle va dans bien des sens sinon dans tous les sens, la question du Châtelet n’est qu’un arbre qui cache la forêt et il faut bien parler un peu de la forêt. Dans ce paysage parisien au trop plein assez uniforme et assez peu excitant au total, il faudrait peut-être revenir à des lieux à la fonction identifiable. Qu’il y ait des hypermarchés du spectacle vivant pourquoi pas s’ils marchent. Mais on sait bien que ce n’est pas des hypermarchés que vient l’originalité et la couleur, que vient la nouveauté et le créatif. Le néo directeur du Châtelet devrait s’en souvenir, parce que Paris chante, danse et tourne à vide.