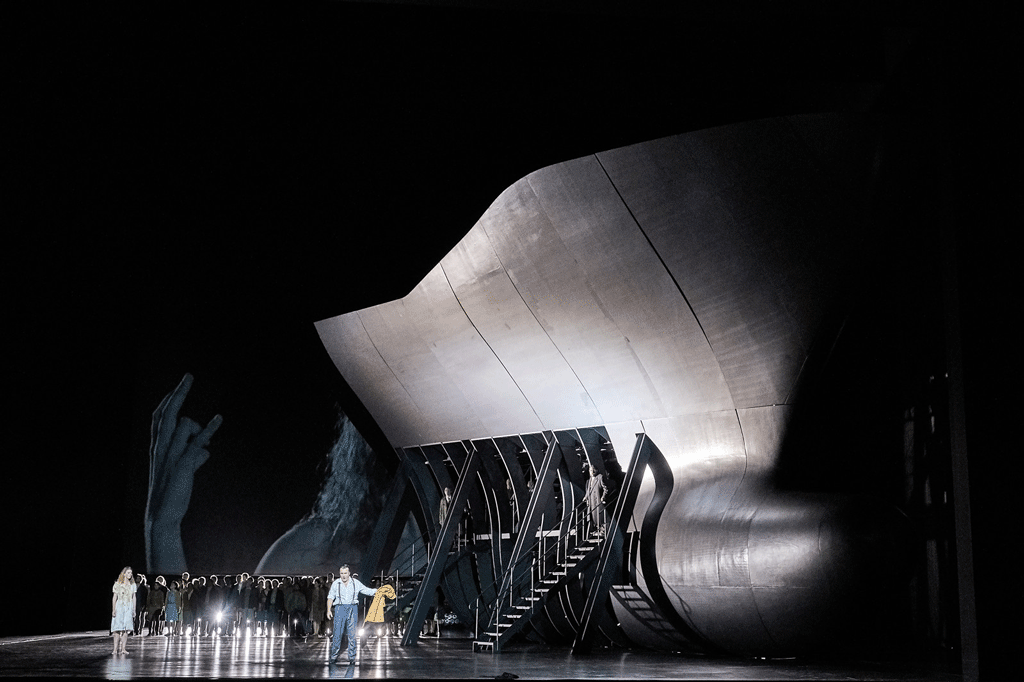Le cas Boccanegra
Une chose est claire : il n’y a pas de production de Simon Boccanegra aujourd’hui qui ne soit mise en relation avec la production légendaire de Giorgio Strehler (1971) qui a fait le tour du monde, de Paris à Tokyo en passant par Washington et Moscou, et qui a fini à Vienne (apportée par Abbado) où deux imbéciles devant l’éternel , Eberhard Waechter (qui pourtant chanta Simon à Munich dirigé par Abbado avec Janowitz en Amelia en 1971, mais pas dans la production Strehler) et Ioan Holänder, ont décidé de la détruire après le départ du chef italien vers Berlin: comme tous les imbéciles, ils devaient en avoir peur, puisqu’ils ont même refusé de la revendre au Teatro Carlo Felice de Gênes qui voulait légitimement l’acheter.
Avec une vidéo de la RAI (qui intègre une introduction flamboyante de Strehler), qui circule encore aujourd’hui, ce spectacle peut être vu de tous les amateurs d’opéra. Il y a aussi une vidéo de l’Opéra de Paris, dont je possède miraculeusement une copie, qui a croupi dans les caves, puisque de sombres questions de droits ont empêché les vidéos de l’ère Liebermann d’être plus tard exploitées. C’est ainsi que la Lulu de Chéreau a disparu des radars et bien d’autres retransmissions. La vidéo de Paris est peut-être encore musicalement supérieure à celle de Milan, malgré les rapports exécrables qu’Abbado a entretenus avec l’orchestre de l’Opéra.
Mon lien à Simon Boccanegra est si personnel qu’un « post » sur le blog était inévitable, tant je sens le besoin, après avoir vu la production parisienne, très digne, de bon niveau, de faire le point sur cette œuvre, sur les mises en scènes de Verdi, et évidemment sur la production de Calixto Bieito et Fabio Luisi.
De la difficulté à mettre Verdi en scène
On serait bien en peine de citer de nombreuses productions « historiques » d’opéras de Verdi, il y a la fameuse Traviata de Visconti-Callas, il y a ce Simon Boccanegra de Strehler, puis quatre ans après son Macbeth, toutes à la Scala. Il y a peut-être l’Otello de Zeffirelli, encore à la Scala et ses différentes Aida, moins réussies, et le Don Carlo de Ronconi, copieusement hué, toujours à la Scala qui était alors un théâtre de référence. Mais connaît-on un Trovatore qui ait laissé quelque trace dans la mémoire, ou une Forza del Destino, voire un Ballo in maschera ou un Rigoletto (peut-être le travail de Jonathan Miller à l’ENO qui inventa la transposition en quartier mafieux) ? Quelques productions de Traviata restent aujourd’hui digne d’intérêt comme celle de Willie Decker à Salzbourg et ailleurs et sûrement Marthaler à Paris mais au total, c’est bien peu.
Verdi a une place tellement particulière dans le paysage lyrique que toute mise en scène un peu « décalée » ou « originale », notamment de l’horribilis Regietheater qui a produit dans les années 80 des Aida, des Nabucco qui provoquèrent de mémorables scandales en Allemagne, signés notamment par Hans Neuenfels, crée souvent le scandale chez un public pour qui compte bien plus la musique et le chant que la mise en scène.
C’est clair, quand un Verdi est merveilleusement chanté, on évacue la mise en scène (voir l’Otello de Karajan…) : on ne compte plus les productions médiocres qui ont servi d’écrin poussiéreux à des diamants musicaux et vocaux.
La question tient sans doute à ce que la mise en scène « moderne » s’intéresse plus aux drames dont le livret est continu, c’est à dire aux livrets écrits après Wagner. Verdi et notamment la première moitié de sa production reste tributaire des formes classiques, récitatif, air, cabalette et la dramaturgie doit passer par les fourches caudines de livrets souvent improbables, sauf lorsqu’ils prennent leurs source chez Hugo ou Shakespeare : ce n’est pas un hasard si la plupart des grandes mises en scène de Verdi travaillent sur les titres notamment issus de Shakespeare (encore plus que Hugo : Ernani mis en scène en 1982 par Luca Ronconi à la Scala fut un échec ). Mise en scène et Verdi ne vont ensemble qu’avec difficulté, même si certaines productions comme le Macbeth de Barrie Kosky à Zurich sont des références d’aujourd’hui.
Aucune des productions verdiennes actuelles de l’Opéra de Paris (mais c’est le cas ailleurs aussi) ne tient la rampe ou ne mérite même la mémoire, et pour moi qui pleure souvent l’ère Liebermann, ni la Forza del Destino d’alors, ni Trovatore qui devait être de Visconti et qui fut de Tito Capobianco ne laissèrent de traces durables. Seuls survivent dans la mémoire I Vespri Siciliani (John Dexter, un spectacle dans les décors de Josef Svoboda très post-Appia, magnifique et fascinant) si adapté par anticipation esthétique à l’Opéra-Bastille qui ne le verra jamais, et ce Simon Boccanegra, venu de la Scala, qui triompha deux saisons de suite, malgré l’absence d’Abbado (remplacé par Nello Santi) la seconde saison…
Au commencement était Strehler
Cette longue introduction pour replacer la mise en scène de Calixto Bieito dans la double perspective des mises en scène verdiennes, et de l’histoire de Simon Boccanegra en particulier.
On doit à Giorgio Strehler quatre mises en scène verdiennes, La Traviata (1947) Simon Boccanegra (1971), Macbeth (1975), Falstaff (1980).

En 1971, Simon Boccanegra n’était pas considéré comme l’un des chefs d’œuvre de Verdi, c’est justement cette production qui va projeter au premier plan une œuvre considérée comme secondaire, au livret alambiqué avec son prologue qui se déroule vingt-cinq ans auparavant, par sa longueur un acte à lui tout seul.
C’est donc depuis Strehler-Abbado que tous les théâtres en ont proposé des productions, toutes à peu près transparentes, y compris celles dirigées par Abbado après Strehler, à savoir Peter Stein à Salzbourg (c’est la production actuelle de l’Opéra de Vienne, qui remplaça celle de Strehler détruite par la paire d’imbéciles citée plus haut), et ce qu’il faut appeler hélas une mise en scène, à Ferrara, signée d’un certain Carl Philip von Maldeghem (2001).
Strehler avait conçu un travail qui rendait compte à la fois des aspects politiques du drame et de la solitude de ces grandes âmes (car par-delà leurs haines, tous ces personnages sont des âmes nobles, Paolo mis à part). Il a conçu un prologue nocturne, pour exalter dans le reste de l’opéra la lumière mordorée du soleil, qui se couche au soir de la vie de Simon.
Strehler fait respirer l’espace en évoquant sans cesse la mer, qu’on ne voit d’ailleurs qu’à travers des voiles (à l’acte I pour l’air d’Amelia « Come in quest’ora bruna/Sorridon gli astri e il mare! » et au final où le corsaire Boccanegra retourne vers la mer) ou à travers le récit des personnages et notamment d’Amelia, élevée en bord de mer, vivant en bord de mer, enlevée par les sbires de Paolo en bord de mer qui chante la mer dès le début de l’acte I et qui ainsi se montre digne fille de son père.
La mise en scène de Strehler donnait un espace, une respiration où la mer sans cesse évoquée était singulièrement ressentie. Il avait su aussi rendre par l’alternance nuit /jour en opposant prologue nocturne et actes et avait inscrit le drame dans une histoire, politique, temporelle (les héros vieillissent : le duo final des deux vieillards était un moment d’émotion incroyable) et individuelle. Il avait su allier destins individuels et isolés et histoire politique, avec les plébéiens un peu populistes contre les patriciens conservateurs, avec la corruption et les manœuvres qui mènent au pouvoir et les sbires qui réclament leur dû après avoir fait élire leur chef : en bref, la loi de tout pouvoir, qui n’est pouvoir que parce qu’il a su gérer sa part d’ombre. Au milieu de cette lecture politique très moderne, qui n’a rien d’étonnant (depuis la République Romaine et la montée des populares contre le patriciat, au Moyen âge sous Cola di Rienzo toujours à Rome, et bien sûr aujourd’hui, le jeu est le même), il y a une histoire d’amour entre une fille et son père, une histoire d’amour entre deux jeunes gens nobles, une histoire d’amour/haine entre deux vieillards que rien n’oppose en fait humainement. D’ailleurs comme une figure christique, Simon le politique ne cesse de demander au peuple et à son assemblée la paix et l’amour.
Dans la production de Strehler (et mettons à part les aspects musicaux inaccessibles aujourd’hui à aucun chef ni aucun chanteur), il y avait la totalité d’une histoire racontée dans son milieu historique d’origine (Strehler ne transpose jamais, sauf dans son Falstaff dont le cadre est la plaine du Pô), qui mêle politique et rêves individuels, dans un décor sublime d’Ezio Frigerio, qui a marqué les esprits (Ah ! ce lent lever de rideau du premier acte avec cette voile qui se découvre) et des éclairages non moins sublimes. Rien n’était laissé au hasard et rien n’était laissé de côté. La légende musicale a fait le reste.
Et aujourd’hui Bieito
Commencer l’analyse de ce spectacle par Strehler, référence universelle de tout metteur en scène qui s’attaque à Simon Boccanegra, est inévitable et il serait bien surprenant que Calixto Bieito, artiste d’une implacable rigueur ne s’en inspirât point.
Mais s’inspirer ne veut pas dire imiter, car imiter la production de Strehler serait une entreprise inutile sinon ridicule : s’inspirer, c’est se positionner « par rapport à ». C’est la démarche de Bieito qui, à l’instar de Johan Simons en 2006 (et même de Nicolas Brieger en 1994, dont la production de l’ère Blanchard a été suffisamment solide pour survivre jusqu’en 2002 sous Gall), privilégie un axe : pour Simons c’était le politique, et pour Bieito c’est le destin individuel des êtres.
Alors, Bieito va mot à mot s’inscrire volontairement à l’opposé de Strehler. Et c’est cette lecture antithétique qui a désarçonné une partie des spectateurs : à la lumière de la mer et du ciel, à la respiration de l’œuvre, Bieito privilégie le noir artificiel coupé de la glace des néons (car l’obscurité de Strehler n’est pas artificielle, c’est celle de la nuit, éclairée à la torche et au rythme de la musique – Strehler était aussi musicien). À l’espace et à la respiration strehleriennes, Bieito propose un espace unique et clos, un espace tragique vite étouffant conçu par Susanne Gschwender. En renonçant à l’histoire politique avec ses assemblées et ses complots, en faisant du chœur plus une utilité (qu’on ne voit même pas toujours) qu’une présence (sinon musicale), en renonçant aux êtres inscrits dans l’histoire, il montre des individus solitaires, surgissant de l’obscurité, seuls, enfermés sur eux-mêmes, distribués dans l’ombre du vaste plateau de Bastille, jamais vraiment hors champ, et rarement dans le champ, se touchant assez rarement, comme enfermés dans leur bulle. Et il renonce à la trame, refusant les armes (épées etc..), refusant les objets, refusant toute anecdote.
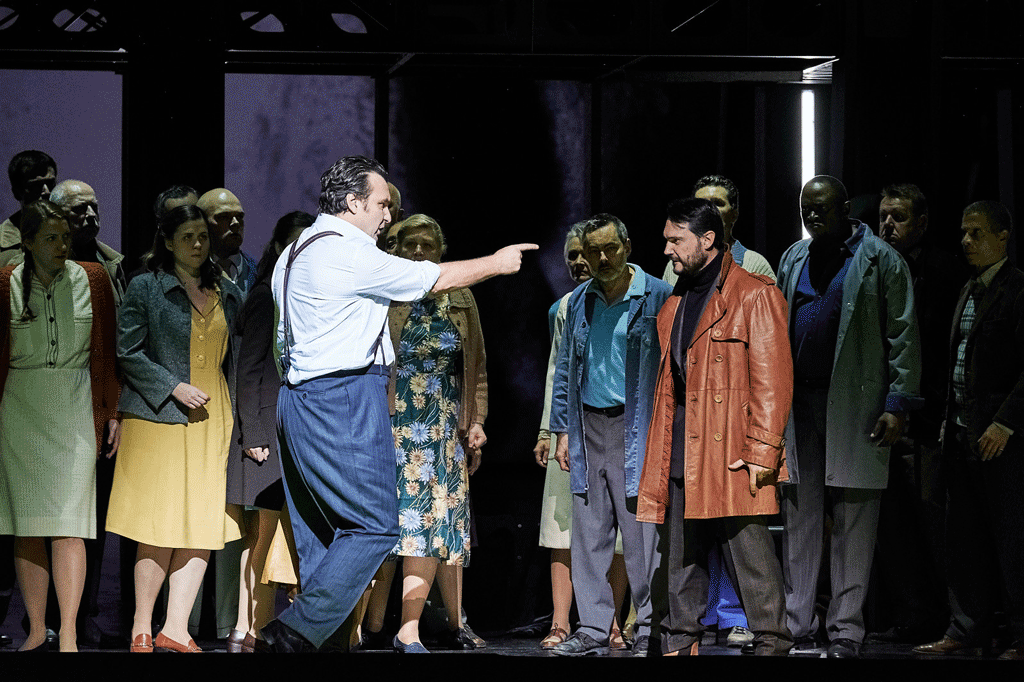
Quant à la mer, elle est présente de manière écrasante et sombre, sous la forme de l’étrave et du bulbe d’un navire en cale sèche, avec ses entrailles dans lesquelles Simon Boccanegra se perd, solitaire, quand il n’est pas sur le plateau : un univers qui évoque le maritime mais un maritime à l’arrêt, en réparation, pourquoi pas à l’abandon comme ces carcasses qui vont mourir en Inde pour être dépecées. Univers mental, concentration (que d’aucuns appellent stupidement ennui : comment s’ennuyer avec cette musique ?), et si tout cela n’était qu’un rêve ? Et dans ces entrailles de navire, avec ses piliers métalliques enchevêtrés, comment ne pas penser non plus au fameux Pont Morandi, dont l’architecture rappelait un peu et volontairement l’architecture navale…
La première image, sans la musique, dans un silence pesant, dans l’ombre, est justement l’ombre de Simon s’allongeant au proscenium, comme il s’allongera à l’acte I (avec sa fille) ou à l’acte III (au moment où il boit le poison). Simon, allongé, comme écrasé, comme plongeant dans un sommeil narcoleptique pour échapper à la crise et au monde devient ici une figure, comme un refrain.
Le traitement même du personnage par Bieito accentue cette singularité : il en fait un être ailleurs, à la fois concerné et distancié. Ses changements de costume aussi montrent une évolution psychologique, au départ personnage « ordinaire » comme l’est le peuple qui l’entoure : certains ont noté la laideur des costumes : qu’est-ce que le beau et le laid au théâtre ? Qui peut qualifier la laideur ? Le laid est sublimé par l’art…
Au théâtre c’est le fonctionnel qui doit dominer : or Bieito fait de Simon furtivement le porte-parole des gens ordinaires et habille Amelia-Maria comme eux, parce qu’elle est issue de ce monde-là, parce qu’elle n’est pas une aristocrate, parce qu’elle est la fille de sa classe et de son père. Les costumes (de Ingo Krügler) sont d’ailleurs le seul signe « idéologique » de cette production, et c’est sur eux que certains se sont fixés…signe idéologique de ce qu’est le genre « opéra ».
Suivons les évolutions du costume de Simon : il est d’abord en parka de cuir, corsaire si l’on veut, plus ou moins comme les autres, et mal coiffé.
En devenant Doge, ostensiblement il se recoiffe, se change à vue, endosse cravate et costume, et lunettes, qui lui donnent un air sérieux et classent son homme avec des attributs du politique selon les lieux communs (souvenons-nous de l’ironie suscitée par les cravates mal nouées de François Hollande, signe d’un ordinaire peu conforme à l’image que les médias voulaient de la fonction, mais pourtant signe d’une normalité revendiquée).
Mais cela dure peu: dès qu’il découvre en Amelia sa fille, il se « défroque », enlève cravate et veste, et se retrouve en chemise col ouvert et bretelles : il est nu, en quelque sorte, il est non plus le politique, mais l’individu.

Retrouver sa fille, c’est du même coup faire coller politique et individu (il porte sans cesse la veste de cuir de sa fille) et œuvrer à la réconciliation des deux classes dont elle est le fruit, c’est porter un discours d’amour et de paix, un discours direct et non plus le discours xyloglottique auquel nous sommes habitués. Bieito lie l’aventure du père désormais comblé à celle du politique (d’où aussi le discours sur Venise, très lisible pour le public de la création, en plein Risorgimento) et fait du destin de Boccanegra un destin individuel presque indépendant des vicissitudes politiques : christique là encore, il meurt pour l’amour, la paix et la réconciliation qu’Adorno portera, incarnation du καλὸς κἀγαθός (litt. Le beau et le bon) de l’idéologie grecque, incarnation du bon gouvernement.

Le jeu des costumes est une sorte de fil rouge de cette mise en scène : Simon porte la veste de sa fille, qui a servi de couverture lorsqu’il s’est allongé, il la porte à la main, comme le signe de sa présence désormais à ses côtés. Même Fiesco, pourtant toujours sanglé dans son costume trois pièces se débarrasse de sa veste et la jette, puis la ramasse selon les scènes.
Un travail minimaliste, concentré, abstrait
Signes minimalistes ? Sûrement, mais rien n’est plus individuel que le costume et la manière dont on le porte. Pietro sanglé dans son cuir ne sera jamais qu’un apparatchik, et Paolo un peu débraillé et vaguement vulgaire (au contraire d’ailleurs du chant impeccable porté par Nicola Alaimo) ne suscite pas, à vue, l’adhésion ; il porte un seau, où certains ont vu une ventoline, mais qui pourrait être aussi l’attribut de son âme (on en fait des choses dans un seau…), en tous cas un signe que le personnage est marginal, qu’il n’est pas comme les autres, une sorte de stigmatisé, percé par les frustrations. Inutile alors de le faire grimaçant avec des yeux hallucinés dans une composition à la Strehler (Felice Schiavi en fit le rôle d’une vie). Le Paolo de Bieito est digne dans son indignité.
Enfin, et à l’opposé de Strehler, les personnages ne vieillissent pas entre le prologue et les trois actes, ce qui peut désorienter le spectateur qui ne connaîtrait pas l’œuvre : Bieito construit un continuum d’un moment à l’autre parce que si le temps a passé les hommes et leurs haines n’ont pas changé, et le monde est le même, avec ce Simon encore perdu dans sa tristesse structurelle, tel qu’en lui-même enfin l’éternité le change.
Tout cela montre la rigueur avec laquelle Bieito a conduit sa mise en scène. Alors, les réflexions sur la beauté ou la laideur sont à la fois vaines et impropres dans un discours scénique où ce n’est pas l’histoire ou la trame qui comptent, mais les relations entre les êtres ou leur terrible vacuité.
Dans ce travail en effet, peu de gens se touchent, chacun arrive sur scène, lentement, d’abord ombre, puis silhouette et enfin personnage d’un lieu imprécis, comme remontant à la surface où défilent en vidéo (de Sarah Derendinger) les visages des personnages en plan si rapproché qu’ils semblent tous se ressembler et être interchangeables. Seuls Fiesco et Simon se touchent déjà au prologue et notamment dans un moment sublime de l’acte III où Fiesco essuie le visage de Simon agonisant, dans un geste fraternel et protecteur, et aussi naturellement la fille et le père, Amelia et Simon. Pour le reste, pas de gestes intempestifs qui seraient trop sentimentaux ou pathétiques, ce qui a fait dire – et je m’inscris en faux- qu’il n’y avait pas de direction d’acteurs. Bieito impose aux chanteurs une fixité, une abstraction qui pèse sur l’ensemble mais qui répond à ce que veut faire de ce drame le metteur en scène, un espace mental, un système aux planètes autonomes et sans soleil qui répond à la noirceur de cette histoire. Un Nadir livide en quelque sorte…
Au long du spectacle traverse la scène sans cesse la silhouette fantomatique de Maria, la fille de Fiesco que Boccanegra a (des)honorée, un cadavre malingre qu’il embrasse au moment où il est élu doge, comme si le pouvoir lui portait en même temps l’absence, le vide et que l’amour de sa vie devenait spectre, imposant aussi son corps nu humé par les rats aux spectateurs, un corps qu’on suppose en décomposition prochaine, comme le bateau gigantesque qui tourne sur scène. Simon Boccanegra ou le drame de la décomposition d’un être qui n’est plus lui-même au pouvoir et ne se retrouve qu’avec sa fille.
D’où ce sentiment de détachement, cette absence de pathétique et de vibration, ces émotions données au compte-gouttes qui n’en sont que plus fortes, et cette vision détachée du réel et presque abstraite qui domine l’ensemble de la production. De manière contradictoire d’ailleurs on entend les regrets de ceux qui voient encore (après vingt ans) en Bieito le provocateur qui fit tant parler lors de son Ballo in maschera mais on voit aussi les regards scandalisés devant le corps nu sur lequel des rats circulent à l’entracte…
Il n’y a aucun doute pour moi, nous nous trouvons devant une des mises en scène récentes les plus accomplies du chef d’œuvre de Verdi. Ceux qui ont vu Strehler sans doute gardent vif le souvenir de cette absolue réussite, mais courir après les fantômes et les souvenirs n’empêche en rien de s’intéresser au présent . Il y eût un jour l’absolu et nous sommes dans le relatif ; une chose est claire cependant, la production de Calixto Bieito, toute discutable qu’elle soit, a le courage de changer totalement de point de vue sur l’œuvre et de présenter une vision très cohérente de cet opéra si particulier, qui allie l’histoire, la politique et l’introspection.
Bieito choisit l’introspection, radicalement, faisant du personnage de Simon le centre d’un système où les autres peuvent apparaître comme des ombres, apparaissant ou disparaissant au gré des montées d’images du personnage principal, perdu dans son monde qui n’a plus de lien avec le réel. Bieito ne nous montre pas une histoire, d’autres l’ont fait et bien mieux, il nous montre des êtres perdus dans leur rêve, leurs haines, leurs fragilités qui errent dans une sorte de no man’s land aux frontières imprécises et ce faisant, il approfondit notre écoute de la musique.
Un parti pris musical aussi sombre que la scène
Justement, c’est une des musiques les plus sublimes écrites par Verdi, que Claudio Abbado pour l’éternité a fixée, dans une interprétation où il allie l’intériorité et la méditation, mais aussi la vibration et le théâtre, fouillant dans la partition jusqu’à donner l’impression d’une musique qui pleure (scène finale entre Fiesco et Simon). Cette musique était un cœur battant à différents rythmes, alliant l’épique et l’intime (acte I), palpitant quelquefois (l’accompagnement des airs d’Adorno). Simon Boccanegra est tellement intimement lié à Abbado qu’il est difficile d’avoir un jugement distancié sur une interprétation dont toutes les fibres vibrent à l’unisson et qui épuise tous les spectateurs sous l’émotion.
Bien entendu, Fabio Luisi va dans une toute autre direction, très cohérente elle aussi, et surtout très en phase avec le spectacle. Comme toujours chez ce chef à la technique rodée par des années au service du répertoire le plus large (il doit être un des chefs qui a dirigé le plus de titres de tous les répertoires), la précision et la sûreté de son geste aboutissent à une interprétation techniquement sans failles, aussi bien dans le dosage des sons que dans la limpidité, et l’orchestre de l’Opéra le suit résolument, affichant un son charnu et délicat, tout en ombres et lumières. Conformément au rythme scénique, ralenti, qui affiche silences longs et ambiances ombrées, le rythme orchestral est plutôt lent, sans moments nerveux, y compris là où ce serait plus nécessaire (par exemple, l’accompagnement d’orchestre de l’air d’Adorno de l’acte II « O inferno! Amelia qui ! … » demeure un peu éteint pour mon goût et pour un air de colère et d’ardeur), à d’autres moments j’ai eu la même impression d’un orchestre très (voire trop) contrôlé sans ce fameux halètement verdien. Mais Simon Boccanegra n’est pas Trovatore, et la mise en scène n’incite pas à l’explosion, mais bien plutôt à la concentration, comme une sorte de Requiem plus noir encore que celui qu’a écrit Verdi lui-même.
En ce sens Fabio Luisi est cohérent, et il veille aussi à contrôler un plateau certes remarquable, mais qui a besoin d’être soutenu par l’orchestre, et qui dans le vaste vaisseau (c’est le cas de le dire) de Bastille, risque toujours d’être un peu couvert par la musique. Luisi se montre donc plutôt retenu, mais sans vraie tension et pour mon goût quelquefois un tantinet mou. Mais de tels choix complètent parfaitement l’ambiance scénique très particulière voulue par Bieito, même si j’ai trop dans la tête un certain chef pour être pleinement objectif.
Le chœur dirigé par le remarquable José Luis Basso n’a pas évidemment la mobilité qu’il pourrait avoir dans les grandes scènes du conseil, ou même au prologue. Calixto Bieito le veut de face, au proscenium, sous l’immense carène de navire, presque comme un oratorio écrasant et les scènes de foules ne sont volontairement pas réglées : Bieito fait presque du « semi-scénique », comme si les personnages surgis de nulle part rentraient dans le moule musical et s’y lovaient sans « agir »…
Ainsi le chœur au proscenium, entourant Boccanegra à terre sur le cadavre de sa fille au prologue, l’étouffant presque (là où chez Strehler le chœur formait une ronde infernale autour d’un Boccanegra porté par la foule et couvert de sa cape) ou celui du conseil, qui devient le peuple tandis que les conseillers s’opposent entre les coursives du navire, comme si prévalait le son et la musique du peuple sur celle des politiques. La mise en scène du chœur dit beaucoup sur le parti pris de Bieito.
Un plateau vocal de haut niveau et convaincant
Mikhail Timoshenko (Pietro) et Nicola Alaimo (Paolo)Soyons immédiatement clairs en ce qui concerne le plateau vocal réuni à Paris : dans mon oreille j’ai en permanence les autres entendus une douzaine de fois entre 1978 et 1982 et à Vienne ensuite, ce qui pourrait être une distribution B (Bruson, Raimondi, Ricciarelli…) C’est ainsi et on pourra m’en faire reproche, que je considère Freni, Ghiaurov, Cappuccilli insurpassables dans leurs rôles. Ce n’est aucunement faire insulte au plateau réuni à Paris, sans doute ce qu’on peut faire de mieux aujourd’hui que de le reconnaître. Qui en effet pourrait refuser la palme du jour à Ludovic Tézier ? J’ai écrit suffisamment souvent que son timbre me rappelait Cappuccilli pour ne pas me dédire aujourd’hui, alors qu’il reprend scéniquement ce qui fut pour Cappuccilli le rôle d’une vie. Rien à reprocher à ce chant, techniquement parfait, contrôlé, avec une belle émission, une projection sans faille et une belle diction. Tézier est aujourd’hui sans doute le baryton le plus accompli pour Verdi.
Il reste qu’il n’a pas encore le rôle totalement dans le corps et dans la tête pour l’incarner totalement : un rôle pareil cela se rode. Il part de très haut et sans doute très vite sera-t-il le Boccanegra de l’époque, c’est déjà aujourd’hui le meilleur de ceux que nous entendons habituellement sur les scènes dans ce rôle. La volonté de Bieito d’en faire un Boccanegra un peu absent, presque désincarné, presque désabusé et constamment ailleurs convient très bien à ce chant et cette une prise de rôle scénique. Et nous ne pouvons que saluer une performance magnifique que nous attendons dans quelques temps encore plus incarnée, encore plus dominée. Mais déjà c’est une très grande performance.
Maria Agresta a l’avantage d’une voix fraiche, jeune et techniquement très au point : elle se sort du final du premier acte (au conseil) avec tous les honneurs parce que toutes les notes sont faites, y compris les « scalette » redoutables. Elle n’aborde pas le rôle pour la première fois : elle l’a chanté avec Riccardo Muti à Rome il y a quatre ans. On entend dans sa manière de chanter qu’elle a beaucoup écouté Mirella Freni. Son Amelia est émouvante, mais le timbre est un peu clair, et ne possède pas dans la voix la couleur tragique qui frappe toujours chez son illustre devancière. Enfin, au moins ce mercredi, la voix accusait de menues irrégularités dans la ligne de chant, pas toujours homogène, avec quelques échos un peu métalliques ou acerbes. Il reste que cette Amelia-là reste aujourd’hui sans doute l’une des plus justes sur le marché lyrique.
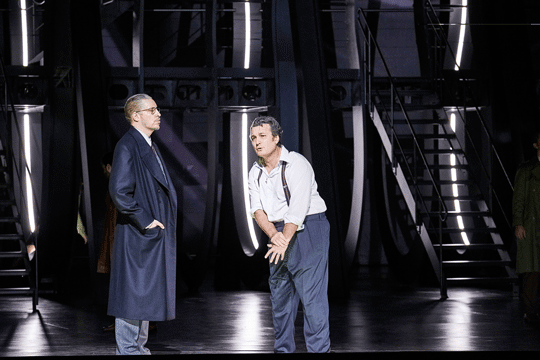
Mika Kares continue la tradition des grandes basses finlandaises et j’avoue avoir été touché par son Fiesco, magnifié par la mise en scène de Bieito et l’attention que le metteur en scène a portée à son personnage. La voix est puissante et profonde (les graves de « il lacerato spirito » passent sans problème et ne sont pas détimbrés), elle s’élargit avec sûreté à l’aigu et les accents, la couleur me sont apparus très en place et particulièrement sentis. Ce n’est pas une voix tout d’une pièce qui ne ferait que du beau son. Il faut attendre le duo final avec Boccanegra pour atteindre au sublime : c’est sans doute le plus beau moment de la mise en scène mais c’est aussi le moment où le chant est le plus ressenti et le plus incarné, par les deux interprètes d’ailleurs. Les accents de Fiesco étaient d’une justesse et d’une intensité très rarement atteintes par les basses habituées à ce rôle. Allez, osons-le, il était « ghiaurovien ».
La vraie surprise vient peut-être du Paolo de Nicola Alaimo, un rôle noir auquel il ne nous a pas vraiment habitués et qui est peut-être un Paolo définitif : justesse des accents, contrôle vocal, magnifique émission, travail sur la couleur ; il réussit même – un comble pour un tel rôle – à émouvoir à chaque fois qu’il chante, tant le personnage voulu par Bieito a l’ambiguïté de certains méchants. C’est une très grande composition, très différente de celle du méchant halluciné de Felice Schiavi chez Strehler et qui personnellement m’a totalement convaincu. Nicola Alaimo est simplement grandiose.
D’une certaine manière, Francesco Demuro est aussi une surprise dans Adorno qui reste un rôle secondaire dans l’économie de l’œuvre. J’ai dans l’œil et l’oreille l’entrée au premier acte de Roberto Alagna courant autour du plateau, solaire en Adorno juvénile dans la production de Stein en 2000 à Salzbourg avec Abbado: il y fut extraordinaire. J’ai aussi dans l’oreille la perfection formelle de Veriano Lucchetti, impeccable de style et d’expressivité.
Demuro lui-aussi réussit à imposer le personnage, dont il n’a pas tout à fait la voix mais qu’il arrive à imposer par la technique, la clarté de la diction, le contrôle. On sent qu’il approche des limites de sa voix, mais cette tension convient parfaitement à la situation, et au total, il est très convaincant. J’irais même jusqu’à dire que c’est dans Adorno qu’il m’a le plus convaincu, bien plus que dans son Fenton que je trouve un peu fade et dont il est le grand titulaire actuellement.
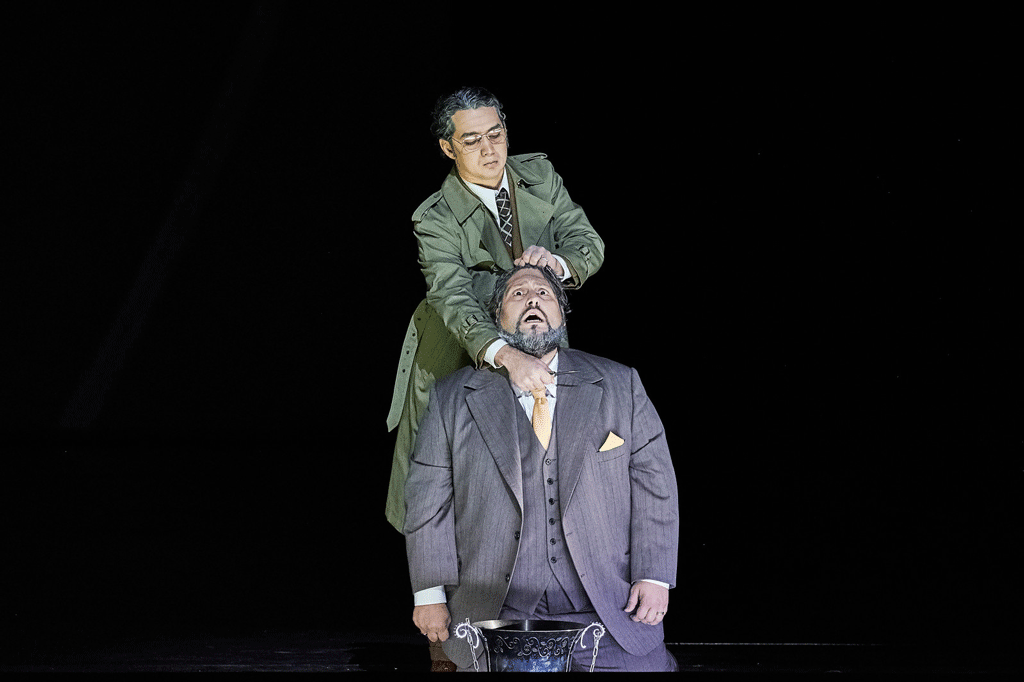
Enfin Mikhail Timoshenko dans Pietro (vu comme un parfait apparatchik à qui est confié le sale boulot d’égorger en scène Paolo) montre un joli timbre de baryton basse, très employé à Paris, et qui ne devrait pas tarder à aborder des rôles plus importants.
On le voit, au terme de cette longue analyse, il n’y a pas grand-chose à reprocher à une production que j’estime être aujourd’hui non seulement la plus belle production verdienne de l’Opéra de Paris, mais aussi la meilleure production qu’on puisse avoir de Simon Boccanegra aujourd’hui, bien supérieure à celles honteusement médiocres de Berlin ou de la Scala, d’une grande tenue musicale (avec mes réserves sur le rythme et la tension) et vocale avec l’une des distributions les plus convaincantes qu’on puisse voir aujourd’hui. Je dis bien, aujourd’hui. Pour le reste, je retourne à mes souvenirs.