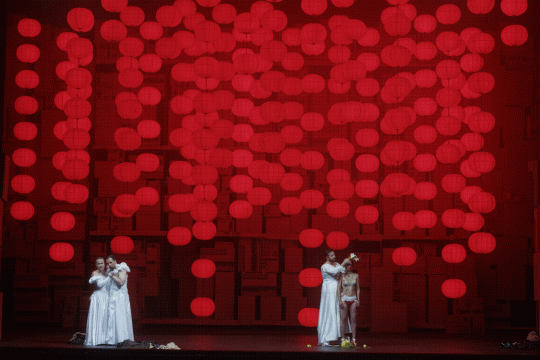
© Patrice Nin
Il en aura fallu du temps pour qu’enfin une production de Calixto Bieito soit présentée en France, à Toulouse, en coproduction avec le Staatstheater Nürnberg. La francophilie de Peter Theiler, directeur de Nuremberg fait que deux des productions phares des dernières saisons, soit coproduites avec la France, Les Huguenots (voir ce blog) mis en scène par Tobias Kratzer, avec Nice et cette Turandot, due à Calixto Bieito, avec le Capitole de Toulouse.
Après plus de 15 ans, l’un des metteurs en scène les plus en vue de la planète européenne prend l’attache d’un théâtre français, puisque les premiers succès de Bieito remontent à la fin des années 90 (Carmen, Un ballo in maschera) . Entre temps, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie ont accueilli ses productions suivies la plupart du temps d’une odeur de soufre. Il est vrai aussi que Bieito (comme Olivier Py) ne faisait pas partie des metteurs en scène qui stimulaient Mortier à Paris lorsque sous son impulsion Paris livrait au public des visions un peu dépoussiérées de l’opéra. On ne parlera pas de la période de Nicolas Joel, mais Lissner a programmé Calixto Bieito pour Bastille la saison prochaine.
Cette fois, c’est à Toulouse qu’on offre à Bieito sa première tribune, une scène réputée pour la qualité de ses productions musicales, moins par l’invention de ses mises en scène (un long séjour dans la ville rose de Nicolas Joel peut l’expliquer…) et de fait, le public a accueilli avec circonspection la vision décapante de l’espagnol, une vision non dépourvue d’intérêt qui reste cependant en dessous de travaux autrement plus forts comme Don Carlos à Bâle ou Die Soldaten à Zurich et Berlin.
En revanche la réalisation musicale est à l’honneur d’une institution qui défend une certaine idée de la musique d’opéra, peut-être quelquefois traditionnelle mais toujours de haut niveau, avec un public chaleureux et visiblement amateur.
L’orchestre National du Capitole de Toulouse construit pendant des dizaines d’années par Michel Plasson est sans doute l’instrument le plus précieux à disposition de l’institution. C’est la seule formation régionale qui ait un prestige international et qui puisse rivaliser avec les formations parisiennes; et cela s’entend, un son clair, des pupitres (bois, cuivres) techniquement impeccables et un ensemble de cordes enviables, avec de belles couleurs qui rendent hommage à la chatoyance puccinienne. Il faut dire aussi que le jeune chef suédois Stefan Solyom, formé à l’école de direction finlandaise de Jorma Panula et Leif Segerstam, l’une des écoles de direction actuellement les plus efficaces domine parfaitement la situation. Il est GMD du Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar, l’un des théâtres historiques d’Allemagne, marqué par Goethe, Schiller, mais aussi Liszt, un théâtre qui a porté l’innovation et la modernité depuis ses origines.
Son approche du chef d’œuvre de Puccini a garanti d’abord une très grande clarté, qui fait que l’on entend à la fois tous les pupitres, bien identifiables, qui fait bien percevoir la qualité et la complexité de l’orchestration puccinienne (notamment les percussions, très novatrices), qu’ainsi on peut aisément comparer au travail d’écriture plus conformiste d’Alfano, puisque la partie terminée par Franco Alfano est bien « séparée » du reste par une longue pause et que la différence se perçoit immédiatement dans la profondeur du tissu orchestral et notamment dans la mise en valeur des différents pupitres. Les cuivres sont remarquables, les cordes sont très précises (très beau premier violoncelle) et l’ensemble dans une salle au volume plutôt moyen ne couvre jamais le plateau. La précision du chef Stefan Solyom, à qui rien n’échappe, et sa manière de soigner les volumes ou les équilibres font qu’on n’a jamais l’impression d’écrasement sonore qu’on pouvait avoir à la Scala, malgré la magnifique direction de Riccardo Chailly et malgré la grandeur de la salle. Solyom ne tire pas Turandot vers le XXème siècle novateur comme son illustre ainé, mais aborde chaque moment de la partition en en respectant la couleur, tantôt un peu Berg, tantôt un peu Gershwin, tantôt même un peu Puccini. Il en fait surtout un vraie pièce dramatique, avec une vraie dynamique, suivant le mouvement du plateau et surtout en accompagnant et en soutenant les voix.
Des voix dont bonne part sont asiatiques (c’est sans doute voulu, et par la direction et par la mise en scène) et dont aucune ne démérite. Nous nous trouvons face à un plateau d’une exceptionnelle solidité pour une œuvre quelquefois difficile à distribuer. On saluera le Timur d’In Sung Sim, belle basse au timbre attachant et au volume très équilibré, qui sait parfaitement colorer et donner une interprétation digne et retenue dans un rôle qu’on a tendance à tirer vers le vérisme et on revoit avec plaisir l’Altoum victime de sa charmante fifille qui le fouette, chanté avec une grande justesse par Luca Lombardo dans un personnage digne du Roi se meurt d’Ionesco tandis que le Mandarin de Dong-Hwan Lee n’appelle pas de reproches. Notons la cohérence qui fait chanter les figures dominantes Altoum et Turandot, père et fille (ainsi que Ping, Pang, Pong les ministres) par des chanteurs européens, quand les autres (les dominés) sont des asiatiques, ce qui est un point particulièrement important dans le discours de la mise en scène.
Les trois ministres Ping (Gezim Myshketa), Pang (Gregori Bonfatti) et Pong (Paul Kaufmann) au chant précis et bien marqué, rentrent bien dans la logique de la mise en scène, les personnages sont à la fois cruels et presque burlesques (scène des robes de mariées), inquiétants dans leur perversion. C’est pour tous trois une très bonne incarnation
La Liù d’Eri Nakamura, une chanteuse bien connue à Munich, montre dans ce rôle une présence et une technique notables. La voix, sans être grande, a une vraie présence et surtout se joue des variations techniques imposées au rôle par Puccini, avec un vrai contrôle sur la voix qui lui fait donner des notes filées d’une rare sûreté et des mezze voci de rêve, il y a là rigueur et justesse car toute l’émotion diffusée naît de la capacité technique et de la maîtrise du rôle. Elle recueille un vrai triomphe justifié d’une salle visiblement connaisseuse à qui on ne la fait pas. Maria Agresta à la Scala avait une capacité d’émotion immédiate peut-être supérieure, mais une technique moins assurée, due à la fréquentation trop rapprochée de rôles aux sollicitations très différentes. Eri Nakamura, voilà une chanteuse à suivre.
Alfred Kim est un splendide Calaf, un timbre clair, éclatant, d’une grande beauté, une voix d’une homogénéité parfaite, avec des aigus d’une sûreté confondante (son nessun dorma est exceptionnel), un chanteur aux capacités naturelles impressionnantes. Sa prestation est bien supérieure à celle d’Antonenko, même si on aimerait quelquefois plus de couleur et un travail plus approfondi dans l’interprétation, et plus de couleur dans le chant.
Elisabete Matos est Turandot. Aucun problème vocal, des aigus impressionnants dardés et tenus, un In questa reggia dans les règles, mais une prestation monolithique dans un style de glace acérée. Une voix froide et coupante, peu subtile, notamment dans les parties où Puccini fait un peu fondre la glace et où le personnage se déstabilise. Pourtant, la mise en scène de Bieito devrait l’amener à plus de sensibilité, mais la chanteuse reste froide, avec des sons un peu fixes. À la Scala, Nina Stemme, avec un timbre il est vrai plus intéressant non dépourvu de rondeur, réussissait à laisser percevoir une certaine fragilité. Elisabete Matos reste à distance, même dans la dernière partie, où il est vrai le parti pris de Bieito ne l’aide pas.
Au total, une réalisation musicale d’une grande solidité, qui rend pleinement justice au drame de Puccini et qui épouse la vision décapante de Calixto Bieito.
On connaît le regard impitoyable de Calixto Bieito sur le monde et les humains : lu à travers son prisme, le monde n’est que rapports de force, n’est que violence, n’est qu’abus de pouvoir où les faibles paient toujours le prix fort. Les parisiens découvriront l’an prochain sa lecture de Lear de Reimann mais un public traditionnel est toujours plus tolérant sur la mise en scène dans les pièces peu jouées, contemporaines ou inconnues que dans les grands standards du répertoire.
C’est bien la Chine que Bieito nous présente, mais une Chine présente par certaines images : les uniformes ouvriers uniformément bleus, où hommes et femmes se fondent de manière indistincte, les lanternes rouges dans le très beau tableau des trois ministres, voire dans l’alignement initial des poupons qui fait penser de manière assez précise aux alignements de l’armée de terre cuite enterrée de Xi An.
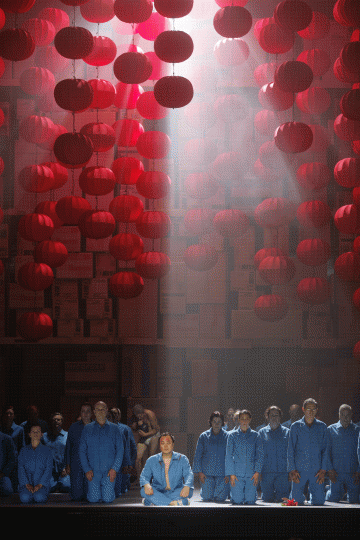
© Patrice Nin
Bieito en outre plonge dans l’histoire de la Chine notamment dans ses rapports avec l’Occident dominateur des concessions au XIXème, mais en même temps dans une Chine d’aujourd’hui, industrieuse qui travaille pour les marchés occidentaux: nous sommes dans l’espace d’une fabrique de poupons où les patrons sont occidentaux (Turandot, sorte de femme d’affaire sûre d’elle et dominatrice, Altoum, lui aussi occidental, mais souffre douleur de sa fille), les trois ministres en uniforme militaire n’ont plus rien des clowns habituellement représentés, mais deviennent des tortionnaires, clairement inspirés cette fois de Salo’ ou les 120 journées de Sodome de Pasolini (notamment dans la scène où ils s’habillent en mariées, rien à voir comme j’ai pu le lire avec les Drag Queens). Par ailleurs qui regarde avec attention la marque écrite sur les boites en cartons qui forment mur lit clairement que derrière les poupons se cachent sûrement des trafics d’organes (de nombreuses caisses portent le nom « Medorgan » qui nous y oriente). Évidemment, les rapports de pouvoir lorsqu’ils s’exacerbent tirent vers le fascisme, et le fascisme lorsqu’il s’exaspère tire vers l’insoutenable et la folie, où les valeurs et l’humanité n’ont plus cours. Nous sommes dans un monde où l’exploitation du faible tourne à la barbarie.
Mais dans la vision de la violence proposée par Bieito, il y a en même temps une sorte de distance, les scènes sont réalistes, mais en même temps très symbolisées, voire ouvertement mimées, mais maladroitement mimées, les coups sont donnés à côté, par exemple, comme si Bieito nous demandait de ne pas y croire comme s’il donnait à voir le trucage. Il nous invite d’ailleurs à installer l’univers du conte, de l’irréel, de l’irrationnel par cette allusion, si justement trouvée par un ami plus cinéphile et plus cultivé que moi au film Kwaïdan (1964) de Masaki Kobayashi illustrée par l’image centrale du visage couvert d’écriture qui est une des images les plus célèbres du film. La première histoire du film est celle d’un homme qui abandonne sa femme pour épouser une femme plus riche et plus puissante, qui pourrait rappeler l’histoire de Calaf.
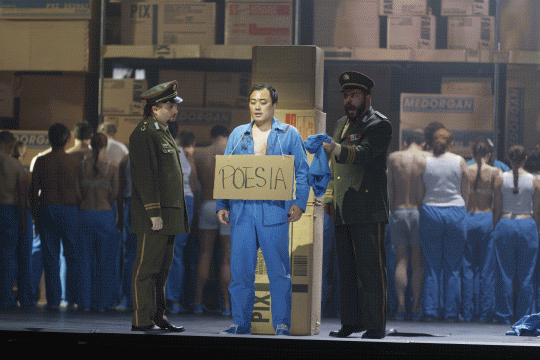
Les allusions cinématographiques et les allusions historiques renvoient d’une certaine manière à un univers du récit, à un univers littéraire que le panneau POESIA accroché au cou de Calaf pourrait illustrer. La poésie, comme force de révélation du monde, comme entreprise prométhéenne pour lutter contre le cours des choses, la POÉSIE, comme forme suprême de la révolte, et ce qui la porte, la littérature. Il y a en effet quelque chose de distancié et de littéraire dans cette vision qui pourrait rappeler la poésie morbide de Mirbeau dans le Jardin des Supplices où la Chine est si présente.

Dans les personnages, il y a les torturés, Liù, Timur, Altoum, il y a Calaf, presque intouché, celui qui ose, le Prométhée des petits, mais il y a aussi l’installation de rapports sado-masochistes chez la “maîtresse” Turandot, désespérée de perdre pied qui s’arrache sa perruque outrageusement blonde pour apparaître chauve, et figure de poupon adulte : la fabrique de poupons n’est alors qu’une fabrique de petites Turandot, de petites poupées sans doute apotropaïques que la vraie Turandot, assise au milieu de la scène comme un enfant désespéré et boudeur, va dépecer. Il paraît qu’à la première les poupons dépecés pissaient le sang, qui a désormais disparu, laissant une belle image de désespoir et en même temps l’étrange image d’une Turandot infantile, mais pourtant, et pour cela, dangereuse car elle fait le mal comme dans la cour de récréation.
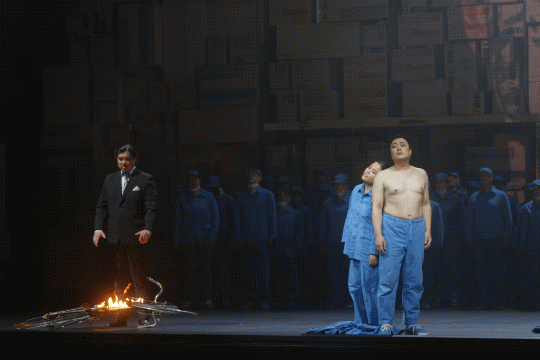
© Patrice Nin
Enfin, Bieito choisit d’arrêter de raconter ou de figurer l’histoire là où Puccini s’est arrêté. Elle reste donc suspendue à la mort de Liù devenant du même coup l’élément central et perturbant pour l’éternité. L’intrusion de l’humain et la fin sur l’humain.
Le rideau se baisse, plusieurs minutes d’interruption, et il se lève sur le chœur et les deux protagonistes en rang, face au public chantant le final sans le figurer, comme si après la mort de Liù plus rien n’était figurable, mais comme si aussi la musique ne disait plus rien d’intéressant. Inutile de gloser sur les personnages qui ne se touchent pas, ou sur la fixité finale : nous sommes dans une version oratorio où la musique est exécutée, mais ne nous dit plus rien parce qu’il n’y a plus rien à dire. C’est peut-être une coquetterie, mais c’est aussi une manière de dire le vide d’une happy end qui n’a rien d’happy, la fin d’un conte où tous sont morts, morts réels (Liù, Timur) ou morts vivants (Turandot, Calaf).
Calixto Bieito part de l’histoire de Turandot, qui n’est pas spécialement un conte à la Walt Disney, mais une histoire de violence, d’écrasement et de domination, et l’habille de son univers et de son pessimisme structurel sans grand effort vu l’histoire originelle. Son travail ne va pas cependant aussi loin que d’autres (son Don Carlos balois, ses Soldaten, comme on l’a dit plus haut, son Ballo in maschera ou son Entführung aus dem Serail ), et sent un peu son système, il y a de belles idées, de magnifiques images, il y a aussi une grande justesse de lecture, il y a comme toujours une rigueur et une cohérence, mais on n’y croit pas tout à fait, et même pas à cette violence trop figurée. Et en tout cas cela ne justifie pas les huées ou les remarques horrifiées de certains articles parus. Toulouse fait honneur à Puccini et fait surtout honneur à une manière intelligente et contemporaine de voir l’opéra. [wpsr_facebook]

