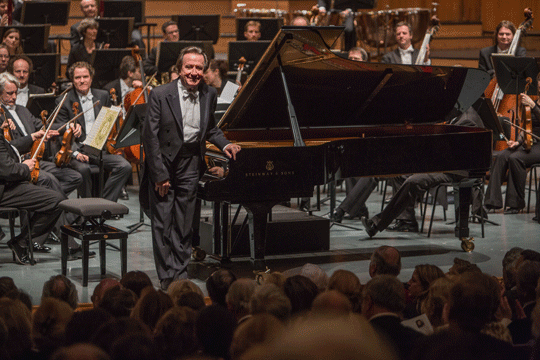Cette année le Festival de Pâques était dédié à Shakespeare pour le 400ème anniversaire de sa mort (1616). Voilà qui justifiait entre autres Otello, Roméo et Juliette (Tchaikovski), qui sont au programme.
Tout le programme de ce concert à mis à part le 1er concerto pour piano de Beethoven, est fondé sur « A Midsummer’s night dream », Le songe d’une nuit d’été puisque l’Oberon de Weber reprend la pièce de Shakespeare, ainsi qu’évidemment Ein Sommernachtstraum de Mendelssohn, mais aussi la 8ème symphonie de Henze, une œuvre tardive dont lui est venue l’idée à Amsterdam . Le concert est donc une sorte de variation sur trois moments de l’œuvre fantasmagorique de Shakespeare : une construction intellectuelle dont le programme est aussi typique de Vladimir Jurowski que du directeur artistique Peter Ruzicka, lui même compositeur.
C’est bien la symphonie de Henze qui fait l’originalité du programme, notamment placée en conclusion comme la pièce maîtresse ; voir Henze en majesté dans un programme à Salzbourg-Pâques, c’est inciter certains à la fuite éperdue.
C’est la raison pour laquelle, à ma grande surprise dans un cadre aussi ritualisé que le Festival de Salzbourg, Jurowski va prendre le micro et expliquer pourquoi le programme est ainsi construit et par deux fois intervenir dans la deuxième partie, avant le Mendelssohn et avant le Henze pour expliquer assez longuement avec des exemples personnels le pourquoi du programme, de la symphonie de Henze, entrant même dans la composition pour en expliquer les citations ou les inspirations (notamment la descente au Nibelheim de Rheingold). Cela bien sûr n’a pas empêché quelques irréductibles de sortir soit après le Mendelssohn, soit entre deux mouvements de la symphonie de Henze, mais la chose est rare et je dois le dire, appréciable car elle casse le rituel du concert, en l’humanisant en quelque sorte, et surtout pointant la relation fermée, incompréhensible et ridicule, d’un certain public envers la musique contemporaine. D’ailleurs la première chose que Jurowski dit en prenant le micro fut « Merci d’être restés ! ».
On doit donc applaudir cette initiative, très inhabituelle et très sympathique de la part d’un chef d’orchestre, qui sait parfaitement que peu de personnes dans le public ont une connaissance approfondie de ce type d’oeuvres. Jurowski a à un mois près le même âge que Kirill Petrenko et leurs destins sont parallèles, tous deux d’une famille de musiciens, tous deux émigrés à la même période, Jurowski à Berlin, Petrenko en Autriche où chacun va compléter sa formation. Si Petrenko n’a jamais quitté la sphère allemande (mais tous deux ont dirigé à la Komische Oper, l’un comme Kapellmeister et l’autre comme GMD), Jurowski va mener une large partie de sa carrière au Royaume Uni où il a dirigé le London Philharmonic Orchestra et le Festival de Glyndebourne ; à partir de 2017-2018, il succèdera à Marek Janowski à la tête du Rundfunk-Sinfonieorchester de Berlin, la ville où il réside.
Au milieu de ce programme dédié au fantastique shakespearien, le concerto n°1 pour piano de Beethoven faisait figure de concession à cette partie du public un peu fossilisée qui écume les grands festivals. Rien de plus classique qu’un Beethoven, rien de plus classique et carré que Rudolf Buchbinder. Et ce concerto écrit en 1795, est influencé par Mozart bien que la composition de l’orchestre soit un peu étoffée (clarinettes, cuivres…). L’introduction assez longue pose le premier thème de l’œuvre. L’ensemble de l’œuvre est fraîche, jeune, vive. Buchbinder est un solide pianiste, sûr, peut-être moins imaginatif que d’autres, mais son interprétation de ce Beethoven est rigoureuse, voire assez brillante dans le rondo final, particulièrement vivant, enlevé et très virtuose. Il a donné en bis le final de la Pathétique, triomphe assuré. L’accompagnement orchestral est particulièrement attentif, tout en finesse, énergique et précis, évitant la complaisance et avec une sécheresse étudiée du son, tirant plus vers le XVIIIème que le XIXème non encore né (l’œuvre est publiée alors que ce siècle avait un ans). Un joli moment.
L’ouverture d’Oberon de Weber avait ouvert la soirée, pour la mettre sous le signe de Sommernachtstraum. L’œuvre même est rare, je l’ai vue une fois à la Scala en 1989, sous la direction de Seiji Ozawa et dans une mise en scène de Luca Ronconi (et des décors magnifiques de Margherita Palli la magicienne). Une ouverture nerveuse, auguisée, une vision romantique vaguement agressive, ce qu’est le romantisme aussi. Et comme Jurowski est bien connu à Dresde, la relation à l’orchestre est excellente avec des bois et des cuivres remarquables.

Dans la deuxième partie, interrompue par les précisions bienvenues apportées au micro par le chef, a commencé par l’ouverture du Sommernachstraum de Mendelssohn, une pièce que Wagner a bien écoutée (Tannhäuser) et qui est à la fois raffinée et dynamique, toute en mouvement d’étoile filante. Bien sûr j’ai dans l’oreille de dernier concert d’Abbado à Berlin, avec cette légèreté phénoménale que l’on ne retrouve pas ici. Mais dans l’ensemble, c’est une interprétation classique sans fioritures et bien maîtrisée, rien de trop. Mais on peut difficilement juger sans avoir la vision de l’ensemble des musiques écrites par Mendelssohn. En fait, cette ouverture fait écrin au Henze, comme Oberon faisait écrin à la soirée Shakespearienne, c’est la course de Puck qui débute.
L’intérêt de la soirée, c’est bien entendu cette symphonie n°8 de Henze composée en 1992 et créée par le Boston Symphony Orchestra sous la direction de Seiji Ozawa en 1993.
La symphonie retrace d’abord le voyage de Puck (1er mouvement) non sans humour avec ses variations de hauteurs selon les directions (est, sud, nord), d’où l’allusion au voyage au Nibelheim dont il était plus haut question et rappelé par Jurowski . Le voyage en bas, la descente est ici utilisée par Henze pour dessiner le rythme du voyage. Puis le second mouvement, c’est l’amour délirant de Titania et de Bottom avec sa tête d’âne, avec son rythme “ballabile” (dansant) qui finit presque en vrille orgiaque . C’est tout un programme, une vraie symphonie à programme où Henze se souvient du travail de Mendelssohn. La symphonie est toute richesse mélodique, moins sombre que la précédente (appuyée sur Hölderlin). Le monde Shakespearien ici est un monde de poésie et de légèreté (cf l’ouverture de Mendelssohn), de notations sonores diverses, de traits, d’ombres et de lumières comme le sublime dernier mouvement adagio reprenant les paroles de Puck « If we shadows have offended », supposant que tout n’a été qu’un rêve merveilleusement interprété par l’orchestre au sommet et par Jurowski qui sent magnifiquement cette musique, aux accents ici finalement assez traditionnels, en détaillant les couleurs, et lui donnant en même temps une grande puissance évocatoire, tout en variations et en miroitements. La Staatskapelle lui répond avec une très grande clarté, avec des accents quelquefois stravinskiens, quelquefois même straussiens, des cordes incroyablement ductiles et des bois totalement engagés et parfaitement en phase avec les demandes très lisibles du chef. C’est par un moment de très grande poésie que cette soirée se termine. Ceux qui sont partis auparavant, comme toujours, ont eu tort. Il y a deux enregistrements de cette symphonie à ma connaissance, par Markus Stenz et le Gürzenich Orchester de Cologne, et par Marek Janowski avec le Rundfunk-Symphonieorchester de Berlin. Il est à espérer que Vladimir Jurowski, nouveau directeur musical de cette formation, puisse s’y confronter à nouveau. [wpsr_facebook]