
Le festival 2013 est bien équilibré dans sa programmation: une création (Claude), un grand standard (Fidelio) et deux œuvres appariées en une soirée, plutôt rares sur les scènes, Il Prigioniero (créé en 1949 en version de concert à Turin et en 1950 au Comunale de Florence) de Luigi Dallapiccola et Erwartung d’Arnold Schönberg (Créé en 1924 à Prague).
Le rapprochement des deux œuvres interroge sur la valeur de la quête: celle du prisonnier de Dallapiccola condamné par l’inquisition qui rampe jusqu’à la lumière pour croiser finalement le Grand Inquisiteur qui l’amène au supplice et peut-être au salut (Fratello…andiamo) et celle d’Erwartung (Attente), quête d’une femme errant dans une forêt à la recherche de l’amant, dont elle découvre le cadavre et que peut-être elle a tué.
Il Prigioniero a peut être plus à voir avec le thème de l’année Justice/Injustice, puisque Dallapiccola au sortir de la guerre renvoie aux condamnations arbitraires (Il s’inspire de Victor Hugo – la rose de l’Infante- et du Don Carlos de Schiller, mais surtout d’un récit des Nouveaux contes cruels de Villiers de l’Isle Adam, La torture par l’espérance où le prisonnier est “rabbi Aser Abarbanel, juif aragonais, qui, prévenu d’usure et d’impitoyable dédain des Pauvres, — avait, depuis plus d’une année, été, quotidiennement, soumis à la torture” selon les termes exacts du texte de Villiers). Celui de Dallapiccola n’est pas vraiment décrit, on ne sait pas la cause exacte de sa condamnation, qui a probablement à voir avec la répression des Flandres par Philippe II. C’est la lutte contre l’oppression et pour la liberté qui en est l’enjeu.
L’action est assez linéaire: Il Prigioniero rencontre sa mère dans un prologue intense à qui il raconte que le geôlier l’a appelé frère, puis le geôlier arrive, l’appelle de nouveau frère “Fratello”, et l’expression répétée est un moment clef de l’œuvre et le remet sur la route de l’espérance en lui parlant des Flandres, de la révolte des Gueux qui pourrait être fatale à Philippe II. Le geôlier part en laissant la porte ouverte, et le prisonnier de glisse dans le souterrain de l’official de Saragosse où il fait des rencontres effrayantes, jusqu’au moment où il croise le Grand Inquisiteur, qui a les traits du geôlier: frappé de stupeur, il se laisse conduire au supplice en répétant “Liberté?”.
Le dispositif scénique imaginé par Alex Ollé (La Fura dels Baus) et son décorateur Alfons Flores est unique pour les deux opéras, un cyclorama, une large colonne de tulle centrale, un plateau tournant autour, noir oppressant pour Il Prigioniero, projections à plusieurs niveaux pour Erwartung. Les éclairages de Marco Filibeck installent parfaitement cette atmosphère oppressante qui de plus sied parfaitement à l’espace de l’Opéra. Cette présence obsédante du noir fait du décor une sorte de prolongement de la salle.
Dans Il Prigioniero, Alex Ollé raconte cette dernière nuit comme un rêve où défilent différents personnages à commencer par la mère. Il situe le prologue après la mort du prisonnier, au moment où la mère vient voir le cadavre de son fils, couvert d’un drap, sorti du noir comme du frigidaire de la morgue. Du même coup, dès la fin du prologue, le récit se construit avec le prisonnier qui se lève, dévêtu, et qui va revivre, comme remonter le temps immédiat où les différents interlocuteurs vont défiler sur la tournette où sont installées une succession de portes qu’on va franchir peu à peu. Le mot “fratello”, central dans l’oeuvre est chanté à la perfection, avec une vérité extraordinaire aussi bien par le héros que par le geôlier (Raymond Very, remarquable). La mère devient un des personnages qui défilent, on y voit aussi, outre les prêtres du livret, un double du héros ou un jeune enfant, image d’innocence originelle, Alex Ollé joue sur les regards, les points de vue -du prisonnier, du spectateur-;

il analyse aussi les rapports troubles que peut entretenir le geôlier avec le prisonnier (qu’il prend tendrement sur les genoux). Même rapport de tendresse étrange et effrayante avec le Grand Inquisiteur (Raymond Very encore) , sorte d’image double qui provoque le trouble final du héros et son suicide (il s’ouvre les veines au lieu d’être emmené au bûcher. Un rêve, un retour en arrière, un rêve dans le rêve, plusieurs niveaux de lectures dans ce travail très attentif qui laisse vraiment une impression forte, amère, d’une insondable tristesse, et servi par une impeccable distribution: le baryton estonien Lauri Vasar presque christique, est d’une criante vérité, avec sa voix chaude et son timbre doux et plaintif, dans sa semi nudité fragile et vaguement érotisée (scène avec le geôlier), il a la puissance, la couleur, et une diction claire de l’italien. De même Raymond Very, qui colore sa voix d’une manière confondante en collant au texte qu’il prononce impeccablement, et qui construit un personnage inquiétant et passionnant rien que par l’écoute de la performance vocale. La mère (Magdalena Anna Hoffmann) est aussi très intense, avec ses aigus dardés qui créent une forte tension dès le début. Les jeunes Christophe de Biase et Thierry Grobon, du Conservatoire de Lyon, complète une distribution très homogène et qui sait transmettre l’atmosphère irrespirable de l’œuvre.
Enfin, le chœur (invisible) de Alan Woodbridge est impressionnant, dans cette nuit, en imposant une présence invisible et là encore oppressante. La direction de Kazushi Ono rend cette atmosphère glacée avec une exactitude d’une précision exemplaire. L’orchestre est d’une grande clarté, explose d’une multitude de sons et de couleurs, tantôt chatoie, tantôt se concentre fortement dans une atmosphère de clair obscur, et fait bien ressentir la parenté entre les deux œuvres, distantes de 25 ans. On sait que Kazushi Ono excelle dans ce répertoire.

La vision de Erwartung est musicalement exemplaire. Kazushi Ono donne à cet orchestre à la fois la tension voulue, le mystère par un soin particulier donné aux couleurs: on connaît l’histoire de ces quelques scènes où une femme erre dans une forêt en quête de quelque chose ou quelqu’un, elle butte sur le cadavre de son amant. Son apparition finale ensanglantée amène à penser qu’elle l’a tué. Une œuvre cryptique, qui peut-être la représentation d’un espace psychologique, qui peut-être simplement un récit qu’on doit suivre sans autre forme de procès. Trente minutes de musique, séparées en quatre scènes aux ambiances marquées par la différence d’images projetées, par le passage de la femme au fond de scène; une fois de plus est utilisée la tournette. Les projections sont utilisées sur tous les supports du décor, et l’impression de forêt dense est très habilement rendue, et le jeu des projections qui investissent l’espace jusqu’au fond de scène, de niveaux divers, est particulièrement bien rendu, d’autant que la femme circule entre ces différents espaces, avec l’impression produite qu’elle erre vraiment entre les arbres. Le résultat esthétique est impressionnant; autant dans Il Prigioniero le décor fonctionnait comme un espace auquel on ne réussissait jamais à se raccrocher, accentuant l’idée d’irrationnel, et de construction mentale. Autant ici au contraire on a une sorte d’hyperréalisme avec des changements d’ambiance, des lueurs, une façade, des objets en superposition, des branches en gros plan, des arbres qui pourraient sans doute être une métaphore de l’âme de la femme et l’on pourrait presque se passer du cadavre de l’amant, bien réel, qui vient remplir l’espace et devenir une sorte de centre de préoccupations.

Il faut tout de même reconnaître que les motifs sont répétitifs, que l’impression de redite est forte, malgré la prouesse technique incontestable, une sorte de sur place que la performance très honnête de Magdalena Anna Hoffmann n’arrive pas à faire progresser. La chanteuse a la voix, du moins elle remplit l’espace du l’Opéra de Lyon, elle n’est pas dénuée d’une certaine présence, mais un tel rôle est réservé à des chanteuses hors normes, qui dès leur entrée remplissent la scène et fascinent, des Jessie Norman par exemple qui par un seul effet vocal et aussi un seul geste vous chavirent. Il ne suffit pas de passer la rampe, il faut la piétiner, l’envahir, l’investir, et ce n’est pas le cas malgré ses qualités de Magdalena Anna Hoffmann. Une prestation très digne qui ne réussit pas néanmoins à faire décoller le spectacle.
Au total, un rapprochement qu’Ollé souligne par la confrontation de deux univers mentaux où la prison est dans les têtes, avec la grande réussite, la pleine osmose avec Il prigioniero, spectacle incontestablement très fort, et le relatif échec d’Erwartung, où malgré la prouesse technique et la beauté plastique du plateau, il ne réussit pas à installer la fascination, sans doute aussi parce que la soliste ne réussit pas pour sa part à imposer sa présence et son aura sur la scène: seule en scène, face à l’orchestre luxuriant de Schönberg, il faut être un monstre sacré, ce qu’elle n’est pas encore.
[wpsr_facebook]
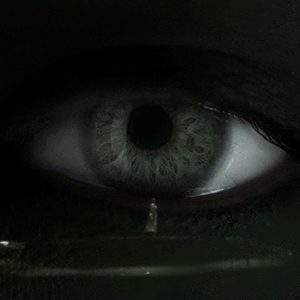








 Claudio Abbado a toujours affirmé que les concerts qu’il dirigerait à Berlin porteraient sur des projets particuliers, terminer les symphonies de Mahler non dirigées, ou bien exécuter dans des conditions optimales le Manfred de Schumann ou le Te Deum de Berlioz (non exécuté à la Philharmonie, à la suite d’un incendie malencontreux, mais à la Waldbühne devant 20000 personnes) ou bien ce Rinaldo, absent des programmes du Philharmonique de Berlin depuis plus de cinquante ans. L’an prochain, le projet tournera autour de la Lulu Suite (on sait qu’Abbado a le projet de diriger Lulu) et de l’adagio de la Xème de Mahler.
Claudio Abbado a toujours affirmé que les concerts qu’il dirigerait à Berlin porteraient sur des projets particuliers, terminer les symphonies de Mahler non dirigées, ou bien exécuter dans des conditions optimales le Manfred de Schumann ou le Te Deum de Berlioz (non exécuté à la Philharmonie, à la suite d’un incendie malencontreux, mais à la Waldbühne devant 20000 personnes) ou bien ce Rinaldo, absent des programmes du Philharmonique de Berlin depuis plus de cinquante ans. L’an prochain, le projet tournera autour de la Lulu Suite (on sait qu’Abbado a le projet de diriger Lulu) et de l’adagio de la Xème de Mahler. L’attraction de la soirée est donc ce rarissime Rinaldo, défendu par les Berlinois et Abbado, et aussi par le double choeur d’hommes de la radio de Berlin et de la radio bavaroise, ainsi que, last but not least, par le ténor Jonas Kaufmann. Cette cantate pour ténor et voix d’hommes fut commencée en 1863 pour un concours de pièce chorales à Aix la Chapelle. Brahms la termina (par le choeur final “Auf dem Meere”) en 1868. Le texte choisi est celui de Goethe, qui s’appuie sur la “Jerusalem délivrée” du Tasse pour concentrer en 40 minutes l’histoire de Rinaldo, pris dans les filets d’Armide, qui n’arrive pas à s’en libérer, tandis que ses compagnons les chevaliers (le choeur d’hommes) cherchent à le convaincre de les rejoindre et de quitter la magicienne, rôle muet de cet opéra en réduction. L’intérêt réside évidemment dans cette esquisse d’opéra que Brahms, on le sait, n’écrira jamais, et peut-être a-t-il eu raison…La première impression à l’audition est un certain ennui, malgré l’excellence de l’interprétation et des interprètes: Jonas Kaufmann, avec la voix merveilleuse qu’on lui connaît, reste en retrait, plus préoccupé par la partition dans laquelle il est plongé que par le souci de proposer un vrai personnage, mais la précision et la technique sont là: il est vrai qu’il n’aura sans doute pas l’occasion de le retrouver de si tôt. L’orchestre (Faust et Mayer, malades, sont absents, mais le premier violon est le nouveau venu, et remarquable violoniste japonais Daishin Kasdhimoto) est comme toujours complètement engagé et fait vibrer cette musique énergique, qui est plus un mélange de Schubert, Beethoven ou même Schumann par certains accents qu’une grande trouvaille mélodique du Brahms des symphonies, dont on entend tout de même fortement certains (futurs) accents. Grand vainqueur de la soirée: les choeurs d’hommes de la Radio de Berlinet de la Radio bavaroise, absolument exceptionnels d’engagement, de précision, de couleur, d’énergie: miraculeux. Au total, le 14 mai on se dit que si l’exécution est exemplaire, l’oeuvre ne justifiait peut-être pas le voyage et nombre de mes amis rendent leur billet pour les concerts suivants (beaucoup de mélomanes berlinois, fous d’Abbado, réservent habituellement pour les trois concerts) . Ils ont tort de céder à l’humeur du moment… car si le 15 (soirée à laquelle je n’ai pas assisté) semble aux dires de tous à peu près de la même eau, le 16 tout explose. Certes, la première partie est toujours aussi plombée par la voix de la mezzosoprano, dont on se demande vraiment pourquoi elle est si réclamée (son nom est fréquent sur les affiches des concerts), mais la deuxième partie s’envole, et emporte dans son tourbillon le public qui finira délirant. Kaufmann est plus sûr, même si encore un peu “neutre”, le choeur est toujours superbe, mais avec une énergie encore plus vitale, qui tient en haleine le public. La seconde audition se laisse écouter avec plaisir, puis avec émotion: Abbado danse sur le podium, emporté par ses musiciens, et c’est vraiment un moment d’une beauté étourdissante qui nous est là donné, tant l’engagement de tous est marqué. Bref, ce petit plus qui fait passer la soirée à un niveau d’intensité rare, au stade du Moment musical. Diable d’homme!Il nous étonnera toujours. Morale de l’histoire, ne jamais abandonner le navire Abbado au milieu du gué, il réussit toujours à nous bluffer, à nous emporter, à nous séduire,et à nous bouleverser.
L’attraction de la soirée est donc ce rarissime Rinaldo, défendu par les Berlinois et Abbado, et aussi par le double choeur d’hommes de la radio de Berlin et de la radio bavaroise, ainsi que, last but not least, par le ténor Jonas Kaufmann. Cette cantate pour ténor et voix d’hommes fut commencée en 1863 pour un concours de pièce chorales à Aix la Chapelle. Brahms la termina (par le choeur final “Auf dem Meere”) en 1868. Le texte choisi est celui de Goethe, qui s’appuie sur la “Jerusalem délivrée” du Tasse pour concentrer en 40 minutes l’histoire de Rinaldo, pris dans les filets d’Armide, qui n’arrive pas à s’en libérer, tandis que ses compagnons les chevaliers (le choeur d’hommes) cherchent à le convaincre de les rejoindre et de quitter la magicienne, rôle muet de cet opéra en réduction. L’intérêt réside évidemment dans cette esquisse d’opéra que Brahms, on le sait, n’écrira jamais, et peut-être a-t-il eu raison…La première impression à l’audition est un certain ennui, malgré l’excellence de l’interprétation et des interprètes: Jonas Kaufmann, avec la voix merveilleuse qu’on lui connaît, reste en retrait, plus préoccupé par la partition dans laquelle il est plongé que par le souci de proposer un vrai personnage, mais la précision et la technique sont là: il est vrai qu’il n’aura sans doute pas l’occasion de le retrouver de si tôt. L’orchestre (Faust et Mayer, malades, sont absents, mais le premier violon est le nouveau venu, et remarquable violoniste japonais Daishin Kasdhimoto) est comme toujours complètement engagé et fait vibrer cette musique énergique, qui est plus un mélange de Schubert, Beethoven ou même Schumann par certains accents qu’une grande trouvaille mélodique du Brahms des symphonies, dont on entend tout de même fortement certains (futurs) accents. Grand vainqueur de la soirée: les choeurs d’hommes de la Radio de Berlinet de la Radio bavaroise, absolument exceptionnels d’engagement, de précision, de couleur, d’énergie: miraculeux. Au total, le 14 mai on se dit que si l’exécution est exemplaire, l’oeuvre ne justifiait peut-être pas le voyage et nombre de mes amis rendent leur billet pour les concerts suivants (beaucoup de mélomanes berlinois, fous d’Abbado, réservent habituellement pour les trois concerts) . Ils ont tort de céder à l’humeur du moment… car si le 15 (soirée à laquelle je n’ai pas assisté) semble aux dires de tous à peu près de la même eau, le 16 tout explose. Certes, la première partie est toujours aussi plombée par la voix de la mezzosoprano, dont on se demande vraiment pourquoi elle est si réclamée (son nom est fréquent sur les affiches des concerts), mais la deuxième partie s’envole, et emporte dans son tourbillon le public qui finira délirant. Kaufmann est plus sûr, même si encore un peu “neutre”, le choeur est toujours superbe, mais avec une énergie encore plus vitale, qui tient en haleine le public. La seconde audition se laisse écouter avec plaisir, puis avec émotion: Abbado danse sur le podium, emporté par ses musiciens, et c’est vraiment un moment d’une beauté étourdissante qui nous est là donné, tant l’engagement de tous est marqué. Bref, ce petit plus qui fait passer la soirée à un niveau d’intensité rare, au stade du Moment musical. Diable d’homme!Il nous étonnera toujours. Morale de l’histoire, ne jamais abandonner le navire Abbado au milieu du gué, il réussit toujours à nous bluffer, à nous emporter, à nous séduire,et à nous bouleverser.