
Il y a une tradition à Salzbourg de création contemporaine ou du moins d’une production contemporaine par saison, ce fut Al gran sole carico d’amore de Nono en 2009 (Metzmacher, Mitchell), Dionysus de Wolfgang Rihm (création mondiale) en 2010, aussi dirigé par Ingo Metzmacher à la Haus für Mozart, puis Die Soldaten de Zimmermann en 2012 (Metzmacher, Hermanis), puis Gawain de Harrison Birtswistle (Metzmacher, Hermanis) en 2013, l’an dernier ce fut Charlotte Salomon, de Marc-André Dalbavie (Dalbavie, Bondy) en première mondiale, et cette année une nouvelle production de Die Eroberung von Mexico (la conquête du Mexique) de Rihm (Metzmacher, Konwitschny) qui est une production Pereira puisque l’intendant a été poussé dehors l’an dernier lorsqu’il a repris la Scala, pour cause de dépassements budgétaires et de conflit avec le Conseil d’administration du Festival conduit depuis 1995 et jusque 2017 par Helga Rabl-Stadler passée par la politique et par la Chambre de Commerce de Salzbourg , un parcours qui conduit tout naturellement à la présidence du festival. Les intendants passent (entre intendants et interims, il y a eu Mortier, Ruzicka, Flimm, Hinterhäuser, Pereira, Bechtolfchtoolf) et madame Rabl-Stadler reste. Metzmacher aussi d’ailleurs qui semble être ici le chef plus ou moins attitré des ouvrages du dernier XXème siècle. Nous ne nous en plaindrons pas.

Cette production comme quelques autres bénéficie du cadre unique de la Felsenreitschule: vu la beauté du lieu, il est assez rare de rater totalement une production (La Fura dels Baus y avait raté sa Damnation de Faust du temps de Mortier, Hermanis n’y a pas réussi son Gawain malgré un décor somptueux mais ses Soldaten furent considérés comme une réussite avant les productions Bieito (Zurich-Berlin) et Kriegenburg (Munich) qui ont tout remis en question et en perspective.
Salle pleine et gros succès pour cet opéra plus spectaculaire encore musicalement que scéniquement. Il s’est reconstitué pour cette production une équipe Metzmacher/Konwistchny qui avait très bien fonctionné quand Metzmacher était GMD à Hambourg où ils ont fait ensemble Lulu, Meistersinger, Moses und Aron qui furent d’énormes succès.
Peter Konwitschny (né en 1945) est l’un des grands de la scène allemande, fils du chef Franz Konwitschny, il a grandi à Leipzig et a commencé sa carrière à l’Est, il est l’un des assistants de Ruth Berghaus au Berliner Ensemble : comme Castorf, comme Berghaus, comme Friedrich, comme Kupfer, il fait partie de cette génération d’hommes de théâtre solidement formés à l’Est à l’école brechtienne, et devenus naturellement des références culturelles essentielles après la chute du mur dans l’Allemagne réunifiée, mais Konwitschny n’a jamais porté en drapeau comme Castorf son « Ossitude » (Ossis , ainsi a-t-on appelé très vite les habitants de l’ex DDR). Comme tous les grands hommes de théâtre allemands, c’est un désosseur de textes : on comprend que cet opéra de Rihm construit sur des textes d’Artaud et d’Octavio Paz l’ait fasciné.
Quant à Ingo Metzmacher, c’est le créateur de l’œuvre à l’Opéra de Hambourg en 1992 avec le Philharmonisches Staatsorchester Hamburg dans la mise en scène de Peter Mussbach. Autant dire qu’il est chez lui dans ce répertoire.
De conquête du Mexique il est peu question dans cette œuvre et en même temps, elle en est vraiment à la fois le prétexte mais aussi le centre. Rappelons rapidement les éléments historiques : Hernan Cortez arrive avec ses hommes dans la ville aztèque de Tenochtitlan en 1519 et guidé par l’empereur Montezuma il en découvre éberlué les merveilles : il dit lui même « Il prit ma main et il me montra les merveilles de sa ville : des marchés grouillants, de somptueux palais en pierre blanche, d’immenses jardins, des œuvres de génie jamais vues. » . Un peu moins de deux ans après, Cortez conquit la ville dont il ne resta rien.
La conquête du Mexique est un des grands drames de l’histoire et la rencontre Cortez-Montezuma l’une de ces rencontres ironiquement tragiques où se jouent les regards sur l’autre, les émerveillements, les jalousies, les peurs.
Artaud connaît le Mexique. Il y est parti en 1936 chez les Tarahumaras pour essayer de comprendre la culture des indiens et de se faire initier au culte du soleil et au Peyotl, un cactus utilisé depuis des siècles chez les amérindiens, contenant une substance hallucinogène sous l’influence de laquelle Artaud comme d’autres a écrit.
L’expérience du Mexique est un basculement chez Artaud qui déclare « ce n’est pas Jésus Christ que je suis allé chercher chez les Taharumaras mais moi-même hors d’un utérus que je n’avais que faire » . Selon J.Paul Gavard-Perret , près de la montagne Tahamura il pense s’approcher au plus près de son pur être débarrassé (enfin) des forces masculines et féminines par ce coït tellurique au sein « non d’une mère mais de la MÈRE ».
La question du masculin/féminin est centrale dans l’œuvre d’Artaud, et centrale dans le travail de Rihm sur le texte d’Artaud. Dans son œuvre, Montezuma est chanté par un soprano dramatique : part féminine, part masculine, homme-femme, l’échange est tout à la fois violent et indispensable.
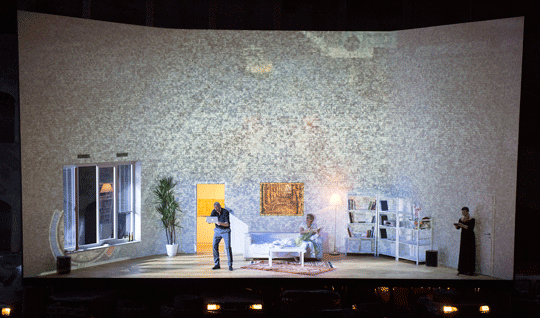
La question de la parole chez Artaud est essentielle également : une parole qui est voix avant d’être parole, qui est d’abord expression physique avant que d’être sens, l’importance de la perception physique et de la prise de conscience corporelle dans tous ses éléments est centrale chez Artaud, mais est aussi déterminante à l’opéra puisque la parole chantée est d’abord exercice physique avant d’être vecteur de sens. Et d’ailleurs, le spectateur ne comprend pas toujours ce qui est chanté, mais perçoit le chant physiquement. C’était, par une hardie simplification, l’effet qu’Artaud voulait produire dans son théâtre. En s’intéressant à Artaud, Rihm essaie évidemment de travailler sur les limites : il flanque des deux personnages principaux (et seuls personnages au sens théâtral du terme) de personnages-voix, notamment un mezzosoprano et un soprano colorature suraigu aux aigus si extrêmes qu’ils sont à la limite de la souffrance pour l’auditeur, expérience purement issue du théâtre de la cruauté, à voir, à subir, à entendre, à vivre dans son corps.

Konwitschny propose donc un travail sur le masculin/féminin comme expérience de l’étranger dans tous les possibles où l’étrange relation entre Montezuma et Cortez et devient emblématique de tout ce que recouvre le couple moi/autrui, masculin/féminin, tendresse violence, sexe, où la Conquête du Mexique devient théâtre de la cruauté. Mais plus encore que l’altérité vécue comme combat : c’est la question générale de l’autre et de l’étranger qui est posée, sa découverte, sa séduction, ses similitudes, ses différences, et les inévitables conflits qui dégénèrent : le couple n’est qu’alors que la rencontre de deux « étrangers » irréductibles qui ne peuvent fusionner. La conquête du Mexique démonte ces mécanismes-là, en suivant parfaitement les 4 moments de l’opéra, Die Vorzeichen (les premiers signes, les signes avant-coureurs), Bekenntnis (confession), Die Umwälzungen (les bouleversements), Die Abdankung (l’abdication). Et l’œuvre joue sans cesse entre le général et l’intime, et la mise en scène entre l’énorme volume de la Felsenreitschule, les vidéos qui montrent soit le monde soit les représentations du monde dans les films ou les images, et l’intime de cette pièce unique où se retrouve le couple et où quelquefois le chœur et tous les participants se serrent.
Un des moments les plus cyniques et en même temps les plus amusants, mais pas forcément le plus original est l’accouchement de Montezuma, dont l’enfant est en fait une succession de tablettes et d’Ipad, sur lesquels se précipite Cortez pour s’abstraire dans une communication qui désormais ne passe que par l’outil numérique : c’est drôle parce que le public est interloqué de cette venue au monde des Ipad (gloussements divers), c’est terrible car cela décuple les blocages de la communication, et en même temps on a déjà vu ça dans d’autres mises en scène avec ou sans Ipad, mais avec les téléphones mobiles etc…Il reste que cet élément pour Konwitschny concourt à l’âpreté des relations humaines : on préfère l’autre quand il est lointain et virtuel et on s’enferme dans une sorte d’autisme. Tous les éléments qui dessinent des tics de notre société (jeux vidéos, notamment les plus violents, tablettes, automobiles de luxe) sont à un moment des outils de consommation pour séduire ou combattre.(l’image de la Porsche rutilante en première partie et épave en seconde partie est assez parlante).
Konwitschny travaille aussi en profondeur les relation interpersonnelles, les attitudes, la violence de chaque petit détail, le tout sous le regard central d’un tableau de Frida Kahlo, mexicaine, qui a connu les vicissitudes agitées du couple avec son mari Diego Rivera (dont elle divorcera et qu’elle réépousera).
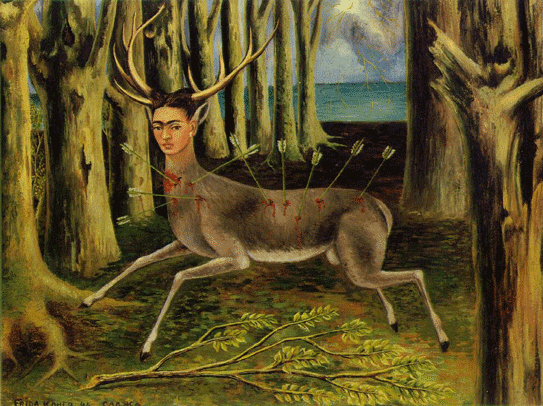
Ce tableau, de 1946, à la fin de sa carrière (la fin de sa vie sera marquée par des problèmes de santé plus lourds encore que ceux qu’elle a connus toute sa vie), s’appelle The little deer ou The wounded deer et représente un cerf à visage féminin blessé par des flèches : une image terrible de la relation de l’homme à la femme qui ne se résout que par le supplice ou le martyre (Saint Sébastien) et la mort.
Les deux personnages ne se parlent jamais, chaque parole proférée l’est dans le vide de la salle, chaque parole est proférée mais pas adressée. Il en résulte une sorte de ballet, de chorégraphie d’une relation à la fois intimiste et presque épique, c’est à dire prise entre un espace du moi et un espace sidéral qu’Artaud cherchait.
Pour installer cette relation dialectique sans dialogue, Konwitschny et son décorateur Johannes Leiacker avec l’aide les éclairages du légendaire Manfred Voss auteur des éclairages du Ring de Chéreau à Bayreuth ont conçu dans l’espace de la Felsenreitschule, déjà en lui-même imposant un dispositif où un salon blanc assez clos (genre salon d’expo IKEA ou maison de poupée grandeur nature) repose sur un cimetière de voitures sombre, embourbé, déjà en voie de fossilisation.
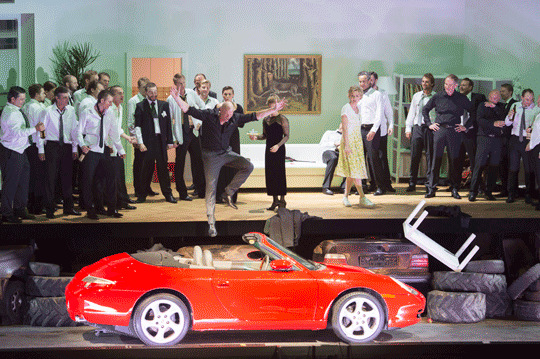
Les voitures, mortes, devenues matières après avoir été symboles sont là, phares allumés comme des yeux énormes assistant au drame. La Porsche rouge rutilante avec laquelle Cortez entre à un moment (tous les artifices de séduction sont bons) devient elle même épave dans la deuxième partie, complètement méconnaissable.

Les vidéos, tantôt circonscrites à la pièce aux murs d’une blancheur aveuglante, tantôt embrassant tout l’espace, les lumières jouant sur la scène et la salle, tout concourt à spatialiser le drame au maximum et à le concentrer sur les deux personnages dans un dedans/dehors permanent, dans un scène/salle permanent, dans un téléobjectif /grand angle panoramique permanent et ainsi se dessine aussi une sorte d’épique de l’intimité, rejoignant la grande histoire des massacres espagnols au Mexique, et celles des hommes assoiffés de sexe et de violence : la scène où Montezuma livre en pâture des créatures de rêve (dans la mise en scène des sortes de danseuses de Moulin Rouge) et où les hommes deviennent des bêtes en proie au désir, la scène de l’orgie où le chœur se tord de désir pendant que Montezuma se tord de douleur sont des moments magnifiques de composition scénique.

Osons le mot, au théâtre ou à l’opéra nous avons très rarement un sentiment de Gesamtkunswerk, d’œuvre d’art totale: Die Soldaten dans cette même salle séparait presque violemment la vie et la vue du spectateur et celle de la scène. Ici, scène et salle sont mêlées, des moments très forts se déroulent dans la salle où le chœur dispersé prend place parmi les spectateurs les obligeant à se lever pour passer, où Montezuma parcourt avec la mezzo soprano et la soprano les travées, en dérangeant les spectateurs, les prenant à partie ( une habitude très « années 70 ») où l’orchestre est éclaté en quatre éléments, où les violons solos sont sur scène et les voix des récitants et du soprano et mezzo soprano en fosse, puis les violons vont en fosse et les voix vont sur scène, deviennent non plus des voix mais des personnages, comme des projections des sentiments des personnages, comme des ombres qui les accompagnent (un peu le principe du Rheingold de Cassiers à Berlin et à la Scala), et nous sommes aussi en plein dans les problématiques d’Artaud, car tout le corps est sollicité, l’audition est quelquefois très douloureuse tellement elle est forte, et aussitôt elle devient à peine perceptible : cette œuvre est pour le spectateur une expérience physique.
Metzmacher fait un travail magnifique, fantastique même avec l’ORF Symphonieorchester : le début avec les percussions qui ont déjà commencé à jouer avant l’arrivée du chef, qui se poursuivent ensuite de manière inquiétante, obsessionnelle, répétitive et menaçante en une sorte de crescendo, avec une précision d’horloge. Comme beaucoup de spectateurs, je n’ai pas l’habitude de cette musique, mais je l’ai trouvé prenante, cohérente, et surtout j’ai trouvé l’œuvre vraiment dramaturgiquement achevée, ce qui est très rare dans l’opéra contemporain (enfin, créé il y a 23 ans quand même…). Artaud fonctionne mieux à l’opéra qu’à la scène (les rares fois où on le joue encore) car le chanter est un exercice physique qui fait de la voix l’instrument, qui fait souffrir, pousser, s’efforcer, projeter. Il faut évidemment des voix toujours au bord de l’extrême pour pareil travail : les voix avec le soprano ahurissant de Susanna Anderson avec des aigus à déchirer le tympan, le mezzo profond de Marie-Ange Todorovitch, qu’on est très heureux de retrouver ici, et les récitants, dont la litanie est à elle seule un exercice impossible, litanie avec des ruptures de volume et de rythme, avec des respirations où à l’extrême du souffle.

Evidemment Bo Skhovus n’est jamais aussi bon que dans ces personnages border line, violents, tendres, démonstratifs, enfermés en eux mêmes, qui sont tout et son contraire. La voix est suffisamment opaque, avec sa manière de forcer, d’éructer quelquefois pour réussir la performance, et quel personnage en scène ! C’est un rôle qu’il n’interprète pas, où il est dans une profonde vérité physique.
En entendant Angela Denoke (qui chantait déjà Montezuma à Ulm en 1993) , je me disais qu’elle aurait dû être à Bayreuth pour Brünnhilde et qu’elle avait eu raison de renoncer. Ce n’est pas un rôle pour elle. Mais en revanche Montezuma est fait pour cette voix ductile, quelquefois au bord de la rupture, au bord de la justesse, juste au bord, et pourtant toujours en phase avec la musique et capable d’incroyables acrobaties vocales tout en gardant un jeu d’une vérité et d’une rigueur phénoménales. Elle réussit des moments d’une lyrisme étonnant, avec une voix adoucie, ronde, jamais agressive ou métallique et puis sans transition des cris rauques, menaçants, des sons terribles et presque inouïs (au sens propre, jamais entendus) : ses premières entrées sont stupéfiantes.
Elle a à la fois une figure de jeunesse (c’est en scène une jeune fille proprette) et d’innocence, de fraîcheur même, et aussi de maturité, la première scène où elle prépare sa maison, ajuste les objets pendant que Cortez frappe à la porte est d’une vérité et d’une simplicité presque touchantes. Mais les scènes se suivent et les situations se succèdent, chacune emblématique des moments clés d’une relation de couple, et même de toute relation humaine, avec ses tendresses, ses excès et ses violences comme le jeu de la mariée et du mannequin que Cortez déchire.

Enfin quand l’un et l’autre, abordent ensemble le final d’une retenue, d’une poésie impensable à peine 30 minutes auparavant, un final qui renvoie à la tradition de Bach et aux grandes œuvres aériennes de la littérature religieuse, un duo éthéré, un duo de deux personnages déjà morts, déjà en suspension, c’est un moment inoubliable.
Du très grand art, et pour l’un et pour l’autre.
Du très grand art aussi pour ce chœur mobile époustouflant, qui n’est pas un chœur constitué apparemment puisque les participants sont tous nommés dans la distribution, un jeu d’une variété et d’une précision rares (notamment lorsqu’ils se rassemblent sur scène en un mouvement presque pictural), un chant puissant y compris dans les gradins, une mobilité étonnante, des sauts, des escaliers dévalés : jamais vu pour ma part quelque chose de tel (le chœur enregistré est celui du Teatro Real en 1993).
Enfin, l’orchestre dirigé par un Ingo Metzmacher extraordinaire, un orchestre de fosse, essentiellement des percussions des bois et des vents, et trois petites formations, deux latérales et l’une en haut des gradins : la musique arrive de tous les côtés, avec une netteté et une précision incroyables, mais aussi une fluidité et une clarté étonnantes, ce qui est indispensable vu la concentration nécessaire. Le geste du chef a tantôt l’élégance du volute ionien, aérien, céleste, tantôt la brutalité terrienne. Tantôt des moments de rêve à peine audibles, à écouter le silence, et tantôt un déchaînement tellurique de toutes ces masses. Pas une scorie, pas une attaque approximative : un travail métronomique d’un côté et d’une vie, d’une agilité, d’une ductilité indicible. Dans cette production, toute la salle est orchestre, toute la salle est chœur, et les solistes se baladent au milieu. Tout bouge tout le temps avec en même temps et paradoxalement une impression de fixité monumentale.
Ce fut une expérience passionnante dont je suis sorti enthousiasmé : on sait que Wolfgang Rihm est l’un des plus grands compositeurs de notre époque. Et c’est un opéra qui n’aurait aucun mal à être inscrit au répertoire de tous les théâtres susceptibles d’accueillir un tel gigantisme, tant livret, situation, disposition orchestrale, systèmes d’écho, images sonores et espaces sonores et tant full immersion dans la musique, électronique ou non, et dans une musique toujours en tension mettent le spectateur au centre de l’exécution et en disponibilité totale pour voir et entendre. Pour moi, c’est la plus grande réussite du Festival 2015 et c’est une production qui devrait intéresser les grands théâtres capables de monter ça, bien plus réussie que Die Soldaten d’Hermanis.
Allez Paris, du courage ![wpsr_facebook]


 Photo Marthe Lemelle
Photo Marthe Lemelle
 Photo Marthe Lemelle
Photo Marthe Lemelle