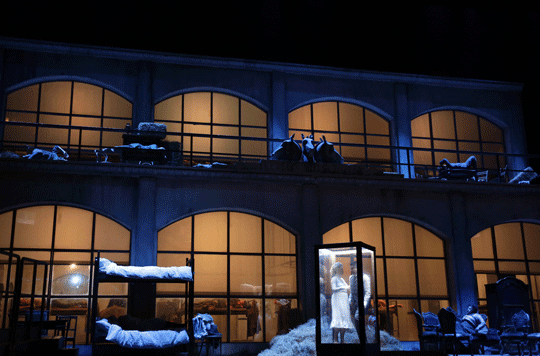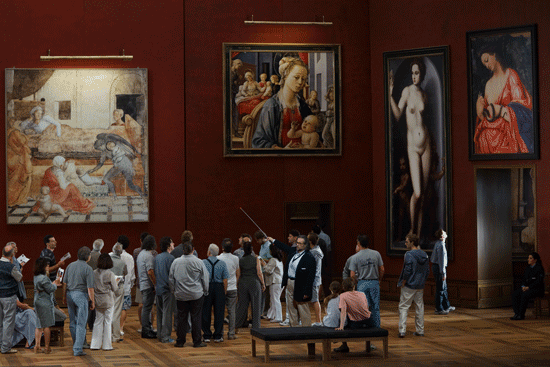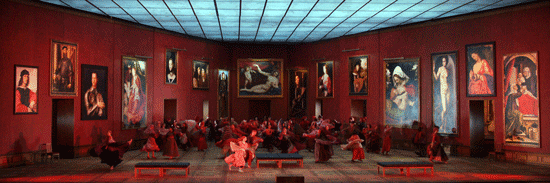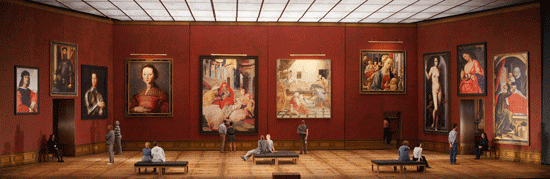Bogdan Roscic, (venu de Sony Classical) nouveau directeur de l’Opéra de Vienne où il succède à Dominique Meyer, commence son mandat avec une année à surprises motivées par l’épidémie de Covid-19. On ne sait en effet que sera le 6 septembre, jour de l’Ouverture, la situation en termes de circulation du virus, de distanciation sociale, de thérapies, même si les conditions en Autriche ont été moins dramatiques qu’ailleurs en Europe. Chargé de faire souffler un vent nouveau sur l’institution et la programmation, Bogdan Roscic propose effectivement beaucoup de changements, dans beaucoup de continuité aussi.
D’une certaine manière, l’évolution de la Staatsoper de Vienne est comparable – toutes proportions gardées- à celle du Grand Théâtre de Genève, avec les mêmes ingrédients, et une même volonté de changer de logiciel, même si sur le papier cela semble être une révolution. Méfions-nous quand même de la communication triomphaliste…
Des nouvelles productions qui renversent la vapeur, mais dont un certain nombre sont connues parce qu’elles viennent d’ailleurs. C’était attendu et c’était le motto de la nouvelle direction qui faisait fuiter habilement certains noms annonciateurs de crises cardiaques à Vienne, comme Frank Castorf.
Des « Wiederaufnahme » (reprises retravaillées) ou des « Musikalische einstudierungen » (retravail musical) avec des productions sorties du répertoire et qui y entrent de nouveau (Elektra de Kupfer par exemple), c’est en revanche un peu inattendu…
Et le répertoire, parce que dans cette maison on ne peut le changer du jour au lendemain, affiche des masse de granit historiques (Tosca…), et des productions nombreuses de Sven-Eric Bechtolf, c’est à dire une modernité qui-ne-fait-pas-peur et souvent désolante.
Quelque chose change, c’est sûr, et une institution aussi installée dans l’histoire et la tradition doit le faire sans tout à fait heurter les habitudes…parce qu’à Vienne, les directeurs d’opéra ont souvent valsé, et pas au bal de l’Opéra.
Historiquement, il faut être clair. Vienne est une capitale musicale de premier plan, et la Staatsoper est le navire amiral de la musique à Vienne, c’est une institution énorme, où c’est la musique qui prime sur la scène, et cela a toujours été le cas. Les très grandes productions d’opéra, celles dont on se souvient, celles qu’on aimerait voir et revoir, ne viennent pas de Vienne. Il y a eu des productions qui ont marqué la « Haus am Ring », mais le temps d’une saison et d’un règne, pas sur toute une vie. Même le fameux Rosenkavalier de Otto Schenk, une référence, est plutôt meilleur dans sa version munichoise un peu postérieure. Mais on se souvient de la présence de Karajan, de Bernstein, de Kleiber, d’Abbado, de Muti, de Prêtre, d’Ozawa au pupitre, et plus récemment de Thielemann ou de Rattle. C’est là la force de cette maison, et de cet orchestre qui est le terreau du Philharmonique de Vienne, c’est ce qui fait et qui fera la gloire de Vienne, pas les productions (pas même celles des metteurs en scène que j’aime si dans la fosse il y a un quidam…).
Si l’on veut voir à Vienne des curiosités, ce sont des productions historiques, encore au répertoire, Il Barbiere di Siviglia (Gunther Rennert, depuis 1966, première dirigée par Karl Böhm avec Fritz Wunderlich), Tosca (Margarethe Wallmann depuis 1958, première dirigée par Herbert von Karajan avec Renata Tebaldi en Tosca !), La Bohème de Franco Zeffirelli depuis 1963, copie exacte de celle de la Scala, première dirigée par Herbert von Karajan avec Gianni Raimondi et Mirella Freni (tout comme à la Scala), ou la Salomé de Boleslaw Barlog de 1972, première dirigée par Karl Böhm) et cela ne dérange pas. Pour Bohème et Tosca, on se demande bien ce qu’une nouvelle production pourrait apporter, tant les nouvelles productions de Bohème et Tosca çà et là sont sans intérêt.
Plus important que les productions fétiches citées, ce qui est important à Vienne, c’est le répertoire, c’est la présence de nombreuses reprises qui font que le touriste de passage ou le viennois qui a envie d’entendre un opéra, le puisse pratiquement chaque soir, la plupart du temps (mais pas toujours) dans des conditions plutôt honnêtes et quelquefois pour des soirées musicalement exceptionnelles. Les tentatives de revenir sur le système de répertoire se sont toujours heurtées à l’hostilité du public et de la presse et ont conduit à l’interruption de plusieurs mandats par le passé.
Que cette maison soit celle qui, plus que toute autre en Europe, illustre une certaine histoire de l’opéra, son archive en ligne le montre, qui depuis 1869 retrace beaucoup de soirées avec leur distribution, et depuis 1955 toutes les soirées sans exception, une promenade dans les rêves, les mythes, qui enchante l’amateur d’opéra. Tapez Lilly Lehmann et vous aurez toutes les représentations où elle chanta à Vienne…
Voilà qui fascine ici.
Pour une maison à l’activité aussi énorme, il faut lister les titres pour se faire une idée globale, voici donc les nouvelles productions que nous reverrons point par point pour l’essentiel.
Nouvelles productions (10 et 2 opéras pour enfants):
- 2020
- Madama Butterfly (Septembre)
- Die Entführung aus dem Serail (Octobre)
- Eugène Onéguine (Octobre)
- Die Entführung in Zauberreich (Octobre, opéra pour enfants)
- Das verratene Meer (Décembre)
- 2021
- Der Barbier für Kinder (Janvier) adaptation pour enfants de Il barbiere di Siviglia de Rossini
- Carmen (Février)
- La Traviata (Mars)
- Parsifal (Avril)
- Faust (Avril)
- L’incoronazione di Poppea (Mai)
- Macbeth (Juin)
En italique, les productions créées ailleurs.
Hors opéras pour enfants, sur 10 nouvelles productions, seules deux (Parsifal, et Das verratene Meer) sont d’authentiques nouvelles productions…l’imagination ne semble pas vraiment au pouvoir…
Wiederaufnahmen (3 reprises retravaillées) :
- Elektra
- Don Carlos (Fr.)
- Le nozze di Figaro
Musikalische Wiedereinstudierung (1 production retravaillée musicalement)
- Der Rosenkavalier
Répertoire (26 titres):
- Simon Boccanegra
- L’elisir d’amore
- La Fille du régiment
- Salomé
- Don Pasquale
- Cavalleria/Pagliacci
- A Midsummer night’s dream
- Roméo et Juliette
- Ariadne auf Naxos
- Arabella
- Werther
- La Bohème
- Tosca
- Hänsel und Gretel
- Die Fledermaus
- Rusalka
- Nabucco
- La Cenerentola
- Don Pasquale
- Manon
- Rigoletto
- Turandot
- Die Walküre
- Die Zauberflöte
- Les contes d’Hoffmann
- Lohengrin
Vienne a eu jusque-là un plus grand nombre de productions de répertoire, à partir de la saison 2020/2021, la Staatsoper sera à peu près dans la bonne moyenne haute des autres théâtres de l’ère germanophone.
—-
Nouvelles productions
Septembre 2020/Janvier 2021/Mars/Avril
Puccini, Madama Butterfly (12 repr.), MeS : Anthony Minghella Dir : Philippe Jordan (sept-janv)/Ramón Tebar (16 janv)/Joana Mallwitz (Mars-Avril) avec :
-sept. : Asmik Grigorian, Freddie De Tommaso, Boris Pinkhasovich
-janvier : Asmik Grigorian, Marcelo Puente, Boris Pinkhasovich
-mars-avril : Hui he, Roberto Alagna, Boris Pinkhasovich
Quelle drôle d’idée ! Non pas d’ouvrir avec Butterfly, mais avec cette production-là. On concède que la production Josef Gielen (Près de 400 représentations depuis la création en 1957 sous la direction de Dimitri Mitropoulos avec Sena Jurinak…) avait vécu depuis longtemps, sans avoir la qualité de la Tosca de Wallmann. Il était temps de la remiser.
Mais au lieu d’ouvrir sur une production maison, ce à quoi on pouvait s’attendre avec une nouvelle équipe de direction, on présente une production née en 2005, dont le metteur en scène est mort il y a douze ans (Anthony Minghella), passée successivement par l’ENO (où elle a été créée), puis le MET, avant d’atterrir à Vienne. Drôle de manière d’annoncer des nouveautés.
Les nouveautés elles sont dans la distribution, avec Asmik Grigorian dans Butterfly, et les deux ténors en alternance qui sont parmi les voix nouvelles intéressantes, Freddie De Tommaso et Marcelo Puente. Dans les reprises de l’année, on retrouvera du plus traditionnel (mais pas moins bon) avec Hui hé et Roberto Alagna, mais sans Jordan puisque c’est la jeune et talentueuse Joana Mallwitz (34 ans) qui dirigera en mars et avril… Un début en mode mineur et c’est dommage.
Octobre 2020/Juin 2021
W.A.Mozart, Die Entführung aus dem Serail (8 repr.), MeS : Hans Neuenfels, Dir : Antonello Manacorda avec:
– oct: Lisette Oropesa, Regula Mühlemann, Daniel Behle, Michael Laurenz, Goran Juric
– juin : Brenda Rae, Regula Mühlemann, Daniel Behle, Michael Laurenz, Goran Juric
Jolie distribution dominée par Lisette Oropesa, une magnifique Konstanze. Je pense cependant que pour une œuvre aussi inscrite dans le répertoire et dans les gênes de la ville de Vienne où elle a été créée (au Burgtheater), le choix du chef Antonello Manacorda, assez irrégulier, peut surprendre, mais qui sait…
Quant à Neuenfels, qui signe la production, c’est sa deuxième apparition après une production du Prophète pendant la saison 1997-1998. On aurait pu tout aussi bien la reprendre d’ailleurs, puisque Manacorda a dirigé Meyerbeer à Francfort…Au lieu de cela on va chercher une production de Mayence de 1999, qui a même eu les honneurs d’une retransmission télévisée.
Il est vrai en revanche qu’une nouvelle production de Die Entführung aus dem Serail s’imposait vu la désastreuse production précédente (signée Karin Beier et dirigée par Philippe Jordan, avec Diana Damrau) qui n’a duré que 10 représentations en 2006 (pour un ouvrage du répertoire aussi important, c’est un vrai trou noir).
Il est enfin dommage que la production des Herrmann (1989) créée par Harnoncourt n’ait probablement pas été conservée, parce qu’elle aurait été une reprise intéressante.
Là encore, risquer une nouvelle production maison pour un ouvrage aussi essentiel dans le répertoire de Vienne, n’aurait pas été un contresens.
Octobre-Novembre 2020
P.I.Tchaïkovsky, Eugène Onéguine (5 repr.), MeS : Dmitry Tcherniakov, Dir : Tomáš Hanus avec Tamuna Gochashvili, Anna Goryachova, Andrè Schuen, Bogdan Volkov, Dmitry Ivashchenko
Dans ce Musée de la production moderne, il fallait évidemment une salle Tcherniakov. Le choix est tombé sur une de ses productions premières montrées en Europe occidentale (Barenboim l’avait déjà invité à Berlin pour Boris et Nagano à Munich pour Khovantchina, Eugène Onéguine, créée au Bolchoï et montrée ensuite à Paris (en 2008…) avec les forces du Bolchoï, dont il existe un DVD. Les viennois verront donc du jeune Tcherniakov, en souhaitant qu’il retravaille sa production. Solide distribution : on est heureux de voir l’excellent Bogdan Volkov dans Lenski.
Surprise du chef : Tomáš Hanus qu’on connaît sur un autre répertoire sera au pupitre. C’est plutôt un bon chef, on attendra donc avec confiance.
Décembre 2020
Hans Werner Henze, Das verratene Meer (4 repr.) MeS: Jossi Wieler & Sergio Morabito, Dir: Simone Young avec Vera Lotte Böcker, Bo Skovhus, Josh Lovell
Création à Vienne de cet opéra rarement proposé, créé à la Deutsche Oper de Berlin en 1990, sur un livret de Hans Ulrich Treichel d’après Le marin rejeté par la mer, de Mishima (1963).
C’est la première production maison de la saison, confiée à Jossi Wieler & Sergio Morabito, une garantie dans le monde de la mise en scène d‘aujourd’hui avec Bo Skovhus toujours impressionnant en scène et la jeune Vera Lotte Böcker qu’on a récemment découverte à la Komische Oper de Berlin dans Frühlingsstürme où elle était vraiment excellente. Dans la fosse, la très solide Simone Young.
Février-mars/mai-juin 2021
Georges Bizet, Carmen (11 repr.) MeS : Calixto Bieito, Dir : Andrés Orozco-Estrada (Février-mars-mai-juin)Alexander Soddy (9 juin) avec
– Février-mars : Anita Rashvelishvili, Charles Castronovo, Erwin Schrott, Olga Kulchynska
– Mai-juin : Michèle Losier, Dmytro Popov, Sergei Kaydalov, Vera-Lotte Böcker
Ne rions pas, après avoir fait le tour du monde de l’opéra depuis plus de 20 ans, la Carmen de Calixto Bieito, qui est même passée par Paris, arrive à Vienne pour remplacer la vieille production de Franco Zeffirelli ; j’y avais vu en son temps Baltsa, Carreras et Ramey, dirigés par Claudio Abbado (en 1990) (Soupir…), ce sera cette année Castronovo et Rashvelishvili, ce qui est bien, et Erwin Schrott, ce qui est moins bien, mais le rôle d’Escamillo-Matamore lui va bien…Au pupitre Andrés Orozco-Estrada, l’actuel directeur musical du Symphonique de Vienne, autrichien d‘origine colombienne, ce qui ne devrait pas être mal.
Enfin gageons que Bieito ne fera même plus peur au public de Vienne, c’est dire…
Mars 2021
Giuseppe Verdi, La Traviata, (5 repr.) MeS : Simon Stone, Dir : Giacomo Sagripanti avec Pretty Yende, Frédéric Antoun, Igor Golovatenko
Tiens, une mise en scène récent mais bien entendue née ailleurs, la Traviata parisienne signée Simon Stone arrive à Vienne avec ici aussi Pretty Yende dans le rôle-titre et l’excellent Frédéric Antoun en Alfredo. Igor Golovatenko est Germont. Giacomo Sagripanti est pour la première fois dans la fosse viennoise, un chef correct, mais pour une nouvelle Traviata à Vienne, d’autres chefs ne convenaient-ils pas mieux ?
La production de Simon Stone succède à celle de Jean-François Sivadier, vue aussi à Aix, qui n’était pas si médiocre et qui en valait bien d’autres, d’autant que la production de Simon Stone ne vaut pas cet excès d’honneur, ce n’est pas l’une de ses meilleures créations. Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ? Oui sans doute si on veut montrer à tous prix que la dernière actualité de la scène moderne arrive à Vienne. Inutile.
Voir: http://wanderersite.com/2019/09/le-bucher-des-vanites/
Avril 2021
Richard Wagner, Parsifal (4 repr.) MeS Kirill Serebrennikov, Dir: Philippe Jordan avec Jonas Kaufmann, Elina Garanča, Wolfgang Koch, Georg Zeppenfeld, Ludovic Tézier
Deuxième authentique production maison qui remplace la très récente production d’Alvis Hermanis (12 représentations depuis 2017) d’une œuvre qui il faut bien le dire, était l’objet chaque année de distributions très solides et souvent de chefs remarquables. Quelle raison peut justifier le retrait au bout de si peu de temps? Peut-être sa qualité discutable, peut-être les déclarations d’Hermanis, politiquement très peu correctes, qui ont singulièrement freiné sa carrière ces dernières années. mais ce sont des conjectures. (Et un grand merci au lecteur qui m’a rappelé que la production Mielitz, médiocre, avait été retirée en 2017).
Parsifal est donc un symbole, et c’est Philippe Jordan qui en assurera la direction. Il ne pouvait en être autrement à partir du moment où il y a un directeur musical dans la maison.
C’est Kirill Serebrennikov qui en assurera la mise en scène, mais sa situation en Russie impose la présence d’un dramaturge qui est Sergio Morabito. D’autres théâtres ont fait ainsi travailler Serebrennikov par personne interposée, et le message pacifique de Parsifal convient à la situation difficile à laquelle il doit faire face.
Une distribution hors normes, pour quatre représentations seulement où ce sera la ruée, avec deux prises de rôle, Ludovic Tézier, en Amfortas, deviendra-t-il le lointain successeur d’Ernest Blanc ? Et Elina Garanča aborde Kundry face au Parsifal de Jonas Kaufmann, au Gurnemanz de Georg Zeppenfeld, et au Klingsor de Wolfgang Koch, remarquables tous, voire exceptionnels mais moins nouveaux dans ces rôles.
Une distribution de feu. C’est la production à ne rater sous aucun, mais aucun prétexte.
Mai 2021
Charles Gounod, Faust (4 repr.) MeS: Frank Castorf Dir: Bertrand de Billy avec Juan Diego Flórez, Adam Palka, Nicole Car, Boris Prygl
Castorf à l’opéra de Vienne !! je présume que des défibrillateurs supplémentaires seront installés dans la salle pour soigner les crises cardiaques.
Pour faire au mieux, on devrait souhaiter que le Burgtheater accueille le Faust de Goethe du même Castorf, pour établir un discours cohérent entre ces deux Häuser am Ring…
La production est connue, elle vient de Stuttgart et Wanderersite en a rendu compte, c’est évidemment une production d’une prodigieuse intelligence, qui travaille sur le mythe de Faust dans un contexte français et parisien (stupéfiant décor de Alexander Denić) .
C’est Bertrand de Billy qui dirige, on espère qu’il connaît la production et c’est Juan Diego Flórez et Nicole Car qui chantent Faust et Marguerite, ce qui nous garantit un chant impeccable. Bien heureusement, c’est le seul survivant de Stuttgart, Adam Palka, qui reprend Mephisto, où il avait été totalement bluffant. Wanderer y sera, peut-il en être autrement ?
Voir: http://wanderersite.com/2016/11/f-comme-faust-f-comme-france/
Mai-juin 2021
Claudio Monteverdi, L’incoronazione di Poppea (5 repr.) MeS : Jan Lauwers, Dir: Pablo Heras Casado avec Kate Lindsey, Slávka Zámečniková, Xavier Sabata, Christina Bock, Willard White, Vera-Lotte Böcker.
Autre production importée, cette fois de Salzbourg où elle a été présentée en 2018 avec William Christie en fosse. On y retrouve Kate Lindsey entourée du remarquable Xavier Sabata, de Willard White notamment. La production fortement marquée par le corps, qui souligne où illustre les sentiments et attitudes des personnages avait été assez bien accueillie à Salzbourg, même si certains l’avaient vertement critiquée. Dans la fosse, Pablo Heras Casado aborde un répertoire où on l’entend très peu, mais la direction de Willima Chrisite avait été critiquée à Salzbourg. Raison de plus pour faire le voyage.
Juin 2021
Giuseppe Verdi, Macbeth, (6 repr.), MeS Barrie Kosky, Dir: Philippe Jordan avec Luca Salsi, Roberto Tagliavini, Martina Serafin, Freddie De Tommaso
Si la distribution est loin de me convaincre pour les deux protagonistes, car Macbeth exige bien plus que deux grandes voix, et Luca Salsi n’a pas vraiment la subtilité exigée pour un rôle où se sont illustrés un Bruson ou un Cappuccilli. Un Tézier aurait été bienvenu. Quant à Serafin, dans le répertoire italien…(soupir…). Reste Tagliavini, excellent, et Freddie De Tommaso, la voix de ténor émergente qu’on va voir partout. La manière de distribuer le répertoire italien lourd (comme le Macbeth de Verdi) me laisse quand même quelquefois rêveur hors d’Italie, notamment pour ce genre d’œuvre.
Jordan dans la fosse, cela montre aussi l’importance accordée à cette dernière production de la saison…
Car et c’est là le point fort, ce Macbeth venu de Zurich est simplement la plus belle mise en scène de Macbeth de Verdi qu’on ait vu depuis Strehler. Barrie Kosky fait un Macbeth noir, avec un espace de jeu de quatre m2, éclairé, un drame à deux où les deux protagonistes se meuvent et s’étouffent. Un des plus beaux spectacles de ces dernières années, à voir absolument si on l’a raté à Zurich, où le rapport scène salle était idéal.
Voir: http://wanderersite.com/2018/10/les-corbeaux-volent-la-ou-est-la-charogne/
Wiederaufnahmen (Reprises retravaillées)
Septembre 2020/Juin 2021
Richard Strauss, Elektra (7 repr.), MeS: Harry Kupfer, Dir: Franz Welser-Möst /Alexander Soddy (19 & 22 sept) avec
Septembre: Ricarda Merbeth, Doris Soffel, Camilla Nylund, Derek Welton
Juin: Ausrine Stundyte, Michaela Schuster, Camilla Nylund, Derek Welton
On est évidemment curieux d’entendre Ausrine Stundyte (on connaît l’Elektra de Merbeth)qui devrait mieux lui convenir que Salomé – du moins pour mon goût. Belle distribution, avec Nylund et Doris Soffel, et l’Orest de Derek Welton ne devrait pas décevoir non plus.
Franz Welser-Möst pour son grand retour à Vienne dans une de ses œuvres fétiches, mais surtout le retour (après l’intermède raté Uwe-Eric Laufenberg) de la très belle production de Harry Kupfer, violente et glaciale, créée par Claudio Abbado en 1989, une des rares productions de Kupfer au répertoire de Vienne. Comme le grand metteur en scène vient de disparaître, ce sera aussi un hommage. Par chance, la production n’a pas été détruite. Une excellente initiative.
Septembre-Octobre 2020
Giuseppe Verdi, Don Carlos (version originale) (5 repr), MeS: Peter Konwitschny Dir: Bertrand de Billy avec Jonas Kaufmann, Ildar Abdrazakov, Igor Golovatenko, Eve-Maud Hubeaux, Malin Byström, Roberto Scandiuzzi
Autre belle initiative, la reprise de ce Don Carlos spectaculaire, qui se déroule sur scène, en salle, dans les corridors, avec son ballet délirant et si juste « le rêve petit bourgeois d’Eboli » . D’une part, la production Peter Konwitschny est cohérente et sans concessions, d’autre part elle rend justice au grand opéra spectaculaire. En fosse, Bertrand de Billy et une distribution rompue à cette œuvre (à part Golovatenko…on rêverait là aussi Tézier) où il y a certes Kaufmann (magnifique dans Carlos) et Byström, mais on remarque en Eboli celle qui à Lyon nous avait tant plu, Eve-Maud Hubeaux, qui entre à Vienne « alla grande », avec le Grand Inquisiteur de Lyon, Roberto Scandiuzzi et le Philippe II de Ildar Abdrazakov, qui le chantait à Paris.
Janvier-Février 2021
W.A. Mozart: Le nozze di Figaro (5 repr.) MeS: Jean-Pierre Ponnelle (reprise par Grischa Asagaroff) Dir: Philippe Jordan avec Andrè Schuen, Federica Lombardi, Louise Alder, Philippe Sly, Virginie Verrez
On devrait conserver les productions Ponnelle qui circulent encore précieusement, tant elles ne vieillissent pas, avec leurs images magnifiques et leur élégance intrinsèque. Certes, aujourd’hui, la mode est à la trilogie Da Ponte confiée à un seul metteur en scène mais je ne suis pas si sûr que ce soit une idée géniale de notre théâtre contemporain. Il fait donc accueillir ce retour de Ponnelle à Vienne avec une joie sans mélange. Philippe Jordan dans la fosse retrouvera Mozart dans la ville où le compositeur vécut, et où il créa Le nozze di Figaro. Distribution qui ne me convainc pas où l’on entendra cependant avec plaisir l’Almaviva Andrè Schuen, originaire du Sud Tyrol (italien) mais d’origine ni germanophone ni italophone, mais ladine (la langue des Grisons, troisième langue du Sud-Tyrol) que les spectateurs d’Angers ont déjà entendu.
Musikalische Neueinstudierung (reprise musicale)
Décembre 2020/juin 2021
Richard Strauss, Der Rosenkavalier ( 7 repr.) MeS: Otto Schenk. Dir: Philippe Jordan avec
- Décembre : Krassimira Stoyanova, Günther Groissböck, Daniela Sindram, Jochen Schmechenbecker, Erin Morley, Piotr Beczala
- Juin : Martina Serafin, Albert Pesendörfer, Adrian Eröd, Jennifer Holloway, Louise Alder, Freddie De Tommaso.
Voilà une œuvre fétiche de l’opéra de Vienne, voilà une mise en scène historique de la maison (Otto Schenk, 1968, antérieure à sa production munichoise et un peu moins de 400 représentations) créée en fosse par Leonard Bernstein, voilà aussi la dernière production d’opéra dirigée par Carlos Kleiber… un monument en somme.
Le directeur musical ne peut faire autrement que la diriger, d’autant que Philippe Jordan est un bon straussien et qu’il n’e l’a dirigée que deux fois à Paris, une fois sous Mortier, et une fois sous Lissner.
Il est légitime qu’il retravaille la lecture avec l’orchestre et qu’il « créée des habitudes » dans une œuvre rebattue pour l’orchestre de la Staatsoper et reprise presque chaque année au répertoire.
En décembre, il dirigera un cast excellent (Krassimira Stoyanova, Günther Groissböck, Daniela Sindram, Jochen Schmechenbecker) avec le chanteur italien de Piotr Beczala, un peu moins excitant en juin (Martina Serafin, Albert Pesendörfer, Adrian Eröd, Jennifer Holloway, Louise Alder, Freddie De Tommaso).
Il n’importe, Rosenkavalier à Vienne c’est un « Hausoper », un opéra qui est chez lui. Il s’agit donc d’un enjeu fort pour le directeur musical.
Chefs engagés :
Philippe Jordan, Directeur musical : Parsifal, Der Rosenkavalier, Madame Butterfly, Le nozze di Figaro, Macbeth
Bertrand de Billy : Don Carlos, Faust, Tosca, Werther, Ariadne auf Naxos
Giacomo Sagripanti : La Traviata, L’Elisir d’amore, La Fille du régiment
Pablo Heras Casado: L’incoronazione di Poppea
Antonello Manacorda : Die Entführung auf dem Serail
Franz Welser-Möst : Elektra
Alexander Soddy : Elektra, Carmen, Salomé
Ramón Tebar: Madama Butterfly
Joana Mallwitz: Madame Butterfly
Simone Young: Das verratene Meer, A Midsummer Night’s Dream
Sebastian Weigle: Arabella
Christian Thielemann: Ariadne auf Naxos
Andrés Orozco-Estrada: Carmen
Marco Armiliato: Cavalleria Rusticana – I Pagliacci, Don Pasquale
Cornelius Meister: Die Fledermaus, Hänsel und Gretel, Lohengrin
Adam Fischer: Die Walküre, Die Zauberflöte
Tomáš Hanus: Eugène Onéguine, Rusalka
Stefano Montanari: Il barbiere di Siviglia
Eun Sun Kim: La Bohème
Gianluca Capuano: La Cenerentola
Axel Kober, Les contes d’Hoffmann
Evelino Pidò: Manon, Roméo et Juliette, Simon Boccanegra
Paolo Carignani: Nabucco, Rigoletto
Pier Giorgio Morandi: Tosca
Giampaolo Bisanti: Turandot
On le voit, parmi les chefs engagés, on remarque quelques chefs de premier plan, comme Christian Thielemann et le retour de deux chefs qui avaient rompu de manière spectaculaire avec Dominique Meyer, Franz Welser-Möst l’ex-GMD de l’Opéra de Vienne et Bertrand de Billy, ce dernier très sollicité, dirigeant trois opéras français, Ariadne auf Naxos une longue série de Tosca, l’une des reprises importantes de l’année, comme on va le voir.
Pour le reste, on remarque quelques noms intéressants comme Gianluca Capuano (La Cenerentola), Cornelius Meister (qui dirige trois productions dont un Lohengrin de fin de saison, Andrés Orozco-Estrada, qui succède à Philippe Jordan à la tête du Wiener Symphoniker (c’est une courtoisie normale que d’inviter le voisin) Sebastian Weigle à qui est confié Arabella. Stefano Montanari, nouveau venu à Vienne pour il Barbiere di Siviglia, nouveau également Giacomo Sagripanti, invité tout septembre pour diriger L’Elisir d’amore et La Fille du régiment .
Dans le regard sur le répertoire, nous avons relevé une sélection de titres qui pourraient être intéressants.
Novembre 2020/Mars 2021
Richard Strauss, Ariadne auf Naxos (7 repr.) MeS Sven-Eric Bechtolf, Dir : Christian Thielemann (Novembre), Bertrand de Billy (Mars) avec
– Novembre : Camilla Nylund, Jennifer Holloway, Stephen Gould, Erin Morley
– Mars : Lise Davidsen, Angela Brower, Brandon Jovanovich, Erin Morley
Christian Thielemann, adoré à Vienne, revient pour Strauss, un de ses compositeurs de prédilection pour une petite série d’Ariadne auf Naxos en novembre. En mars, ce sera Bertrand de Billy, décidément très sollicité dans cette saison.
Les deux distributions, très différentes, sont vraiment d’un (très bon) niveau comparable, avec dans l’une la très belle primadonna de Camilla Nylund, et en mars la présence de Lise Davidsen, entendue dans ce rôle à Aix. Mise en scène de Sven Eric Bechtolf, rien à dire.
Décembre 2020/Janv-Fév 2021/Mai 2021
Giacomo Puccini, Tosca (12 repr.) MeS: Margarethe Wallmann, Dir: Bertrand de Billy (déc.)Pier Giorgio Morandi (Janv-fév-mai)
Qu’il soit entendu que Tosca à Vienne doit être vu une fois par tout visiteur, c’est une production muséale (1958) et Dominique Meyer avait pris soin de faire restaurer les productions les plus anciennes. Qu’il soit aussi entendu qu’avec 12 représentations, c’est une production alimentaire, avec un prix d’appel, la présence d’Anna Netrebko pour les trois premières (au-delà ce serait hasardeux) avec Monsieur…Dès la quatrième, c’est au tour de l’excellente Saioa Hernandez, qui ne chantera cette saison qu’une représentation.
Décembre : Anna Netrebko/Saioa Hernandez, Yusif Eyvazof, Wolfgang Koch
Janv-Février : Sonya Yoncheva, Roberto Alagna, Alexey Markov
Mai : Anja Harteros, Massimo Giordano, Luca Salsi
On a là une palette de possibilités selon les goûts, avec quatre Tosca qui sont des grands noms (Netrebko, Harteros), des petits noms (Yoncheva) un véritable espoir (Hernandez), palette de ténors aussi desquels on retiendra Alagna évidemment, et Giordano en l’espérant plus en forme qu’à Lyon, et trois Scarpia de choix, Koch pour l’intelligence, Markov pour l’élégance, Salsi pour la grosse voix, mais pour rien d’autre tant il n’a pas le profil pour le personnage. Bref, en douze représentations, une sorte de voyage dans les possibles pour Tosca.
Décembre 2020
Jules Massenet, Werther, (4 repr.) MeS : Andrei Serban, Dir : Bertrand de Billy avec Piotr Beczala, Gaelle Arquez, Daniela Fally, Clemens Unterreiner.
Andrei Serban fut dans les années 1990 un exemple de metteur en scène ébouriffé. Il s’est coiffé depuis et représente une sage modernité aux yeux du très conservateur Opéra de Vienne. D’où plusieurs productions de répertoire, jouées assez souvent, comme ce Werther qui remonte à 2005 et repris plusieurs dizaines de fois depuis. Intérêt de cette reprise, la présence de Bertrand de Billy en fosse, mais surtout de Piotr Beczala, un Werther exemplaire et Gaelle Arquez en Charlotte.
Janvier 2021
Antonín Dvořák, Rusalka (4 repr.) MeS : Sven-Eric Bechtolf Dir : Tomáš Hanus avec Piotr Beczala, Elena Zhidkova, Kristine Opolais etc…Bechtolf, la fausse modernité et le vrai conformisme, directeur du théâtre au Festival de Salzbourg jusqu’à 2016. Ce n’est pas de la mise en scène que vient l’intérêt mais du chef, pleinement dans son répertoire, voire une référence, et une belle distribution, avec Opolais, Zhidkova, deux bêtes de scène, et Beczala, moins bête de scène, mais lui aussi référence dans ce type de rôle.
Avril 2021
Wagner, Die Walküre (4 repr.), MeS Sven-Eric Bechtolf, Dir : Adam Fischer avec Andreas Schager, Mika Kares, Günther Groissböck, Camilla Nylund, Martina Serafin.
Là où Walküre passe…le wagnérien fait halte. Avril sera un mois wagnérien à Vienne avec ce Parsifal exceptionnel dont on a parlé et cette Walküre. En arrangeant son emploi du temps, on peut voir la dernière de Parsifal (11 avril) et la première de Die Walküre (14 avril). Adam Fischer est un chef solide, qui fréquente le Ring depuis des décennies, la mise en scène de Bechtolf est attendue, c’est à dire sans intérêt, et la distribution entre Schager, Kares, Groissböck et Nylund est plutôt très flatteuse. Il reste que je me demande ce qu’on continue de trouver à Martina Serafin.
Juin 2021
Richard Wagner, Lohengrin (4 repr) MeS : Andreas Homoki, Dir : Cornelius Meister avec Kwangchul Youn, Klaus Florian Vogt, Sara Jakubiak, Tanja Ariane Baumgartner, Adrian Eröd.
Continuons la promenade wagnerienne. La production de Homoki, qu’on voit aussi à Zürich est faite pour les amateurs de Dirndl et culottes de peau, la direction de Cornelius Meister ne devrait pas être négligeable, la distribution solide mais pas exceptionnelle, même avec Vogt, le Lohengrin de ce début de XXIe siècle. Vous pouvez combiner avec l’autre production de Zurich, le Macbeth miraculeux de Kosky, qui est présenté dans la même période. Cela vous fera du Zurich sur Danube.
Mai 2021
Jacques Offenbach, Les contes d’Hoffmann (5 repr.), MeS : Andrei Serban, Dir : Axel Kober avec Juan Diego Flórez, Sabine Devieilhe, Miche!le Losier, Erwin Schrott etc…
Andrei Serban, production de 1993, qui a sans doute épuisé ce qu’elle avait à dire. Axel Kober, bon chef, mais surprenant dans ce répertoire qui n’est pas le sien. Enfin dans la distribution, à part Erwin Schrott qui dans ce rôle (Lindorf etc..) c’est à dire le méchant, en fera des tonnes. On note Michèle Losier dans la Muse, Sabine Devieilhe en Olympia et Juan Diego Flórez dans Hoffmann, celui qui fut le plus grand chanteur pour Rossini et le répertoire romantique à la faveur de l’âge se lance dans le répertoire fin XIXe, Werther, Faust et Hoffmann…soit. L’intelligence, le phrasé, la technique restent… et on l’aime.
Conclusion :
Au-delà du souhait que la saison se réalise complètement et dès septembre, c’est une saison un peu bizarre, qui semble une manière de dire : « c’est le changement », en s’appuyant sur une dizaine de productions de metteurs en scène d’aujourd’hui, comme un défilé muséal de mises en scènes contemporaines (enfin pas toutes, parce que certaines sont de vieux souvenirs), de metteurs en scène qui souvent jamais n’ont travaillé dans la maison. Donc c’est la carte de visite d’un futur qu’on espère plus original, plus inventif et moins « conforme » (dans l’autre sens…). Avec Vienne, dernier bastion d’un théâtre plutôt traditionnel, qui rentre dans l’ordre moderne, le « mortierisme » se sera installé dans tous les grands théâtres d’opéra d’Europe occidentale ou peu s’en faut. Mais c’est un faux mortierisme, parce que Gérard Mortier était un intellectuel et un vrai créateur dans son ordre. Ici, on a de la gestion de productions achetées ou louées ailleurs. Le panier de la ménagère, c’est possible une saison mais pas deux. Vienne devra ou bien aller plus loin et se montrer créatif et simplement plus intelligent, ou bien le spectateur verra le même style partout et la routine s’installera.
Du point de vue musical, on est à Vienne et des chefs invités stimulants sont attendus. Vienne est pour moi d’abord un Opéra pour grands chanteurs et grands chefs : grands chanteurs cette année ? Un peu mais pas trop, et quand même pas mal de jeunes artistes qui commencent la carrière et qui vont se faire entendre, ce qui est positif. Grands chefs d’aujourd’hui ? Un peu mais vraiment pas trop. L’impression est celle d’un « plan plan » un peu plus coloré que précédemment, mais pas fondamentalement différent avec d’autres noms d’une qualité comparable. Sans doute la nouvelle direction procède-t-elle prudemment, à l’instar d’un Aviel Cahn à Genève, mais Aviel Cahn a un projet lisible et affirmé, ici il ne l’est pas encore, sinon par l’effet d’annonce : mais à vouloir s’afficher moderne, on arrive à faire sourire : reprendre après 20 ans et une douzaine de théâtres la fameuse Carmen de Bieito, c’est touchant dans la volonté de se montrer risque-tout (on pouvait en dire de même quand cette Carmen a été montrée à Paris). Il valait mieux garder la vieille production Zeffirelli…
Évidemment, d’un point de vue économique avec deux seules vraies nouvelles productions d’opéra sur une dizaine, c’est plutôt de bonne gestion.
En fait, à part la production de Parsifal, vraiment exceptionnelle, les bonnes idées on les trouve dans les reprises de vieilles (et excellentes) productions de la maison, L’Elektra de Kupfer, créée par Claudio Abbado en 1989 et reprise jusqu’à 2012, Le nozze di Figaro de Ponnelle (243 représentations de 1977 à 2010) une production que personne n’a oubliée, d’une suprême élégance, et l’intelligent et spectaculaire Don Carlos de Peter Konwitschny (2004), dont la dernière reprise remonte à 2013. Il reste qu’on aura par ailleurs plaisir à (re)voir le Kosky, le Tcherniakov, le Lauwers etc…Car ces considérations n’empêchent pas les productions présentées d’être intéressantes, mais comme elles sont connues et appréciées, c’est autant de risque que l’équipe de Vienne ne prend pas, Attendons la saison suivante pour nous faire une idée plus précise du nouveau cours que prend cette vénérable maison.