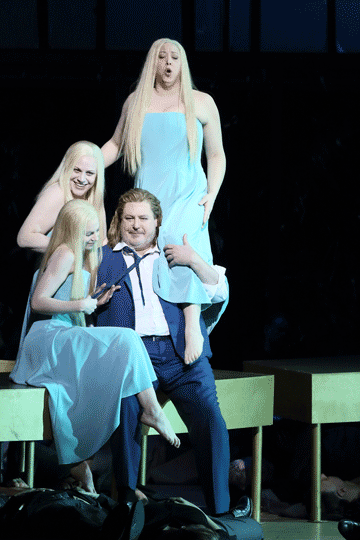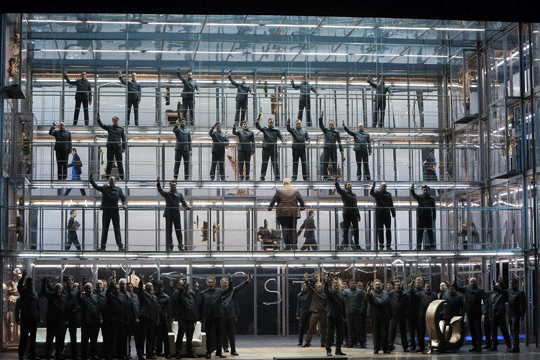
Même à Munich il y a des grèves de machinistes, comme lors du Siegfried représenté dans la semaine et même à Munich il y a des malades et des remplacements, deux ce soir, la deuxième Norne de Jennifer Johnston remplacée par Nadine Weissmann, plutôt une bonne pioche, et plus délicat, la Brünnhilde de Petra Lang remplacée par Rebecca Teem. C’étaient les surprises du jour qui finalement n’ont pas trop perturbé la soirée.
Dans le projet de Andreas Kriegenburg, le Crépuscule est un moment de rupture, la fin du Mythe et le début de l’Histoire, dans laquelle Brünnhilde et Siegfried tombent brutalement. Histoire qui est déjà elle-même fin et qui s’ouvre sur l’humanité d’après Fukushima, compteurs Geiger, contrôles de radioactivité, familles perdues, humains errants soumis à tous les contrôles (mobile, passeport etc..) dans les plus petits détails – petits faits vrais inouïs – enfermés dans les cordes que filent les Nornes et tellement enserrés que les fils se rompent. Puis vient le dernier duo mythique de Siegfried et Brünnhilde et ce voyage de Siegfried sur le Rhin représenté par des figurants qui font se mouvoir des vestes noires retournées mimant les flots, image saisissante qui renvoie au Rhin heureux du début de Rheingold où l’on copulait à plaisir, et dans le sourire : c’est ici une image sombre, inquiétante, qui ouvre sur un avenir incertain.

Et puis on arrive chez les Gibichungen avec ces projections obsédantes du mot « Gewinn » gain et ce « Lust » qu’écrivent des figurants en fond de scène: gagner et jouir, la seule chose que savent faire ces hommes là, des hommes d’aujourd’hui, médiocres, comme Gunther que jamais je n’ai vu représenté aussi minable, aussi lâche, en proie au désir immédiat, utilisant les femmes de ménage comme des objets, incapable de n’être autre chose qu’un suiveur, un héros pour Siegfried qui n’y voit goutte, et en réalité seulement un héros de magazine pour photos de modes. Car le décor, je ne l’avais pas vu avec cette précision, montre en fait une sorte d’ « outlet » dédié à la mode, une sorte de Fashion center, c’est à dire le monde le plus glamour, superficiel et friqué qui soit, où tous prennent des pauses, à commencer par Gutrune, affublée d’une longue robe rouge comme dans une photo de magazine, se balançant langoureusement sur un cheval de bois fait du symbole de l’Euro (€), symbole répétitif qu’on retrouvera au second acte comme table de mariage, : Anna Gabler n’a peut-être pas tout à fait la voix, mais pour le look, c’est fantastiquement réussi.

Immédiatement, l’idée d’un Siegfried perdu s’installe lorsque sur les dernières mesures du Voyage, il se heurte sans savoir où aller à une foule compacte d’hommes en gris avec un attaché-case ou un cartable, qui vont dans tous les sens : il est littéralement balloté, comme si cette foule était produite par des flots du Rhin qui finissaient par le perdre ou le noyer, saisissant.
Saisissant aussi son apparition vêtu en Siegfried traditionnel, au milieu de tous ces gens en costume trois pièce bleu, ce qui l’isole et le ridiculise au pays de la mode, totalement ignorant des rituels des possédants, cigares ou verre à cocktail avec paille et paillettes dont il ne sait que faire.
On se reportera pour plus de précisions à ce que j’en avais écrit en son temps en janvier 2012, mais cette idée de deux pauvres enfants perdus est sans doute l’une des plus fortes ce soir, accentuée par les hésitations de la Brünnhilde de Rebecca Teem, un peu erratique dans une mise en scène qu’elle ne connaît pas, très aidée par Petrenko qui lui indique du pupitre les mouvements à faire. Au lieu d’être un obstacle, cette ignorance devient un atout parce qu’elle est exactement – et, dirais-je, très naturellement – la femme paumée qui arrive au milieu de cette fête de mariage qu’elle ne comprend pas au départ pendant le 2ème acte. N’étant pas physiquement particulièrement leste, elle en devient dans la scène finale du 3ème d’autant plus saisissante, malgré les problèmes vocaux rencontrés. Elle en est émouvante, comme perdue au milieu de cette grande scène, avec une modestie dans le geste qui touche le cœur.
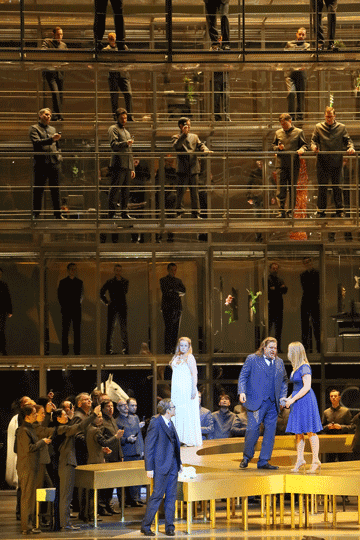
Ayant déjà vu et commenté le spectacle, je savais à quoi je m’attendais, mais le revoir permet de mesurer avec quelle finesse Kriegenburg travaille sur cette histoire. On est à l’opposé de l’option dévastatrice (mais passionnante aussi) de Castorf à Bayreuth: Kriegenburg dit aussi sur le monde des choses délétères, il n’est que de voir ces figurants méc anisés qui ne savent au deuxième acte qu’agiter leur mobile pour faire des photos ou des selfies, comme si c’était la seule chose qui les intéressait dans l’histoire qui se déroule : le Crépuscule ou l’histoire d’une décadence, ou d’une déchéance. À ce titre, l’apparition des filles du Rhin au 3ème acte au milieu des invités à la noce cuvant leur vin, ivres morts d’une nuit orgiaque, est singulière et forte.
Déchéance sur scène, mais sûrement pas en fosse : le rendu musical est impressionnant, malgré un orchestre quelquefois moins parfait (notamment dans les cuivres), mais toujours engagé dans une aventure incroyable d’énergie et de puissance, d’une impressionnante lisibilité. C’est que Kirill Petrenko est partout : il donne tous les départs au plateau, veille de manière très sourcilleuse aux équilibres, aux volumes, à la mise en valeur de tel ou tel pupitre, et en plus ce soir il donnait des indications de mouvements à la Brünnhilde novice, tout en exprimant avec un sourire séraphique ses satisfactions.

Comme c’était à prévoir, son Ring munichois est assez différent de celui de Bayreuth et son attention à la mise en scène induit d’autres voies, d’autres choix, d’autres rythmes : on avait remarqué à Bayreuth une dynamique et une énergie, on remarque à Munich la même énergie, mais une dynamique différente, plus contrôlée, plus serrée, laissant peut-être un peu moins aller les musiciens, laissant moins le son se développer, prenant des décisions plus radicales dans les volumes, dans la construction du son, tout en veillant sans cesse à ne jamais couvrir le plateau, ce qui dans le cas de la Brünnhilde du jour, sans grave ni medium, est une entreprise difficile. Petrenko visiblement retravaille sans cesse les partitions, reprend sans cesse les choses pour chercher ce qu’il va conjuguer au mieux : par ce travail il rappelle bien sûr d’autres gloires de la baguette disparues aujourd’hui. Et ce travail d’artisan du son, on le ressent, sans cesse : rien n’est laissé au hasard, rien n’est décidé sans justification, et surtout, il n’y a aucune concession, même là où la tradition a installé des habitudes. C’était patent et tellement surprenant dans sa Lucia di Lammermoor, l’une des plus stupéfiantes options musicales dans ce répertoire laissé habituellement à des chefs moins originaux. Dans Götterdämmerung, il est plus attendu, car il est dans un répertoire qu’il a déjà labouré, depuis longtemps, mais il continue d’innover et de surprendre. Il est perpétuellement neuf.
Il reste que nous entendons des merveilles, comme le prélude – dès le premier accord, perturbant d’émotion rentrée- et toute la scène des Nornes, totalement bluffante à l’orchestre, évidemment le Voyage de Siegfried et la marche funèbre, mais surtout toute la scène finale, qui est un monument : monument parce que la mise en scène et la musique s’accordent en profondeur, parce que l’émotion étreint (et Kriegenburg la cherche autant que Petrenko, là où Castorf essaie de la briser) et aussi parce que Brünnhilde est moins en difficulté qu’on attendait, les dernières mesures ont cet effet habituel lors des grandes représentations musicales chez le spectateur : on a envie de reprendre tout depuis le début, on a envie de continuer…
Cette conjonction des astres aboutit à l’un des plus beaux finals de Götterdämmerung qui m’aient été donné d’entendre, même si la folie qui nous a saisi il y a trois ans avec Nina Stemme et Kent Nagano n’est pas reproductible, car elle a duré toute la soirée, avec Stemme en état de grâce. Il y a cependant là un miracle Petrenko, qui nous laisse, comme disent nos amis italiens, di stucco.
Le plateau réuni est vraiment d’une très grande solidité. Les trois Nornes, Okka von der Damerau, Nadine Weissmann et Anna Gabler sont prodigieuses de tension et de rigueur, autant que les trois Filles du Rhin, Jennifer Johnston, Hanna Elisabeth Müller, Nadine Weissmann, très lyriques, et très mélancoliques, même si les aigus très sûrs d’Hanna Elisabeth Müller gagneraient à mieux se fondre et restent un peu trop dardés.
La Waltraute de Okka von der Damerau remporte, et c’est justifié, un très grand succès : belle ligne de chant, tension palpable, véritable engagement dans le jeu, des graves notables alliés à une diction remarquable si importante dans ce récit provoquent l’enthousiasme du public.
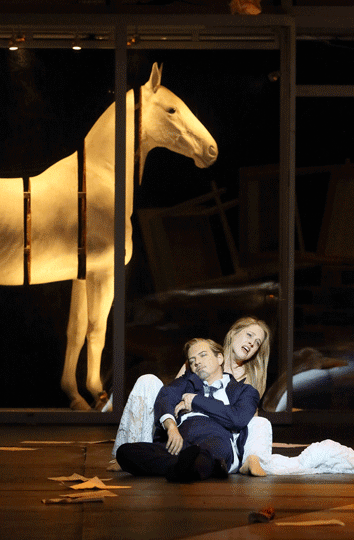
Anna Gabler dans Gutrune est scéniquement phénoménale de vérité, et de naturel : elle compose son personnage de bécasse prise à son propre piège d’une manière supérieure. La voix en revanche n’a ni la puissance ni l’assise nécessaire pour Gutrune (souvent confiée à des Freia ou des Sieglinde), il en résulte une présence scénique supérieure et une présence vocale en devenir notamment dans la scène qui suit la marche funèbre au troisième acte, qui est le moment le plus important du rôle tant les interventions auparavant restent épisodiques. Il y a d’ailleurs un problème avec cette chanteuse : son Eva n’était pas plus convaincante à Salzbourg il y a deux ans. L’intelligence scénique et la sensibilité ne peuvent suppléer aux moyens.
Tomasz Konieczny est en revanche un phénoménal Alberich : il est le personnage voulu par Kriegenburg, pénétrant presque par effraction dans l’espace des Gibichungen, mangeant et buvant ce qu’il y a à manger et à boire au passage, comme quelqu’un qui découvre un monde qui lui est interdit. Il a aussi une jeunesse et une énergie frappantes. Ce devrait être Hagen le jeune (il est le fils) et Alberich le vieux. Ici c’est l’inverse : Hagen (Hans-Peter König) est plutôt mûr et Alberich a l’énergie du quadragénaire…La voix est éclatante de santé, incroyablement expressive, énergique, inondant le plateau de sa soif de vengeance : c’est cette soif, cette foi dans la conquête de l’Or qui lui donne cette énergie là, quand Hagen au contraire semble plus lointain, et surtout loin de son père. Saisissant.
Hans-Peter König est depuis quelques années le Hagen des grandes scènes internationales, il en a la stature, la voix, l’allure. La voix a un tantinet moins d’éclat que naguère, mais toujours autant de présence et d’intelligence dans la couleur et l’expression. Il pose dans cette conception un Hagen plus politique, qui a les habits élégants du pouvoir, mais qui en a aussi la brutalité et la violence cachées au départ, explicites à la fin. Il n’a jamais sur scène l’allure du méchant, c’est un personnage plus subtil et moins « brut de décoffrage » que certains Hagen ; il en est d’autant plus dangereux : il réussit face à son père à montrer une finesse dont son géniteur manque, d’où l’extraordinaire duo qu’ils forment au début du 2ème acte (« Schläfst du Hagen mein Sohn ? »). Magnifique de bout en bout.
Alejandro Marco-Buhrmester est l’un de ses artistes qui font leur bonhomme de chemin, sans vagues, mais toujours avec bonheur, depuis qu’il est apparu en Amfortas dans le Parsifal de Boulez-Schlingensief à Bayreuth. Son premier acte est splendide et son jeu particulièrement ciblé : Kriegenburg en fait un pauvre jouisseur, un parasite, un inutile, l’inverse d’un héros, ce que Siegfried tout à son monde mythique ne voit pas (la scène de l’échange des sangs est d’une rare drôlerie, où Gunther boit le sang, immédiatement pris d’une irrépressible envie de rendre). La voix assez charmeuse et le timbre chaleureux contrastent avec ce personnage aux apparences élégantes et à l’être veule et sans épaisseur. Les scènes du premier acte sont vraiment réussies, alors que la voix semble se fatiguer un peu au deuxième, pour gagner en présence au troisième, plus dramatique (et plus court pour le rôle) .
Le Siegfried de Stephen Gould, avec beaucoup de hauts et quelques bas est dans l’ensemble splendide. Son premier acte est phénoménal, la voix est lumineuse, énergique, le volume impressionnant, et surtout le contrôle impeccable. Les variations sur les aigus, les mezze voci : tout y est. Le deuxième acte est moins éclatant, et le troisième acte bouleversant. Il réussit à rendre ce Siegfried sympathique tant il est perdu et berné, à l’opposé du Siegfried mauvais garçon et antipathique de Castorf à Bayreuth. Ce Siegfried reste frais, innocent, premier degré, pendant tout l’opéra, sans aucune évolution psychologique, tel qu’en lui même l’éternité le change : il est étranger à toute notion de bien et de mal et son chant rend tout cela. Avec un timbre très chaleureux, une vraie présence même si, on l’a dit, ce n’est pas a priori un acteur du niveau d’un Lance Ryan qui s’épuise en scène. C’est une vraie performance, non dépourvue d’émotion et d’humanité, et la voix, contrairement au 8 mars dans Siegfried (il paraît que les représentations suivantes ont été anthologiques), n’a eu aucun accident, à part des fatigues passagères bien compréhensibles qui n’ont cependant gâché aucun moment.
Et cette Brünnhilde de substitution ?
Comme il doit être difficile d’entrer dans une production sans la connaître et surtout dans une production de ce niveau, avec l’enjeu que cela doit représenter pour une chanteuse moins connue et arrivée là par accident. Les hauts et bas de Petra Lang sont bien connus, avec des soirées quelquefois difficiles, mais comme Nina Stemme était prise à Vienne par sa toute nouvelle Elektra, il devait être difficile de trouver une chanteuse de référence pour ce rôle.
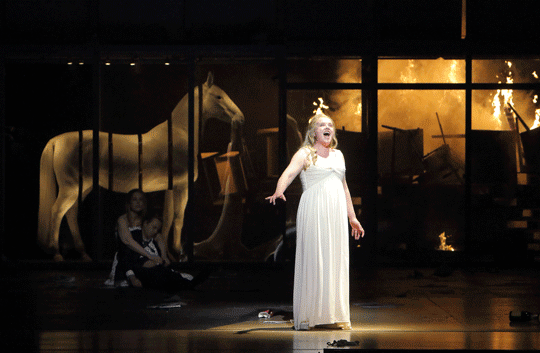
Munich a donc appelé une des nombreuses Brünnhilde des troupes allemandes, qui est un réservoir enviable, une chanteuse américaine dont la carrière est déjà bien avancée et qui a plusieurs fois chanté Brünnhilde. Mais dès le départ, on mesure le problème : pas de graves, pas de centre complètement inaudibles, mais des aigus assez sûrs et sans vibrato excessif. Cette voix sans homogénéité est évidemment en difficulté dans le premier duo et ne va pas cesser dans les premier et deuxième acte d’avoir des problèmes, sans pourtant, c’est bien le mérite des opéras wagnériens, (trop) nuire au déroulement de l’ensemble. Si physiquement elle ressemble aux Brünnhilde des vieilles photos jaunies, elle semble surtout perdue et isolée, et ce qui est la conséquence de la situation de remplacement, mais cela finit par apparaître comme un atout dans cette mise en scène, tant c’est cohérent avec l’idée de Kriegenburg. Et c’est au troisième acte où elle est finalement seule au milieu de la scène, très émouvante, touchante alors que son air final est moins problématique qu’on ne pouvait craindre. Avec un certain cran, elle a redressé une situation assez mal partie.
Le public, compréhensif, l’accueille avec des applaudissements nourris. Elle a relevé le défi.
Les interventions du choeur, impressionnantes tant par le son et le volume que par sa disposition en hauteur sur l’ensemble du volume de la scène, donne en même temps une impression physique de puissance: on est écrasé et émerveillé de la performance. Mais ce choeur est rompu à Wagner et cela s’entend.
Au total, avec des ingrédients un peu plus contrastés, on pouvait tabler sur un succès moindre que pour les autres journées avec des moments plus faibles, et un orchestre légèrement plus fragile dans les cuivres, mais tellement solide par ailleurs : le triomphe fut quand même indescriptible, il a duré plus de 25 minutes, avec un public en délire quand Kirill Petrenko a salué au milieu de son orchestre sur scène. À l’évidence, il est cause de bonne part du succès obtenu ce soir, où c’était un Götterdämmerung imparfait, plein de petits ou gros problèmes, mais complètement transcendé par le chef et quelques chanteurs dans une mise en scène qui reste exceptionnelle. Quant à ce Ring, il a été pour moi dominé par une Walkyrie anthologique, mais chaque journée est un sujet d’admiration et d’étonnement. La saison prochaine, Walkyrie et Crépuscule sont repris, il ne faut pas hésiter : c’est de la belle ouvrage qui mérite le voyage, ou la Wanderung…[wpsr_facebook]