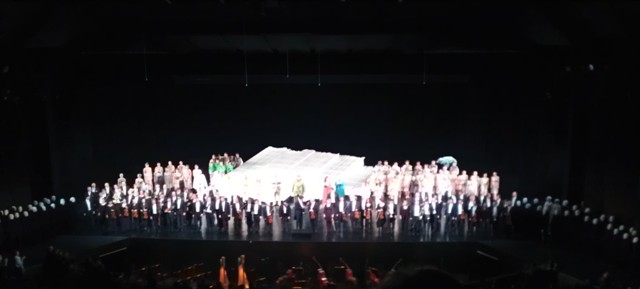Si le Don Giovanni bruxellois a fait passer le cerveau à la centrifugeuse ou au triturage, au moins à Dresde il a pu se reposer de ses fatigues, vu l’extrême platitude de la mise en scène de Uwe-Eric Laufenberg, vieille de 14 ans, dont il ne reste plus rien, si tant est qu’elle eût à offrir quelque intérêt un jour. Il est vrai que ce déplacement dans le théâtre où fut créé en 1911 Der Rosenkavalier n’avait dans mon cœur qu’un seul motif du nom d’Anja Harteros. Et je n’ai pas été déçu.
Concluant l’année Strauss après des représentations de Capriccio, que Thielemann a dirigé le mois dernier avec Renée Fleming, d’Arabella dans la pâle production de Salzbourg, mais avec Anja Harteros, de Josephslegende (Ballet) direction Paul Connelly, de Daphné dirigé par Omer Meir Wellber, voici donc un Rosenkavalier assez luxueusement distribué, avec Anja Harteros, Sophie Koch qui est désormais un des Octavian de référence et Christiane Karg en Sophie, un nom qui monte depuis deux ans, Peter Rose est Ochs, comme il se doit (il l’est à peu près partout), et Faninal comme à Salzbourg, c’est Adrian Eröd. La Staatskapelle Dresden étant dirigée par Christian Thielemann, évidemment, c’est un grand soir et le magnifique Semperoper est archi comble. Voilà en effet un Rosenkavalier somptueusement distribué, dirigé par un chef qui fait référence dans Strauss et avec l’orchestre qui l’a créé, accessoirement l’un des meilleurs d’Allemagne. Qui peut souhaiter mieux ?
La production ne sort pas de la grande tradition des Rosenkavalier, sauf qu’elle transpose l’action au XXème siècle, dans les années cinquante, au moment où l’on peut s’enrichir assez facilement dans un monde en pleine expansion.
Ainsi, si l’intérieur des appartements de la Maréchale reste très proche de celui qu’on verrait au XVIIIème (le passé), celui de Faninal est au sommet d’un haut bâtiment avec vue sur tout Vienne, on a convoqué la presse people et l’arrivée d’Octavian et de la rose est traitée comme une mise en scène pour la télévision (projecteurs, spots) où Octavian montre un art consommé du paraître et une habitude des médias (comme on dirait aujourd’hui) qui tranche avec le naturel de Sophie. C’est l’avenir…il y a un côté Gattopardo dans l’œuvre de Hofmannsthal.
Le dernier acte se déroule dans une sorte d’espace abandonné qu’on aménage pour l’occasion et qui semble servir à des « parties » (en anglais dans le texte) un peu décalées ou déjantées. C’est peut-être le mieux réglé ou en tous cas le plus riche d’idées (enfin… idées…n’allons pas trop loin).
Remettez tout cela dans un décor et avec des costumes XVIIIème sans rien changer à la mise en scène, et vous aurez un Rosenkavalier comme on en voit des centaines. Il y a quelques menus points intéressants, mais l’ensemble reste bien plat et conventionnel.
Monsieur Laufenberg remplace Jonathan Meese pour le Parsifal de Bayreuth en 2016, gageons que le choix de Katharina Wagner, fait pour pacifier les esprits et peut-être reconquérir un public échaudé, est sage et que Uwe-Eric Laufenberg satisfera la majorité du public…un choix par défaut, un choix de tranquillité, un gage en somme. Mais il reste à souhaiter que l’imagination et la créativité de Laufenberg se seront un peu réveillées en 2016.
Il en va autrement musicalement.
Moins d’un mois auparavant j’ai entendu Petrenko à Vienne, cet été j’ai entendu Welser-Möst à Salzbourg (difficile de ne pas entendre vu le volume) : cette année, anniversaire Strauss aidant, je suis revenu vers Rosenkavalier après une longue abstinence. Mais il est vrai qu’il y a aujourd’hui des chefs de choix et des Maréchales intéressantes Schwanewilms, Isokoski, Fleming, Harteros. Pour moi qui ai été nourri à Christa Ludwig, ma première Maréchale, puis Janowitz , Te Kanawa et Gwyneth Jones et qui ai été fulminé par Kleiber plusieurs fois (ah, je vous laisse imaginer quand il arrivait sur le podium, laissant à peine le public applaudir et se retournant brutalement pour faire exploser l’orchestre sans nous laisser reprendre le souffle…), il fallait du temps pour revenir à une œuvre où j’ai laissé tant de larmes au trio final .
J’ai entendu rarement Thielemann dans Strauss, c’était aussi l’occasion de me convaincre à mon tour. Tant d’amis me disent qu’il est insurpassable dans ce répertoire .
Disons le d’emblée, je n’ai pas été convaincu et ce Strauss au cordeau ne m’a pas secoué.
La Staatskapelle de Dresde, avec ce son si personnel, avec cette perfection dans l’exécution, a donné une performance de référence, sans aucune scorie, d’autant que la direction de Thielemann est très claire, isole les pupitres, fait vraiment tout entendre avec une diabolique précision. Même si le premier violon ne vaut pas Küchl à Vienne qu’on a encore dans l’oreille, c’est magnifiquement préparé.
Donc, du point de vue de la « mécanique musicale », il n’y a qu’à couvrir chef et orchestre de louanges. Mais dans Rosenkavalier, il en faut plus. Il faut de la rutilance, de l’explosion, de la dynamique, il faut un rythme, il faut un discours, il faut du sourire, il faut des larmes, il faut de la tension, il faut…il faut…

Il faut beaucoup de ce qui a manqué dans une représentation impeccable aux lignes parfaites, sauf que je n’ai pas senti d’engagement, sauf que je n’ai pas senti de dynamique, d’explosion, de vie.
Autant Petrenko partait en nous entraînant, en nous faisant tourbillonner d’emblée, ici, écouter l’orchestre est un rare plaisir, mais on ne tourbillonne jamais. Pas de tornade. Tout cela reste sage et presque démonstratif. Une belle vitrine de Noël, mais entre moi et ce que j’écoute, il y a une vitre. Il y a un bel objet sous verre.
Il y a aussi un point de vue : le troisième acte est sans doute pour moi le plus intéressant, parce qu’il y a une option claire de retenue de l’orchestre, de légèreté, d’élégance qui renvoie le phénoménal prélude à un tout autre univers que celui explosif de Welser-Möst à Salzbourg, qui savait construire une analytique de l’explosion et de Petrenko à Vienne, qui savait construire une poétique de l’explosion.
Thielemann n’est jamais nerveux, jamais tendu, très descriptif, très sage et conforme, voire conformiste. Il est soucieux de la rondeur des sons et du rendu, il semble moins soucieux de drame (au sens action du terme). C’est du côté du plateau qu’il faut chercher l’émotion, un plateau au volume somptueux que le chef laisse s’épanouir.

Adrian Eröd, chauve pour l’occasion, est plus présent que sur l’immense plateau salzbourgeois : son Faninal existe plus, la voix est plus audible, avec les qualités habituelles de diction et de viennéïté (qu’on me pardonne cet horrible néologisme, mais Eröd est viennois et dans cette œuvre, cela peut compter). C’est un artiste que j’apprécie et il n’a pas dérogé à la règle.
Peter Rose en revanche m’a semblé moins en voix qu’à Vienne. Certes, le personnage est là, imposant, plein d’humour, plein d’allant en scène, mais il m’a semblé moins présent vocalement qu’à Vienne, tout en défendant le rôle comme à son habitude. Mais peut-être passer son temps à chanter Ochs peut-il finir pas lasser…
Le chanteur italien de Yosep Kang a un joli timbre clair, il n’efface pas l’excellent Benjamin Bruns à Vienne. Christa Mayer en revanche dans Annina fait merveille, notamment au troisième acte, son acte.
Restent nos trois dames :

Sophie Koch est un Octavian impressionnant de puissance vocale, mais je trouve qu’elle pousse trop le volume, ce qui gêne pour entendre la Sophie de Christiane Karg quand elles chantent en duo et qui déséquilibre les ensembles. Nul doute que Koch a travaillé son volume et pourrait sûrement à un moment aborder les grands mezzos italiens (on pense à Eboli), mais elle manque de cette distance élégante dans Octavian, dans la diction, dans la tenue, dans le geste même. C’est un chant plein de santé, évidemment au point, mais qui n’est pas encore totalement dompté ou dominé pour mon goût. Nous ne sommes pas encore à des niveaux d’une Fassbaender, inouïe dans ce rôle, de la grande Yvonne Minton, d’Agnès Baltsa, la plus vraie, la plus juste ou même de ma préférée, Tatiana Troyanos qui fut la plus émouvante, ou même dans les plus récents Octavian d’une Graham, d’une Sindram ou d’une Kirschlager.
Et la Sophie fraîche et bien tenue de Christiane Karg au chant contrôlé, aux aigus bien développés, apparaît bien pâle à côté, et ses moyens semblent limités. Est-ce par cette différence de volume entre les deux voix qui finissent par ne pas s’accorder, est-ce parce que la voix est vraiment petite, je ne sais : il reste qu’il y a là une légère déception.
Mais pas pour Harteros.
Avec Anja Harteros, nous jouons à un autre niveau.

On retrouve immédiatement l’aura des grandes Maréchales, impeccable dans les tenues noires que lui réserve la mise en scène années 50 de Laufenberg. Il y a d’abord une tenue en scène d’une élégance et d’une distinction inouïes, on n’a vraiment d’yeux que pour elle, elle est la Maréchale telle qu’on la rêve, telle qu’elle habite nos fantasmes. Elle est ensuite d’un naturel rare, élégante quand il faut, familière et amoureuse quand il faut, énergique et sèche quand il faut : j’ai rarement entendu une maréchale aussi définitive face à Ochs au 3ème acte. Bref, une science du ton et de la couleur, si importante dans un rôle qui exige tant de subtilité, qu’on peut sans crainte qualifier d’unique : cette Maréchale ne chante pas, elle vit, elle est, elle vibre. J’adore Harteros dans tous les rôles où je l’ai entendue, mais là, il y a quelque chose de plus dans la vérité du personnage. Son monologue du 1er acte est vraiment un moment en suspension, un vrai monologue intérieur, très simple et très étudié à la fois, et l’urgence finale n’en est que plus forte et que plus émouvante.
Je n’ai pas encore parlé de la voix, des aigus tenus, de la diction exemplaire, de la ligne de chant, de la variété des tons : bref, elle s’impose, elle est là, immense. Là où elle chantera ce rôle, il faudra y aller. Et je ferai le voyage de Baden-Baden car elle vaut à elle toute seule le voyage. Je pensais qu’elle serait grande, je ne pensais pas qu’elle serait immense, à l’égal des Maréchales du passé qui m’ont accompagné et marqué.
Sans Harteros, ce Rosenkavalier restait quand même ordinaire, même avec Thielemann. C’est Anja Harteros l’épicentre de la production, elle la porte et elle nous emporte ; elle vaut tous les voyages…[wpsr_facebook]