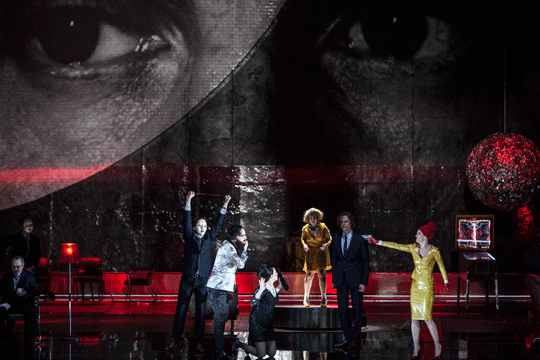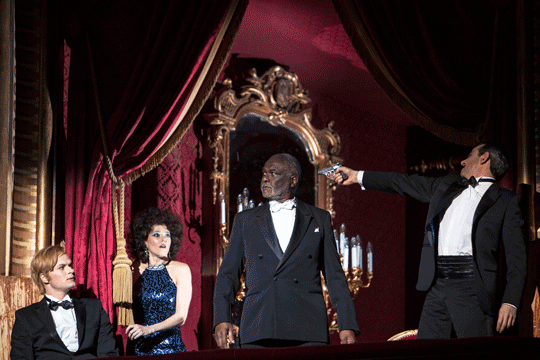- C’est du cinéma…Le meurtre du Commandeur ©Bernd Uhlig
Chaque mise en scène de Krzysztof Warlikowski stimule le petit monde du lyrique. Il y a un snobisme « Warli » qui fait sourire. S’attaquant à l’opéra des opéras, à n’en pas douter le ban et l’arrière ban feraient le voyage de Bruxelles (le dimanche, Thalys permettant) pour s’esbaudir délicieusement de la dernière trouvaille du maître, un maître qui fait partie d’une génération notable de metteurs en scène formés à l’école de Krystian Lupa tout comme Grzegorsz Jarzyna. Et la génération suivante arrive, elle s’appelle Jan Klata ou Barbara Wysocka dont on va voir la Lucia di Lammermoor à Munich le mois prochain. Autant dire une école qui déferle actuellement sur l’Europe, et qui donne une vision décoiffante, passionnante et neuve de la scène polonaise d’aujourd’hui et plus généralement de la scène européenne.
Don Giovanni n’est pas un opéra facile. Warlikowski dit juste quand il affirme que l’œuvre de Mozart est plus puissante que celle de Molière, même si cette dernière reste référentielle pour bien des aspects et notamment la question de l’aristocratie et du libertinage, mais sur la question de la femme, Mozart est autrement plus riche …
De toute manière, un metteur en scène se doit de s’y frotter, et quelquefois même de s’y écrabouiller. À vrai dire, peu s’en sont sortis. Sellars il y a longtemps à Bobigny, puis ailleurs, ou même Bondy jadis à Vienne (Theater an der Wien) avaient laissé de belles traces, Guth à Salzbourg a ouvert des pistes, et Tcherniakov à Aix a exploré un chemin nouveau. Haneke à Paris (merci Mortier) est sans doute celui qui jusqu’ici s’en est le mieux sorti, grâce à une transposition et une actualisation heureuses qui éclairent magnifiquement les attendus du livret sans en bouleverser les données traditionnelles.
Mais pour trois ou quatre productions réussies, combien d’échecs surprenants: Strehler à la Scala, juste joli et élégant, Chéreau à Salzbourg, belles images, mais problématique peu claire, Carsen à la Scala, sans aucun, mais aucun intérêt, tout comme Zeffirelli jadis à Vienne ou même Ronconi à Bologne…
Don Giovanni est un questionnaire à choix multiples : un opéra idéologique sur la liberté, un opéra sur (ou contre) le libertinage, un opéra sur l’aristocratie finissante, sur le désir et ses mécanismes chez les femmes comme chez les hommes, un opéra sur (ou contre) la femme, sur la course à la mort (Claus Guth), sur la désespérance, sur l’au-delà etc… etc…
Warlikowski est très conscient de cette complexité, si conscient qu’il essaie de répondre à tout. Sa volonté, c’est d’embrasser cette histoire dans sa totalité. Et c’est en même temps une volonté tragique, car c’est le type même d’histoire dont on ne touche jamais le fond, car elle est mythe.
Ainsi, l’accueil de cette production a-t-il été très contrasté (public furieux dès l’entracte, wallons, flamands dans l’ire une fois réunis), la critique plutôt dubitative, et l’on sort un peu sonné d’un travail sans conteste d’une intelligence explosive, qui secoue tout ce qu’on croyait jusqu’ici savoir sur Don Giovanni et qui nous fait perdre quelque peu nos repères
On ne s’attaque pas impunément aux monuments, à Mozââââârt, à Don Giovââânni, parce que tout le monde connaît, en a ses représentations et donc sa réponse et parce que ce type d’œuvre est conservé sous verre. Haneke à Paris a eu le génie de conserver la structure du livret et les rapports des personnages entre eux : il les a simplement transposés, mais avec des relations hiérarchiques modernisées, et des relations affectives d’aujourd’hui. Le public s’y retrouvait parfaitement.

Warlikowski met en scène la complexité et donc les contradictions, l’histoire et le mythe, le réel et le fantasmé, la ligne droite et le méandre. Et là, le public ne s’y retrouve plus du tout, tant le livret se diffracte, tant le donjuanisme explose en autant de fragments, en autant de personnages, en autant de lieux, en autant de situations diverses où la violence n’est jamais du côté d’un Don Giovanni plutôt absent, distant, en permanence ailleurs, mais plutôt du côté des autres et de tous les autres, à commencer par le magnifique commandeur Sir Willard White dont la couleur de peau est un des fils que suit Warlikowski. Commandeur noir, danseuse noire stéatopyge à la fin, telle la Vénus hottentote qui stimula tant de fantasmes, mais aussi le Ku Klux Klan comme variation sur la violence de nos regards et nos rejets. C’est un élément inattendu, mais qui fait partie du jardin des désirs plutôt que des délices, dans une composition globale assez proche de l’univers de Jérôme Bosch .
Musicalement la représentation a aussi été critiquée. Pourtant, du côté de l’orchestre, j’ai trouvé que Ludovic Morlot a plutôt bien dominé ce travail, très énergique, très carré. Pas spécialement lourd ou pesant comme je l’ai lu çà et là, mais dramatique et compact. Une direction plutôt symphonique, qui a du corps, de l’épaisseur, et qui n’a effectivement rien de giocoso, mais la mise en scène non plus. Elle tient bien un orchestre qui ne m’a pas frappé par la qualité des pupitres pris singulièrement, mais qui globalement a répondu à la commande. On vient d’apprendre le départ de Morlot, consécutif à un conflit artistique avec l’orchestre. C’est une aventure de plus à rajouter à celles des directeurs musicaux cet automne. Et comme tout départ, il est regrettable.
Du point de vue de la distribution, il est difficile de faire la part du jeu et du chant, tant l’un est imbriqué dans l’autre.
C’est aveuglant dans le cas de Barbara Hannigan, qui fut une Lulu de référence avec ce même Warlikowski, et dans ce même théâtre, qui est une Marie d’exception (Die Soldaten) et qui est une surprenante Donna Anna. Elle utilise ses suraigus au service de son jeu, un jeu volontairement hystérique et possédé par l’addiction au sexe, dès la première scène. Du point de vue stylistique – et je l’avais déjà remarqué dans le répertoire classique – Mozart ou Rossini- elle a tendance à user et abuser du portamento. Elle reste impressionnante de présence et d’engagement, mais on a entendu des Anna musicalement plus convaincantes. En revanche, il est difficile de penser que Warlikowski utilise gratuitement une chanteuse qui fut sa Lulu…lui qui aime l’autocitation.
Rinat Shaham en Elvire est tout autant dominée par l’addiction sexuelle, son entrée en scène est saisissante ; elle est néanmoins plus émouvante notamment dans mi tradi, un des rares airs applaudis à scène ouverte.

Quant à Julie Mathevet en Zerline, elle est intéressante en scène, notamment dans ses numéros de danseuse de boite sur un podium, ou habillée un peu comme l’actrice fétiche de Warlikowski, Renate Jett (dans Iphigénie en Tauride par exemple), comme une Marilyn vieillie, elle revêt plusieurs costumes et plusieurs styles, comme une figure interchangeable et permanente, et reste cependant bien pâle vocalement.
Jean-Sébastien Bou est un Don Juan impeccable scéniquement, qui traverse l’œuvre comme une sorte de zombie ou d’objet, le regard vide (sur les vidéos qui rappellent, qui citent même le film Shame de Steve Mc Queen) une sorte de corps qui se vide, un corps malade (il se traîne au 2ème acte avec un cathéter) un corps qu’on habille, qu’on dénude, un être sans tenue, qui n’est habillé que par ce que les autres projettent en lui. Il en résulte un chant jamais agressif, souvent indifférent, mais une voix très bien posée, au timbre assez velouté, qui manque d’un peu de puissance dans les parties plus héroïques, mais qui propose dans l’ensemble un vrai personnage, qui existe sans exister. Ce corps étendu au final sur une table, presque comme pour une sorte de sacrifice humain, qui fait presque penser à celui, rôti de Peter Greenaway dans Le cuisinier le voleur sa femme et son amant, et qui finit comme le Christ d’une pietà déglinguée, c’est tout l’univers concassé que nous propose Warlikowski.

Avec un Don Giovanni qui structurellement s’autodétruit sans être transparent, il fallait un Leporello qui fût son égal, voire son supérieur. Dès la deuxième scène, Leporello en smoking et Don Giovanni nu puis en ridicule costume de ville, fagoté avec des mocassins rouges et habillé par les autres montrent un rapport maître-valet presque inversé, un Leporello vidé de toute sa valence comique, un Leporello qui sera un double dès la scène finale du 1er acte : un double barbu parfaitement construit, au contraire de la plupart des mises en scène où Leporello et Don Giovanni déguisés sont justement « reconnaissables » même si pas reconnus par les autres.
Vocalement, la voix d’Andreas Wolf, n’est pas de celles qu’on note, malgré tout plus volumineuse et plus marquée, plus basse et un peu plus sonore que celle de Don Giovanni, mais sans vrai caractère. On oubliera le chanteur et on gardera l’acteur, bien que Warlikowski le rende volontairement bien pâle lui aussi dans un couple Leporello/Don Giovanni qui n’existe pas en tant que tel dans la mise en scène.
Si le Masetto de Jean-Luc Ballestra est honnête mais sans grande personnalité, l’Ottavio de Topi Lehtipuu est très franchement décevant. Le personnage est à la fois falot et par moments pris d’une hyper excitation, allant au rythme d’un plateau tantôt plongé dans une sorte de torpeur post alcoolique, tantôt saisi d’une excitation post coke, volontairement effacé, un peu comme tous les hommes d’un plateau décidément dominé par les femmes. Il est très décevant vocalement, lui dont j’aimais il y a quelques lunes la voix posée et élégante est ici en grave difficulté, incapacité à tenir les longues notes, incapacité à vocaliser sans accident, incapacité à placer la voix sans qu’elle ne bouge dangereusement, c’est beaucoup pour un Ottavio dont on attend justement une ligne de chant impeccable. Cet Ottavio involontairement tremblant conviendra à la vision d’un monde très instable du metteur en scène, mais c’est un peu difficile quelquefois pour l’oreille.
Au total, ce n’est pas du côté du plateau que viendront les consolations à une mise en scène que mon voisin considérait comme abominable : un certain public ne peut s’y raccrocher.
Une abomination ? L’abomination serait plutôt les réactions incompréhensibles d’un public choqué jusque par le dessin animé à la mode des années 30, un peu leste (les aventures d’un zizi transformiste et serpentesque, seule concession de la soirée au giocoso) mais visiblement on ne joue pas avec le zizi : « on est pas au porno » a dit une dame derrière moi qui sans doute n’a pas été élevée au biberon des samedis du Canal+ des origines.
Bref une mise en scène qui passe sinon au dessus, du moins totalement à côté des attentes et des idées préconçues d’une partie du public.
Et pourtant, si l’on observe la simple dramaturgie organisée par Da Ponte, et seulement la dramaturgie voulue ou induite par le livret, on se dit qu’il n’a pas fallu beaucoup d’effort à Warlikowski pour illustrer simplement ce que le livret souvent dit, explicitement ou implicitement.
Prenons par exemple la fin en deux parties, un final à la pragoise, où Don Giovanni meurt et où commencent les saluts, ce qui m’a fait gamberger (« pourquoi diable s’arrêter sur la mort ? » etc…) puis les autres personnages s’assoient et chantent le final de Vienne traditionnel, comme dans un bis. Ils sont assis, face au public, et ils discutent comme au salon, chacun de leur disgrâce. Mozart rejoint Molière dans cette terrible fin où les personnages tous meurtris, détruits, blessés, chantent comme s’ils étaient heureux, ils disent leur désarroi et la musique guillerette donne à ce désarroi (aucun ne sera plus comme avant) un ton éminemment sarcastique. Molière avant Mozart avait mis dans l’ultime réplique de Sganarelle cette mélodie grinçante du bonheur : « Voilà par sa mort un chacun satisfait : Ciel offensé, lois violées, filles séduites, familles déshonorées, parents outragés, femmes mises à mal, maris poussés à bout, tout le monde est content.(…) ». La belle satisfaction que voilà, et qui montre que la mort de Don Juan n’arrange rien, et surtout pas ceux qu’il a outragés de mille manières.
Chez Mozart, les a-t-il vraiment outragés ? On est toujours surpris de l’énormité des ressentiments des uns ou des autres et du caractère discutable voire léger des offenses. Prenons le Commandeur : c’est bien lui qui provoque Don Giovanni en duel, c’est bien Don Giovanni qui essaie de l’éviter et se trouve presque contraint d’accepter le duel, c’est tellement ambigu que certains metteurs en scène (Guth) estimant que ce Don Giovanni n’est pas assez noir ni méchant lui font tuer le Commandeur en traître (dans le dos, ou avec une arme dissimulée et non l’épée etc…). Chez Warlikowski, dans la pantomime initiale dans les deux loges qui se font face, le commandeur assis dans une loge voit Don Juan et Anna en posture fort explicite et se précipite lui-même dans leur loge pour le provoquer, non parce qu’il viole sa fille, mais plus sans doute parce que sa fille se jette sur Don Giovanni : il faut éliminer l’intrus, pour enlever à sa fille son jouet. Mais un coup de revolver suffit pour régler son compte à ce père abusif…qui est une des obsessions explicites et continues de Donna Anna…Freud quand tu nous tiens…
La loge de théâtre est réutilisée lors de la rencontre au cimetière et dédouble le Commandeur, figure de cire hyperréaliste statufiée dans la loge de droite, figure fantasmatique et vivante dans celle de gauche, jeu de doubles mort et vivant, peur et courage, qui font aller les regards vers la mort ou la vie, vers l’un ou l’autre, le même et différent à la fois, dans un mouvement où public et Don Giovanni ont des mouvements presque identiques.
Par ailleurs, chez Mozart, les femmes sont bien plus ambiguës que victimes clairement identifiables: Donna Anna reste un mystère, est-elle amoureuse de Don Giovanni, l’a-t-elle accueillie dans sa chambre (bien des metteurs en scène le laissent supposer), écarte-t-elle Ottavio parce qu’elle ne l’aime pas ? Le père mort invoqué à la fin est-il un prétexte ? Anna est plus une victime consentante sans doute en proie à l’horreur d’elle-même qu’une victime passive des entreprises de Don Giovanni. Elle cherche à lui nuire et le poursuivre plus par sentiment d’expiation personnelle que par vengeance ; elle le poursuit par amour, un amour à la Phèdre poursuivant Hippolyte pour qu’il la regarde enfin « Si tes yeux un moment pouvaient me regarder. » (Phèdre Acte II, 5).
Pas d’ambiguïté en revanche chez Elvire, elle aime Don Giovanni et le poursuit jusqu’au bout de ses assiduités, et de sa volonté de le sauver malgré lui, elle ravale son orgueil, son dépit, pour s’humilier lors de la scène du festin.
Enfin on sent bien que Zerline en fera beaucoup voir à son Masetto : dès le jour du mariage, elle se laisse séduire par l’épouseur du genre humain, et pas seulement par ses promesses, mais aussi par son corps.
Chez Mozart, les femmes font vivre Don Giovanni, à moins que ce ne soit l’inverse : elles sont une drogue tout de même bien consentante, et pas vraiment les victimes du grand seigneur méchant homme. Et même chez Da Ponte, Don Giovanni est plus l’objet des fantasmes des unes (Elvire, Zerline) et des désirs des autres (Anna) que l’inverse. Son énergie le fait apparaître protagoniste, mais en réalité même chez Da Ponte il est la projection des regards et des fantasmes des autres : Warlikowski ne fait qu’aller jusqu’au bout de cette logique, faisant du donjuanisme une situation partagée par la plupart des personnages, et notamment par les femmes, totalement habillées pour l’hiver dans ce travail (toutes des nymphos) que j’ai trouvé assez misogyne (y compris dans son traitement de la femme noire, marquée par des attributs féminins démesurés).
La grande différence entre la vision habituelle du livret et ce qu’on voit ici est que Don Giovanni ne domine plus rien chez Warlikowski, tandis que dans un univers assez médiocre qui est l’univers de Da Ponte, Don Giovanni reste un dominateur : Ottavio n’est pas vraiment un aigle, Masetto est un benêt, et Leporello un double comique et dérisoire ; tous se font rouler dans la farine les uns par les autres et tous par Don Giovanni. Don Giovanni reste un esprit dominant ou du moins dominant sur du vide, et donc peut-être faussement dominant.
Warlikowski enlève à Don Giovanni son initiative, son statut, sa noblesse, il le rend comme une part des autres et ne s’appartenant plus : même la séduction de la servante d’Elvire commence par une vision d’Elvire au lit…avec sa servante…ce qui relativise toutes les passions…et ridiculise par ricochet Don Giovanni (le trompeur trompé).
En fait, Warlikowski est dans la logique de Da Ponte, et ne trahit rien du livret : les possibles dans Mozart/Da Ponte sont très larges. Et le personnage de Don Giovanni pose plus de questions qu’il ne donne de réponses.
Ainsi, Warlikowski considère tout ce monde assez interchangeable, dans un univers élaboré par Malgorzata Szczesniak à la fois hyper clean et un tantinet vulgaire, du salon high tech à la boite échangiste, un univers qui dans mon monde cinématographique hésite entre Kubrick et le Fellini du Satiricon ou de la Città delle donne.
Car Warlikowski construit un système référentiel centré sur l’univers du cinéma, et ce dès l’ouverture : les deux couples dans les loges ne sont pas au théâtre, ils sont au cinéma et regardent le film de la scène qu’ils sont en train de jouer. C’est une pantomime en musique (sur l’ouverture) pour le spectateur, un film muet qu’on regarde, où Don Giovanni m’a fait penser à Rudolf Valentino, grand séducteur devant l’éternel : rôles bien marqués, regards lourds, gestes larges, Leporello l’ami un peu indifférent, le Commandeur méchant, Donna Anna assoiffée de chair et Don Giovanni solitaire et glacé. Et Warlikowski s’amuse : il recommande aux spectateurs qui ne peuvent voir ce qui se passe dans la loge de regarder le film au centre (un billet déposé sur les fauteuils d’orchestre nous y invite), comme si le film était là pour rendre service au spectateur, alors qu’il est part de l’histoire qu’il veut raconter, parce qu’il veut que le spectateur ait la même posture que ses acteurs, regardant un film muet qui raconte une histoire finalement autre que celle (la même et pas la même) qu’on aperçoit se jouer dans les loges. Il piège d’ailleurs doublement le public, en ouvrant ainsi sur une fausse adresse au spectateur et clôturant sur une pirouette qui joue sur les deux finals de l’œuvre l’un (Prague) sur la mort du héros, l’autre (Vienne) sur les commentaires de toutes les victimes plus ou moins consentantes, et donc sur la misère, la faiblesse et la médiocrité humaines.
Mais le cinéma est une référence permanente, une référence que je sens mais où j’avoue humblement mon incompétence. Certes, la référence est explicite à Steve Mc Queen (Shame) tant par l’addiction sexuelle du héros que par la relation à ses amis qui ressemble aux relations avec Leporello et par d’autres signes comme l’univers du décor, ou même à Hunger qu’ont ressenti quelques amis à moi. Sans doute les costumes, et notamment ceux de Don Giovanni, et les attitudes, se réfèrent-ils à d’autres films peu identifiables pour moi. Mais ce qui est clair, c’est que Warlikowski plonge dans l’univers du cinéma pour mieux inscrire Don Giovanni dans un univers d’aujourd’hui, dans les mythes d’aujourd’hui et dans les peurs d’aujourd’hui. C’est à la fois un travail sur le mythe et sur la société d’aujourd’hui, qui perd tous repères religieux, moraux, sociaux. Une société perdue dont l’image perd complètement le public : au regard perdu de Don Giovanni correspond le regard perdu du public qui prend pour pornographie sexuelle, la pornographie sociale et morale au quotidien qui nous est imposée par le délitement des temps et que métaphorise sur scène le metteur en scène polonais. Venu à Don Giovanni pour retrouver Mozââââârt, le public se retrouve face à un cinéma miroir, où il ne se reconnaît pas alors qu’il est dans le miroir. D’où la violence du refus.
Alors ? Warlikowski a-t-il réussi son coup ?
Oui, si l’on compte que ce spectacle continue d’intriguer, et qu’il ne donne pas toutes les réponses en multipliant les questions comme autant de possibles. Il est bouillonnant d’idées, de toutes sortes, jusqu’à l’indigestion. Incontestablement c’est une fête de l’intelligence.
Mais c’est tout autant « le canard du doute aux lèvres de vermouth » cher à Lautréamont qui nous saisit. Il y a quelque chose qui résiste et qui nous manque pour être complètement emporté ou convaincu. Il reste au bout du bout un doute. Ce n’est pas la plus convaincante des mises en scènes de Warlikowski : Lulu, qui est ici une référence, par le décor, par l’interprète, par le lieu aussi, était bien plus dominée. Mais peut-être aussi Don Giovanni est-il un opéra impossible à contenir, comme ces masses qu’on essaie de dompter et qui s’échappent par tous les pores et toutes les fissures, une sorte de Chose informe et toujours dangereuse, un piège dans lequel systématiquement on tombe. Nous sommes tombés dans ce piège, et nous en restons agacés. Aucune réponse à Bruxelles, mais tant de questions en plus.
Nota: Ce spectacle a été vu sur Mezzo, sera sur le site d’Arte dans quelques jours…et se joue jusqu’au 30 décembre…
[wpsr_facebook]