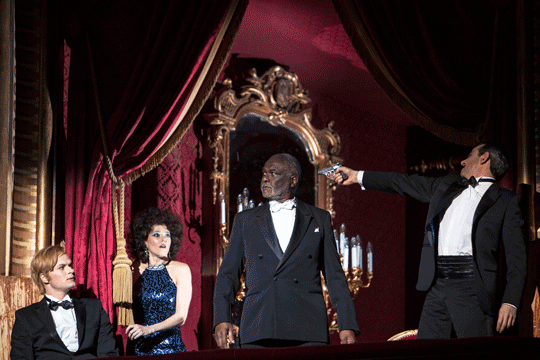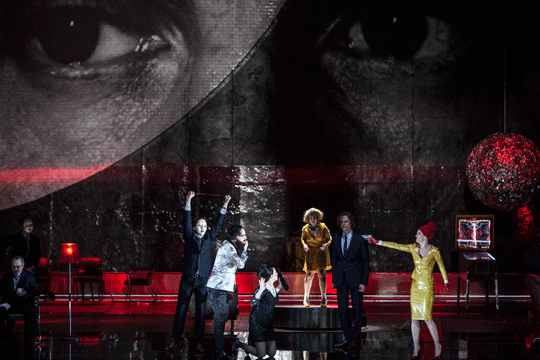L’an prochain, Aix présente pour deux soirées (dans la fosse Esa Pekka Salonen) un spectacle Stravinski – Œdipe -Sophocle mis en scène par Peter Sellars liant Œdipus Rex à Œdipe à Colone, Peter Sellars a eu l’idée de faire suivre d’Oedipus Rex d’un Oedipe à Colone dont la musique serait la Symphonie des Psaumes. Ce sera la prolongation du « projet Sellars » de cette année où, dans la même veine, Aix a programmé une soirée Peter Sellars proposée en 2012 par Gérard Mortier à Madrid, liant dans la dialectique de l’ombre et de la lumière, Iolanta de Tchaïkovski, l’histoire de la jeune princesse aveugle qui retrouve la vue par amour, et Perséphone, le mélodrame de Stravinski, sur des vers d’André Gide, racontant l’histoire de Korè, la fille de Demeter, la naissance du cycle de la nature automne/hiver, printemps/été accompagnant le voyage annuel de Korè (Perséphone) de l’ombre (les enfers et l’hiver) à la lumière (le jour, le soleil, l’été), c’est à dire une sorte de célébration moderne des Mystères d’Eleusis.
Ce spectacle est intellectuellement une très belle idée, stimulante et logique. Il sera reproposé la saison prochaine à l’Opéra de Lyon.
Peter Sellars n’a pas attendu Gérard Mortier pour être une célébrité de la scène internationale, et notamment européenne depuis ses Mozart/Da Ponte à Bobigny en 1989, mais c’est quand même grâce à Gérard Mortier qui lui a proposé Saint François d’Assise au festival de Salzbourg en 1992, (repris en 1998) donné à l’Opéra Bastille en décembre de la même année (et repris en 2004) qu’il est devenu une référence obligée de la modernité. Qui en effet se souvient encore de la production (de Sandro Sequi) qui a accompagné la création mondiale parisienne de 1984 ? Pour le monde entier, Saint François d’Assise est lié à la production de Sellars, un peu comme le Songe d’une nuit d’été à celle de Carsen. Gérard Mortier, homme des fidélités artistiques, a fait appel à Sellars ensuite pour de nombreux spectacles dont le désormais très fameux Tristan und Isolde avec les vidéos de Bill Viola qu’on vient de revoir à Paris.

Bonne idée pour un festival d’afficher Sellars, c’est un nom qui attire et qui garantit un beau spectacle, d’autant que cette production a déjà été rôdée à Madrid avec un DVD à la clef, le même chef, la même distribution de Perséphone et la même Iolanta (Ekaterina Scherbachenko) mais Pavel Černov à Madrid et pas à Aix, hélas.
La soirée se déroule dans le même décor et le même environnement, un chœur vêtu de noir qui dans Iolanta chante, en suivant l’idée excellente du chef Theodor Currentzis un chœur a capella de musique liturgique composée par Tchaïkovski L’hymne des Chérubins, et qui accompagne le mélodrame à l’antique (pas d’antiquité sans chœur), des costumes en écho entre les deux œuvres, puisque Iolanta et Perséphone portent la même robe bleue, couleur de la Vierge Marie dans les représentations médiévales. Il y a donc une volonté de Peter Sellars de replacer le spectacle dans un contexte liturgique ou religieux, d’en faire une cérémonie abstraite et spirituelle. C’est d’ailleurs la tendance de ses derniers spectacles, comme l’adaptation scénique des Passions de Bach.

Peter Sellars a donc commencé sa carrière en proposant pour Mozart le réalisme très concret d’une ambiance à l’américaine et devient désormais plus en plus abstrait. Ainsi donc, sa Iolanta se déroule-t-elle sous des chambranles couronnés de sculptures abstraites (vagues têtes d’oiseau), délimitant des espaces différents pour Iolanta et pour les autres personnages, Iolanta, tel un ange, est accompagnée de musiciens en arrière plan, les autres personnages sont disposés latéralement. Des gestes essentiels, une lenteur calculée, avec peu d ‘action et un réglage minimal des mouvements, c’est assez beau.
Est-ce pour autant parlant ou touchant ? Cet opéra, peu connu en France, mais souvent représenté en Russie et en Allemagne, est l’un des plus émouvants de Tchaïkovski : c’est son dernier, et il doit normalement être représenté avec Casse- Noisette, ce sera le cas à Bastille l’an prochain. La mise en scène, évidemment travaillée, se remet à l’initiative des chanteurs pour donner par leur chant l’émotion : ils font ce qu’ils peuvent, en se limitant à un hiératisme qui rappelle vaguement Robert Wilson, sans introduire de vraie nouveauté dans l’approche. Seule originalité, les projecteurs que braquent les chanteurs eux-mêmes notamment sur Iolanta, provoquant ainsi en fond de scène des ombres gigantesques : ombres, lumières, noir menaçant et jour prometteur. La symbolique est aisée, fait un certain effet, mais va-t-elle plus loin que l’effet ?

C’est encore bien plus criant dans Perséphone, d’abord parce que l’œuvre est indiscutablement plus faible : les bisbilles entre Gide et Stravinski se lisent à travers un texte et une musique qui ne vont pas spécialement ensemble, une musique qui n’est pas l’une des plus marquantes de Stravinski et des vers de Gide qu’on n’apprendra pas par cœur à l’école communale.
Pour mieux clarifier l’histoire, Sellars introduit à côté de Dominique Blanc, valeureuse Perséphone, une danseuse cambodgienne et un ensemble de danseurs, doubles traduisant en gestes très étudiés les discours de la jeune fille et scandant l’histoire. Il en résulte une impression de remplissage comme si Sellars ne savait pas trop quoi faire de l’œuvre. Bien sûr, la danse cambodgienne, par son étrangeté et son rituel, peut se rapprocher d’une ancienne Grèce dont on n’a pas de trace des danses, mais dont on sait qu’elles existaient et qu’elles étaient liées à des cycles naturels et aux forces de la terre, ces forces chtoniennes que Korè va visiter pendant la moitié de l’année (en automne hiver) alors qu’elle revient sur terre au printemps et pendant l’été : elle est celle qui porte la lumière et les fruits de la nature.

Il reste que l’alternance danse/paroles/musique est certes gérée de manière très fluide, mais n’ajoute pas grand chose de passionnant à l’histoire. La volonté de placer Perséphone en seconde partie, après une première partie (Iolanta) triomphale, pour son côté encore plus religieux et ritualisé, tombe à plat : beaucoup de spectateurs se disaient que finir sur Iolanta aurait été plus spectaculaire, et aurait permis d’oublier l’ennui généré par cette œuvre.
Au total, j’ai la singulière impression qu’en matière de création théâtrale, Sellars ne s’est pas trop fatigué, mais qu’il a essayé de rendre cohérents les deux univers en un spectacle unique esthétiquement assez beau grâce aux projections des fonds de scène, grâce à une gestuelle bien dominée, grâce à la diversité mais aussi la cohérence des propositions, mais je ne suis ni convaincu de la portée intellectuelle du propos, ni de l’originalité scénique. Le nom Sellars fait un peu illusion dans ce travail respectable mais sans vrai génie.
Musicalement, les choses sont tout aussi contrastées. Iolanta a remporté un immense succès d’abord grâce la beauté de cette musique : le dernier opéra que Tchaïkovski ait composé est sans doute l’un des plus urgents et des plus émouvants sous ses allures de conte de fées. Évidemment, il fallait qu’un jour Iolanta fût présenté à Aix en Provence car l’opéra raconte l’histoire de la fille aveugle cachée du Roi René, à qui depuis la naissance on a dissimulé la cécité, et qui va la découvrir au contact de celui qui est immédiatement tombé amoureux d’elle, le comte Vaudémont.
Un médecin arabe amené par le Roi René, après avoir observé Iolanta, souligne que celle-ci ne retrouvera la vue qu’à condition de le vouloir à toutes forces. Celle-ci le voudra effectivement à toutes forces pour sauver celui qui lui a déclaré sa flamme, condamné à mourir si elle ne retrouvait pas la vue, du moins selon le subterfuge qu’il a lui même arrangé avec le roi René pour inciter la jeune fille à agir. Elle devra à la force de sa volonté et de son désir, et surtout à la force de l’amour de retrouver la vue.
On aurait aimé un ensemble vocal de meilleure facture : la distribution est honorable certes, mais pas pour un Festival international comme Aix en Provence. On a plaisir à retrouver Diane Montague dans Martha, un rôle certes secondaire, où la mezzo soprano fait encore montre de réelles qualités techniques et de style, accompagné de deux servantes prometteuses Maria Bochmanova et Karina Demurova. De leur côté, aussi bien Vasily Efimov (Alméric) que Pavel Kudinov (Bertrand) font bonne figure. Willard White en Ibn Hakia a toujours fière allure et une vraie tenue scénique, mais la voix est bien fatiguée dans une langue russe visiblement peu familière. Le Robert de Maxim Aniskin très engagé, ne marque pas vocalement dans un rôle il est vrai épisodique et sans grand intérêt. Le Vaudémont de Arnold Rutkowski, est un très beau ténor, très vaillant, et très juste, mais n’a pas pour mon goût le relief scénique qui conviendrait : la prestation est cependant convaincante. Quant à Dmitry Ulianov, avec sa voix de basse chantante, il réussit à émouvoir et à montrer un chant bien plus incarné, grâce à une bonne technique un beau timbre et une vraie présence.
Reste Ekaterina Scherbachenko, très émouvante par un chant particulièrement incarné, mais elle a eu un accident vocal à la fin de la représentation qui a coincé dans la gorge quelques aigus les plus marquants du rôle. La voix est très lyrique, mais le rôle est piégeux, comme les grands rôles de soprano chez Tchaïkovski, qu’on croit communément plutôt lyriques et qui nécessitent plutôt des lirico-spinto, c’est à dire des voix à l’assise large, puissantes, avec des aigus sûrs. J’avais entendu dans ce rôle Anna Netrebko qui était idéale tant par la puissance que par la largeur vocale (c’est aussi une Tatiana exceptionnelle, comme elle vient de le prouver à Munich). Iolanta n’est pas la frêle jeune fille aveugle, c’est au contraire une voix large et solide. Cet accident final mis à part, Ekaterina Scherbachenko est une belle Iolanta, mais pour moi juste en dessous du format voulu.
Dans Perséphone, il y a peu de choix vocaux, puisque le seul personnage qui chante est Eumolpe, voix de ténor, chanté ici par Paul Groves, très habitué au répertoire français, un Faust (Berlioz) qui a fait date, un de ces artistes anglo-saxons au style impeccable et à l’émission parfaite. Dans ce rôle un peu ingrat, il apparaît un peu fibreux et sans souplesse : en retrait par rapport à Perséphone (rôle parlé), il ne réussit pas à être convaincant.

Dominique Blanc en Perséphone n’est peut-être plus le personnage de jeune fille à la fois fragile et décidée qui reconquiert son autonomie qu’on aimerait dans ce rôle, sa diction est parfaite, l’articulation de la langue exemplaire mais la sonorisation bien trop forte, envahit la scène et déséquilibre fortement l’ensemble, même dans les moments plus retenus. Cette magnifique artiste ne réussit pas à me convaincre non plus. Il est vrai qu’un texte plus évocateur et stimulant que celui de Gide eût peut-être permis d’emporter les suffrages. La forme du mélodrame est une forme éminemment difficile où le texte parlé joue toujours à cache-cache avec la musique où il doit la rencontrer, et où doit se tisser un rythme qui ici n’existe pas, tant chacun, le musicien comme l’écrivain, a été par son chemin.
Deux grandes réussites d’ensemble
- pour l’orchestre de l’opéra de Lyon dirigé ce soir par Theodor Currentzis, un des chefs de la jeune génération très réclamés par les théâtres qui a choisi de diriger un lointain théâtre aux confins de l’Oural, l’Opéra de Perm, fondé en 1870 ce qui lui donne une certaine familiarité (et légitimité) dans Tchaïkovski – dont ce théâtre s’est historiquement fait une spécialité. Énergie, grande clarté, mais aussi vrai raffinement, sans excès de pathos mais avec beaucoup de feu et un stupéfiant sens des couleurs orchestrales, voilà ce que nous offre Iolanta à l’orchestre. J’ai été moins convaincu par Stravinski, mais c’est peut-être dû aux problèmes divers rencontrés par l’œuvre : ce Stravinski néo-classique, un peu fade ne me passionne pas. Il remporte néanmoins un très grand succès,.
- pour le chœur de l’opéra de Lyon dont l’interprétation de la liturgie L’hymne des Chérubins restera dans les annales. L’action s’arrête et ce chœur s’enchaîne à l’opéra avec une fluidité étonnante, au point qu’on penserait ce moment suspendu et d’une grande force intégré naturellement à l’œuvre, tant il arrive à propos. Un moment grandiose, magnifique. La performance dans Perséphone où le chœur est plus présent est remarquable également.
Au total, orchestre et chœur mis à part, rien de totalement convaincant dans ce spectacle très chic, qui a affiché des prétentions un peu excessives au vu de la distribution et des choix scéniques au total pas si riches, sinon riches d’effets un peu poudre aux yeux.[wpsr_facebook]