
Les représentations des « opera seria » de Rossini sont assez rares hors de la péninsule. En France en particulier, qui semble les ignorer, y compris lorsqu’ils sont en français. On y préfère le Turc en Italie dont on voit fleurir des productions, ou les sempiternels Barbier de Séville ou Cenerentola, et même pas l’Italiana in Algeri. La récente Zelmira de Lyon au-delà de la fête musicale qu’elle a été, laissait regretter qu’elle ne fût pas produite scéniquement. C’est dire que l’initiative de l’Opéra des Flandres de présenter à Gand et Anvers la quasi inconnue Armida de Rossini était digne d’intérêt. La France baroqueuse se repaît des multiples Armide produites entre le XVIIème et le XVIIIème, mais ignore le Cygne de Pesaro qui a quand même vécu 40 ans de sa vie à Paris.
Rossini est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît, d’abord à cause d’une vocalité difficile et acrobatique que défendent de rares chanteurs (notamment les ténors), ensuite parce que l’orchestration est une mécanique de précision et demande souvent des instrumentistes exceptionnels, et un sens du rythme et de la pulsation que peu de chefs ont su insuffler. Il ne suffit pas de dire « ça pétille comme du champagne », qu’on lit et qu’on entend jusqu’à la nausée, pour faire sonner Rossini et seuls de très rares chefs de grande envergure (Muti, Gatti) se sont risqués à ce répertoire.
Cette complexité, Armida en est un exemple, exigeant rien moins que six ténors dont trois de grand niveau, un soprano qui puisse retrouver un son proche de la Colbran, une de ces voix à la limite, sur le fil du rasoir, à la fois dramatique et acrobatique, soprano et un peu mezzo, mezzo et beaucoup soprano, avec un volume important, des agilités étourdissantes, des aigus assurés et des graves profonds.

Composé pour le San Carlo de Naples en 1817, le livret s’inspire évidemment de la Gerusalemme liberata de Torquato Tasso et des amours de Rinaldo et Armida. Magie et jardins enchantés( qui sont autant de pièges) sont les ingrédients habituels de ces opéras, où curieusement Wagner va puiser des situations dans Tannhäuser (le Venusberg) et encore plus dans Parsifal (le royaume de Klingsor). Dans le fatras religieux qui caractérise Parsifal, on ne penserait pas combien l’aimable rêve de la Renaissance et les jardins enchantés du baroque ont pu influencer l’œuvre d’art de l’avenir, qui en l’occurrence est plutôt celle du passé.
On se trouve donc à Jérusalem dans l’armée des croisés dirigée par Goffredo (Godefroy de Bouillon), où Armida qui veut tromper les chrétiens et les capturer pour les entraîner dans ses pièges à plaisir se prétend la reine de Damas chassée par Idraote. Goffredo se laisse prendre et envoie Rinaldo, le plus grand des héros, aider la magicienne, mais les deux furent jadis amants et l’ancien amour explose à nouveau. Gernando, jaloux, provoque Rinaldo qui le bat en duel, et puis disparaît dans le Venusberg d’Armida : forêts enchantées, plaisirs infinis, et oubli du devoir.
Mais bientôt deux anciens amis partent à sa recherche et réussissent à le convaincre de revenir combattre. Il quitte Armida, celle-ci, folle de rage, détruit son palais enchanté et jure de se venger.
Mettre en scène Armida, c’est prendre le risque d’un travail illustratif à la Pizzi, casques étincelants, plumes et fleurs, ou essayer de poser une problématique pour une partition qui en manque : nous sommes dans l’univers du conte, dans une culture Renaissance issue du Moyen âge, revue et corrigée par un XVIIIème amoureux des machines scéniques et des opéras à merveilles et à l’aube d’un romantisme qui va exalter les amours interdites dans une nature quelquefois sauvage et toujours complice.
Mariame Clément, qui assure la mise en scène, décide de casser cet arrière fond, pour lui substituer une mythologie moderne, non empreinte d’ironie : pour Mariame Clément, les héros des contes de fées modernes, ce sont les sportifs et notamment les footballeurs.

Rinaldo-Zidane (numéro 10) amoureux tue Gernando d’un coup de tête, et tout les hommes du chœur qui sont ses compagnons, et qui pratiquent le même sport, ont d’ailleurs la tête ensanglantée.

On pense immédiatement à l’exploitation que Mariame Clément eût pu faire dans le même contexte de l’affaire Valbuena/Benzema. L’idée qui n’est pas forcément absurde, mais un peu simpliste, est développée dans tout l’opéra : l’entrée du chœur au deuxième acte, en équipe de foot piégée par les nymphes de la forêt vêtues comme des personnages sortis de photos de Pierre et Gilles est ridicule à souhait, d’autant plus quand le chœur de footballeurs enlève chaussettes et chaussures à crampon : sans chaussures, plus de foot possible, ouh là là le piège !

Mariame Clément conduit aussi l’idée d’une Armida seule femme au milieu d’un univers masculin qui se bat avec ses arguments. Mais au-delà, elle ne réussit pas à trouver de fil cohérent

Le spectacle est malheureusement souvent grotesque, on n’y trouve pas un seul moment traité avec rigueur, sauf peut-être le deuxième acte, traité comme un rêve dans un univers à la Pierre et Gilles.

Bien des idées sont seulement ébauchées, comme lancées, avec un jeu d’acteur fruste et traditionnel, et des contextes qui veulent faire sens mais qui se dégonflent vite : décor du stade de Berlin du genre « Les dieux du stade » au premier acte, avec piste en tartan (le première image, c’est Rinaldo seul au milieu de la piste…), mélanges de costumes médiévaux et modernes,
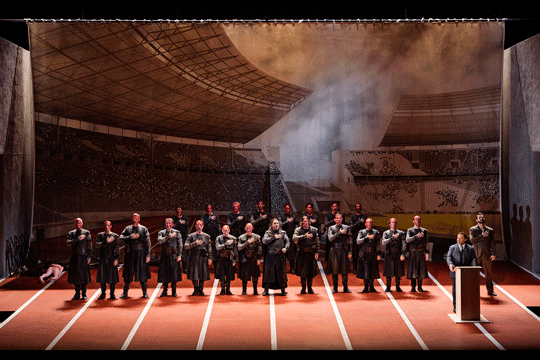
les chevaliers deviennent des footballeurs, qui se passent de main en main une poupée gonflable dont on devine qu’elle est un substitut d’Armida, podium qui trône au milieu des retrouvailles d’Armida et Rinaldo, Armida devenue la star qui chante au milieu du chœur footeux en s’habillant en meneuse de revue tout de rose vêtue, accompagnée d’un chœur qui devient l’ensemble des danseurs admiratifs accompagnant Esther Williams ou Ginger Rodgers, mais aussi Idraote en vieux compagnon (musulman) d’Armida qui brutalement se mue en jeune révolté à Kalashnikov : on a souvent l’impression que tout fait ventre parce que si les idées ne manquent pas en jouant sur les mythes du jour et sur les peurs du jour, mais l’ironie tombe à plat malgré une palette d’images, qui ne donnent finalement aucune direction rigoureuse, parce qu’aucun choix n’est fait comme si la production n’avait pas bénéficié de temps suffisant pour trouver sa couleur. Un dernier exemple d’incohérence ou d’ébauche : Armida dans la scène finale apparaît devant un rideau rouge de théâtre, nous indiquant le théâtre comme solution, et ainsi on entrevoit le “théâtre dans le théâtre” (vieille lune des mises en scène baroques) qui surgit à la dernière minute alors qu’à d’autres moments au contraire on efface le quatrième mur en faisant tomber en pluie des pétales de fleurs sur le spectateur.
J’eus nettement préféré un bon vieux Pizzi qui sait au moins ce que spectacle veut dire ou même une reprise du spectacle de Ronconi à Pesaro en 2014 (qui aurait été repris par un assistant, hélas) que ce spectacle qui semble inachevé ou très vite élaboré sur des grandes lignes, mais jamais vraiment travaillé dans le détail et qui finit par faire pschiiitt. Évidemment, à mesure que les actes avancent, les « idées » diminuent, tout ce qui pourrait avoir de « magique » et de rêve disparaît au troisième acte pour laisser la place à la crudité de la femme blessée et désespérée pendant les dernières scènes; les personnages sont isolés, et pendant les duos entre Rinaldo et Armida, ou pendant le monologue final d’Armida, les chanteurs sont à peu près livrés à eux mêmes…après tout, c’est peut-être préférable, mais on reste incontestablement sur sa faim.
C’est vraiment dommage parce que si scéniquement rien ne tient vraiment, musicalement au contraire il en va tout autrement. C’est une œuvre où il y a un seul rôle féminin, Armida, six rôles de ténor et deux rôles de basse. Bien sûr tous les rôles de ténor ne requièrent pas des voix exceptionnelles, mais il y a au moins trois parties notables, Rinaldo, Gernando et dans une moindre mesure Goffredo. Le reste de la distribution est épisodique.
Le rôle du chœur est essentiel ainsi que la présence affirmée de l’orchestre : l’opéra a quelque chose de monumental, c’est un écrin somptueux pour la chanteuse qui l’a créé, Isabella Colbran.

C’est la jeune Carmen Romeu qui chante Armida ; sacré défi pour une chanteuse qui a une voix très harmonieuse, avec des graves singuliers jamais poitrinés et des aigus qui triomphent. Cette voix est singulière par son homogénéité sur tous les registres. C’est bien ce qui frappe dans ce timbre assez sombre (qui rappelle par certains aspects la Gencer), mais il est à mon avis périlleux d’affronter un tel monument, même si elle l’a chanté à Pesaro. Il se passe avec Armida l’inverse de ce qui est arrivé à Lyon avec Zelmira. À Lyon, l’art consommé et la personnalité scénique incroyable de Patrizia Ciofi ont donné au personnage la force émotionnelle qui compensait une voix pas (ou plus) tout à fait adaptée au rôle. À Gand, Carmen Romeu a toutes les qualités vocales requises, même si son troisième acte accuse une (toute) petite fatigue et même si les aigus ne sont pas toujours impeccables. C’est une vraie voix, une véritable artiste. Il reste que pour tenir pareil rôle, il faut aussi une personnalité assise, une présence scénique qui transcende, et là, il reste encore un degré à gravir. Il est vrai que la mise en scène n’aidait en rien à s’emparer du personnage, mais si elle occupe vocalement la scène, elle ne l’occupe pas corporellement. Il lui manque le charisme nécessaire pour des rôles aussi incroyables. Il faudrait l’entendre et surtout la voir dans quelques années, mais quelle belle voix !
Le jeune roumain Leonard Bernad (Biterolf dans le Tannhäuser de Bieito sur cette même scène) chante à la fois Idraote (au premier acte, vraiment remarquable, engagé, dynamique) et Astarotte (un peu plus pâle) au second ; c’est une voix intéressante, à suivre, la seule basse de la partition, qui fait partie de la troupe de l’opéra des Flandres.
Une note positive aussi pour l’Eustazio, assistant de Goffredo dans la mise en scène, chanté par Adam Smith, lui aussi de la troupe de l’Opéra des Flandres (il chantait Walther von der Vogelweide dans Tannhäuser de Bieito), la voix est belle et ronde, et très bien posée.
Dario Schmunck était Goffredo et Carlo (au 3ème acte), la voix de ténor est claire, mais semble un peu fatiguée, les aigus sont quelquefois détimbrés ou détonent, et il n’a pas vraiment la couleur d’un ténor rossinien. Ce n’est pas le cas de l’américain Robert Mc Pherson, Gernando (et Ubaldo), qui, à quelque menu problème près dans le suraigu, montre de belles qualités de musicalité et d’élégance, et un timbre qui quant à lui est typique de Rossini dont il interprète de nombreux rôles, tout en fréquentant aussi le bel canto romantique. Sa prestation comme Gernando est vraiment de qualité, notamment pour la diction et l’homogénéité.

Rinaldo, c’était Enea Scala qu’on avait remarqué dans le pêcheur de Guillaume Tell à Genève ; d’une certaine manière, un ténor est né : très large étendue vocale, avec des graves assez impressionnants dans ce type de voix, et des aigus et suraigus maîtrisés, contrôlés et tenus. Une présence vocale et scénique forte et une belle résistance. Enea Scala est pour moi ici une révélation authentique et on entend derrière cette voix tous les possibles bel cantistes ou surtout Grand Opéra (et notamment Meyerbeer): c’est un Jean (du Prophète), un Raoul (des Huguenots), et évidemment un Léopold de la Juive de Halévy qu’il chantera bientôt à Lyon. Il a emporté l’enthousiasme du public qui l’a salué tout particulièrement. Retenez ce nom, très facile par ailleurs à retenir pour un amateur d’opéra.
Le chœur de l’Opéra des Flandres, dirigé par Jan Schweiger, malgré les ridicules de la mise en scène, se sort de ce travail important avec les honneurs : on oublie souvent le rôle important des chœurs dans les opéras de Rossini, et notamment ceux de la dernière période. Ils portent en eux bien des chœurs de Verdi. Il y a là de la puissance et de l’engagement même si la diction italienne n’est pas toujours claire.
Alberto Zedda est l’homme au monde qui connaît le mieux Rossini et celui qui au monde a fait le plus pour le faire reconnaître, aimer et représenter. Son travail à Pesaro au-delà de ses immenses recherches musicologiques est irremplaçable, notamment auprès des jeunes chanteurs qu’il suit et forme. Il effectue avec l’Opéra des Flandres un travail suivi et admirable pour présenter les opéras de Rossini et sa popularité auprès du public est évidente. À 87 ans, il dirige encore avec une énergie et un allant étonnants : c’est une vraie force de la nature.
Mais il n’a jamais été pour moi le chef rossinien dont on rêve, même si les chanteurs sont suivis avec précision, même s’il a une science notable des rythmes et un sens de la pulsation. Son orchestre est toujours un peu brutal, un peu trop martial pour mon goût (encore que pour cette œuvre et pour cette mise en scène, cela puisse se justifier). J’aime un Rossini plus fluide, plus subtil, qui fasse place plus évidente au lyrisme et moins à la force.
L’orchestre a néanmoins fait ce qu’il fallait, malgré les pièges incroyables jetés sur le chemin des cors, complètement à découvert dès les premières mesures, et qui font ce qu’ils peuvent. Rossini est un compositeur qui n’a pas toujours pour certains pupitres les prudences nécessaires et ce début d’ouverture est redoutable pour les cors. Mais pour le reste, et même pour cette partie si périlleuse, l’orchestre s’en sort avec les honneurs.
Ainsi donc, cette Armida plus que discutable scéniquement se sauve musicalement, grâce à un plateau de qualité qui répond au défi, et où chœur et orchestre défendent avec ardeur la partition ; il reste que la mise en scène très « Regietheater » de Mariame Clément demanderait justement plus de régie, et plus de théâtre. De ce côté, c’est un ratage, et c’est dommage. [wpsr_facebook]

