
Dès le premier accord de la Symphonie de Haydn nous saisit une évidence : quel son ! cela saute d’autant plus aux oreilles qu’on a encore le son du San Francisco Symphony Orchestra de la veille, beaucoup plus linéaire et sans cet incroyable relief. Ici on est saisi. On avait donc oublié cette profondeur, cette chaleur, cette grandeur alors que les viennois sont en formation réduite (Haydn). L’acoustique de Lucerne est à la fois précise et chaleureuse, réverbérante mais pas trop, elle est un idéal d’équilibre et respecte les volumes et l’intensité, et donc quel que soit l’orchestre elle est fidèle. Ici, le son respire et s’épanche : on est immédiatement sur une autre planète. Il faudrait vraiment étudier les différences en bien comme en moins bien entre les orchestres américains et les orchestres européens, et notamment ceux qui portent une tradition séculaire. Y-a-t-il en dépit des différences entre les orchestres un son européen spécifique?
En tous cas, ce son est une captatio benevolentiae. Un piège à délices. Et ce soir, on s’adonnera d’abord à cette jouissance-là, à la jouissance d’un orchestre en très grande forme, sans aucune scorie (les Wiener sont quelquefois irréguliers).
À dire vrai, je ne suis pas un auditeur régulier de Semyon Bychkov, ma dernière expérience fut cette belle Khovantchina viennoise (avec les mêmes musiciens donc) en novembre dernier, mais je dois dire que Bychkov ne m’a jamais ni enthousiasmé ni déçu. Il est très aimé en Italie depuis son passage à Florence, son passage pourtant intéressant jadis à l’Orchestre de Paris n’a pas marqué les mémoires, mais sa carrière est solide et ses prestations ne sont jamais décevantes, même si elles ne sont pas toujours « caractérisées » par des traits spécifiques. Il reste que c’est un excellent chef d’opéra, aussi bien dans Verdi que dans Strauss, mais aussi dans Schubert (Fierrabras) ou dans le répertoire russe, son répertoire atavique puisqu’il a été formé à Leningrad et qu’il a même failli succéder à Mravinski au Phiharmonique de Leningrad.
Il n’a pas en ce moment d’orchestre attitré, mais il dirige cet été les Wiener Philharmoniker dans une tournée qui va l’amener après Lucerne à Bucarest pour se terminer à Vienne.
Haydn a été beaucoup joué cet été à Lucerne, mais la symphonie funèbre (Trauersymphonie, le nom ne vient pas de Haydn) I :44 (1770/71) est-elle vraiment avec son début particulièrement grave une parfaite illustration de la thématique « Humor » du Festival ? Considérée comme une œuvre du Sturm und Drang, le début est particulièrement grave et solennel tandis que le deuxième mouvement est plus dansant (menuet) et que l’adagio est situé en troisième mouvement. Le premier mouvement avec ses contrastes marqués de volume, son relief, est évidemment typique de la période et l’expressivité de sa musique illustre peut-être un moment où Haydn fréquentait un peu plus l’opéra. On dit qu’il exprima le désir que le mouvement lent (le troisième, et c’est inhabituel) soit joué à ses funérailles. Le mouvement dansant, avec sa couleur de cour, tranche un peu avec la gravité de l’ensemble qu’on retrouve au dernier mouvement.
Mηδὲν ἄγαν, rien de trop, voilà ce qui marque dans ce que nous avons entendu. Bychkov soigne les couleurs, les équilibres, mais ne charge aucun moment : cela reste un peu distancié, très attentif et parfaitement en place. Mais pas très inventif, les contradictions relatives entre les mouvements, qui eussent pu être tirées vers l’humour noir en lien avec le thème du festival ne sont pas vraiment marquées. C’est une performance très équilibrée, parfaitement classique, mais ni Sturm, ni Drang. Comme c’est parfaitement joué, avec des violons à se damner emporté par le remarquable Rainer Honeck on y prend un grand plaisir, mais c’est un plaisir hic et nunc qu’on n’emmènera pas avec soi dans l’armoire à souvenirs. Souplesse, fluidité, perfection des lignes, pureté du son, on ne sait que privilégier. C’est le pur plaisir de l’oreille dans une interprétation sage qui ne vibre pas, mais qui calme notre soif de beaux sons et de plaisirs immédiats.

Il en va autrement pour les Wesendonck Lieder, chantés par Elisabeth Kulman.
Je me souviens avoir découvert cette chanteuse il y a quelques années à l’occasion de la retransmission télévisée de l’Anna Bolena de Vienne (Netrebko/Garanca) où elle chantait le petit rôle de Smeton.
Immédiatement j’ai été attiré par son beau mezzo, et par une pose de voix qui m’a frappé : je me suis dit immédiatement, voilà une voix qu’il faut suivre.
D’où ce que j’écrivais à l’époque (2010) dans ce blog : La surprise de la soirée vient de l’extraordinaire page Smeton de la jeune Elisabeth Kulman, mezzo autrichien qui devrait être promise aux plus hauts sommets du Panthéon lyrique: il ne faut pas la rater si elle passe en France, elle est stupéfiante d’engagement scénique, d’intensité, de technique, de volume (autant qu’on en puisse juger à la TV). C’est une Carmen évidente (elle l’a à son répertoire), mais elle doit être une Vénus de Tannhäuser assez étonnante. Chacune de ses apparitions (le rôle est assez bref) fut vraiment un magnifique moment. Je l’ai ensuite essentiellement entendue dans Fricka, à Lucerne d’abord (avec le Bamberger Symphoniker et Jonathan Nott), puis à Munich dans la production de Kriegenburg. Elle est tout simplement et de loin la meilleure Fricka actuelle.
Ce qui frappe chez Elisabeth Kulman, c’est d’abord une impeccable diction, aucun mot n’échappe, tout est d’une clarté évidente, c’est ensuite une voix d’une rare homogénéité, charnue, sans ruptures, avec des passages impeccables et une ligne de chant exceptionnelle, ainsi qu’une capacité à contrôler les aigus, pour les filer, pour les atténuer, ou à l’inverse pour les darder.
Mais c’est surtout une véritable interprète, avec un sens du mot et une capacité à dessiner un univers qui rend la rencontre de ce soir vraiment exceptionnelle : il faut l’entendre dès Der Engel, appuyer sur von Engeln sagen, ou plus avant saisir la manière dont elle prononce niederschwebt. Il faut aussi entendre la sensibilité avec laquelle elle prononce versinken à la fin de Stehe still ! ou encore dans Im Treibhaus dont la musique est celle du début de l’acte III de Tristan, cette musique sombre et tendue, j’ai rarement entendu si intensément prononcer Luft (Malet Zeichen in die Luft) et süsser Duft. Il y a la douceur du mot lui même, il y a aussi le souffle qui passe, comme quelque chose de léger et d’aérien, tout comme ce Gruft final de Träume (avec cette musique sublime de l’acte II de Tristan) qui évoque presque une mort heureuse et apaisée (et je ne parle même pas de Allvergessen, Eingedenken dits avec une imperceptible respiration entre les deux, qui donne en même temps une vraie urgence).
À cette voix somptueuse correspond un orchestre à ce moment phénoménal : on ne sait que retenir, de l’alto sur schweben dans Im Treibhaus, ou le hautbois dans Stehe still ! Les instruments chantent avec la voix, dans une sorte d’émulation qui naît évidemment de mutuelles perfections. Et Bychkov, sans jamais « en rajouter », en restant d’une impeccable sobriété, accompagne en vrai chef d’opéra, attentif à la voix, aux inflexions, dosant le volume pour ne jamais couvrir. C’est bien là le sommet de la soirée.
Wagner, toujours Wagner…
La dernière fois qu’on a entendu à Lucerne la 3ème symphonie de Brahms, c’était en 2014 avec le LFO et Nelsons remplaçant Abbado qui aurait dû la diriger si hélas, le destin n’en avait décidé autrement.
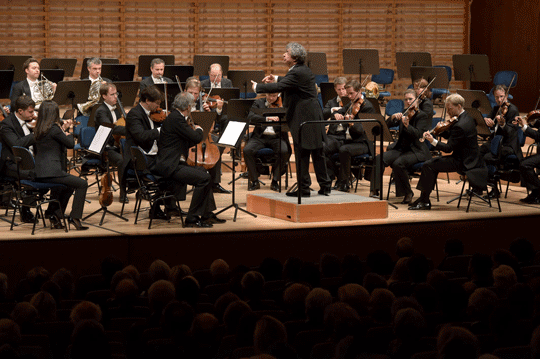
On ne revient pas sur l’orchestre qui est ce soir vraiment fabuleux, avec un son d’une clarté et d’un éclat particuliers : avec Brahms, il sonne dans son répertoire atavique. Bychkov, comme dans Haydn, approche l’œuvre d’une manière assez « classique » avec une certaine lenteur, sinon une certaine gravité. La 3ème n’est pas la plus brillante ni la plus énergique des quatre symphonies de Brahms, et Bychkov, sans jamais insister et en travaillant sur la perfection des équilibres et des volumes, propose une symphonie d’une grande clarté, avec des rythmes marqués sans nuire toutefois à la fluidité d’ensemble, mettant en valeur les pupitres (contrebasses au premier mouvement, la clarinette au début second mouvement). Le troisième mouvement plus lyrique et à la fois plus mélancolique, qui a été repris par de nombreux chanteurs populaires dont Gainsbourg, reste tout de même lui aussi assez retenu, avec un tempo lent, sans jamais se « laisser aller » complaisamment à la mélodie, d’une manière presque pudique. Cette retenue est encore plus nette dans le quatrième mouvement à la tonalité plutôt sombre et inquiétante malgré le caractère intense et passionné de l’ensemble. Bychkov préfère visiblement insister sur le caractère mélancolique, sans jamais en exagérer cependant la portée. Cela reste équilibré et réservé. Mais certains moments de ce quatrième mouvement sont tout simplement prodigieux à l’orchestre comme les crescendos de la (longue) coda avant de se terminer sur des rappels du 1er mouvement mais sur une couleur moins éclatante, plus grise, encore plus réservée, qui clôt de manière surprenante la symphonie. C’est bien cette couleur un peu retenue qui semble intéresser Bychkov sur l’ensemble de la symphonie d’où tout vrai brio est évité, au profit d’une réserve et d’un équilibre qui courent l’ensemble de la prestation. Une troisième de Brahms plus grave qu’à l’accoutumée, un Haydn parfaitement classique, plus classique que Sturm und Drang, et des Wesendonck Lieder exceptionnels, voilà une soirée de très haute tenue, d’une certaine sagesse et qui va se terminer par un bis préparatoire au concert du lendemain puisqu’il s’agit d’une variation Enigma de Elgar, interprétée avec un sens des nuances, des niveaux sonores, une légèreté et une subtilité qui donnaient envie d’en écouter plus.
Les viennois sont grands, Kulman immense, et Bychkov était ce soir une garantie de sagesse et d’équilibre. Le tout a produit un magnifique concert, un vrai moment musical.[wpsr_facebook]






