
En programmant Le Cid de Massenet créé au Palais Garnier et jamais représenté depuis 1919, l’Opéra de Paris est pleinement dans son rôle de conservatoire de l’opéra français, honorant une création ayant eu lieu à Garnier, quand la plupart des opéras de cette période qui ont laissé quelque trace ont été créés à l’Opéra Comique. Il est donc tout aussi légitime de le représenter sur le lieu même de sa création.
On peut discuter du choix du titre, mais cette saison, deux œuvres peu ou pas jouées du répertoire français ont les honneurs de la scène et c’est heureux : le mois prochain en effet, le Roi Arthus de Chausson sera enfin créé à l’Opéra de Paris. Paris découvrira une œuvre à laquelle la capitale n’a eu droit qu’en version de concert grâce à Radio France (tiens…tiens..) en 1981. Il faut donc saluer vigoureusement l’initiative de Nicolas Joel, auteur d’une saison par ailleurs assez pâle.
Mais voilà, en programmant Le Cid, les choix de Nicolas Joel laissent percevoir que cette reprise sera sans doute isolée, puisqu’on est allé chercher à Marseille la production, sans financer de production maison, même si pour l’occasion, distribution et chef sont au-delà de toute éloge.
Car la production de Charles Roubaud est de celles qui méritent de rester au magasin des accessoires. Transposée dans une Espagne des années trente, pré-franquiste, on y brandit force drapeaux, on y voit des soldats et l’armée, des cardinaux et donc l’église, des coteries, des rivalités, un Roi, une infante et un certain nombre de petits héritiers du genre Las Meninas (ou Los Meninos) à la mode 1930, de jolis meubles et un décor ma foi assez efficace pour le genre, signé Emmanuelle Favre.
De mise en scène, pas grand chose, de direction d’acteurs, pas grand chose non plus : les chanteurs sont laissés à eux mêmes avec leurs gestes traditionnels, bras ouverts, main sur le cœur. Bref, de l’archi réchauffé, du tout venant sans véritable intérêt qui ne dérange personne : on préfère hurler contre Warlikowski ou Marthaler, parce que l’intelligence dérange plus que la médiocrité. la scène finale à ce propos est digne de la pire des opérettes.

Par ailleurs en affichant Roberto Alagna dans le rôle, et Michel Plasson en fosse, Joel (et maintenant Lissner) s’assurait du succès (mérité d’ailleurs dans ce(s) cas ce soir). Personne à l’évidence ne venait pour une mise en scène, comme si la mise en scène était la cinquième roue du carrosse, sauf quand elle réveille ceux qui sont assoupis.
Un soin tout particulier en effet a été apporté à la réalisation musicale.
Je n’ai personnellement que peu d’affinité avec cette musique, même si certains moments (ouverture, acte III) me sont apparus plus intéressants. L’espagnolade du IVème acte est même vraiment pénible, vu le sujet.
J’oubliais qu’enfin, après 50 ans, je sais d’où vient la musique que tout jeune à peine sorti de l’enfance, j’écoutais en regardant les pirouettes d’Alain Calmat en patinage artistique à la télévision. Il patinait donc sur le ballet du Cid de Massenet !
Ce soir j’aurai appris quelque chose d’enfoui depuis mes 12-13 ans.
On ne compte pas les adaptations du Cid de Pierre Corneille, la tragi-comédie emblématique du théâtre classique, tout en ellipses et en litotes, un texte merveilleux, une structure dramaturgique hardie, et une fin amère : ce report de décision à un an « Laisse faire le temps, ta vaillance et ton roi » est interprété par un « happy end » possible, mais rien dans le texte de Corneille ni dans les paroles de Chimène ne le laisse espérer. J’ai toujours interprété cette fin comme une fin de non recevoir.
En tous cas souverainement mis en mot et en drame par Corneille. Le livret d’Adolphe Ennery, Louis Gallet et Edouard Blau bannit toute interrogation et toute incertitude : La « mise en scène » de Roubaud, où Chimène se jette dans les bras de Rodrigue venu la rencontrer dans ses appartements renforce les espérances du public.

Seules les interrogations et les lâchetés des soldats qui hésitent à aller combattre sont dans le livret mises en valeur, elles « rallongent la sauce » dans des scènes d’une rare pauvreté à l’acte IV, qui ne servent qu’à préparer l’air de référence de Rodrigue « Ô souverain, ô juge, ô père ! ».
Ce qui était chez Corneille une extraordinaire mise en scène de la dignité humaine est abâtardi dans le livret de l’opéra, où l’on affiche une histoire d’amour assez ordinaire qui illustre plus que Corneille les fameux vers de la parodie de Georges Fourest extraite de La Négresse blonde que je ne résiste pas à vous rappeler in extenso :
Le palais de Gormaz, comte et gobernador,
est en deuil : pour jamais dort couché sous la pierre
l’hidalgo dont le sang a rougi la rapière
de Rodrigue appelé le Cid Campeador.
Le soir tombe. Invoquant les deux saints Paul et Pierre
Chimène, en voiles noirs, s’accoude au mirador
et ses yeux dont les pleurs ont brûlé la paupière
regardent, sans rien voir, mourir le soleil d’or…
Mais un éclair, soudain, fulgure en sa prunelle :
sur la plaza Rodrigue est debout devant elle !
Impassible et hautain, drapé dans sa capa,
le héros meurtrier à pas lents se promène :
« Dieu ! » soupire à part soi la plaintive Chimène,
« qu’il est joli garçon l’assassin de Papa ! »
C’est bien plutôt ces derniers vers qu’illustre Le Cid de Massenet, dont le ton très éloigné de l’original est bien plutôt une resucée sucrée à la mode de l’opéra bourgeois du XIXème, truffée des vers de Corneille, pour faire plaisir au public.
Ces vers se tiennent d’eux-mêmes sans besoin de l’apport d’une quelconque musique, qui en l’espèce, les affadit : « Ô rage, ô désespoir », « à moi comte, deux mots » « Percés jusques au fond du cœur », « pleurez, pleurez mes yeux » sont bien là, mais ces vers ont eu pour effet (salutaire) de me replonger dans la pièce de Corneille, chef d’œuvre du théâtre baroque plutôt que classique, et par erreur inscrite aux programmes de collège alors que sa complexité demanderait une étude plus approfondie au lycée.
On me dira que l’opéra et le théâtre, c’est différent, et je m’inscris en faux : l’opéra, c’est du théâtre, et en l’occurrence, Le Cid de Massenet n’est pas du bon théâtre puisque tout ce qui fait la grandeur du théâtre n’est pas repris, au profit de bons sentiments qui piétinent les grands principes. Le ténor et la soprano seront heureux et auront beaucoup d’enfants, que même l’Infante en vain amoureuse finit par applaudir. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, dans un monde idéal où honneur noblesse et amour sont récompensés.
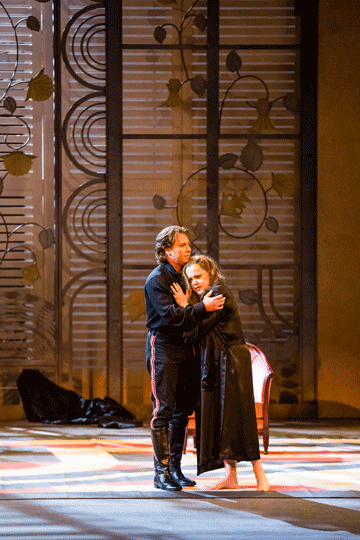
Comme je l’ai déjà souligné, au service de cette guimauve, une distribution et une direction musicale incontestables dans l’ensemble.
Quel plaisir on a à retrouver Michel Plasson qui sait comme personne donner à cette musique un véritable intérêt et une vraie grandeur. L’orchestre est à son meilleur, veloutés des cordes, éclat des cuivres, contrastes, couleurs, extrême lyrisme : il y a des moments de pur bonheur, procurés par l’engagement de l’orchestre et par le rythme imposé par Plasson, tantôt dynamique, tantôt retenu, mais toujours juste, et souvent émouvant. Il est juste dans l’ouverture, exposé un peu touffus pour mon goût de la plupart des thèmes, car il est contrasté, il est d’une ineffable douceur comme d’une fermeté épique, dans le ballet, il a le rythme mais aussi la clarté analytique qui révèle toutes les notes et les recoins de la partition. De plus il ne couvre jamais les chanteurs, et laisse les voix s’épanouir, et son troisième acte, l’acte de l’amour est totalement convaincant. Bref, ce travail est une vraie fête.

Fête du chant français également, car il y a peu à redire des prestations de la distribution dans son quasi ensemble.
Tous les rôles de complément sont bien tenus, aussi bien le Saint Jacques de Francis Dudziak, le Roi de Nicolas Cavalier ou le Gormas de Laurent Alvaro. Notons au passage dans la distribution Luca Lombardo (Don Arias), qui fut un ténor apprécié dans les années 90 (Il enregistra le rôle de Floreski dans la Lodoiska de Cherubini sous la direction de Riccardo Muti).
Paul Gay en Don Diègue est à la fois un personnage de grande allure, avec une belle présence vocale : la voix est bien posée, bien projetée et très intense, par le ton, les accents, la couleur. La prestation dans l’ensemble est plus que convaincante, elle est d’une justesse confondante.
L’infante d’Annick Massis, dont le rôle consiste dès le début à renoncer à l’amour pour Rodrigue (dans un opéra belcantiste, elle aurait sans doute dépensé toute son énergie à nuire à sa rivale, sinon à lui préparer un bouillon de onze heures) au nom de la raison d’Etat et de son statut propre : la voix est comme toujours très bien contrôlée, les aigus sûrs, le tout avec un vrai style. Je ne l’avais pas revue depuis sa princesse Eudoxie dans La Juive de Halévy à Bastille (une production Mortier) : elle est toujours aussi intense, a toujours une magnifique tenue en scène et une voix toujours aussi maîtrisée. C’est vraiment une très belle artiste.
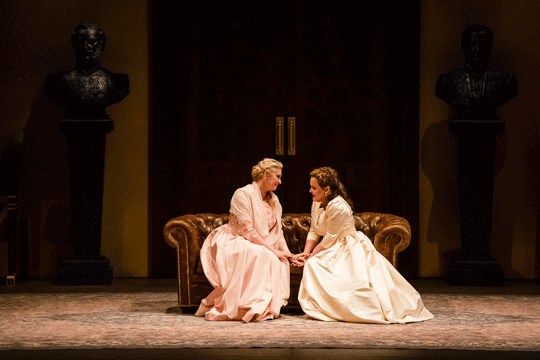
Mes réserves vont plutôt à la Chimène de Sonia Ganassi. J’ai toujours apprécié cette voix et cette artiste, sérieuse, à qui on a peut-être offert des rôles excédant ses possibilités réelles (comme Eboli) : c’est une interprète rossinienne de grande classe, ce n’est pas mezzo dramatique.
Pour Chimène, la voix est un peu à la peine. Chimène est un rôle pour grand mezzo : Grace Bumbry l’a enregistré avec Domingo (sous la direction d’Eve Queler), c’eût put être un rôle pour Urmana, ou même pour Béatrice Uria-Monzon, dont le beau physique et la voix chaleureuse et musicale eût fait merveille. Chez Ganassi, le volume est aux limites, les aigus métalliques et presque criés, elle n’a pas non plus l’allure qui conviendrait au rôle. Son interprétation reste honorable, mais un peu en-deçà du niveau des autres protagonistes.
Roberto Alagna est Rodrigue. Il n’a peut-être pas tout à fait la part héroïque du rôle, dont les aigus les plus marquants lui posent quelque difficulté (courts, un peu vite évacués), mais tout le reste en fait un Rodrigue de rêve. D’abord, la diction, phénoménale, une pure leçon de chant, et de vrai chant français, avec des piani et pianissimi de rêve, tenus sur le souffle, avec des modulations et des variations de couleur, et une voix d’une clarté miraculeuse. Il y a très longtemps que je ne l’avais entendu dans une telle forme et aussi radieux avec dans la voix à la fois une technique impeccable, mais aussi un sens de l’interprétation, un sens de la variété, une jeunesse incroyable du timbre (il a 51 ans).
« Tout Paris pour Rodrigue a les yeux de Chimène » : c’est tellement vrai en l’occurrence et tellement vibrant que cette prestation stupéfie par sa vérité et son authentique engagement. À peu de jours de distance, j’ai eu la chance d’entendre Kaufmann et Alagna, et ai pu vérifier qu’en matière de style, ils n’ont pas beaucoup de rivaux. Mais là où Kaufmann avec son timbre sombre incarne les héros mélancoliques, Alagna est solaire, lumineux, vibrant de jeunesse et vraiment enthousiasmant.
Sur lui et sur Plasson repose le succès incroyable remporté par la production auprès du public parisien. Pour ma part, si je ne suis ni convaincu par la production, ni par la musique de Massenet, mais je dois reconnaître que j’ai rencontré Le Cid ce soir dans les meilleures conditions musicales possible.
Je vais quand même retourner à mon Corneille adoré. [wpsr_facebook]

