 Le printemps est la saison de la renaissance de la nature, des fleurs, et des pluies soudaines. C’est aussi la saison des pluies de programmations des saisons, à qui arrivera le premier, à qui montrera les idées les plus audacieuses etc…
Le printemps est la saison de la renaissance de la nature, des fleurs, et des pluies soudaines. C’est aussi la saison des pluies de programmations des saisons, à qui arrivera le premier, à qui montrera les idées les plus audacieuses etc…
On sait que les opéras se relèvent difficilement de la période troublée par la pandémie, que la guerre en Ukraine pose d’autres problèmes, et provoque aussi quelques absurdités, mais qu’en général l’interruption des dernières saisons a provoqué une crise des publics, que les institutions culturelles cherchent à conjurer, au prix d’une prudence qui provoque des programmations pâlichonnes, comme on le découvre progressivement : jusqu’ici, dans les saisons déjà annoncées, rien de vraiment extraordinaire.
C’est dans ce contexte un peu gris que la saison de l’Opéra de Paris, ère Neef, saison 2 a été présentée au public il y a quelques jours.
Dans cette programmation très sage domine l’impression que c’est moins une programmation artistique que statistique. Il en faut non pour tous les goûts, mais pour toutes les tendances du jour, tout en ne dépensant pas trop, vu la situation financière difficile de la maison. Ainsi aura-t-on droit à une (petite) dose d’opéra français, une dose de femmes aux commandes de la fosse ou de la scène, une dose notable de diversité (et ça c’est particulièrement bienvenu), une bonne dose de répertoire vraiment plat et quelques assaisonnements dont on souligne l’originalité prétendue comme « l’opéra en anglais », après A quiet place (1983, Houston) cette saison, vient Nixon in China (1987, Houston).
Présenter comme notable deux entrées au répertoire de deux œuvres en anglais créées respectivement il y a 39 et 35 ans ne fait que souligner le retard de notre opéra national plutôt que son originalité. Mais bienvenue à la « nouveauté » et merci à qui rattrape les retards…
On a quand même de la difficulté à déterminer une ligne artistique…
Lors de son entrée en fonction, Alexander Neef a annoncé qu’il accorderait une importance nouvelle à l’opéra français. Mais l’histoire de notre première scène, qui fut au XIXe la plus grande scène d’opéra du monde (au moins jusqu’en 1870) est aussi pleine d’œuvres en français de compositeurs étrangers – et notamment italiens, mais pas parce qu’on continue à de rares exceptions de ne pas présenter. S’agit-il d’opéra français ou d’opéra en français… ?
Le lecteur sait bien que c’est là une de mes obsessions rappelées chaque année, mais aussi bien Spontini, Cherubini, Rossini, Meyerbeer, Donizetti, Bellini, Verdi, Wagner (excusez du peu) créèrent à Paris des opéras pour Paris. Est-il si difficile aujourd’hui de proposer Lucie de Lammermoor plutôt que Lucia di Lammermoor, voire un authentique Tannhäuser version de Paris dans sa langue de création, si l’on veut donner à notre première scène une couleur historiquement informée. Certes, on a vu ces dernières années Les Huguenots, Don Carlos, mais Les Vêpres siciliennes en version française remontent à 2003 (sous Hugues Gall), on en attend la reprise ou une nouvelle production…
Quant à l’opéra français… Louise de Charpentier montée par Mortier dans une mise en scène d’André Engel aurait pu faire l’objet d’une reprise, le titre est légendaire et la musique plutôt séduisante, et la mise en scène digne d’au moins une ou plusieurs reprises de répertoire. Mais rien… Pas plus que La Juive de Halévy dans la sage production de Pierre Audi, apparue en 2007 et disparue depuis, ni Mireille de Gounod qui avait ouvert l’ère Joel, ni Le Cid de Massenet (productions certes médiocres) ni Le Roi Arthus de Chausson (meilleur) nés pendant la saison 2014-2015 n’ont été l’objet de reprises. Pourtant on a repris des productions tout aussi médiocres (Don Giovanni, Van Hove) sans sourciller…
Depuis quelques années et avant Neef, oui, l’Opéra s’est constitué un fonds de titres : encore faudrait-il les reprendre. Lorsqu’on veut soi-disant défendre l’opéra français, on cherche d’abord à fouiller les fonds de tiroir de la maison inexplicablement oubliés, à moins que les productions n’aient été détruites, ce qui est toujours possible… Si l’Opéra de Paris est incapable de se constituer un répertoire de titres français, c’est à dire de titre repris pendant plusieurs saisons pour les installer dans le paysage, à quoi sert de claironner tous azimuts opéra français ! opéra français ! La presse généraliste qui ne connaît pas l’histoire de cette maison et crie au miracle à chaque fois qu’un titre français arrive comme si on avait trouvé l’œuf de Christophe Colomb. Encore cette année d’ailleurs on salue un effort qui en réalité n’est pas plus notable que sous l’ère Joël et même sous l’ère Lissner…
Malheureusement, « l’opéra français » est plus un slogan pour identitaires lyriques en effervescence qu’une véritable politique car même si cet intérêt pour l’opéra français est affiché, puisqu’on aura deux opéras français sur sept nouvelles productions (28%, honorable) et une reprise tiroir-caisse, Carmen dans la production de Bieito qui court le monde depuis des lustres pour rien moins que 15 représentations. On reste un peu surpris que le Faust, signé Tobias Kratzer, très bonne production, et presque nouvelle puisque représentée deux fois à huis clos ne bénéficiera en juillet prochain que de 5 représentations pour le public qui la découvrira pour la première fois (alors qu’une dizaine de représentations étaient prévues à la création, toutes annulées pour covid) : on aurait pu penser que cette nouvelle production (c’en est une pour le public) aurait bénéficié d’un autre affichage et de représentations plus nombreuses sur les deux saisons, mais peut-être est-elle trop ébouriffante pour la pusillanimité ambiante ou que les goûts artistiques de la direction actuelle ne vont-ils pas jusqu’à Kratzer, trop intelligent et incisif pour la couleur terne de cette saison/maison un peu plus sensible d’ailleurs aux sirènes d’outre atlantiques que germaniques.
En tout cas, sur 18 productions lyriques le total affiche 3 opéras français, soit un peu moins de 17%. C’est un pourcentage modeste qui ne vaut pas les trompettes de la renommée … Pour mener une vraie politique en la matière, il faudrait en afficher au moins le double, mais ce serait un peu risqué, car mieux vaut une bonne Bohème intergalactique en italien qu’un Roi Arthus de Chausson pour faire le plein – on ne peut pas le dire, alors on claironne sans faire vraiment. Saint Potemkine priez pour nous.
Ainsi au programme dans les nouvelles productions aura-t-on Hamlet de Thomas et Roméo et Juliette de Gounod (inexplicablement absent depuis 1985). Au total rien que de très normal et « L’opéra français (est) à l’honneur » … en somme ni plus ni moins que d’habitude et ni plus ni moins qu’avant. Poudre aux yeux.
Dans l’autre volonté claironnée, celle d’afficher la parité hommes-femmes, on trouve aussi dans les nouvelles productions un opéra sur une femme, fait par des femmes (Salomé), c’est même le premier fait souligné dans le dossier de presse : « Parmi les nouvelles productions de cette saison, trois sont confiées à des metteuses en scène invitées pour la première fois à l’Opéra de Paris : Lydia Steier, Deborah Warner et Valentina Carrasco. ».
Il fallait brandir aussi ce drapeau-là.
Que Valentina Carrasco soit invitée un peu partout depuis quelques années (à Lyon par exemple), et Deborah Warner depuis des années dans tous les grands théâtres internationaux ne fait que confirmer la politique un peu timide en la matière de notre première scène nationale. Ce qui m’insupporte, c’est que ces invitations soient inscrites sous le drapeau « femmes » alors que chacune mène une carrière artistique riche, qui tient à un travail tout de même plus intéressant que « le genre ».
Au cœur du projet, la qualité, pas le genre…
Ainsi Lydia Steyer et Simone Young, Deborah Warner et Joana Mallwitz ainsi que Speranza Scappucci sont-elles invitées pour la saison prochaine, rien que de très normal au vu des carrières que mènent ces artistes dans les théâtres européens dont certaines depuis des années : il serait donc plus conforme de l’inscrire au tableau de la normalité plutôt qu’au tableau d’honneur de la maison.
__________________
Mais au-delà de la programmation que nous allons aborder en détail, je voudrais insister sur un point qui peut sembler accessoire mais qui m’agace par ce qu’il présuppose.
C’est mon moment « humeur ». Qu’il me soit pardonné d’avance.
Depuis des années, à l’Opéra de Paris, selon les directeurs, les titres des œuvres sont affichés en français ou dans la langue originale. Puisque c’est selon les directeurs, cela veut dire que certains considèrent cela comme un enjeu ou un « signe ».
Nous sommes dans une période de « titres en français ». Ainsi verra-t-on « Les Capulet et les Montaigu » ou « Le Trouvère ». Laissez-moi rire.
Nous sommes en France, à une époque (ridiculement) sourcilleuse sur l’identité, qui passe par la langue : on connaît les grands discours sur la défense et illustration de la langue française et c’est un marronnier politique depuis des décennies, qui lui, ne vieillit jamais car notre pauvre langue doit se défendre des vilaines autres langues, et surtout du perfide anglo-américain. Mais il y a des manières de se défendre quelquefois un peu à côté de la plaque et juste franchouillardes.
La francisation des titres d’œuvres présentées en langue originale fait penser à l’italianisation des auteurs, des titres et des œuvres sous Mussolini (sauf l’étrange exemple de Thaïs et non Taide à la Scala en 1942), Riccardo Wagner, Giovanni Sebastiano Bach ou Giulio Massenet. Mais j’ai contrôlé : Le Trouvère est bien de Giuseppe Verdi et non de Joseph Verdi. Qu’est-ce qu’on attend ?
Même si je ne les partage pas, je ne rentrerais pas dans ce débat mouvant et ridicule si cette francisation correspondait à un vrai choix d’affichage « idéologique », au moins pour les titres, parce qu’il devrait alors répondre à une logique, à une rigueur et à des règles.
Ce n’est pas le cas.
Dans la liste des œuvres affichées à l’Opéra de Paris, un signal bizarre est envoyé sur les titres d’opéra : tantôt en français (avec le titre original en sous-titre) La Flûte enchantée pour Die Zauberflöte ou La Force du Destin pour La Forza del Destino (titre évidemment incompréhensible en langue originale à un lecteur français normalement constitué).
On peut comprendre que pour des œuvres écrites originellement dans des langues moins connues (je pense aux œuvres de Janáček par exemple ou certains titres d’opéras russes) on puisse discuter, mais à ce moment-là, si l’œuvre est donnée comme dans 95% des cas aujourd’hui en langue originale, on affiche le titre original avec en sous-titre la traduction en français.
Il y a une règle simple appliquée un peu partout : quand un opéra est donné en langue originale, on donne le titre en langue originale quelle qu’elle soit, avec éventuellement en sous-titre la traduction dans la langue du pays. Si le titre est donné directement dans la langue du pays, c’est que l’œuvre est donnée dans la langue du pays. Exemple : Die Hochzeit des Figaro pour Le nozze di Figaro. On peut le vérifier sur le site de la Volksoper de Vienne qui donne tous ses opéras en langue allemande.
À l’opéra de Paris, la pratique est chaotique et ne répond à aucune règle, voire contreproductive. C’est Lingua è mobile…
Voici tels qu’affichés les titres de la saison, et bravo pour la cohérence :
Tosca (Titre original)
La Cenerentola (Titre original)
La Flûte enchantée (Titre traduit : Die Zauberflöte (original))
Les Capulet et les Montaigu (Titre traduit : I Capuleti e i Montecchi (original))
Salomé (Titre français, un lecteur avisé m’a rappelé opportunément que la version originale s’écrit Salome, mais soyons magnanimes)
Carmen (Titre original)
Les Noces de Figaro (Titre traduit : Le nozze di Figaro (original))
La Force du destin (Titre traduit : La Forza del destino (original))
Tristan et Isolde (Titre modifié on traduit le « et » : Tristan und Isolde (original))
Le Trouvère (Titre traduit : Il Trovatore (original))
Peter Grimes (Titre original)
Lucia di Lammermoor (Titre original)
Hamlet (Titre original)
Nixon in China (Titre original)
La Scala di seta (Titre original)
Ariodante (Titre original)
La Bohème (Titre original)
Roméo et Juliette (Titre original)
Relevons les incohérences :
Pourquoi l’Opéra annonce-t-il La Scala di Seta et pas l’Échelle de soie ?
De même pourquoi Nixon in China et pas Nixon en Chine ?
De même pourquoi Lucia di Lammermoor et pas Lucie de Lammermoor ?
Réponse supposée : parce qu’il existe une version en français de Lucia di Lammermoor, signée Donizetti.
Mais alors, pourquoi afficher Le Trouvère de Verdi pour Il Trovatore, alors que comme pour Lucia di Lammermoor, il existe une version en français Le Trouvère (1857), signée Verdi.
Réponse supposée : parce que ceux qui ont en charge la publication du programme ne le savent pas.
Et pourquoi afficher La Cenerentola (titre original) de Rossini et pas Cendrillon (de Rossini)
Réponse supposée : pour ne pas confondre avec Cendrillon de Massenet à peine entré au répertoire de l’Opéra de Paris ou que La Cenerentola est considéré comme un nom propre, alors que c’est la traduction italienne de Cendrillon. On se perd en conjectures
Autre stupidité :
Tristan et Isolde n’existe pas, le titre français est ou serait Tristan et Yseult. Alors autant écrire Tristan und Isolde parce que le lecteur qui n’est pas si dénué d’imagination comprendra.
Pour les autres titres (j’avoue que Les Capulet et les Montaigu me fait rire, tellement c’est idiot), on serait inspiré de se donner une règle claire et pas un semblant de faux respect de la langue française qu’on utilise un titre oui un titre non selon ce qu’on suppose de la culture du lecteur. D’ailleurs je pourrais aussi protester vigoureusement parce que cette année A quiet place de Bernstein a été affiché en anglais et sans traduction du titre en français en sous-titre : ce serait tellement mieux si on avait écrit « Un endroit tranquille ».
Avec ces règles qui n’en sont pas, c’est le lecteur qu’on prend pour un imbécile et ceux qui ont institué cette règle ridicule feraient mieux de se regarder au miroir.
La seule règle qui vaille : titre en français pour œuvre en français. Un rappel : Don Carlos (ou Le Trouvère ou Les Vêpres siciliennes) est la version en français de l’opéra de Verdi, Don Carlo (Il Trovatore ou I vespri siciliani) la version en italien, simple non ?
Sinon titre dans la langue originale avec traduction en sous-titre.
Je suis désolé d’insister mais cette affaire pitoyable est un signe de nos faiblesses, et de nos peurs, et en l’occurrence des peurs de se faire épingler par les (fausses) vestales de la langue. Elle est aussi ridicule que les nudités de Michel Ange dans le Jugement dernier (ou Giudizio universale) de la Sixtine couvertes lors de la contre-réforme mais qui ne couvraient pas les licences et turpitudes de la vie romaine.
Faudra-t-il répéter que l’opéra est un art international, traversé par de multiples langues et de multiples langages. Et que notre théâtre national est de fait un théâtre international, avec directeur allemand, directeur musical espagnol d’origine vénézuélienne, qui invite pour Ariodante une formation baroque anglaise alors que les formations baroques en France sont nombreuses et de haut niveau, et que l’essentiel des chanteurs invités sont des non-français, comme l’indique la liste des chanteurs pointés dans le dossier de presse :
Roman Burdenko, Saioa Hernández, Christiane Karg, Huw Montague Rendall, Margarita Polonskaya, Iurii Samoilov, Caroline Wettergreen, Dominic Barbieri, Bastian Thomas Kohl Thomas Ricart, Matthäus Schmidlechner, Golda Schultz, Boglárka Brindás, Rachel Frenkel, Teona Todua, Russell Thomas, Ryan Speedo Green, Eric Owens, Okka von der Damerau, Mary Elizabeth Williams, Judit Kutasi, Anna Pirozzi, Rosie Aldridge, Allan Clayton, James Gilchrist, Jacques Imbrailo, Thomas Bettinger, Brenda Rae, Joshua Bloom, Ning Liang, John Matthew Myers, Enrico Casari, Eric Ferring, Gianluca Buratto, Joshua Guerrero, Slávka Zámečníková, Jérôme Boutillier, Huw Montague Rendall, Sergio Villegas Galvain, Marina Viotti.
Dans cette liste communiquée à la presse on relève deux noms français, Thomas Ricart et Jérôme Boutillier et un nom francophone, Marina Viotti.
Mais soyons honnêtes jusqu’au bout, les distributions d’Hamlet (oubliée dans le dossier de presse) comme celle de Carmen et Roméo et Juliette sont largement françaises, mais elles disparaissent inexplicablement dans la liste des chanteurs proposés par le dossier.
Qu’on ne se méprenne pas, je ne fais ici qu’une constatation d’incohérences pour montrer qu’opéra français et titres en français sont des affichages, des arbres qui cachent une forêt habituelle. Je prêche en l’occurrence pour la simplicité et la logique et surtout pour que cessent l’affichage de slogans inutiles.
Enfin, je n’ai jamais défendu une identité nationale pour les chanteurs, pourvu que les chanteurs affichés soient bons, ni l’opéra français pour l’opéra français. J’estime seulement (au-delà de mes propres goûts) que la plus grande maison d’opéra en France doit afficher quelques titres qu’on ne voit pas ailleurs : il n’est pas normal que ce soit Berlin qui ait entamé un cycle Meyerbeer alors que tous les Meyerbeer berlinois ont triomphé d’abord à Paris au XIXe. Il n’est pas normal que les grands Spontini (La Vestale…) les grands Rossini français, que la Muette de Portici d’Auber ne soient pas au répertoire, que Les Dialogues des Carmélites ait disparu des programmes depuis 2005, et Médée de Cherubini depuis 1986 : qu’on aime ou non ces œuvres, c’est la mission de cette maison de les produire, à laquelle elle continue de ne pas répondre en dépit de ce qu’elle claironne. Alors, mettre les titres des opéras (étrangers) en français, dans ce contexte, c’est encore plus risible et certes véniel face à la tâche.
C’était mon moment « humeur ».
________________________________
Reste la programmation.
Pour une fois, nous allons commencer par une courte considération sur le ballet.
Le Ballet
Nihil novi sub sole.
Au lieu d’afficher une ligne directrice, une cohérence, Aurélie Dupont propose une saison non pas statistique comme à l’opéra, mais erratique, bien que soit affichée une rhétorique qui vante l’équilibre d’une saison plus que jamais déséquilibrée.
Nous aurons droit au Noureev de service pour les fêtes, figure prétendument tutélaire qui n’est là que pour remplir les caisses ; ce sera le seul et unique ballet académique offert cette saison par cette Compagnie de 154 danseurs (hors multiples surnuméraires et effectifs d’appoint), ce qui est injustifiable pour une compagnie de ce « niveau » (?), d’autant que le reste du programme est un patchwork fait de bric et de broc sans thématique, sans colonne vertébrale, sans idée force ni ligne.
Ainsi verra-t-on deux ballets de MacMillan, dont l’entrée au répertoire grotesque de Mayerling, deux ballets de Balanchine qui feront une soirée d’un peu plus d’une heure de danse, Kontakhof de Pina Bausch (là encore, à quoi bon ?). Enfin Bobbi Jene Smith, ancienne de la Batsheva Company récemment invitée à l’Opéra, Alan Lucien Oyen et Mc Gregor complèteront le tableau. On passe sur l’invitation chic et choc de Peeping Tom.
En outre, hommage (justifié) sera rendu par le Ballet à Patrick Dupond ; enfin, Elisabeth Platel, directrice de l’Ecole de danse, a choisi de rendre hommage à Claude Bessy qui l’a précédée dans ce mandat.
Alors face à cette offre explosée mais vraiment pas explosive, et à cet encéphalogramme plat en terme d’idées, il y a d’autres bonnes nouvelles toutefois dans l’univers de la danse : Manuel Legris est en train de revivifier le Ballet de la Scala, Olga Smirnova vient d’être recrutée au sein de l’excellent Dutch National Ballet, le Bayerisches Staatsballett va connaître un nouveau directeur qui s’appelle Laurent Hilaire, le Royal Ballet à Londres continuera de régner sur la danse mondiale. Alors, Frecciarossa, Thalys, ICE ou Eurostar seront les meilleurs amis des balletomanes pour les saisons à venir !
L’Opéra
Nous l’avons déjà écrit, il s’agit pour l’Opéra de Paris et d’autres maisons de cette importance de reconquérir un public un peu évaporé partout et devenu vaporeux en France sous les coups de boutoirs successifs des grèves et du covid.
La recette réside-t-elle dans des reprises de grands standards de type « tiroir-caisse » ? Pas si sûr si c’est le seul remède à la mélancolie ambiante. Le défi parisien est d’autant plus difficile à tenir qu’il ne s’agit pas de remplir 2000 places, comme dans la plupart des maisons européennes comparables, ou 3800 comme au MET, mais 4700, excusez du peu, en deux théâtres aux caractéristiques techniques différentes. Un défi d’ailleurs – soyons justes- que la programmation la plus excitante et les idées les plus stimulantes ne seraient pas non plus assurées de relever, mais qu’une programmation grise est assurée en revanche de ne pas relever.
À cela s’ajoutent les trois autres salles parisiennes qui affichent de l’opéra, et qui quelquefois concurrencent notre Opéra national sur son terrain au lieu de se différencier sur le répertoire ou la couleur des productions : à quoi sert au Théâtre des Champs-Élysées d’afficher une Bohème en version scénique en juin 2023, alors que les opéras nationaux de tous les pays en ont une à leur répertoire et que l’Opéra de Paris présente La Bohème le mois précédent ?
C’est simplement affligeant.
En lisant et relisant la programmation lyrique, j’y trouve peu de productions stimulantes, soit dans l’offre de nouvelles productions, soit dans les reprises de répertoire qui quelquefois pourraient offrir des motifs de curiosité. Le paysage est relativement monotone.
Certes, beaucoup de chefs et cheffes font leur apparition en fosse parisienne pour la première fois, mais beaucoup sont aussi des chefs « de répertoire » bien connus ailleurs, parmi lesquels on ne repère que très peu d’espoirs réels de la baguette, et quelques chefs consommés, sinon consumés.
Quant à Gustavo Dudamel, il dirige deux reprises, Tosca et Tristan und Isolde, et se frottera donc à un Wagner, et là c’est intéressant, et la nouvelle production de Nixon in China. Dudamel a explosé très tôt dans la carrière, a très vite récupéré un orchestre de prestige comme le Los Angeles Philharmonic, mais a acquis tout aussi vite une réputation de showman, avec la com qui allait avec.
Du coup, il est apparu à beaucoup comme un chef certes doué, mais superficiel, à effets, un phénomène médiatique. Mais tout cela n’a qu’un temps, et pour durer au sommet, il faut plus. Cette nomination parisienne lui donne l’occasion de se cimenter avec le répertoire d’opéra qui reste son maillon faible, mais aussi de revenir à une lecture plus approfondie du grand répertoire symphonique : sa symphonie « Résurrection » de Mahler avec les Berliner récemment était par exemple une très grande réussite.
Il est intéressant que ce moment clef de sa carrière soit vécu à Paris.
En ce qui concerne les mises en scène, on note le retour tellement attendu, tellement surprenant, tellement original de Robert Carsen, dans son ère post-industrielle, pour Ariodante de Haendel, en coproduction avec le MET qui ne sait plus à quel metteur en scène se vouer pour sortir de son image fossilisée, de Kzrysztof Warlikowski dans Hamlet au nom de son rapport à Shakespeare, mais encore faut-il savoir en quoi Ambroise Thomas, Jules Barbier et Michel Carré sont shakespeariens.
On note aussi l’arrivée de Deborah Warner dans une production de Peter Grimes qui vient d’être proposée avec succès à Covent Garden après l’avoir été à Madrid l’an dernier, avec à peu près la même distribution (Bryn Terfel est cependant remplacé par Simon Keenlyside) qui ira aussi à Rome.
Valentina Carrasco venue de La Fura dels Baus (aujourd’hui bien fatiguée) va mettre en scène Nixon in China, succédant à Peter Sellars (Houston, 1987) qui a fait le tour du monde, et Thomas Jolly, après son échec dans Eliogabalo, va se frotter à Gounod, et à Roméo et Juliette, lui aussi officiellement au nom de son goût pour Shakespeare, officieusement de son goût pour le spectaculaire tape à l’œil qui attire du public. Personnellement, j’ai encore en mémoire la belle production de Georges Lavaudant à Garnier avec dans l’oreille Neil Shicoff et Alfredo Kraus, autres temps… Depuis, l’œuvre a disparu de l’affiche de toute manière.
Nouvelles productions
Octobre-Novembre 2022
Richard Strauss, Salome
Du 12 oct au 5 nov, (9 repr. dont APJeunes)
Dir : Simone Young, MeS : Lydia Steier
Avec Elza van der Heever, Karita Mattila, Zoran Todorovitch, Tansel Akseybek, Iain, Paterson.
Distribution intéressante, Elza van der Heever s’impose de plus en plus comme un soprano qui compte, la mythique Karita Mattila sera un must en Herodias et Iain Paterson est l’un des meilleurs barytons-basse actuels. Simone Young est la cheffe solide que l’on connaît depuis longtemps dans un répertoire qui lui est familier et donc aucune crainte de ce côté-là… A signaler cependant qu’elle dirige depuis des dizaines d’années partout en Europe, mais qu’elle n’a dirigé à Paris qu’en 1993 pour une production des Contes d’Hoffmann… Il fallait quand même rattraper cela.
Salomé n’a pas beaucoup intéressé l’opéra de Paris, bien moins qu’Elektra en tous cas. Avec une histoire de deux productions entrecroisées, l’une d’André Engel créée en 1993, l’autre de Lev Dodin créée en 2003 par Hugues Gall et reprise deux fois par Gérard Mortier (dernière en 2009). C’était suffisant pour que Nicolas Joël reprenne la saison (2011) suivante la vieille production Engel. Depuis, plus rien.
Salome n’a pas été donné à l’Opéra de Paris depuis 2011, et le TCE devait donner celle géniale signée Warlikowski venue de Munich, les répétitions étaient en cours et avançaient, mais le covid en a décidé autrement, et Michel Franck s’est résolu à ne pas la reprendre (la peur sans doute d’une mise en scène trop forte pour le tendre TCE).
Lydia Steier n’est pas un choix surprenant, et ce choix a du sens pour Salomé : elle est l’une des metteuses en scène qui montent, en créant souvent d’ailleurs la polémique là où elle passe (on se souvient de sa Zauberflöte à Salzbourg remise sur le métier et jamais vraiment accomplie), mais au moins on y trouvera de l’idée, et sans doute les contestations du public. À voir de toute manière.
Janvier-Février 2023
Benjamin Britten, Peter Grimes
Du 26 janvier au 24 février (10 repr. dont APJeunes)
Avec Allan Clayton, Simon Keenlyside, Maria Bengtsson, Catherine Wyn-Rogers etc…
La saison actuelle a connu trois productions de Peter Grimes dont on a parlé, celle de Vienne, ancienne, mais avec prise de rôle notable de Jonas Kaufmann, celle de Munich, nouvelle production signée Stefan Herheim et celle de Londres, mise en scène par Deborah Warner, qui a commencé son tour européen à Madrid puis à Londres, l’an prochain à Paris donc et enfin Rome.
Deborah Warner est une metteuse en scène intelligente et habile sans être révolutionnaire, mais elle garantit un spectacle au minimum digne.
Après Ivor Bolton à Madrid, Mark Elder à Londres, c’est Joana Mallwitz, GMD du Staatstheater de Nuremberg qui sera dans la fosse parisienne, choix surprenant dans cette œuvre, mais la qualité et le répertoire tous azimuts de cette jeune cheffe qui s’est cimentée à Heidelberg, puis à Erfurt avant d’arriver à Nuremberg et bientôt à Berlin devraient emporter les suffrages.
Distribution très correcte, avec Allan Clayton qui a débuté à Madrid dans le rôle-titre et qui est un ténor très engagé et expressif, c’est lui qui fut un Jim Mahoney inoubliable à la Komische Oper dans la production de Mahagonny l’automne dernier.
Mars-Avril 2023
Ambroise Thomas, Hamlet
Du 11 mars au 9 avril 2023 (11 repr. dont APJeunes)
Dir : Thomas Hengelbrock, MeS : Krzysztof Warlikowski
Avec Ludovic Tézier, Eve-Maud Hubeaux, Lisette Oropesa/Brenda Rae.
Les petits plats dans les grands pour le retour d’Hamlet de Thomas à l’Opéra. Une distribution sans failles avec des chanteurs référentiels aujourd’hui, un des plus grands metteurs en scène qui a déjà travaillé au théâtre sur l’original shakespearien, et un chef très solide avec qui Warlikowski a déjà fait belle équipe pour Iphigénie en Tauride. Donc a priori rien à redire.
Pour ma part, je remarque qu’on a revu Hamlet cette saison à l’Opéra-comique dans la production de Cyril Teste, qu’on l’avait déjà vue en 2018. On repasse le plat dans une salle de bal plus grande, et dans sa maison d’origine, soit, mais y avait-il urgence à ce qu’en cinq ans à Paris on vît trois fois Hamlet ? N’y avait-il pas plus d’urgence à remettre sur le métier d’autres titres français, comme Don Quichotte de Massenet pas vu depuis 2002 et qui aurait prolongé l’entrée au répertoire cette saison de Cendrillon. Il faudrait aussi songer à un nouveau Pelléas et Mélisande, la production Wilson suant l’épuisement par tous les pores.
Enfin l’Hamlet de Thomas est aussi Shakespearien que le Faust de Gounod n’est Goethéen, à qui la production mythique de Lavelli avait fait un sort. Faisons certes confiance à Warlikowski qui a le talent chevillé au corps pour reshakespeariser une œuvre qui peut-être tient la rampe pour d’autres motifs, mais comme dit l’autre, la route est droite et la pente raide.
Quoi qu’il en soit, et malgré mes doutes, cela reste le projet sans doute le plus intéressant de la saison.
John Adams
Nixon in China
Du 26 mars au 16 avril 2023. (8 repr. dont APJeunes)
Dir : Gustavo Dudamel, MeS : Valentina Carrasco
Avec Thomas Hampson, Renée Fleming, Kathleen Kim etc…
Distribution de stars pour l’entrée au répertoire du premier opéra de John Adams, sous la direction du directeur musical de la maison, chef-star lui aussi. Musicalement, c’est donc une succession de garanties.
Scéniquement, l’Opéra ne reprend pas la mise en scène référentielle de Peter Sellars, et choisit de donner à l’œuvre une autre image scénique (ce qui est une bonne idée) en confiant la production à Valentina Carrasco, venue de la Fura dels Baus. Les travaux récents de la Fura dels Baus ne m’ont pas vraiment convaincu, pas plus de ceux de Valentina Carrasco dont les Vêpres siciliennes à Rome avaient été une déception. J’ai donc mes doutes, d’autant que l’école de la Fura dels Baus souffre de vieillissement et de défaut de renouvellement. Wait and see donc.
Gioachino Rossini
La Scala di Seta
Du 1er au 15 avril 2023 (6 repr.)
Dir : Jean-François Verdier MeS : Pascal Neyron
Avec les artistes en résidence à l’Académie.
Quatrième des nouvelles productions de la saison concentrées sur mars-avril au théâtre de l’Athénée Louis Jouvet .
On pourra discuter à l’infini des productions de studio ou d’académies, celles de la Scala ou de Munich ont lieu dans de vrais théâtres (à la Scala dans la salle du Piermarini, c’est à dire la mythique Scala), et permettent d’affronter les conditions exactes de la représentation. On a vu récemment à Munich une « vraie » production de L’Infedeltà delusa de Haydn au Cuvilliés Theater. Ici, c’est voie moyenne de l’Athénée Louis Jouvet qui a été choisie pour un spectacle “petit format” à la capacité limitée en termes scéniques, mais c’est un vrai théâtre qui depuis des années produit de la bonne musique et donc c’est positif. Pascal Neyron est metteur en scène attaché à l’Académie, c’est donc un spectacle « entre soi » et cette production sonne au total comme a minima ; c’est dommage. On aura quand même plaisir à entendre Jean-François Verdier diriger un orchestre dans lequel il a longtemps officié au poste de clarinette solo.
Avril-Mai
Georg Friedrich Haendel
Ariodante
Du 20 avril au 20 mai 2023 (12 repr. dont APJeunes).
Dir: Harry Bicket, MeS Robert Carsen
Avec Luca Pisaroni, Olga Kutchynska, Emily d’Angelo, Christophe Dumaux , Eric Ferring
Hormis Luca Pisaroni, la distribution est presque entièrement composée de jeunes solistes qui viennent de surgir avec grand succès sur le marché comme Olga Kutchynska et Emily d’Angelo. C’est bien.
C’est Harry Bicket et son orchestre The English Concert qui sont invités dans la fosse, sans doute parce que le saxon Haendel est aussi un peu anglais et qu’on considère qu’une formation britannique sera plus à même de trouver la couleur juste à une œuvre créée en 1735 à Londres. Il reste que la France regorge de formations baroques de qualité et qu’il peut paraître étrange de faire appel à un ensemble étranger (quand on pense aussi aux frais de résidence…). Mais les voix du Seigneur sont impénétrables.
Quant à la mise en scène, elle est confiée à Robert Carsen, dont ce sera la treizième production à l’opéra de Paris. Il signe d’ailleurs trois productions en 2022-2023, et, dans Haendel après son Alcina très aimée à Paris, et reprise cette saison en novembre et décembre derniers, il s’attaque à Ariodante qui date aussi de 1735. Autant dire que l’Opéra de Paris joue sur du velours : Carsen, c’est toujours propre, c’est la « modernité » sans peur, le prêt à porter de la mise en scène (d’où la coproduction avec le MET, expert en la matière), sans exclure quelques réussites. Souhaitons-le pour cette nouvelle production.
Juin-juillet
Charles Gounod
Roméo et Juliette
Du 17 juin au 15 juillet 2023 (16 repr. dont APJeunes)
Dir: Carlo Rizzi, MeS: Thomas Jolly
Avec Elsa Dreisig/Pretty Yende, Benjamin Bernheim/Francesco Demuro, Lea Desandre/Marina Viotti, Huw Montague Rendall/Florian Sempey.
Grosse machine pour ce retour après 37 ans d’absence du second opéra le plus célèbre de Gounod. Avec une distribution A plus française, B plus étrangère mais avec Florian Sempey, Roméo est un rôle idéal pour Benjamin Bernheim, et pour Francesco Demuro s’il ne se met pas comme dans le Duc de Mantoue à Vienne à s’égosiller dans des aigus (mal) tenus inutilement, quant à Juliette, le public choisira entre les deux délicieuses Elsa Dreisig ou Pretty Yende.
La direction musicale est confiée à Carlo Rizzi, chef très solide, pas du « premier cercle » des chefs de référence, mais plutôt dans le top des chefs dits « de répertoire ».
C’est Thomas Jolly le « fin connaisseur de Shakespeare » (sic) qui signe la mise en scène, ce sera du spectacle sans aucun doute, et son nom devrait attirer le public que les 15 représentations prévues prévoient.
Ces nouvelles productions sont dans leur ensemble très bien distribuées. Le choix de certains chefs peut être discuté, mais il y a longtemps qu’à l’Opéra de Paris, -à part le directeur musical, on ne voit plus beaucoup de grands chefs consacrés (Nagano pour A Quiet Place est une exception). On sait aussi qu’à part dans certaines maisons, les chefs consacrés (disons le top ten) ne dirigent plus hors de la fosse dont ils sont titulaires ou dans les festivals. C’est le résultat du marketing du classique qui conduit lentement à la ruine. On rêve quand on pense qu’un Karl Böhm a dirigé à L’Opéra de Paris trois productions Elektra, Zauberflöte et Entführung aus dem Serail, aussi bien qu’Abbado, Boulez, Maazel, Solti, Ozawa, Prêtre, Plasson, von Dohnanyi, Gergiev (peu et mal), Bychkov, Salonen ou d’autres. Un Noseda n’a jamais dirigé à Paris, pas plus qu’un Gatti, ni même Harding (il a failli) et on attendrait avec une certaine impatience actuellement un François-Xavier Roth.
Quant aux mises en scène il y en a pour tous les goûts et bien malin serait celui qui saurait déterminer là une ligne, sinon le parfum d’une certaine timidité… On ne sent pas de stratégie artistique, mais seulement de la tactique de gestion serrée un peu fade. Nous l’avons souligné, les temps sont rudes et il faut sans doute faire des choix drastiques, mais où sont les idées qui compenseraient?
________
Les reprises
La politique en matière de reprises est souvent guidée par la nécessité économique : il faut remplir la salle, et séduire un public souvent habituellement plus attiré par la nouveauté.
Comme le MET ou Covent Garden, l’Opéra de Paris qui produit en temps ordinaires une vingtaine de spectacles à l’année doit afficher grosso modo un tiers de nouvelles productions et deux tiers de reprises, d’où la nécessité d’un répertoire large et de nombreuses productions entreposées dans les magasins et en état d’être remontées.
En Italie, le nombre de productions annuelles des saisons des grands théâtres excède peu la dizaine, et donc la majorité sont des nouvelles productions et les reprises sont en rapport minoritaire.
Or les nouveautés attirent, et pour que les reprises attirent, il faut un vrai motif, un très bon chef, ou Netrebko (enfin, pas trop en ce moment), Kaufmann, c’est à dire des grands noms. Quand dans les reprises il n’y ni chefs ni noms, c’est un peu difficile de remplir (n’oublions pas les 4700 spectateurs nécessaires au quotidien à Paris…).
Les grands standards, Carmen, Tosca, Bohème, Pagliacci, Don Giovanni et quelques autres ne peuvent remplir une programmation, il faut alterner des titres où le chœur et occupé et d’autres non, des titres plus rares et des standards, tenir compte des distributions pour attirer le chaland. En bref, les contraintes sont nombreuses, encore plus dans les temps difficiles. Et l’Opéra en traverse actuellement.
Septembre, octobre, novembre 2022
Giacomo Puccini, Tosca
Du 3 sept. au 26 nov. (17 repr.) Dir : Gustavo Dudamel-Paolo Bortolameolli/MeS : Pierre Audi
Avec Saioa Hernandez/Elena Stikhina, Joseph Calleja/Brian Jagde, Bryn Terfel/Gerald Finley/Roman Burdenko etc…
Voilà l’exemple typique de la reprise tiroir-caisse, lancée par le directeur musical de la maison Gustavo Dudamel pour six représentations en septembre (soit un petit tiers), et reprise ensuite par un des espoirs de la direction d’opéra en Italie Paolo Bortolameolli.
Laissez-vous guider par les Scarpia : entre Bryn Terfel et Gerald Finley vous avez le choix de l’excellence dans deux styles de personnages très différents le salaud brutal et le salaud persiflant. Du côté des sopranos, Saioa Hernandez est une belle Tosca, et Stikhina a de la personnalité, mais ni l’une ni l’autre ne sont des Tosca de légende. Peu importe les ténors… De la grande série. Si vous avez envie d’une Tosca un soir d’ennui, pourquoi pas mais surtout pas pour la mise en scène de Pierre Audi, tranquillement sans intérêt et donc faite pour durer.
Gioachino Rossini
La Cenerentola
Du 10 sept au 9 oct (10 repr.), Dir : Diego Matheuz/MeS : Guillaume Gallienne
Avec Dmitry Korchak, Carlo Lepore, Vito Priante, Luca Pisaroni, Gaelle Arquez
Pourquoi le titre La Cenerentola n’est-il pas traduit en « Cendrillon » ? mystère de l’édition. Pourquoi La Cenerentola à l’opéra de Paris n’a jamais trouvé une production maison qui soit satisfaisante. Les deux meilleures furent Ponnelle (importée par Nicolas Joel, une de ses bonnes idées) et Savary (importée de Genève par Hugues Gall), Jacques Rosner dans les années Leibermann valait par la distribution étincelante et l’actuelle de Guillaume Gallienne est une erreur de focale.
Le chef Diego Matheuz, un ancien du sistema vénézuelien fut assistant d’Abbado, directeur musical de La Fenice de Venise, mais n’est pas une forte personnalité de la direction musicale, surtout dans ce répertoire où dans les chefs italiens de la génération actuelle il y au moins cinq noms qui réussiraient mieux.
Une distribution de bon aloi, avec de bons chanteurs, Lepore, Kortchak, Pisaroni, Priante. Mais la production met en valeur Gaelle Arquez, dans un répertoire qui est loin d’être facile (Crebassa y arrive sans tout à fait convaincre). Le problème avec Rossini, c’est le même qu’avec Feydeau : cela ne supporte à aucun niveau la médiocrité.
Allez-y si vraiment un soir vous êtes en manque….
W.A. Mozart
Die Zauberflöte
(Du 17 sept. au 19 nov.)(15 repr.)(Dir : Antonello Manacorda-Simone de Felice / MeS : Robert Carsen)
Avec :
-Distr.A : René Pape, Martin Gantner, Mauro Peter, Pretty Yende, Caroline Wettergreen…
-Distr.B : Brindley Sherratt, Michael Kraus, Pavel Petrov, Christiane Karg, NN
Là encore on sent la production tiroir-caisse, qui deviendra un inusable, une production Carsen (pas mauvaise d’ailleurs) qui fait les beaux jours de l’Opéra de Paris depuis sa venue en direct de Baden-Baden en 2014 et dont c’est la sixième reprise (à peu près une fois par an…).Deux distributions la plus intéressante est la A avec trois voix masculines vraiment bonnes dont Pape, mythique dans ce rôle et Pretty Yende très aimée à Paris, mais la B affiche la Pamina céleste de Christiane Karg…
Dans la fosse, Antonello Manacorda en alternance pour 3 représentations avec Simone De Felice. Soit, ni l’un ni l’autre n’appartiennent à mon paysage.
Vincenzo Bellini
I Capuleti e I Montecchi
Du 21 sept. au 14 oct (9 repr.) (Dir : Speranza Scappucci/MeS : Robert Carsen)
Avec Julie Fuchs, Marianne Crebassa, Jean Teitgen, Francesco Demuro, Krzysztof Bączyk
Voilà encore une production Carsen qui remonte à 1995 et que même Mortier a reprise en 2008 (avec Netrebko/Ciofi et Di Donato…).
Français sur scène et femme en fosse, c’est un cast « bien sous tous rapports ». Speranza Scappucci qui dirige beaucoup désormais arrive à Paris et c’est heureux. Et Julie Fuchs et Marianne Crebassa font partie des voix qui comptent en France aujourd’hui. Si Demuro sait être sage, ce peut être intéressant aussi, c’est l’italien de l’étape.
L’œuvre est magnifique, et elle exige la perfection à tous niveaux… Wait and see.
Novembre-décembre 2022, janvier-février 2023
Georges Bizet, Carmen
Du 15 nov. Au 25 fév. 2022 (15 repr.) (Dir : Fabien Gabel/MeS: Calixto Bieito)
Avec Michael Spyres/Joseph Calleja, Lucas Meachem/Etienne Dupuis, Gaelle Arquez/Clémentine Margaine, Golda Schultz/Adriana Gonzales/Nicole Car
Quand on veut faire un peu de sous, il y a toujours une Carmen au fond du placard. Hugues Gall avait trouvé Alfredo Arias, qui a fait son temps mais qui aurait pu continuer. Joel avait trouvé Yves Beaunesne, médiocrissime, et Lissner pas fou avait été cherché la production Bieito, qui avait en 2017 près de vingt ans, qui avait le tour de l’Europe en associant un nom sulfureux (Bieito), et une production intelligente et plutôt sage, l’alchimie parfaite pour trouver la pierre philosophale.
Alors elle reste au répertoire : on ne change pas une équipe gagnante, et même pour 15 représentations. Cette saison en effet, il y avait de la place pour une vieille Carmen, mais pas pour un Faust encore jeune (j’y reviens, je ne digère pas !). Méthode habituelle, des noms aux premières représentations (A) qui vont attirer, comme Michael Spyres et Gaelle Arquez, qu’on ne va pas manquer de valoriser, en espérant que ceux qui voudront les entendre quand il sera trop tard se rabattront sur une distribution B où dominera l’excellente Clémentine Margaine, chanteuse française moins médiatisée (hélas) que Gaelle Arquez.
On notera l’arrivée dans la fosse de Fabien Gabel, pour la première fois à l’Opéra, et c’est une bonne nouvelle. Pour le reste, à votre bon cœur.
Novembre-Décembre
W.A. Mozart
Le nozze di Figaro
(du 23 nov. Au 28 dec. ) (12 repr.) (Dir : Louis Langrée/MeS : Netia Jones)
Avec Gerald Finley, Miah Persson, Luca Pisaroni, Rachel Fenkel, Jeanine de Bique etc…
Excellente distribution dominée par Finley, conte extraordinaire, et Pisaroni, Figaro inusable, toujours intelligent, notons la Susanna de Jeanine de Bique, qui devrait être émoustillante et juste à souhait.
Direction de Louis Langrée, qui fait le voyage de la rue Favart au tout proche Palais Garnier et mise en scène encore neuve de Netia Jones, qui a partagé entre faveur et agacement dans son utilisation des questions sociales de l’époque (la condition des femmes) et des modes théâtrales plus poussiéreuses (le théâtre dans le théâtre) en sauce moderne.
Les nouvelles productions des grands Mozart actuelles ou qui s’annoncent (Vienne, Berlin, Munich) nous diront s’il y a mieux ailleurs…
Décembre 2022
Giuseppe Verdi
La forza del destino
(Du 12 au 30 déc.)(7 repr.) Dir : Jader Bignamini/MeS : Jean-Claude Auvray
Avec Anna Netrebko/Anna Pirozzi, Ludovic Tézier, Russell Thomas.
Avec le retour apparemment prévu (pour quatre représentations) d’Anna Netrebko, on doit s’attendre sur les réseaux sociaux à des polémiques des héros en chambre pro/contre l’invitation d’artistes russes de renom. Mais comme on le sait Netrebko est aussi autrichienne… Au moins elle chantera Pace Pace avec des accents vécus et vibrants. Pirozzi est la plus grande voix italienne du moment, Tézier est Tézier, c’est à dire ce qu’il y a de mieux et Russell Thomas un excellent ténor sans compter le grand Nicola Alaimo en Melitone. La mise en scène d’Auvray est à oublier, mais quelle mise en scène de La Forza del Destino ne l’est-elle pas (sauf Castorf à Berlin, au moins différente) ?
Quant à Jader Bignamini, c’est le chef bien aimé de Netrebko, alors ce que femme veut, Neef le veut.
Janvier-Février 2023
Richard Wagner
Tristan und Isolde (7 repr.)
(Du 17 janv. au 4 fév. 2023) (Dir : Gustavo Dudamel/ MeS : Peter Sellars/Bill Viola)
Avec Mary Elisabeth Williams, Bryn Hughes Jones, Eric Owens, Okka von der Damerau, Ryan Speedo Green etc…
Depuis la géniale idée de Gérard Mortier, les directeurs de l’Opéra sont tranquilles pour un temps assez long à Paris avec cette production-performance qui est référence théâtrale et plastique qu’on vient voir comme une grande œuvre muséale.
Intérêt de cette reprise, tous des petits nouveaux ou presque, presque tous les chanteurs venus de l’espace anglo-saxon (qui semble une tendance marquée de la nouvelle direction, chacun a ses tics).
Une nouvelle Isolde, Mary Elisabeth Williams, chanteuse américaine qu’on a entendue dans Abigaille (Lille, Dijon) où elle a triomphé. C’est toujours intéressant (et riche d’avenir) d’entendre une nouvelle Isolde.
Un nouveau Tristan, le britannique Gwyn Hughes Jones, qui fut Walther avec succès à Covent Garden en 2017, qui doit être son premier Tristan. Son répertoire affiche des rôles plus lyriques que Tristan mais wait and see.
On est heureux d’entendre Eric Owens en Roi Marke, lui qui fut un inoubliable Alberich du Ring de Lesage au MET et de réentendre la superbe Brangäne de Okka von der Damerau, seule chanteuse idiomatique de la distribution.
On ne rate pas un Tristan bien sûr, d’autant que celui-ci sera le premier Wagner de Gustavo Dudamel et ce sera donc en fosse aussi un moment intéressant
Donc à ne pas manquer, d’autant que c’est le seul Wagner de la saison.
Giuseppe Verdi
Il Trovatore
(du 21 janv. au 7 fév.) (9 repr.) Dir : Carlo Rizzi/MeS : Alex Ollé/Valentina Carrasco
Avec Anna Pirozzi, Judit Kutasi, Yusif Eyvazov, Quinn Kelsey, Roberto Tagliavini
Bon d’emblée on sait que ce ne sera pas Il trovatore del secolo, ni même celui de l’année, de bons chanteurs sans être toujours les mieux choisis. Pourquoi aller chercher Kelsey qui est une fausse référence et que j’ai entendu à Zurich dans le pire Conte di Luna de ma longue carrière de spectateur ? Eyvasov a plus de qualités, mais est-ce un Manrico solaire comme on le souhaite ? Kutasi est une bonne mezzo, mais on en a une formidable, l’une des meilleures actuellement, française qui plus est, qui est Clementine Margaine. Et Pirozzi peut être sans doute une bonne Leonora.
Carlo Rizzi est comme on l’a dit plus haut, un bon professionnel.
Si vous avez une envie subite de Verdi, peut-être. Mais sans grand enthousiasme.
Février-Mars
Gaetano Donizetti
Lucia di Lammermoor
(Du 18 fév. au 10 mars) (8 repr.) (Dir : Aziz Shokhakimov/Mes: Andrei Serban)
Avec Brenda Rae, Quinn Kelsey, Javier Camarena, Adam Palka etc…
Qui aurait cru, aux sifflets reçus à la première, en 1995 (June Anderson, Roberto Alagna) que cette production d’Andrei Serban durerait presque trente ans…28 ans exactement ?
C’est pourtant le cas, parce qu’elle posait déjà la question de la jeune fille perdue dans un monde d’hommes. Cette reprise vaut par l’arrivée d’un jeune chef à la réputation plutôt positive, Aziz Shokhakimov. Distribution plutôt classique avec le remarquable Javier Camarena, authentique styliste, et Brenda Rae, un des grands sopranos colorature du moment. On remarque l’excellent Adam Palka dans Bidebent et Quinn Kelsey, à oublier.
Si vous n’avez pas encore vu la production, il faut y aller.
Mai-juin 2023
Giacomo Puccini
La Bohème
(Du 2 mai au 4 juin)(12 repr.)(Dir : Michele Mariotti ; MeS : Claus Guth)
Avec Ailyn Pérez, Joshua Guerrero, Slávka Zámečníková, Gianluca Buratto, Andrzej Filónczyk.
Et si vous n’en avez pas assez de douze représentations, le TCE présente en juin une Bohème, dans une de ces aberrations de programmation…
Celle de l’Opéra de Paris est connue pour son côté cosmonaute et fait encore frémir certains qui iront reposer leur cœur au TCE comme on va au sanatorium. Pourtant, elle a des atouts : si Ailyn Pérez est bien connue (jolie voix, mais pas plus pour moi) le jeune ténor venu d’outre atlantique Joshua Guerrero par exemple devrait être écouté avec attention. Mais c’est dans les autres que sont peut-être les plus intéressants, le Colline de Gianluca Buratto, la Musetta de Slávka Zámečníková qui vient de chanter une incroyable Donna Anna à Berlin ou le Marcello d’Andrzej Filónczyk, un jeune baryton polonais qui casse la baraque partout où il chante.
Enfin un vrai grand chef en fosse, Michele Mariotti, ce qui devrait rendre cette reprise éminemment stimulante. En route pour les étoiles…
Eléments de conclusion :
Faisons d’abord quelques statistiques:
Opéra français : 3
Thomas : 1, Gounod : 1, Bizet : 1
Opéra aire germanique : 4
R.Strauss : 1, Wagner : 1, Mozart : 2
Opéra italien : 8
Bellini, 1 : Donizetti : 2, Verdi : 2, Rossini : 1, Puccini : 2
Opéra aire anglo-saxonne : 2
Britten : 1, Adams : 1
C’est le répertoire italien qui comme d’habitude se taille la part du lion, avec quasiment la moitié des productions, l’opéra français en occupe 3 sur 17, pas de quoi se glorifier.
La distribution nouvelles productions/reprises est assez conforme aux exigences de l’année budgétaire, beaucoup de reprises (7) en fin d’année 2022 et une seule nouvelle production (Salomé) quand les trésoreries s’épuisent, les autres nouvelles productions (6) se concentrant au printemps, dès le mois de mars quand les trésoreries sont au plus haut.
Pour les mises en scène des nouvelles productions, on note Lydia Steier et Krzysztof Warlikowski qui sont les plus digne d’intérêt, ni Warner ni Carsen, ni Carrasco, ni Jolly, ni Neyron ne révolutionneront la scène, même si certains peuvent sans doute faire du bon travail.
De même du côté des chefs, à côté de Gustavo Dudamel, seul Michele Mariotti est un chef vraiment très intéressant en fosse, et Aziz Stokhamirov un possible espoir de la baguette. Sinon, ce sont des artistes solides, mais pas forcément inventifs.
Les distributions sont quelquefois excellentes, la plupart de temps très solides sinon stimulantes, mais elles ne font pas vraiment rêver.
Il est vrai que l’Opéra traverse une période difficile et cherche d’abord à assurer prudemment les arrières, on le pressentait et c’est confirmé. Mais on aimerait qu’en absence de pétrole il y ait peut-être un peu plus d’idées originales qu’un tableau statistique fait de croix à remplir et que le ballet danse un peu plus, c’est lui qui au total coûte le moins cher et pourrait faire rentrer plus de recettes…







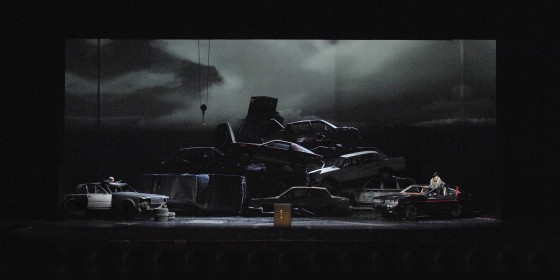

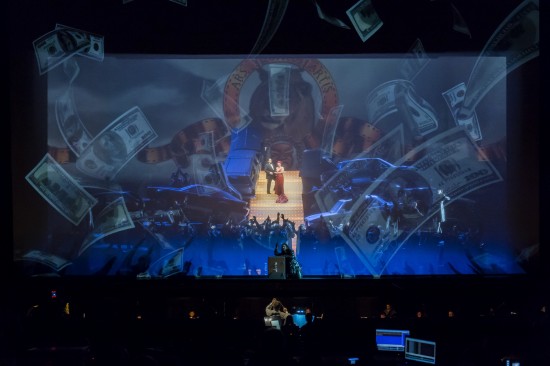










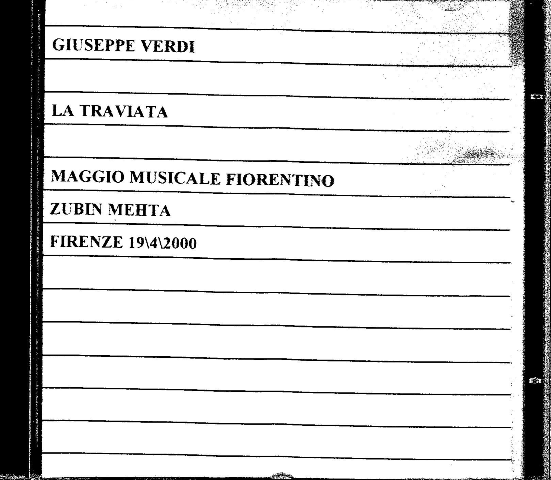
 Don Carlo, 14 mars 2010, saluts
Don Carlo, 14 mars 2010, saluts