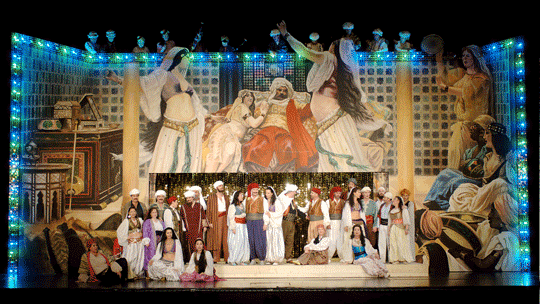Le Grand Théâtre de Genève vient d’annoncer sa nouvelle saison, l’avant-dernière du mandat d’Aviel Cahn, et elle apparaît comme l’une des plus complètes et mieux composées des dernières années, d’abord parce qu’elle propose un véritable éventail d’œuvres de répertoires divers, offrant au spectateur genevois un choix allant du plus populaire (La Traviata) aux expériences scéniques les plus raffinées ou particulières (le Stabat Mater de Pergolesi par Romeo Castellucci ou la Clemenza di Tito vue par Milo Rau).
La deuxième observation porte sur la diversité des répertoires, offrant dans une même saison et pour la première fois du mandat d’Aviel Cahn Richard Wagner (Tristan und Isolde) et Richard Strauss (Salomé), mais aussi plusieurs œuvres du XVIIIe ou du baroque (Dido and Aeneas, Stabat Mater, La Clemenza di Tito), deux œuvres du répertoire italien populaire dont l’une très peu connue hors d’Italie (Fedora de Giordano) compensée par La Traviata qui est le grand standard universel par excellence, enfin, dans le sillon des productions précédentes du répertoire russe, Guerre et Paix de Prokofiev et Lady Macbeth de Mzensk de Chostakovitch, qui font partie des très riches heures de ce théâtre, c’est cette fois-ci Khovantchina de Moussorgski, encore un très grand un chef d’œuvre qui sera à l’affiche, avec la même équipe Alejo Pérez/Calixto Bieito : on ne change pas une équipe qui gagne.
Il faut compléter par deux œuvres chorales inscrites dans la saison d’opéra : c’est depuis longtemps la mode des oratorios mis en scène et cette fois-ci c’est le tour du Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi qui passera à la moulinette de Romeo Castellucci, prévu dans la Cathédrale de Genève, et pour faire bonne mesure, le temple de Saint Gervais accueillera pour deux concerts plus « intimes », la Petite messe solennelle de Rossini, son dernier chef d’œuvre, qui mériterait d’être plus souvent proposé.
En ce qui concerne les récitals, là encore un florilège de voix de premier plan, de différents types, permettront d’entendre aussi bien contre-ténor que soprano dramatique, liederiste ou belcantiste.
Enfin, la programmation de Sidi Larbi Cherkaoui pour le ballet réunit outre Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jalet bien connu à Genève, l’immense Sasha Waltz qui proposera son travail à partir de la symphonie n°7 de Beethoven qui a déjà, depuis les temps de Covid, marqué les amateurs de danse.
Cette saison au titre syncrétique de « Sacrifices » à cause des histoires que racontent notamment les opéras, sacrifices, renonciations, déceptions, de Tristan à Fedora, de Dido à Tito, de Traviata à Salomé bénéficie aussi enfin des deux dernières productions « sacrifiées » à cause du Covid, que de très rares privilégiés avaient pu voir en salle lors de leur création et qu’on avait pu voir en streaming, le passionnant travail de Milo Rau sur La Clemenza di Tito, qui va désarçonner sans doute une partie du public, et Dido and Aeneas, remarquable travail de la compagnie Peeping Tom, une production elle-aussi transmise en streaming, deux spectacles dont Wanderersite.com a rendu compte alors (il suffit de suivre les liens Clemenza di Tito et Dido and Aeneas).
Au total, il faut bien dire que chaque production de la saison est digne d’intérêt à des titres divers, même s’il y a dans le détail des éléments qui appellent des commentaires un peu contrastés, mais dans l’ensemble, le public genevois est gâté : autant les prochaines saisons annoncées des différents théâtres cette année apparaissent en demi-teinte (voir Zurich par exemple), voir peu stimulantes, autant celle de Genève est plutôt excitante. Acceptons-en l’augure.
OPÉRAS
Septembre 2024
Richard Wagner : Tristan und Isolde
5 repr. du 15 au 27 sept. 2024 – Dir : Marc Albrecht / MeS : Michael Thalheimer
Avec Elisabet Strid, Gwyn Hughes Jones/Burkhard Fritz, Tareq Nazmi, Kristina Stanek, Craig Colclough, Julien Henric, Emanuel Tomljenović
Orchestre de la Suisse Romande
Coproduction avec le Deutsche Oper Berlin
Après un Parsifal sobre et maîtrisé, mais sans grande originalité, Aviel Cahn fait de nouveau appel à Michael Thalheimer pour Tristan und Isolde, ce qui est de toute manière une garantie de rigueur et de vrai travail scénique. En fosse, Marc Albrecht, autre garantie d’un travail intelligent et de qualité. Au moins ce Tristan fleure bon la solidité.
L’intérêt de la distribution est qu’elle tente de nouveaux noms, à un moment où les Isolde des dernières années terminent leur parcours ainsi que leurs Tristan. Gwyn Hughes Jones n’avait pas convaincu en Calaf à Bastille, voix plate écrasée par l’orchestre, mais c’était en 2021 et depuis les choses ont peut-être évolué. En revanche d’Elisabet Strid nous écrivions (à propos de sa Sieglinde) : La voix est particulièrement lumineuse, l’engagement est total, l’expressivité maîtrisée, les aigus convaincants, le phrasé magnifique. Tous les espoirs sont donc permis, et Kristina Stanek (Brangäne) avait impressionné en Eboli à Bâle (voix puissante, des aigus triomphants). On connaît suffisamment Tareq Nazmi pour espérer un Marke de grand niveau et en Kurwenal, on découvrira Craig Colclough très familier des rôles italiens aux USA, moins des rôles allemands mais qui a débuté Alberich et chanté Telramund et Kurwenal. Quant à Julien Henric, on le connaît comme très bon ténor du répertoire français, ce sera une découverte en Melot.
Au total : ce devrait être un Tristan au moins très honorable, et donc devrait valoir le voyage. Et Aviel Cahn fait confiance à la production puisqu’il la programme aussi pour la Deutsche Oper Berlin, son prochain poste (en remplacement de celle de Graham Vick…)
Octobre 2024
W.A. Mozart: La Clemenza di Tito
6 repr. du 16 au 29 oct. 2024 (Dir : Tomáš Netopil /MeS : Milo Rau)
Avec Bernard Richter, Serena Farnocchia, Maria Kataeva, Yuliia Zasimova, Giuseppina Bridelli, Justin Hopkins/ Mark Kurmanbayev
Orchestre de la Suisse Romande
C’est une petite déception de ne pas retrouver en fosse Maxim Emelyanychev, un chef particulièrement intéressant dans Mozart. C’est Tomáš Netopil qui officiera, qu’on connaît comme chef de qualité dans Janáček, mais jamais entendu dans Mozart. À chaque étape du tour européen de ce spectacle coproduit, les coproducteurs ont fait appel à des chefs différents (Hengelbrock, Pérez, Biondi), est-ce à dire que l’expérience est douloureuse pour les chefs ? Au moins, ici le tchèque Tomáš Netopil dirigera une œuvre créée à Prague… Retour à la maison en quelque sorte.
Finalement, après Les Flandres, Vienne, Luxembourg, Genève qui a créé le spectacle devant un public réduit à quelques priviléfgiés l’accueille enfin pour l’offrir au public. Inutile de dire qu’il fera polémique (j’ai lu quelque part « c’est Mozart qu’on assassine… »), car c’est un spectacle fort, qui travaille l’œuvre d’une manière totalement inattendue, mais qui au moins est une véritable expérience, plus forte et dérangeante à mon avis que ce que Milo Rau a fait pour Justice. Elle est en tout cas suffisamment singulière pour que tout spectateur qui s’est confronté à cette production, même en streaming, s’en souvienne. Et c’est mon cas.
Distribution partiellement modifiée aussi, puisque si on retrouve l’excellent Bernard Richter (Tito), Serena Farnocchia (Vitellia) et Justin Hopkins en Publio (pour trois représentations seulement), on découvrira en Sesto (où Anna Goryachova avait tant ému) Maria Kitaeva mezzo qui de Palerme à Hambourg, remporte de beaux succès dans le répertoire rossinien et belcantiste. et Yuliia Zasimova en Servilia, jeune chanteuse ukrainienne qu’on commence à entendre dans bien des scènes européennes, quant à Giuseppina Bridelli, c’est un mezzo particulièrement convaincant partout où elle chante, elle sera Annio.
C’est un vrai moment singulier, inhabituel, et surtout pensé, au contraire d’autres productions prétendument modernistes, et c’est un spectacle bien distribué, c’est pourquoi il faut absolument s’y confronter, avec la disponibilité d’un spectateur ouvert.
Novembre 2024
Gioachino Rossini: Petite messe solennelle
Chœur du Grand Théâtre de Genève
6 & 8 novembre 2024 – Dir : Mark Biggins
Giulia Bolcato, Maria Kataeva, Omar Mancini, Michael Mofidian
Xavier Dami, Réginald Le Reun et Jean-Paul Pruna (pianos & harmonium)
Le dernier chef d’œuvre de Rossini dans sa version pour deux pianos et harmonium avec quatre jeunes solistes très valeureux, pour mettre en valeur le Chœur du Grand Théâtre et son nouveau chef, Mark Biggins, dans le cadre plus intime du Temple Saint Gervais . Ceux qui connaissent l’œuvre s’y précipiteront, ceux qui ne la connaissent pas devraient s’y précipiter tant l’œuvre est surprenante et originale, déjà « théâtrale » avant le Requiem de Verdi. À ne pas manquer pour tous les mélomanes.
Décembre 2024
Umberto Giordano: Fedora
7 repr. du 12 au 22 déc. – Dir: Antonino Fogliani / MeS: Arnaud Bernard
Avec Roberto Alagna-Alexandra Kurzak/ Najmiddin Mavlyanov-Elena Guseva, Simone del Savio, Yuliia Zasimova, Mark Kurmanbayev etc…
Orchestre de la Suisse Romande.
Bien moins connu que Andrea Chénier, Fedora est représenté surtout en Italie et pas repris au Grand Théâtre depuis la saison 1902-1903. Un opéra pour grandes stars à la fois au sommet et souvent à la fin de leur carrière car la musique les sollicite plus sur le registre central que sur les aigus et demande une grande intensité d’interprétation pour bien fonctionner, sans quoi certaines scènes peuvent sombrer (notamment la fin) dans le ridicule. Pour se faire une idée de ce que peut-être le mélo dans ses excès, écouter séance tenante l’air final de Fedora et sa mort par Licia Albanese sur Youtube (à 5.57min) un monument digne du pavillon de Sèvres.
Deux distributions à Genève, et d’abord le couple Roberto Alagna/Alexandra Kurzak, idéal à ce moment de leur carrière : il faudra y courir. Mais Elena Guseva et Najmiddin Mavlyanov en alternance proposeront un couple plus jeune et sans doute une couleur très différente. En fosse l’excellent Antonino Fogliani, désormais bien connu à Genève avec une mise en scène confiée à Arnaud Bernard, et donc une vision sans doute plus traditionnelle, mais vu l’opéra la trame et le style d’œuvre, c’est loin d’être gênant, d’autant qu’Arnaud Bernard est un metteur en scène plutôt intelligent.
On ne peut manquer cette fête du vérisme tragique et lacrimal, parce qu’on ne reverra pas Fedora de sitôt à Genève.
Janvier-février 2025
Richard Strauss: Salomé
6 repr. 22 janv. du au 2 fév. – Dir: Jukka-Pekka Saraste /MeS: Kornél Mundruczó
Avec Olesya Golovneva, Gábor Bretz, John Daszak, Tanja Ariane Baumgartner, Matthew Newlin, Ena Pongrac etc…
Orchestre de la Suisse Romande
A côté d’interprètes consommés de leur rôle comme Gábor Bretz, Jochanaan à Salzbourg, John Daszak (Herodes) et Tanja Ariane Baumgartner (Herodias) un peu partout, dans le rôle-titre une nouvelle venue dans le marché lyrique qui chante les grands Verdi mais aussi Turandot et travaille en Allemagne, le soprano russe Olesya Golovneva. À l’heure où les grandes interprètes se raréfient par limite d’âge, c’est intéressant de découvrir des voix d’avenir. En fosse, une très grande chance pour Genève, un remarquable chef qu’on ne voit pas assez souvent à l’opéra, Jukka-Pekka Saraste. Quant à la mise en scène, elle est confiée au plus connu à Genève Kornél Mundruczó qui devrait être très efficace dans cette peinture d’une figure majeure de l’opéra du XXe.
Une production qui s’annonce sous les meilleurs auspices
Février 2025
Henry Purcell : Dido and Aeneas
5 repr. du 20 au 26 fév. 2025 – Dir : Emmanuelle Haïm/MeS : Franck Chartier (Peeping Tom)
Avec Marie-Claude Chappuis, Jarrett Ott, Francesca Aspromonte, Yuliia Zasimova
Le Concert d’Astrée.
Même cheffe qu’en 2021, même orchestre, avec deux changements de distribution, où l’on retrouve Francesca Aspromonte, spécialiste de ce répertoire et remarquable chanteuse.
Voilà ce que dans wanderersite.com, nous écrivions : « On mesurera donc sa chance d’avoir été parmi les happy few, pour assister à ce spectacle singulier, déconcertant et fort qui marquait les débuts à l’opéra de la célèbre compagnie Peeping Tom, et de son co-directeur Franck Chartier qui signait la mise en scène d’un Didon et Enée d’une force particulière. En fosse, pour la première fois à Genève, Le Concert d’Astrée et sa cheffe, Emmanuelle Haïm. Une soirée fascinante, foisonnante et complexe, qui fait honneur à l’institution genevoise, et qui méritait vraiment un public. »
C’est fait, enfin, le public va pouvoir voir ce spectacle vraiment singulier, et c’est une très grande chance.
Mars-avril 2025
Modest Moussorgski: Khovantschina
5 repr. du 25 mars au 3 avril – Dir : Alejo Pérez /MeS : Calixto Bieito
Avec Dmitry Ulyanov, Dmitry Golovnin, John Relyea
Raehann Bryce-Davis, Vladislav Sulimsky, Ekaterina Bakanova etc…
Orchestre de la Suisse Romande
Cinq représentations seulement, c’est faire bien peu confiance au public pour un spectacle qui devrait, sur la foi des autres productions russes de la série, attirer quand même la curiosité, d’autant que la distribution entre Ulyanov, Golovnin, Sulimski, Rutkowski affiche parmi les plus belles voix actuelles pour ce répertoire avec une nouvelle venue en Marfa, l’américaine Raehann Bryce-Davis, qui permettra de vérifier si cette voix dont on parle tant passera la promesse des fleurs.
Comme Khovantschina plus que Boris encore a de sérieux problèmes d’édition, Aléjo Pérez a choisi (comme Abbado en son temps à Vienne et comme la plupart des chefs aujourd’hui) la version Chostakovitch avec le final d’Igor Stravinski.
Pas représenté à Genève depuis la saison 1981-1982, Khovantschina pose la question très actuelle du fanatisme religieux face au politique et constitue un des grands chefs d’œuvre de l’opéra à ne manquer sous aucun prétexte.
Mai 2025
Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater
Giacinto Scelsi : Three latin prayers (1970), Quattro pezzi (1959)
6 repr. du 12 au 18 mai 2025 – Dir : Barbara Hannigan/ MeS : Romeo Castellucci
Avec Barbara Hannigan, Jakub Józef Orliński
Chœur il Pomo d’oro
Ensemble Contrechamps
A la Cathédrale Saint Pierre de Genève (sous réserves)
Coproduction avec l’Opera Ballet Vlaanderen, le Teatro dell’Opera di Roma, le Dutch National Opera.
Un des must de la saison à n’en point douter, un spectacle chic et choc avec des noms des sonnent haut, Barbara Hannigan en cheffe et soliste, et Romeo Castellucci en metteur en scène, et pour compléter Jakub Józef Orliński le contreténor qu’on s’arrache…
Si la Cathédrale est concédée, Castellucci ne pourra sans doute pas se permettre de trop « charger la barque » en matière de décor, et si cela reste au Grand Théâtre, alors tout sera permis…
Trêve de plaisanterie, la mode des oratorios mis en scène essaime désormais, dans un retour à un certain XVIIIe où c’était une pratique possible et on doit à Romeo Castellucci un Requiem (de Mozart) mémorable à Aix et une Passion selon Saint Matthieu qui ne l’est pas moins à Hambourg. Alors, gageons que le Stabat Mater, plus court et moins spectaculaire, et mêlé à des pièces plus récentes de Giacinto Scelsi (mort en 1988) un compositeur encore aujourd’hui mystérieux, sera l’occasion d’un grand moment.
Juin 2025
Giuseppe Verdi: La Traviata
8 repr. du 14 au 27 juin – Dir : Paolo Carignani /MeS : Karin Henkel
Avec : Ruzan Mantashyan/Jeanine De Bique, Enea Scala/Julien Behr, Luca Micheletti/Tassis Christoyannis, Emanuel Tomljenović, Yuliia Zasimova etc…
Orchestre de la Suisse Romande
La Traviata confiée à une metteuse en scène, c’est assez intéressant et rare (si ce n’est pas Lydia Steier), qui plus est à une spécialiste de Dostoievski, à qui Aviel Cahn avait confié Le Joueur de Prokofiev à l’Opéra des Flandres qui avait été assez bien accueilli, ce peut être encore plus stimulant. Mais ce qui m’intéresse plus dans l’équipe de production, c’est de voir qu’Aleksandar Denić, le génial scénographe de Frank Castorf (Ring de Bayreuth et tant d’autres spectacles), qui actuellement expose dans le pavillon serbe de la Biennale de Venise, va signer le décor. Ça c’est une grande promesse et pour moi un événement…
On connaît Ruzan Mantashyan, un des sopranos lyriques de très bon aloi, elle alternera avec Jeanine De Bique qu’on n’attend pas forcément dans ce répertoire, mais qu’il sera pour cela aussi intéressant d’entendre. Enea Scala est désormais un des ténors qui compte, mais plus intéressant dans Rossini que dans Verdi, et on découvrira Julien Behr en alternance dans ce must du répertoire. Le plus intéressant sans doute, c’est Luca Micheletti, le baryton (et aussi metteur en scène ce qui est presque unique) qui devient l’un des plus réclamés en Italie et qui explose sur les scènes internationales, en Germont, même s’il est encore jeune pour le rôle. Tassis Christoyannis est plus habituel, plus connu, mais lui aussi une garantie dans l’autre distribution.
En fait, il n’y a qu’une inexplicable faute de goût dans ce tableau, c’est de confier la fosse à Paolo Carignani un chef plus connu pour son côté routinier et sans envergure que par ses traits d’originalité. Une manière de dire « de toute manière, Traviata fera le plein, inutile de se gratter la tête pour trouver un chef », alors qu’il y a une foule de bons chefs italiens plus jeunes qui pourraient faire mieux, Diego Ceretta pour ne citer que l’un des plus jeunes et des plus intéressants. Mais les voies du Seigneur Cahn sont impénétrables.
Récitals et concerts
Cinq noms qui devraient ne pas avoir de mal à remplir la salle, tant ils sont aujourd’hui des incontournables du chant lyrique, voire des stars.
20 septembre 2024
Jakub Józef Orliński, contre-ténor
Michał Biel piano
Œuvres du baroque italien, Henry Purcell, Franz Schubert et de compositeurs polonais.
Le fantasque et étourdissant champion de breakdance et contre-ténor polonais proposera un florilège d’air divers et d’ambiances musicales à ne pas manquer, avant de le revoir dans le Stabat Mater de Pergolesi.
3 novembre 2024
Lisette Oropesa, soprano
Alessandro Praticò, pian
Chansons et airs de Maurice Ravel, Léo Delibes, Jules Massenet, Georges Bizet, Gioachino Rossini, Saverio Mercadante et Guiseppe Verdi.
Star d’aujourd’hui, irremplaçable dans le jeune Verdi et dans le belcanto, disponible, sympathique et surtout fabuleuse en scène, Lisette Oropesa propose un récital fait de mélodie et d’airs du répertoire romantique qui devrait faire monter la salle au paradis.
A ne pas manquer.
31 décembre 2024
Camilla Nylund, soprano
Concert du Nouvel An
Orchestre Symphonique Bienne Soleure
Yannis Pouspourikas direction musicale
Valses, polonaises, airs et polkas de Johann Strauss II, Franz Lehár et Emmerich Kálmán.
Un programme typique de 31 décembre, mais la présence de la voix wagnérienne la plus importante du moment, qui a récemment explosé à l’heure où les grandes voix wagnériennes finissent leur carrière, ici dans un répertoire qui n’est jamais facile, et où elle aura à montrer la versatilité de son immense talent.
9 février 2025
Aušrinė Stundytė, soprano
Andrej Hovrin, piano
Récital mis en espace
Erwartung, monodrame d’Arnold Schönberg, livret de Marie Pappenheim.
Lieder d’Arnold Schönberg, Richard Strauss et Alban Berg.
Il était difficile d’imaginer la bête de scène qu’est Aušrinė Stundytė, seulement enfermée dans les limites d’un récital, fût-il fait de Lieder d’Arnold Schönberg, Richard Strauss et Alban Berg. Elle offre en sus Erwartung de Schönberg, instruite de son expérience munichoise avec Warlikowski dans sa réduction pour piano et ce devrait être fascinant. C’est ce qu’on appelle un must.
15 mai 2025
Benjamin Appl, baryton
James Bailleau, piano
Lieder de Gustav Mahler, Alma Mahler, George Butterworth, Erich Wolfgang Korngold et autres.
Troisième récital à Genève d’un des seuls authentiques Liederistes de ce temps, dans la tradition des Fischer Dieskau, ou des Thomas Quasthoff. Il est rarissime désormais qu’une carrière de chanteur lyrique se bâtisse sur le Lied ou l’oratorio. Benjamin Appl a cette singularité, même s’il déroge par quelque représentation d’opéra çà et là. Si vous n’avez jamais goûté au véritable récital de Lieder, c’est l’occasion de s’initier, ici dans un programme particulier marqué par le post-romantisme.
DANSE
Je renvoie au site du Grand Théâtre en attirant l’attention sur la venue de Beethoven 7 de Sasha Waltz qui devrait être un événement (4 repr. du 13 au 16 mars 2025, Bâtiment des Forces Motrices)
CONCLUSION
J’ai été suffisamment souvent critique ou dubitatif sur certains choix du Grand Théâtre pour ne pas bouder mon plaisir à affirmer qu’il s’agit là de la meilleure saison de l’institution depuis de longues années, et que le public genevois et frontalier aura du mal à faire des choix dans cette somme d’excellents spectacles et d’un ensemble exceptionnel de récitals. La saison est bien composée, équilibrée, avec des distributions globalement de bon niveau et des choix de chefs pertinents à une exception.
Bien sûr, il faut comme dit Malherbe, que les fruits passent la promesse des fleurs, mais il faut reconnaître que la promesse est vraiment déjà une aube dorée. Alors, au public de faire son travail de public curieux et cette prochaine saison particulièrement gâté.

 Sauve qui peut.
Sauve qui peut.