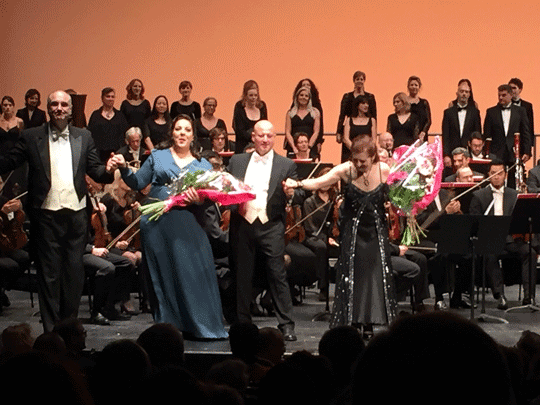C’est une excellente initiative que de proposer des « opere serie » de Rossini à un public peu habitué à ce répertoire : on attend avec impatience Ermione l’an prochain, car cette Zelmira a justement triomphé avec un public lyonnais debout, ce qui est rare.
Justement, même si je pense que la programmation de Serge Dorny est l’une des plus inventives et des plus construites en France aujourd’hui, je regrette depuis longtemps qu’il n’ait pas servi ce répertoire autrement que par des versions concertantes. Espérons que l’arrivée de Daniele Rustioni comme directeur musical permettra aussi d’oser de ce côté là.
Il est vrai que d’une part il n’est pas facile de trouver des chanteurs qui soient familiers de ce Rossini là, mais il est encore plus difficile de trouver des metteurs en scène qui aient envie de travailler sur ces intrigues à la fois complexes et surannées, même si la mode baroque, très française, a pu çà et là permettre de faire émerger des travaux intéressants. Et ce Rossini-là vient évidemment de cette tradition-là.
Pour la dernière œuvre (1822) faite pour le San Carlo de Naples, la plus grande salle d’alors avec les meilleurs musiciens et choristes, le librettiste Tottola s’est inspiré de Zelmire de Dormont du Belloy (1762) une des ces nombreuses tragédies écrites XVIII°siècle et oubliées. L’intrigue est complexe et se passe à Lesbos, où le roi Polidoro bon et sage, est renversé à l’occasion d’une absence : on le croit mort mais il est caché par sa fille Zelmira. L’usurpateur Azor meurt, mais un autre usurpateur, Antenore, prend sa place et accuse Zelmira d’avoir tué son père. Ilo, mari de Zelmira, revient, et croit sa femme coupable. À la fin, les bons sont vainqueurs et les méchants punis.
Comme tout bon opera seria rossinien, deux ténors se partagent les difficultés, Antenore et Ilo, un soprano lirico colorature (Zelmira), un mezzo colorature (Emma) et deux basses un gentil, Polidoro, et un méchant, Leucippe.
Rossini, pour ce dernier opéra napolitain, a voulu concentrer toutes les difficultés possibles, et surtout plaire à un public varié, à commencer par Vienne, où Zelmira est créée avec succès moins de trois mois après Naples (Avril 1822). Ce n’est pas seulement un opéra vocal, mais aussi orchestral et choral et par bien des aspects, il prépare les formes du Grand Opéra monumental que Rossini va mettre en place avec Moïse et Guillaume Tell.
Immense succès au XIXème, Zelmira disparaît des programmes pendant un siècle pour réapparaître à la fin du XXème siècle, à l’occasion de la Rossini Renaissance, notamment portée par la Fondation Rossini de Pesaro. C’est en effet à la fin des années 70 qu’on commence en Europe à regarder Rossini au-delà de ses opéras bouffes et à explorer un autre répertoire : Aix en Provence présente en 1975 Elisabetta Regina d’Inghilterra et Semiramide en 1980, qui sont des pierres miliaires de cette renaissance en 1980.
Ainsi donc la version de concert présentée à Lyon (et qui n’a pu comme chaque année être présentée à Paris le 14 novembre à cause des attentats du 13) a été un moment vraiment privilégié.
C’est Patrizia Ciofi qui était Zelmira. La cantatrice italienne a interprété souvent Rossini, mais est plus connue pour ses incarnations belcantistes. Son engagement, sa facilité à occuper la scène et sa personnalité ont fait de cette Zelmira un très grand moment, elle a notamment tout donné dans l’air final “Riedi al soglio”, une sorte de feu d’artifice de la joie retrouvée qui fait que Zelmira commence en drame et finit en Cenerentola. Patrizia Ciofi a une capacité toute particulière à incarner les personnages frappés par le destin, donnant souvent une âme très sombre et très émouvante aux situations, ce fut le cas de toute cette Zelmira, mais l’explosion finale fut l’occasion d’une performance exceptionnelle où la Ciofi est allé au bout de ses possibilités, à l’extrême d’une voix qui n’est pas tout à fait celle du rôle, ni qui n’a même pas tout à fait la technique rossinienne, notamment dans la précision des notes et dans la couleur, mais qu’importe : la performance fut bluffante et l’engagement inouï . C’est à cela qu’on reconnaît les très grandes.
C’est incontestablement l’Emma de Marianna Pizzolato qui quant à elle a la vraie couleur et la vraie technique rossinienne. La jeune cantatrice sicilienne fréquente le répertoire baroque depuis plusieurs années et étonne de plus en plus par la qualité croissante de ses prestations : ici, son Emma est splendide, les graves sonores, la couleur veloutée, la précision dans les agilités incroyable et elle est de plus douée d’une vraie présence ; son « Ciel pietoso » de l’acte II est magnifique et provoque un triomphe.
Du côté masculin, on est très agréablement surpris par le Leucippo de Patrick Bolleire, grave sonore, diction impeccable, belle présence, voix posée et d’une très grande qualité, l’autre basse, Michele Pertusi, reste une référence dans le chant rossinien, même si ce dimanche, il ne semblait pas être au sommet de sa forme : on l’a entendu plus engagé et plus présent. Il reste que son Polidoro reste remarquable.
C’est des ténors que vient la surprise. Mais pas d’Antonino Siragusa, ténor rossinien typique, avec une voix très haut perchée, nasale, stylistiquement sans faille, contrôlant toutes les notes, avec une distance assez amusante, en faisant un personnage presque comique avec ses petits gestes (lunettes, soin jaloux du nœud papillon). Bref, il donne l’impression de se promener dans un rôle qu’il domine, mais sans véritablement approfondir les aspects psychologiques (s’il y en a, car ce mari aimant croit bien vite les pires mensonges sur sa femme), c’est une mécanique impeccable, sympathique, mais un peu superficielle.
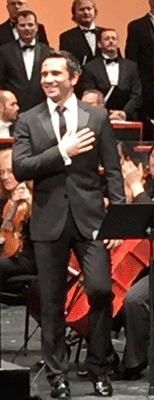
La révélation s’appelle Sergey Romanovsky, qui remplace John Osborn prévu à l’origine. Une révélation à plusieurs niveaux : d’abord il est rare d’entendre un ténor qui ait des graves aussi contrôlés et sonores et des aigus, voire suraigus aussi sûrs, et donc qui ait cette étendue étonnante. Formé par le conservatoire de Moscou, membre du programme pour jeunes chanteurs du Bolchoï, il n’a pas du tout de « couleur russe » dans l’émission et il est surtout doué d’une diction italienne exemplaire.
Ensuite son physique avantageux et son attitude en scène le rendent immédiatement intéressant : on imagine ce qu’un metteur en scène pourrait faire de ce pur méchant dont le chant et l’apparence ne semblent jamais aussi noirs que le livret le dit. Il en résulte une incroyable présence vocale et sonore, mais aussi scénique, qui semble le promettre à de grandes choses.
Un opéra aussi monumental exige un chœur exemplaire, celui de l’opéra de Lyon sous la direction de Philip White, a donné une belle preuve de sa qualité, les femmes étaient peut être plus à l’aise que les hommes au départ, mais dans l’ensemble, ils ont fait tous honneur à la représentation et à Rossini, tout comme l’orchestre, peu familier d’un répertoire qui exige une aussi grande ductilité orchestrale que vocale. Il est vrai qu’Evelino Pidò est un tel technicien, au geste tellement précis qu’il est une garantie et une sécurité pour un orchestre. Son sens des volumes et des rythmes, sa manière de maîtriser toutes les masses, et son aisance, ainsi que le sens dramatique et la tension qu’il sait imprimer rappellent un peu un chef que peu connaissent aujourd’hui et dont les gens de ma génération se souviennent, Giuseppe Patanè, qui était un des maîtres du style italien dans les années 70 et 80. Pidò a ce style de manière innée, et c’est une excellente idée de Serge Dorny que de lui avoir confié ces opéras en forme de concert. Il a un geste tellement sûr, il sait tellement vite trouver la juste couleur que c’est pour un orchestre une chance de l’avoir dans un répertoire moins familier.
Au total, une matinée dominicale de très haut niveau, qui fut une fête rossinienne extraordinaire . Il n’en fallait pas plus…enfin non… à quand une Zelmira scénique de ce niveau ? [wpsr_facebook]